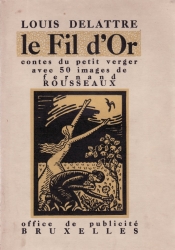Miguel de Cervantes y
Saavedra - Don Quijote de la Mancha - Ebook:
HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP
Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006
HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP
Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006
CLASSICISTRANIERI
HOME PAGE - YOUTUBE
CHANNEL
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
L. Delattre : Le Fil d'or : contes du petit verger (1927)
Static
Wikipedia 2008 (no
images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2007 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2006 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Sub-domains
CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -
Other Domains
https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
| DELATTRE, Louis
(1870-1938) : Le Fil d'or : contes
du petit verger avec 50 images de Fernand Rousseaux.- Bruxelles
: Office de publicité, 1927.- 212 p. : ill. ; couv. ill. en coul. ;
23,4 cm.
Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (13.III.2012) Relecture : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros] obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Texte établi sur l'exemplaire d'une collection particulière. Le Fil d'Or
Contes du petit verger par
Louis Delattre ~ * ~
DÉDICACE
Au Souvenir de mon Père.
(1849-1916)
Ta mémoire n’est pas pour moi un trésor mis sous la pierre du passé où
j’aille seulement en retournant sur mes pas. Elle porte mes jours.
Ainsi à travers les calmes verdures des champs bien travaillés, nos rivières du Hainaut roulent leurs eaux troublées. L. D.
Uccle, Le Petit Verger.
Jour de la Saint-Étienne, 1926.
~ * ~
le Fil d’Or PIERRE-ANDRÉ, sous un pommier en fleurs s’était endormi. D’abord assis dans l’herbe nouvelle, haletant d’une après-midi de travail à la bêche, il avait quelque temps lutté contre la somnolence. Mais peu à peu, la terre sous lui s’était faite étrangement moelleuse. Le ciel de printemps, sur ses épaules, s’était abattu comme un manteau d’azur. Sur ses paupières, le soleil avait posé des lèvres insistantes et si chaudes que l’homme, distrait un court instant dans son attention à se retenir debout sur le flot mouvant des choses, tout à coup avait coulé à pic. Le menton sur la poitrine, l’ombre de son vieux chapeau de paille traçant un loup bleu sur le haut de sa face rose, il avait cet air, si profondément calme qu’il arrive à inquiéter, de l’homme heureux qui dort, de la créature qui a remis, pour un temps, à son maître, les clefs de la maison. Or, voilà qu’une petite mouche au ventre de métal brun, aux gros yeux rouges, lui sortit tout à coup de la bouche, ouvrit ses ailes aux nervures irisées, et s’envola dans un rayon de soleil. Elle tirait derrière elle, se déroulant de la tête de Pierre-André, un fil d’or fin comme un cheveu de nouveau-né, et qui s’allongeait, s’allongeait, montait au ciel, plus haut, plus haut encore, jusque dans un de ces mondes dont nous soupçonnons l’existence sans jamais y être allés. Et c’était l’âme de l’homme endormi qui, sous cette forme, s’évadait. Du moins une de ses âmes. Car s’il est des hommes qui en sont totalement dépourvus, Pierre-André assure avoir pour sa part, sinon autant d’âmes différentes et bigarrées que jadis les Egyptiens, sûrement deux, pour le moins. Son âme d’amour, son âme de rayonnement avait donc dit à l’autre, à l’âme qui ne sert qu’en manière de sel à préserver le corps humain de la pourriture : « Je vais faire un tour. Il y a trop longtemps que ma princesse me fait signe. Je ne puis cependant pas me refuser toujours à ses gentillesses. Cela passerait pour de la grossièreté, à la fin. - Quelle princesse ? demanda l’âme de salaison. - Je ne sais pas encore exactement, répondit l’âme d’amour. Je dois bien l’avouer, j’en aime tant ! Est-ce la belle et douce Chélinde, fille du roi de Babylone, qui sut se souvenir de son amant Sadoc dans les bras de tous ses ravisseurs successifs et précipités ? » Est-ce Yseult la blonde, habile en l’art de guérir les plus dangereuses blessures ? » Est-ce Claremonde qui eut à se défendre contre un bossu ? » Ou Blanchefleur qui, dans son château assiégé, fit un si tendre accueil à son défenseur, Perceval le Gallois ? Je verrai bien quand j’y serai. Mais j’ai faim de la société d’une belle princesse de légende ». C’est ainsi que sous la forme d’une mouche diaprée, l’âme de gloire de Pierre-André avait quitté le corps de son maître gisant à l’ombre d’un pommier en fleurs, par ce beau jour de printemps. Cependant, l’âme de salaison avait mené en rêve l’homme assoupi à ses petites affaires du bas monde. Il se lève sur l’herbe, et au premier pas, pose son sabot sur une jolie courtillière d’or vert qui allait à la chasse et l’écrase. A la fourche de deux branches, un nid de trois petits œufs verdâtres tachés de brun se présente. D’un coup de poing, il fait voler le paquet en l’air, pour rire. « Qu’est cela ? se demande l’âme de salaison. En voilà un plaisir ! Je ne reconnais pas mon Pierre-André. » Le chat dormait sur la pierre du seuil, l’oreille entre ses pattes pelues, montrant son ventre jaune. L’homme, d’un coup de pied, met l’animal debout la queue dressée, terrifié et meurtri. On sonne à la grille. Il y va. C’est un petit vieux, une torsade de lacets de bottines au col, qui vient comme chaque semaine solliciter l’aumône. « Décampe ! » lui crie Pierre-André. C’en est trop. « Dis donc, Pierre-André, lui demande son âme de salaison, vas-tu longtemps continuer ce manège ? Et parce que ton amour est en quête de Claremonde ou de Blanchefleur, vivras-tu ici comme une brute ? - Il est vrai, murmure l’homme, que j’étais inquiet de ce que je faisais. Mais pourquoi celle-là demeure-t-elle là-haut si longtemps ? Qu’elle revienne ! Je peux me passer de l’amour des princesses, mais non de celui des choses qui sont sous mes pieds. Chélinde, Yseult, rendez-moi mon fil d’or. J’en ai besoin pour me lier à ce qui m’entoure. » Et Pierre-André sortant de son rêve s’éveilla sous le pommier. Une fourmi, sur son visage, tentait la traversée. Il la saisit avec précaution dans ses gros doigts. « Ah ! c’est donc toi qui me fais rêver ces folies, et tu crois peut-être avoir coupé mon âme en deux ? Non. Ma vie est faite aussi de la tienne et je ne saurais te renier. » Mon souffle est cette émanation même qui me fait t’aimer. Mes princesses bien-voulues courent dans l’herbe et mes légendes sont dans le cœur des roses et des fruits pleins de jus de mon jardin. » Ce que je vois au ciel n’est pas plus resplendissant et plus digne d’amour que le sol verdoyant que foulent mes sabots.
la Souche de Glycine
AU fond du jardin, Pierre-André casse du bois, assis sur un tronc d’arbre. Vêtu de nippes en loques, il disparaît dans le fouillis des branches mortes dont le tas monte jusqu’à la crête du mur voisin. De sa hache bien tranchante, il frappe à tour de bras et les éclats volent de toutes parts avec des rebondissements inattendus. Voici un groseillier que Pierre-André pose entier sur le billot. L’écorce noire s’en détache en minces anneaux où des champignons d’un rouge incarnat semblent faire égoutter un reste de sève des anciens fruits. « Où êtes-vous, troupes d’enfants qui pilliez les trésors du vieux groseillier ? Que tu as contemplé d’avides bouches, groseillier, que tu as été heureux ! Sans doute, il n’y a pas de plus vive jouissance que la vue de lèvres tendant vers nous leur désir ? Être désirée, ô groseille de pourpre ; être mordue, ô lèvre qui saigne ; être dévorée, ô chair palpitante !... Grappes acides, que votre âme couleur de sang doit jouir de la vie, sous la dent des hommes ! » Pierre-André maintenant attire à lui une branche de cerisier aux minces ovales tracés en travers de l’écorce. « Toi, tu levais au ciel, toute berliquottante, la houpette de cerises étincelantes dans l’azur ? Cerises, vous êtes à la fois les yeux brillants et la bouche humide, vous êtes le désir, ce qu’on n’a pas, ce qui fait vivre... T’aurais-je ?... Si je t’avais ?... Et le temps nous déchire. » Tranchée d’un coup ferme, la branche montre, au cœur du bois, les filets d’un riche ton d’ivoire veiné de brun. Un pinson proche lance, éperdu, son couplet : « Rabi... rabi... rabiscottia... ». Ah ! c’est dès l’instant, que la vie commence !... Tout à l’heure, les bourgeons feront éclater leur peau vernie. Tout à l’heure, il y aura du chaud soleil plein les midis. La vie réchauffe le soleil lui-même. Bûchant à grands coups sonores, les dents serrées, Pierre-André a mis son cœur dans sa hache. Non, les choses ne sont pas toutes moulues en poussière, blutées et ressassées. Toutes ne sont pas égales et indifférentes, devant la balance et le mètre. Et d’abord, il y a une chose : ton âme, ton âme vertigineuse qui bouillonne et déborde le monde comme le champagne la coupe ; ton âme pinson, ton âme groseille, ton âme nuage ; ton âme fer de hache, toi enfin sans qui il n’y a pas d’univers. Frappe de toute ton âme et chante, coupeur de bois ! Ne te laisse pas couvrir de cendre. Laisse ceux-là étaler leurs expériences, comme les gueux, à la porte de l’église, leurs ulcères. Et ils marmonnent : « Ayez pitié d’un pauvre aveugle ayant perdu la vie depuis cinq mille ans. » A coups de son fer luisant, il pénètre la matière fraternelle ; il y introduit sa vie, son âme buvant son âme. Chacun de ses gestes d’amour et de rapt, le porte plus loin. Mais au milieu de cette souche de vieille glycine, tout à coup, sa hache décèle un prodige. Dans une fine farine de bois, une pupe couleur de vieil ivoire se dresse, bombant le ventre. De sa tête au profil songeur, voici le front pur, la tache rouge des yeux, les bandeaux aplatissant les tempes. Moignons d’ailes futures, hiératiquement immobiles ses bras demeurent collés aux flancs. Au creux du cocon entr’ouvert, elle se tord sur la pointe de son corps comme sur un pied. C’est quelque ébauche où la vie en secret s’essaie à la forme humaine sur une autre échelle, et que Pierre-André vient de surprendre miraculeusement. Il n’y a que son ventre qui palpite ; tandis que ses mains hésitent encore devant la vie. Grave, Pierre-André descend en ces limbes où les dieux insufflent les idées dans les formes. « Nymphe, petite poupée, qui t’éveilles du sommeil éternel, me vois-tu ? demande l’homme. Vois-tu ma poitrine haleter comme je vois tes flancs ? As-tu pitié de moi comme j’ai pitié de toi ? Dans la souche de glycine qui t’emprisonnait, as-tu entendu quelque murmure de la parole à laquelle d’ici-bas, nous tendons l’oreille, ô dryade molle encore de la salive de Dieu ? » Mais la pupe demeure muette. Des mains tremblantes du fendeur de bûches, elle a glissé sur le sol, et pour suivre les palpitations du petit ventre blond, tache de miel sur la terre noire, Pierre-André s’est mis à genoux. « Certes, dit-il, je ne serai jamais au bout de ma joie, si du sein même des souches mortes, il sort pour moi des joyaux de ce prix ? Si du cœur nourricier des arbres, il monte vers mon cœur de ces révélations ? O Pierre-André, sois pieusement attentif : Regarde, écoute. Aime et fais ta prière. »
la Chope de Bière
ECOUTE, Pierre-André, dit la mère à son fils, puisque nous voilà maîtres à nouveau d’un jardin, nous allons reprendre nos habitudes de village. Je voudrais un carré de potager avec quelques-uns de ces légumes qu’on doit avoir sous la main. La terre est ressuyée à souhait. Viens, que je te montre comment t’y prendre. Car avec tous tes livres, tu es devenu innocent au point de ne pouvoir plus faire le moindre bout de culture sans guide. » Docile et souriant, Pierre-André a ceint l’antique tablier de toile où les pièces innombrables, chef-d’œuvre de raccommodage, montrent toutes les nuances du bleu, de l’azur tendre du tissu délavé à l’outre-mer épais du coton neuf. Une poche lui monte des cuisses à l’estomac, tel l’étui de la sarigue, où il a serré la boule de ficelle terreuse, la jambette et le sécateur. « T’en souviens-tu ? lui demande sa mère. Quand ton père revêtu de ce grand écours, travaillait à rouler ses tonneaux en cave ou à hisser ses sacs au grenier ? D’heure en heure, il s’asseyait pour souffler. Sa tête ronde fumait, et il pliait son mouchoir rouge sous sa casquette pour y éponger la sueur. » Pierre-André chausse ses sabots et sur son épaule, charge la bêche et le râteau. Il marche à grand bruit vers le jardin ; sa pipe laissant derrière lui une traînée de fumée bleue. Il se met à l’ouvrage. Comme il en sait tout de même là-dessus plus qu’il n’en veut dire, un carré de belle terre brune et montée toute neuf des profondeurs du sol, luit bientôt au soleil : tapis frais bien étalé sur la friperie des mauvaises herbes enfouies. C’est la table rase des projets avortés et des entreprises hésitantes. C’est le grand rien exactement uni sur quoi, à nouveau, les espoirs peuvent être replantés debout. « Ah ! se dit Pierre-André, poussant du pied le fer en terre, faire en soi place nette, se raboter à vif, et s’il le faut, au papier de verre, atteindre la fibre !... Un bon jardinier, quel moraliste ! » Un pissenlit. Sa triple collerette soigneusement dentelée, s’étale en un sourire polygonal de chose muette qui s’amuse de tous les côtés à la fois. « Déjà en besogne, pissenlit ? Tout prêt, à la Saint-Grégoire, souriant et sûr de vaincre ? Mais tu n’iras pas plus loin. Tu es de trop ». Pierre-André, de sa pelle, tranche à un pied sous terre, la brune racine du florion d’or d’où s’écoule une sève blanche comme le lait. Il en porte une goutte aux lèvres, savourant cette amertume âpre et bienfaisante. Du petit labour étalé au soleil, monte une fine buée, ombre d’une ombre. La matière encore inerte, il y a une minute sous sa croûte fanée, exhale à présent son souffle, telle une poitrine qui respire par un temps frais. « Pierre-André, tu animes la terre sous tes pieds ; tu crées les éléments ; tu es dieu. Serais-tu Pan ? » Dans la cave, la mère du laboureur a tiré un pot de bière qu’elle apporte débordant. Sur le grès bleu, apparaît le bonnet de mousse posé de travers. « Tu as bien travaillé, mon « fi, » dit-elle. Je t’offre la chope de dix heures, comme je faisais à ton père. Assieds-toi. La bière se goûte mieux le matin, quand on a œuvré, disait-il. Bois ! » Sur le banc, le front fumant, les bras gourds, les mains noires, Pierre-André hume la boisson pétillante qui coule sa longue caresse dans sa poitrine. Son sang enfiévré par l’effort, fouetté par le breuvage, rougit ses joues. La fleur béate de sa vie heureuse s’étale. Le ciel devient plus vaste, le vent plus doux, la terre plus molle. Une volupté simple entr’ouvre ses lèvres et anime son regard. Il voit le sentier qui gravit la colline, traverse champs et bois et le conduit à la métairie du village wallon, là-bas, sous les grands peupliers : le berceau de son père. « Si loin déjà dans la vie, saurai-je enfin entendre la suprême leçon du bien-aimé ? » Le bonheur, répétait-il, c’est la paix. » Cœur plein de chaleur, tête froide et claire, esprit toujours en harmonie avec lui-même, il ne portait, sur toutes choses, qu’un regard bienveillant. Sans gémir, il allégeait les infortunes avec simplicité, ou écartait les ennuis avec décision. » Mes efforts, mes études, mes souffrances, m’ont-ils mené aussi loin que cette âme modeste alla seule et par ses propres forces, sur le chemin de la sagesse ? » Devant mon carré de terre qui fume au soleil, pour être sincère que répondre ? » J’ai revêtu les nippes de mon père, et je bois dans sa chope. Mais pourrai-je transmettre le flambeau qu’il m’a passé, aussi chaud et lumineux, à celui qui doit me suivre ? » A l’œuvre, fouille la terre ! A l’œuvre, Pierre-André, ranime la torche ! »
le Prunier en Fleurs
CE matin de mars, Pierre-André, à quatre pattes au fond du jardin, se bat contre une troupe de renoncules rampantes, petites plantes entêtées et folles comme des fillettes. Levant les yeux, il aperçoit au-dessus de lui les branches d’un prunier qui s’est fleuri tout à l’heure. C’est d’un resplendissant si inattendu que l’homme, sous l’arbre, enfonce la tête sous les épaules et demeure la face haussée, la bouche béante d’un large sourire. De chacune de cette multitude de blessures qui plissent son écorce, le prunier darde un bouton d’un rose fin, pur comme une note de hautbois. Tendre, ardente la couleur crie une plainte d’amour heureux, un long sanglot qui monte et meurt dans le ravissement. L’homme, en sa poitrine qui se gonfle, ses reins qui se cambrent, ses bras qui se tendent, sent le désir de se fondre avec cette vie jeune, dans cette innocence et cette pureté. « Fleurs roses du prunier, vous me tirez l’âme par les yeux. Je me sens, près de vous, aussi beau que vous-mêmes ; autant que vous, capable d’un doux et profond silence. » Vous me versez dans le cœur la splendeur de vos regards. Vous êtes des amantes, embaumant votre bien-aimé. » Fleurs roses du prunier, plus belles que les fruits d’été, vous êtes le gage de mon épanchement fraternel, de mon assensiment à l’univers. Vous renouvelez pour moi la promesse de la communion dans le sein du père. » Ma pensée près de vous se fait tendresse ; les mots se rythment en prière ; ma chair tremble ainsi qu’au seuil de l’extase. » Ramassant sur le sol une houppe de ces fleurs jetées bas par le vent, Pierre-André l’attache à sa boutonnière et s’en va. Au fond d’une petite rue, il entre dans l’étroite boutique se munir de tabac. La marchande, une pauvre veuve aux cheveux gris soigneusement lissés en bandeaux, aux yeux d’un bleu qui a souffert, demeure les paupières agrandies, la face illuminée à son apparition. « Ah ! Monsieur ! s’écrie-t-elle, que c’est beau ! » Et son regard, la rougeur subite de ses joues, témoignent de son émotion à la vue de ces fleurs de l’aurore. Pierre-André les lui ayant offertes : « Je les accepte avec plaisir, Monsieur ! » répond-elle joyeusement. Et à deux mains, elle les tient comme de fragile vie qu’elle craindrait de blesser. « J’ai la passion des fleurs, continue-t-elle, et ma fille a hérité de moi ce goût à un point que, tout enfant, je l’ai vue désirer des fleurs et s’enivrer du plaisir d’en posséder, jusqu’à sacrifier jouet ou colifichet. » Son parrain, horticulteur à Grand-Bigard, lui offrait le premier dimanche de mai, un bouquet de lilas blanc. La petite y pensait tout l’hiver. Sur la route, chacun s’arrêtait pour la voir serrer les fleurs sur sa poitrine au retour. Et voilà que certaine année, arrivant au village, nous apprenons que la culture a manqué. « Pas le moindre lilas à offrir, » nous dit le parrain. » Nous nous en retournions, l’enfant désolée donnant la main à mon frère, quand tout à coup elle s’arrête, puis se met à courir vers la grille du jardin bordant la route. Un magnifique lilas en fleurs garnit l’entrée. La petite s’attache aux barreaux pour s’approcher de l’arbuste. Sourde à nos prières, elle prétend ne plus faire un pas, quand mon frère, impatienté, arrache une branche fleurie et la tend à l’enfant. Cependant, à la fenêtre de la maison, la propriétaire nous regarde. Je pousse la porte et vais à elle. » J’ai tout vu, répond-elle à mes excuses. La fillette avait vraiment l’air si malheureux que je n’en veux pas au maraudeur. Et puisqu’elle aime tant les lilas, qu’elle vienne en cueillir chaque année. Il y en aura toujours pour elle. » La bonne dame est devenue très vieille. Nous allons encore lui demander des fleurs. Les lilas nous ont fait amis. - Il est vrai, pense Pierre-André, prenant congé de la pauvre marchande, les jardins sont des lieux où l’on devient meilleur. Leur vie muette remet, au cœur, le sens de bien des liens perdus. Les fleurs nous apportent, de l’inconnu, des signes suaves de consolation et d’amour. » Ceux qui seront sauvés
DANS un coin du salon, la jeune femme aux cheveux noirs, larges mâchoires et cou maigre, demanda à Pierre-André : « Croyez-vous que nous serons tous « sauvés » ? - Tous, non, répondit-il. Il n’y a que ceux dont l’âme s’est éveillée et ouverte qui rejoindront le Père. - Mais, les « autres » ? - Les autres, ceux dont l’âme est demeurée engourdie, non. L’âme, le feu sacré, ne brûle pas nécessairement chez tous les hommes. Et ceux qui en nourrissent une flamme ne la voient pas briller également à chaque instant. Chez moi, souvent, elle vacille, elle veut s’éteindre... comme une lampe faute d’huile qui fait pe... pe... pe... Une fois, ah ! une fois, j’ai cru la mienne morte, morte à jamais. Avec rage, avec bonheur, avec quel bonheur enragé, je criais : - Enfin ! enfin, je n’ai plus d’âme ! Je suis libre ! » Et puis, peu à peu, au fond du noir, la lueur bleuit à nouveau en moi. Elle se ranima, éclata et tout s’éclaircit, tout se réchauffa, tout se parfuma... Et derechef, je sentis la douleur, je vécus. - Reconnaîtriez-vous une âme qui pourra être « sauvée » ? - A coup sûr ? Je ne sais. Cependant, il me semble bien que j’en vis « une » hier, comme j’arrivais, à la tombée du jour, du bas de la ville, au jardin dépouillé de la rue de la Régence. » Devant moi marchait la petite bossue, jeune encore, habillée d’étoffes disparates de toutes sortes de gris pauvres. » Les talons des souliers par lesquels elle voulait relever sa taille, étaient gauchis à la culbuter à chaque pas. » Sur sa tête, une toque de velours vert faisait penser au nain qu’on voit, dans les tableaux des primitifs, jouer avec le singe traînant son boulet par la chambre du somptueux seigneur. » A sa main, une fillette de sept, huit ans qu’en boitillant elle couvrait d’un regard si ardent d’amour ; tandis que l’enfant au mince visage levait, sur elle, des yeux si clairs et ravis que l’ombre m’en parut un instant éclairée. » Le couple atteignit l’escalier du Musée. Devant le groupe qui symbolise la peinture, la femme s’arrêta et d’une voix douce et impérieuse : - Vois-tu, dit-elle, au haut des degrés, ce rebord de pierre ? Monte et vas-y. Tu marcheras tout le long et arrivée à la femme de bronze, tu passeras devant, tu continueras et je te rattraperai sur le trottoir. Va ! » Et de son bras maigre, d’un geste de commandement royal et fou, la femme montrait, à deux ou trois mètres au-dessus d’elle, la mince frise en surplomb sur la rue. - Non ! cria l’enfant. J’ai peur. - Tu n’as pas peur. Regarde-moi. Je le veux, te dis-je. Je le veux ! » Quelle flamme brûlait dans ses yeux ! Quelle énergie passait dans les mains qui serraient l’enfant ! » Là-haut, s’accrochant aux reliefs du bronze, la petite déjà piétine l’étroite bordure de pierre. » A menus pas, elle avance, droite, le dos au mur, les deux mains à plat collées de chaque côté à la paroi. » La bossue la suit du trottoir. La terreur à la fois et la fierté agrandissent ses yeux levés et font resplendir, dans le malingre visage, l’héroïque regard de la vie menacée qui tient tête au danger, le repousse, le bouscule, le dompte. » L’enfant parvenue au bout du dangereux liseré, la femme est venue se placer sous les petits pieds. - Halte ! Baisse la tête. Regarde-moi. - Non, non, j’ai peur, répond la petite, la nuque à la muraille. - Baisse la tête et saute. Je le veux ! » L’enfant jette les bras en avant, à pieds joints bondit, et la bossue la saisit au vol et la couvre de baisers sur la bouche, les yeux, le front. » La main dans la main, elles ont repris leur route dans la boue. On dirait que c’est son âme héroïque que l’infirme vient de remettre à nouveau dans son cœur. » La dame aux larges mâchoires et au cou maigre murmure : - Oui, je le crois aussi, le monde doit se « sauver » lui-même. »
les Merles
PAR cette fin d’après-dîner de dimanche, Pierre-André est au jardin. Mars éclora demain. Aux branches, les opales des bourgeons, les pendeloques dorées des chatons étincellent, tels des yeux qu’anime l’amour ; des yeux de créatures aux formes invisibles, mais dont il entend le gémissant murmure rythmer sa solitude voluptueuse. Une plainte tendre qui meurt et renaît, est éparse dans le jardin. Et l’homme aux tempes blanchissantes se sent, jusqu’au creux des os, empli de cette douce rumeur qui soulève régulièrement et s’abaisse, balancée au rythme de son sang. En sabots, calé dans la terre molle, Pierre-André nettoie un coin de la prairie où la renoncule a glissé ses insidieux lacets. Son râteau crisse entre les menues racines. Tout le sol est en vie. Une courtillière, bijou bleu, vert et rouge, s’échappe en chatoyant d’une motte retournée. Dans sa hâte, elle culbute, et renversée sur le dos, montre son ventre d’un noir d’encre de Chine. « Quoi, tu as peur ? Va... Ce n’est pas moi qui ferai du mal aux jardinières. » Au pied d’un brin d’herbe qui, sans doute, est pour elle un palmier plein de murmures, luit la goutte de laque tavelée d’une coccinelle en naïf casaquin rouge à pois noirs. « Ne crains rien ! » La vie bouge jusque sous les semelles de bois du bonhomme au râteau, et le vent colle sur sa nuque une fraîcheur de lèvres. Au creux de sa poitrine, penché en avant, il sent des gouttes de sueur ruisseler sur sa peau. Ce ne sont plus des pensées, fils de fer raides et durs, qui fixent, pour l’instant, dans son cerveau, les traces du visible ; mais des ondes de buées, de longues franges de fumées, des chaînes de parfums, des réseaux de sensations puissantes et imprécises. Dans le jardin contigu, un homme longuement frappe un arbre. Les chocs de la hache retentissent avec une cadence pleine et franche, et chaque coup ouvre, aux yeux de Pierre-André, un horizon de forêt. Le soleil baigne les ramilles flottantes du grand saule voisin comme une fine chevelure blonde. Dans une pelouse que l’ombre gagne, les crocus ont les teintes pures et vives d’œufs de Pâques disposés pour la fête des petits enfants. Strident, bref un cri d’oiseau sort de la boule verte d’un vieux buis étalé sur le sol ; un cri dru, vigoureux qui monte, fuse, se prolonge en hachures de plus en plus aiguës ; appel d’impatience affolée ; roucoulement de joie qui délire. Un deuxième cri coupe le premier, d’une intonation plus grave, d’un timbre plus gras ; une voix qui chanterait dans la crainte. Mais le ramage initial reprend. Il enroule de sa volute la voix plus douce, l’étreint, l’écrase, l’emporte, la rejette et recommence haletant, menaçant, sauvage. On dirait le radieux et bégayant ramage d’un pinson, mais formidablement grossi. « Qu’est-ce que cela ? se demande Pierre-André dressé comme à l’affût. Un oiseau, deux oiseaux ? » Les mains sur la manche de l’outil, immobile, il sonde du regard le massif de buis où se cache le mystère. La poitrine oppressée, sans pensée, il attend. Mais son corps d’homme qui a vécu, son sang qui connaît la fièvre, devinent, savent... Et son cœur bat, bat, bat... Voletant à coups d’ailes forcenés, noués par le bec, deux oiseaux, masse noire tourbillonnante à contours déchiquetés dans la lumière, apparaissent un instant par-dessus le dôme de feuillage, puis retombent dans le creux des branches. La furie des chants recommence ; percement, déchirement, rejaillissement de notes aiguës. Ce n’est pas le chant naïf du merle qui précède ou suit le crépuscule. Ce n’est pas la fanfare printanière du philosophe joyeux, se posant à lui-même, au plus haut de l’arbre et pour rire, des questions faciles auxquelles il fait en grasseyant d’interminables réponses. Il y a dans ces cris, un accent de douleur triomphale qui fait haleter l’homme à l’oreille tendue. Du buisson agité, le feuillage s’entr’ouvre. Un oiseau, un seul au plumage d’ébène, en sort d’un vol bas, lancé droit ainsi que par une main. Subitement, il zigzague, tourne sur lui-même, atteint par raccroc une branche voisine, retombe, s’élance à nouveau. Enfin, longeant la muraille de clôture, il arrive au pied du lierre qui garnit l’encoignure, criant, piaulant, semant sur son chemin les morceaux de son chant brisé. « Bon Dieu ! murmure béatement Pierre-André, détaché de sa contemplation muette, retombé de l’extase où il a suivi le manège des bestioles. Mais ce merle est fou ! Il est fou de joie ! » Tenant les deux mains vers le coin feuilli où la bête s’est réfugiée, d’une voix tremblante de fraternité : « Merle, merle, merle ! » crie l’homme. Et il se laisse choir dans l’herbe, n’entendant plus du monde que le chant d’un couple d’oiseaux au fond du vieux jardin. « Ah ! pense-t-il, baisant la terre, la douleur de l’homme n’est que son désir de tout faire éternel ; son désir fou de posséder, aujourd’hui, ces ailes sur lesquelles peut-être il volera, un jour... C’est de toujours dire toujours, et d’oublier de fermer la main sur le moment – sourire de fleur ou chant d’oiseau – qui passe. »
les deux Branches
PIERRE-ANDRÉ, le Wallon aux yeux bleus, aux larges joues rouges d’un sang qui, du cœur à la tête, coule vif et chaud, c’est l’optimisme, la bonne humeur, le besoin d’épanchement. « Le vrai type du Wallon, » promulguent ses amis. Et Pierre-André sous l’arrêt branle le chef comme pour secouer l’étiquette attachée une fois pour toutes à son col : « Wallon garanti ». Or, remuant des papiers de famille, il découvre, en un cahier relié en peau de tambour, écrits à la plume d’oie d’une encre de sépia, des détails sur ses origines qui le rendent rêveur. Tandis que jusqu’à présent, il a borné, à quelques sites du Hainaut, l’horizon natal où il revoit en imagination se succéder les ascendants de son père ; tandis que c’est à des oncles et des cousins régulièrement prénommés Pierre, Louis, André qu’il rattache les histoires du mémorial ressassées à ses oreilles durant son enfance ; aujourd’hui, s’il doit en croire cette suite de documents exhumés, c’est dans le coin de la Belgique le plus foncièrement flamand : le pays de Waes ; par des villages aux noms qu’il n’est pas certain de pouvoir prononcer correctement, que se sont régulièrement succédées les générations de sa lignée maternelle ; liés par les grandes accolades des tableaux de ces généalogies, ce ne sont que prénoms comme Pieters, Gillis, Nicolaus, Jan, Joos. « ... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sache un chacun enfant de Notre-Mère la Sainte Église que comme Mabelie d’Eeckaute et Gertrude sa sœur, et Baudouin Van R... avec leur postérité furent d’état et de condition libres, et néanmoins la justice séculaire les en ayant privés à tort et réduits à la servitude de la comtesse de Flandre, la noble matrone Marguerite, comtesse de Flandre, a cherché et trouvé la vérité, et déclare les prédits Mabelie, Gertrude et Baudoin Van R... avec leurs descendants libres de servitude et par Willeman d’Oostkerke qui en ce temps fut bailli de Gand et du pays de Waes en présence de ses hommes, savoir : Théodore dit Scampenois, seigneur de Pumbeke ; Bertram de Bordebure, chevalier ; Danekin de Rodesakke, Soïkin de Borsele et de beaucoup d’autres hommes probes, les a fait déclarer libres à l’entrée de Waesmunster, du coté Est... Et en témoignage perpétuel de ce, moi, Nicolas, prêtre, et moi, Théodore, seigneur de Pumbeke, ayant ouï et vu ces choses, avons fait sceller les présentes lettres de nos sceaux, l’an de Notre-Seigneur 1249... » Pierre-André se met à la recherche, dans le plat pays du Nord, de cette partie de son âme dont il se sent tout à coup privé, qu’il veut retrouver au pays de sa mère et incorporer. Les champs de chanvre et de lin des bords de la Durme... Les vastes emblavures de terres lilas, planes comme des aires de grange... Les saules argentés au bord des ruisseaux sans courant... L’horizon, à hauteur de ses yeux, ouaté d’une buée molle et tendre... L’eau se sent toute proche sous la couche du sol poreux. Prés et champs éclatent d’une vie débordante. Les fermes étalent leurs fabriques solides de briques roses sous des toits de chaume plaqués de mousse. Des mares bordées de roseaux portent des bacs d’allures massives où des pêcheurs, la ligne à la main, immobiles, vivent les scènes des tableaux de l’ancienne école flamande. Les églises de pierre blanche haussent des clochers fastueux, signes d’une fois dans un Créateur riche et généreux, et dont l’ombre, au cours du jour, tourne sur des cimetières à tombes largement espacées. Dans le chœur des chapelles, des pierres posées debout font lire, au voyageur, de ces noms que sa mère-grand mêlait à d’interminables histoires d’héritages, jadis à la veillée. Et ainsi, des jours et des jours, il arpente le pays maternel reconquis. Ces hauts gars à peau rose et yeux bleus qu’il croise sur les routes ; ces ciels où naviguent noblement des escadres de somptueux nuages ; cette mer de verdure sans fin, mettent en lui un sentiment nouveau de vie facile, grasse, sans inquiétude. Ici, son cœur bat plus lentement et plus fort. Ses pieds qu’il voulait faits pour la montagne, semblent prendre racine et, de cette terre molle, laisser monter en lui une sève plus riche. Dans un village où l’a mené un chemin qui borde la frontière de Hollande, en buvant sa bière, il aperçoit, dépassant les toits des petits maisons, d’étranges bannières qui flottent au vent et passent dans le ciel fleur de lin. Il s’informe, et l’hôtesse, Flamande au long nez, à la forte mâchoire, d’éclater de rire. « ’t Is de Schelde ! C’est l’Escaut. Ce sont les navires qui descendent vers la mer, dont vous voyez les pavillons.” Ainsi tout musant, Pierre-André est arrivé au Doel. Il monte sur la digue, d’où la vue embrasse une nappe sublime de lumière et d’eau. Sous les yeux frissonne une soie moirée où glissent triomphalement légers, à des lieues et des lieues au large, dans tous les sens, barques fines et colosses marins. Devant le merveilleux domaine qu’il vient de retrouver, Pierre-André sent son cœur s’élargir à la dimension de sa conquête. Dans son esprit, avec le soudain d’un rais de soleil perçant un nuage, se fait un jour nouveau, un jour flamand. Il sent qu’en réalité, il n’est exclusivement le fils des roches de Wallonie, pas plus que les nuages galopant au ciel du Doel ne le sont de ces étangs et de ces mares. Un pli de ses lèvres, sous ses narines aspirant l’air marin, rit des sottises rabâchées sur les antinomies des deux races nées ennemies. « Ne cherche pas plus loin, Pierre-André, et bénis l’abondance de ces sources mêlées en toi par mille ans de mariage. L’homme se lie par les mots comme par ses folies. Refuse de choisir entre Flamand et Wallon. Il n’est pas trop de deux branches, au tronc sorti de la terre belgique, pour porter ton cœur. »
la petite École
PIERRE-ANDRÉ, qui lit parfois les gazettes, a eu vent des transformations qu’on veut apporter, du grenier à la cave, dans l’ « édifice scolaire ». En cette école modèle, munie de tout le confort moderne, – eau, gaz, électricité, W.-C. à l’étage – qu’il sera donc facile et agréable – genre appartement français – pour les enfants et les parents – ascenseur, lift – de s’instruire ! Non sans l’amertume d’une certaine jalousie dans le sourire, tandis qu’il admire ces idées nouvelles, Pierre-André se souvient de la simplicité des moyens qu’on mettait au village, en son temps, au service de l’instruction. Il revoit l’école de Mademoiselle Camille, dans sa chambre basse à côté de l’atelier de la couturière-modiste, Mademoiselle Marie. Six bancs des garçons à droite ; six bancs des filles à gauche ; Pierre-André courant à quatre pattes en cachette et prenant la gauche. Debout l’institutrice, une baguette usée du bout à la main, montre les lettres sur le tableau. Et toute la classe chante l’ABC, comme une cantate triomphale, pensant que c’est pour s’amuser. Le soleil à travers les poiriers darde, par la fenêtre du fond, des rayons qui tranchent dans la poussière comme des glaives. Par les baies du devant, se découvrent le préau vert, le chœur de l’église de pierre bleue de Saint-Christophe, les maisonnettes cahin-caha, les jardins aux murs bas d’où tombent les vignes vierges en guirlandes jusqu’à terre. Le pas traînant du bourrelier qui passe, chargé d’un collier de cheval dont dindrelinent les sonnailles et qui sent le dégras. La charrette basse du petit, gros, court, aviné brasseur qui crie : hue et dia, à plein gorge, toujours gai et imbibé de bière. Une planche sur l’épaule, la scie sous le bras, la chevelure mêlée de sciure : le vieux menuisier au dos rond. Le village tout entier s’anime pour la petite école et défile à plaisir devant les fenêtres. Gracieusement la vie des bonnes gens du dehors égaie la grammaire et l’arithmétique. A la récréation, comme l’école ne possède ni cour ni enclos, écolières et écoliers mêlés bondissent sur le préau. Bientôt ils tournoient autour de l’église, grimpent au clocher ou filent dans la ferme par la barrière entre-bâillée. Les uns se coulent dans la forge où le cloutier, manches retroussées et tablier de cuir noirci, bat son fer ; les autres gambadent sous l’appentis du batteur de coquemards, tout secoué de tintamarre et piquant des vapeurs de l’eau-forte. « Mais avec tout cela, se dit Pierre-André, je n’ai pas connu les récréations intégrales qui auraient tant fortifié mon esprit en délassant mon corps... et réciproquement. » Et comment ai-je appris à lire ? J’en rougis encore. » La puissante Mademoiselle Camille a montré au tableau la lettre B, mais un B contourné et muni d’ornements bizarres. Sa tête s’agite, ses lèvres se ferment convulsivement. Emmagasinant longuement son souffle, sa face rougit ; les yeux lui sortent des orbites. Elle va éclater. Elle éclate et mugit : « Beu ! Beu !... Vous voyez cette bête qui tire la charrue, mes enfants ? C’est un bœuf. Remarquez, sur ses cornes, une traverse de bois qui s’attache au timon de la charrue. Chaque fois que vous rencontrez cette lettre B, vous penserez au bœuf et vous direz : « Beu ! Beu !... consonne ». « Beu ! Beu !... » répète la classe docile des petits veaux. » Mais Mademoiselle, de sa baguette, a dû toucher quelque chose de terrible. Elle siffle : » Seu ! Seu !... et ses bras se tortillent comme deux anguilles de la Sambre, perdues au crochet du poissonnier. Voyez-vous ces lettres : SSS ? Ce sont autant de serpents qui se redressent en poussant des sifflements. Quand vous les verrez, vous ferez comme eux, mes enfants, vous direz : « Seu ! »... et vous les appellerez consonnes. Seu... consonne. « Seu... Seu... sifflent les enfants comme le vent de bise passant sous la porte. « Gueu... Gueu... ». « Mademoiselle Camille penche le cou en avant ; sa tête s’enfonce entre ses épaules, son visage se crispe en une affreuse grimace. Elle tend la main comme le vieux pauvre à la porte de l’église. « Reconnaissez-vous, demande-t-elle, ce pauvre homme réduit à mendier ? C’est un gueux. Comme il baisse humblement la tête pour solliciter la pitié des passants ! A côté, aussi un gueux, mais mieux élevé. Il fait des tours sur un tonneau, et à son chapeau porte un petit plumet. Eh bien, quand vous retrouverez ces « bribeux », vous direz : « Voilà les gueux ! » en ajoutant : consonne !... Maintenant, ensemble, répétez : « Gueu, consonne ». » Et la classe entière de crier : « Gueu, consonne », comme pour faire s’enfuir tous les mendiants, estropiats et culs-de-jatte du pèlerinage de Saint-Quirin qu’on célèbre à Leernes, le dimanche de la Fête-Dieu. » I... i... Regardez donc ces images ! Ne représentent-elles pas parfaitement deux écoliers, un grand et un petit ? Mais ils pleurent. C’est qu’ils jouaient à la balle et croient l’avoir perdue. Les entendez-vous crier : « I... i... » ? Chaque fois que vous rencontrerez les deux petits gamins au tableau, vous les imiterez en disant : « I » et vous ajouterez : voyelle droite. Élève Pierre-André, répétez ! « Et Pierre-André, encore tout ému du chagrin des écoliers en quête de leur balle, éclate en piaulements de douleur : « I... i... i... » si aigus que la maîtresse doit l’interrompre. » Pas si fort, Pierre-André, pas si fort. Il ne faut pas être si triste que cela, mon Dieu ! C’est pour rire, Pierre-André. « a... Mais voyez-vous donc ce Monsieur avec son gros ventre ? Quel beau gilet ! Comme il en est fier et satisfait ! Il ouvre une large bouche et crie : « a... a... ». Voyelle ronde, répéterez-vous, quand vous rencontrerez le gros monsieur au beau gilet. a... a...voyelle ronde. « Est-il possible, se demande Pierre-André, que ce soit ainsi que j’aie appris mes lettres ? N’en aurais-je pas à rougir, ne fût-ce que par respect humain, devant les pédagogues de mes amis ? Et le débraillé de ma pédagogie primaire pourrait-il leur laisser admettre que je sache réellement lire ? » Mais, en vérité, est-ce que je sais lire ? La danse folle des images qui se pressent à mes yeux, à mes oreilles, à mes narines, à tous mes sens, quand je tiens un livre ; la ronde enivrée des idées qui tourbillonnent dans ma cervelle, à la lecture de tel conte que j’aime, n’est-ce pas le stigmate indélébile d’une infirmité que m’a causée jadis la maîtresse d’école, Mademoiselle Camille, à la baguette blanche ? » J’ai trop de plaisir à lire parce que j’ai manqué jadis des vraies méthodes et eu l’esprit gâté pour toute ma vie par la petite école. » Au moins, sais-je pourquoi : Mademoiselle Camille, la chambre basse pleine de soleil et Beu et Gueu et Seu ! »
les Hirondelles du Rivage
AU bout d’une allée d’Uccle, la carrière de sable creuse la dune d’une excavation grande à enterrer un hameau. Couronnée par des champs de céréales dont la bordure d’épis déjà hauts tranche d’un vert clair sur l’azur, la paroi jaune est taillée abrupte comme un mur. Concrétions et cailloux se détachant de la falaise y ont laissé une multitude de petits trous, minuscules galeries plus ou moins profondes, dont la bouche ronde ne montre que de l’ombre. Pierre-André les a curieusement constatées durant l’hiver, à mesure que l’homme au sable, le carrier en costume de velours verdâtre, tête noire bretaudée, mine renfrognée, à coups de pioche rabotait la montagne et la faisait crouler sous ses pieds, pour la pelleter ensuite aux tombereaux des maçons. Or au beau matin du premier jour de mai, apparaît un spectacle merveilleux. Le ciel de la carrière s’est rempli d’un vol d’hirondelles rentrées cette nuit de leur voyage saisonnier : traits noirs qui se balancent nets comme des arcs d’arbalète, si rapides qu’ils semblent suspendre des guirlandes dans le bleu et nouer des banderolles défaites sans cesse, rattachées aussitôt. En silence les laborieux oiseaux à la queue fourchue, ayant peut-être encore dans le ventre les criquets du désert africain, tout à leur affaire d’ici, vont, viennent, se croisent, se contournent, se surmontent. Et s’approchant de la paroi du cirque, brusquement chacun de son côté pique dans le mur de sable et disparaît. Pierre-André suit des yeux le manège affairé, l’infinie arabesque, l’emmêlement tourbillonnant de ces vols gracieux qui viennent, unanimes et un à un, se terminer dans l’épaisseur de la paroi de terre. Par une étonnante prévision des choses naturelles, chaque pertuis de la falaise est devenu une maison ; dans chaque maison, gîtent un ou deux oiseaux. Un instant, l’hirondelle battant de l’aile plane en Saint-Esprit, se pose debout, le bec en haut, sur le bord de son logis, et prestement y pénètre. Quelquefois ayant à peine effleuré le sable, sans aller plus loin, elle se renverse dans le vide, reprend son vol. C’est qu’elle s’est trompée de maison. Mais en face de cette multitude d’ouvertures toutes pareilles, combien rares se montrent ces confusions ! Sa visite faite, au bout de quelques secondes, l’oiseau réapparaît au bord de sa grotte, se laisse tomber et reprend son vol en une courbe planée. Ah ! si malgré la rapidité de sa course, chaque hirondelle peut retrouver sa demeure parmi tant d’autres toutes semblables, c’est que, dans son cœur, brûle déjà tout l’attrait de l’amour. Chaque trou dans le sable est un nid. Le mois se passe. Les oiseaux ont persévéré. La falaise, à quelque heure du jour que Pierre-André s’y présente, est animée par la guirlande de vie enfiévrée. Par tous les temps, pluie ou soleil, alertes les hirondelles caracolent dans le ciel, plongent au nid et en ressortent pour y revenir bientôt. Nul trouble, nul bruit, nul combat. La moindre erreur est tôt réparée, et l’hirondelle qui se présente à un logis étranger, jamais n’insiste, tôt reprend sa course et trouve son vrai gîte. « Quoi ? se demande Pierre-André. Animant ses ailes inlassables, réglant l’assurance de ses trajectoires dans le ciel, il y a donc, pour chacune de ces bestioles, une âme active, une âme d’amour et de tendresse, une âme d’accord avec l’ensemble ? » Pour toutes, un but a donc été fixé, une joie en chaque action, une émotion pour chaque instant ? » Pas une aile ne frémit dans l’azur, qui ne tende vers un bonheur et n’aspire à une réalisation ? Cette légèreté plus légère que le vent, cette rapidité plus rapide que la flèche, se trouvent donc animées de la plus puissante chose du monde ? Chargées d’amour ? » Et le moucheron invisible que l’hirondelle gobe au fond du ciel, il a sa place marquée dans l’univers de ces harmonies ? Oui ; et c’est le fond du nid de sable où, sur quelques plumes, repose le cœur de l’oiseau. » Pierre-André voudrait demeurer calme devant la falaise creusée de mille nids. Surtout, il voudrait ne point effaroucher ces mères hirondelles affairées à leur œuvre. Il se tient accroupi derrière la haie, sans bruit, ravalant ses cris d’admiration. Se mordant les lèvres, il tient muette sa joie de participer à la vie enfiévrée de ces tourbillons de l’azur, et il attend. Le soir tombe. Très tard, peu à peu, les entrelacs des gyries se font moins emmêlés. Dans le ciel où apparaissent les étoiles, le tissu des ailes est plus lâche. Voilà la dernière hirondelle rentrée. Écoutez. Les oiseaux au cœur vaillant ne dorment point encore. Dans les profondeurs du sable, les couples se forment. Écoutez. C’est une longue et tendre plainte sous la terre. Dans la nuit, la falaise au bord du chemin sourdement gémit d’amour.
les deux Sous
CE vieux pauvre à demeure, hiver et été, à l’entrée du bois de la Cambre, avait plutôt l’air d’un sylvain hirsute et dépenaillé que d’un mendiant patenté. Il semblait posé là pour son plaisir ; plaisir de frapper la terre de ses sabots et de secouer ses nippes de velours défraîchies ; et plaisir de dire soigneusement à tous ses amis passant par là, aux différentes heures du jour, le vrai temps qu’il faisait. Pour deux sous ou même pour un, on était sûr de savoir s’il pleuvait ou gelait. Un matin, la grosse dame qui vient de la ville occuper une chambre au hameau, une fois son magasin fermé, histoire de pouvoir dire qu’elle est à la campagne, décide de présenter deux sous au vieux pauvre. Il est, depuis tant d’années, sur son chemin, et lui a tant de fois donné pour rien des nouvelles de la température et du temps, qu’elle en a pris honte. Elle tient le nickel entre le pouce et l’index ; et de loin elle le tend vers le vieillard, en frappant l’air à petits coups, comme pour dire qu’elle est là : Pst... pst... Le sylvain a les mains en poche jusqu’au coude, et ses yeux rient dans sa barbe en voyant la grosse dame agiter plus vivement sa pièce à mesure qu’elle approche. Mais quel guignon ! Il ne parvient pas à extraire les mains de ses goussets, et voilà que la monnaie tombe dans les feuilles et disparaît. Or cela ne déplaît pas à la dame charitable. Il lui va assez que l’homme en loques doive se courber devant elle pour ramasser son aumône. C’est une attitude qui a de l’expression, et qu’on aime à voir prendre aux mendiants : les reins cassés, grattant la terre à vos pieds. Et ainsi s’éloignant elle fait un pas en avant, guignant le vieux du coin de l’œil. Mais celui-ci, de ses regards embroussaillés, la suit elle-même en souriant, sans s’inquiéter, dirait-on, du sou perdu. Il faut que la dame s’arrête, son instinct de bourgeoise économe révolté : « Mais je vous ai donné deux sous ! dit-elle d’un ton sévère. - Vous m’avez donné deux sous, ma bonne dame ? reprend le vieux, la tête encore plus enfoncée dans les épaules. Et montrant sa paume ouverte : Vous devez vous tromper, je n’ai rien. - Naturellement, puisque vous avez laissé tomber la pièce. - Ah ! ah ! C’est cela ? Voilà... répond bonnement l’homme, comme s’il n’en parlait que pour faire plaisir à la passante. Voilà ce qui sera arrivé, ma bonne dame : elle aura roulé à terre. Les sous, ça roule, ça roule... Mauvais temps, mauvais temps, ma bonne dame ». La passante immobile, promène des regards farouches. « Mais cherchez donc ! C’est une pièce de deux sous, vous savez ? - Ah ? Une pièce de deux sous ? Pas possible ? - Elle doit être tout près, peut-être sous vos sabots. Cherchez, voyons, bougez-vous ! - Hé ! hé ! ma bonne dame, c’est que j’ai la vue basse. » Le large visage de la promeneuse est déjà écarlate. Elle se penche cependant vers la terre et, de son parapluie, remue rageusement les feuilles, secouant le beau tapis que la forêt étend pour son sylvain familier. « A-t-on idée d’un tel mépris pour l’argent, chez un mendiant de profession ? Comment, vous restez là fiché ainsi qu’un pieu ? Retournez donc les feuilles avec moi. » Dans ses sabots blancs, immobile, souriant, il s’excuse : « J’ai la vue si mauvaise ! Je ne vois pas plus loin que ma main, figurez-vous. Et avec cela les reins, ma bonne dame ; les reins qui ne veulent plus se plier ! Mauvais temps, mauvais temps, vous dis-je. - C’est trop fort ! Qui vous parle de vos reins ? A-t-on jamais vu un pauvre de votre espèce ? Vous vous moquez de qui vous fait l’aumône, à présent ; de qui vous fait vivre ? - Ben quoi ? C’est rapport à mes yeux. Je n’y vois pas. » Enfin, la vieille dame aperçoit le rond de métal qui brille dans le terreau : « La voici ! crie-t-elle, avec un éclat de voix de petite fille. Et désignant la pièce du bout du parapluie : Ramassez-la ! - Ah ! Vous l’avez retrouvée ? Quelle chance ! Que je suis content pour vous ! répond le pauvre. C’est comme si je l’avais, je vous assure. Gardez-la, je vois bien qu’elle vous fait plus de plaisir qu’à moi. » Et tandis qu’elle demeure les sourcils relevés, la bouche pincée, le regard foudroyant, le mendiant se baisse lentement, ramasse le nickel, et l’insère dans la paume de la grosse dame : « Allons, prenez ! dit-il, c’est de bon cœur. Et comme à une amie : « Mauvais temps, n’est-ce pas, ma bonne dame ? Mauvais temps. »
les Tournesols
SE penchant à sa fenêtre, Pierre-André avise une touffe de tournesols que les pluies de juin et le soleil de la canicule ont grandi de façon étonnante. Il semble que la faculté de se mouvoir leur ait été subitement donnée, sinon pour courir comme les bêtes, du moins pour monter. Les superbes plantes ! De la hampe grosse comme le poing de leur tronc vigoureusement cannelé, se détachent, sur les longs pétioles horizontaux, les feuilles en forme de cœur qui ont l’air de s’ouvrir pour prendre essor. Entourant la tige, on dirait autant de paires d’ailes qui bossuent le dos de quelque svelte créature dont la face serait cette fleur d’un riche ton de brun doré, sertie dans une couronne de languettes resplendissantes. Et toutes ces plumes étalées que le vent agite paraissent soutenir le vol sans fatigue de cet être glorieux au sourire sans fin. Nous refusons l’âme aux fleurs. Nous prétendons ne prêter point de sens à l’expression de leur physionomie. Pour nous, leur beauté est muette. Mais Pierre-André qui marche les pieds nus dans son jardin, mendiant de la nature, quémandeur des plus humbles grâces de la terre, Pierre-André a appris à contempler les fleurs ; et parfois il croit comprendre le sens de leur vie. Ainsi que lui, un gros bourdon de velours, couleur de loutre rehaussée d’anneaux d’ivoire, à la longue trompe gourmande, aux cuisses rondes, fait ses dévotions au tournesol, l’ange immobile aux cent ailes déployées. Large comme deux paumes de main, la face angélique saupoudrée d’or moulu, penche sur sa tige qui fléchit. Et lui, l’heureux Bombus, dans ce bassin qui doit, pour sa taille, faire toute une mare, dans cet étang de délices, il nage, patauge et parfois s’enfonce tout entier. Courtaud et velu, son corps s’est chargé du pollen des milliers de fleurettes dont l’agglomération compose le gâteau merveilleux. La bestiole est devenue une boule de nectar qui flotte et roule dans le propolis poudroyant que le tournesol en amour projette à la lumière. Pierre-André, tirant à deux mains la hampe de l’hélianthe, a baissé, à la hauteur de ses yeux, la face flamboyante. Sans inquiétude, le bourdon enivré continue sa vendange. Et l’homme se demande : « Que sommes-nous, créatures avides et misérables, à peine assurées d’un pain pétri de sueurs et de larmes, d’une eau qui goûte le cadavre, d’un manteau taché de sang ? Que sommes-nous, les hommes, au prix de cet insecte dont la vie n’est qu’une délectation innocente au sein d’une fleur épanchant son amour ? - Ce que tu es, Pierre-André ? lui répond, du fond de lui-même, une voix qu’il connaît bien. Tu es le bourdon de velours, et tu es la fleur de tournesol dont s’épanche le pollen jusqu’à terre. » Tant que ton cœur bat, Pierre-André, tu n’es ni plus ni moins que la somme de ces merveilles éparses. Ferme les yeux. Ne sens-tu pas ta face briller comme l’hélianthe lui-même ? Sous ta peau, ta chair et tes os sont-ils autre chose qu’une masse chaude et d’un riche parfum que tu humes à pleine bouche ? » L’univers disparaîtrait à l’instant dissocié en atomes informes, si tu venais à lui manquer. Car tu es son esprit. »
le Plan du Village
SUR le mur blanchi à la chaux du palier, Pierre-André, devant la vitre, en pleine lumière, a cloué un tableau grand comme un mouchoir de poche et qui est le plus émouvant à son cœur. C’est une feuille de papier jauni à gros grains, couverte d’un bariolage de figures géométriques à contours irréguliers, teintées de bleu, de vert et d’orange pâle. Au centre, une manière de grosse lettre X d’un rouge vif, irradie des traits zigzagants. Quelques mots en lettres imitant l’imprimé, se lisent par-ci par-là, semés comme au hasard. C’est tout. Mais c’est le plan de son village, à l’échelle de 1 pour 5000, qu’un pauvre homme de bonne volonté et qui devait garder la chambre par force, lui a précieusement dessiné. Ainsi, à toute heure du jour, déjà vieillissant Pierre-André a, devant les yeux, le signe figuré de la portion de l’univers où son corps a bu la lumière et mangé la joie d’une jeunesse enivrée. Quand il veut, devenu un dieu, il couvre, de la paume de sa main, l’espace d’herbe et de ciel qui va de la carrière des Gaux à la ferme Sainte-Barbe. Voici le cœur du village : « Le préau Saint-Christophe ». Ici s’ouvre, devant le château figuré en vert, la maison natale où brûlait une fournaise d’amour quand, de la cave au grenier, dans chacune de ses chambres, traînaient les pas lents et lourds, les pas sacrés de Celui qui n’est plus. « Ne va pas trop vite, Pierre-André, sur l’image. Ton ongle, à chaque millimètre du plan, découpe une maison. Celle-ci avec sa courette devant la porte ; celle-ci avec sa ruelle ; celle-ci avec son coin qui déborde sur la route. » Pierre-André, d’un bout à l’autre du village, peut en faire le compte, une à une ; frapper à chaque fenêtre ; entrer dans chaque « allée » ; trouver, dans chaque cuisine, des cœurs familiers. Ces deux ou trois cents demeures sont siennes, toutes. Il y a vu les vieux en bonnet de coton, étendus livides sur leurs lits de mort ; serrant, dans leurs doigts raidis, le chapelet et le rameau de buis. Il y est entré, « parrain à la chandelle », avec la sage-femme qui portait le nouveau-né de retour du baptême. Dans un grenier du coin de cette rue, il contempla, durant des heures, des collections de couvertures de cahiers classiques, seule imagerie connue en ce temps-là, au pays. Dans ce cul-de-sac, il tirait le soufflet du cloutier. Au coin de cette place, il goudronnait les marabouts de fer passés au feu. Avec le boulanger à dos rond qui sortait de cette venelle, il allait à la tache verte de ces jardins, par une petite porte basse à arcade de pierre. Ce n’était pas un village où vivait Pierre-André enfant. C’était un grand feu où la flamme de sa vie pétillait en dansant. Ce n’est pas du passé qu’il rappelle à l’instant. C’est une illumination intérieure où il descend comme dans une cave regorgeant de trésors. Et ceci, ce n’est pas un plan d’architecte, mais la propre cervelle de Pierre-André placardée sur le mur ; une surface enduite de son cœur et de son âme. Son doigt suit ce trait d’encre de Chine, et il entre à la ferme d’Henrichamp, sous les noyers. Il crie : « Bonjour, censière ! » Les mouches font : « frou » quand il ouvre la porte de la chambre. Il flaire longuement l’odeur du lait aigri et de la fumée. Il s’assied, les pieds dans la cendre de l’âtre fumant. Le temps a rebroussé. Le revoilà enfant, les yeux étincelants, en admiration énamourée, avide de toutes les choses. Pierre-André, debout devant cette feuille de papier étalée, tend le cou pour regarder par la fenêtre même le logis de sa vision. Il retrouve le sentiment de calme et de confiance de l’enfant que son père et sa mère attendaient dans la maison du préan. La chaîne d’amour est reformée. Magie de la pensée retournée sur elle-même, ô souvenir, que voilà contents de peu ceux qui vous définissent : un reflet, une trace, une impression. Il n’y a qu’une chose, et dont l’univers est le signe : l’Esprit ; l’esprit qui ne se morcelle ni ne se divise ; l’esprit éternel, unique, entier, omniprésent ; l’esprit, Dieu, aux champs, ici, partout. Fils de ce père, quand l’homme reconnaîtra-t-il donc sa puissance ? Quand, sur les murs, saura-t-il lire les mots magiques que lui-même a écrits ?
le vieux Poêlon
PIERRE-ANDRÉ, assis au coin de la cheminée de briques rouges de la cuisine, fume sa pipe à bouffées précipitées. Ces mèches de fumée lancées sans rythme ne disent rien de bon. Ce n’est pas là le tabac favorable, les volutes du rêve d’un cœur bénin, mais plutôt feu de hargne et halenée d’inquiétude. « Qu’as-tu, mon fi ? lui demanda sa mère. - J’ai... J’ai tout juste ce que je mérite pour m’être montré à nouveau l’inguérissable naïf que tu as mis au monde... Il y a quelques jours, je demande à un ami, mon plus vieil ami peut-être, un petit service... Ah ! « petit » service ; ah ! « vieil » ami !... Voilà sa lettre où il se déclare incapable de m’aider. - Que veux-tu, mon fi ? Ce sont les mots qu’on prononce depuis toujours. Les services qu’on demande sont également de petits services, et les amis qui vous le refusent, de vieux amis. - Mais qu’on m’y reprenne à solliciter rien de personne ! Et à leur tour qu’ils y viennent ! Je les... - Quoi ? Quelle sottise vas-tu avancer ? - Je... je les écraserai sous ma générosité ! Tous, je les ferai rougir ! - Allons, à la bonne heure ! dit la mère. Rallume ta pipe. Il faut de la philosophie... Viens, couet ! ajoute-t-elle en saisissant, sur la planche de l’armoire, son poêlon par la queue. Viens, nous allons faire le souper. Il reste un peu de beurre, de vrai beurre, au fond du pot, et quelques pommes de terre froides de midi. Il ne nous en faut pas plus, avec une bonne jatte de café. Allons, couet ! » Docile, le poêlon se laisse prendre, prêt à l’œuvre. Avec son manche percé d’un œil au bout, vraiment il est encore d’assez bonne apparence, malgré son âge. « Hein ? continue la vieille, vaquant de l’armoire à la table, l’ustensile à la main. Hein, couet, voilà des ans et des ans que nous nous connaissons ? En avons-nous préparé ensemble, des patates aux oignons et de belles fricassées ? Et tu vas toujours comme un neuf. Ah ! on ne fait plus aujourd’hui des poêlons de ta sorte. Le temps des bons batteurs de fer ne reviendra plus. Il ne s’agirait pas d’avoir à te remplacer pour le moment. Hier, tu m’avais paru un peu usé du fond. Mais j’avais mal vu. Tu ne voudrais pas trahir Marie-Catherine. Nous devons achever jusqu’au bout notre voyage ensemble. Ah ! rassure-toi, couet, je ne désire plus tarder bien longtemps. » Tout devisant, la vieille Marie-Catherine, à la lueur de sa lampe à huile de colza, a raclé son pot de beurre et réuni gros comme une noisette de la précieuse denrée. « Pourvu que la marchande m’apporte demain ma demi-livre. Me voilà sans. Tiens, couet, dit-elle, en détachant la crotte dorée, fristouille ! » En tisonnant elle découvre, dans l’âtre, une braise encore rose. Elle y porte un peu de menu bois, cale dessus le poêlon, et s’en va couper ses pommes de terre en tranches. Le feu se rallume. Comme une broderie, de petites langues courent au long des bûches qui se mettent à flamber, et le beurre commence à grésiller sa chanson, tel le rouge-gorge au creux du buisson. Les flammes bourdonnent : hou ! hou ! hou !... Le beurre en riant dit : chi ! chi ! chi !... Le foyer ranimé par ces voix des choses fidèles, est redevenu le centre de la maison. Ici plane la bénédiction de l’être humain qui va pouvoir assouvir la faim que le Bon Dieu a fait naître dans ses entrailles. Tout à coup, une grande flamme paraît dans l’âtre, filant d’un saut jusque dans la cheminée. Fouh !... Et une odeur pénétrante et fine, la savoureuse odeur du beurre qui frit, fait retrousser les narines de la bonne vieille occupée à ses légumes. « Le souper sent déjà bien bon, dit-elle. Ah ! je vais me régaler. » Ravalant sa salive, elle extrait deux assiettes de l’armoire ; les établit sur la table, dispose les fourchettes, les jattes et le pot de café. Mais le parfum de beurre fondu a changé sur l’entrefaite. Et comme la mère se dirige vers le poêlon pour y jeter ses pommes à roussir, elle aperçoit une fumée bleue qui monte des cendres en nuage opaque et qui la fait éternuer. D’un mouvement rapide, elle saisit le poêlon. Il est, à sa main, d’une légèreté qui lui donne une secousse. L’approchant de ses yeux, elle voit qu’il est vide. Vide le poêlon, et sans fond. A travers le cercle de fer, le foyer apparaît comme dans une lucarne. - Ah ! couet, couet ! s’écrit Marie-Catherine. Quel tour m’as-tu là joué ?... Je te laisse mon beurre à frire, tout ce qui m’en reste pour souper, et tu ne dis pas que tu es près de tomber en morceaux. Tu me fais belle mine, et puis tu jettes mon repas au feu, méchant couet du diable ! » Le poêlon usé sent bien que sa longue fidélité ne mérite point ce reproche. Mais, son temps est passé. « Tu l’as dit tantôt, ma mère, il faut de la philosophie et ne demander, aux amis, plus qu’ils ne peuvent donner. Nous irons coucher sans souper. »
la Nuit de Printemps
PAR la fenêtre ouverte, la nuit de printemps jette des bouffées de vent tiède qui pénètrent dans la chambre avec un bruit de grands soupirs. Il semble à Pierre-André couché, qu’il en pourrait suivre les vagues qui viennent, sur le plancher, entre les meubles, dans les rayons chargés de livres, se rouler en volutes et mourir. Le vent est une vie ardente et déchaînée qui meurt tôt. Quelque puissante énergie là-haut emplit, de son désir et de son inquiétude, le ciel chargé de nuages mouvants et déchiré d’étoiles. Un dieu souffle son haleine pour agiter les ténèbres et angoisser notre cœur. La vie, en cette heure, est dense comme un trésor. Plus d’aumônes, plus d’avares pincées parcimonieusement semées autour de nous ; mais une infinie largesse, un don rapide et total. « Nuit de Printemps, flots de sève, torrents de joie et de souffrance, venez, murmure Pierre-André, et emportez-moi. » Or, à la lueur de la flamme secouée de sa lampe, Pierre-André lit une étude d’Anoutchine sur la peine de mort. Pourquoi a-t-il fallu qu’en cette minute divine, lui tombassent, sous la main, ces feuillets terribles ? C’est que son âme, d’instinct s’élance toujours au tréfonds secret de l’autre pôle, du différent, de l’opposé. Parce qu’elle est près de la mort, je la connais, elle se mettra à chanter ; et elle sortira en deuil d’un banquet. ... Le forgeron, appelé au dernier moment, vient de briser les fers qu’on avait oublié d’enlever à Jacques Stebliansky mené à la potence. L’homme détend ses jambes délivrées, regarde les autorités d’un air interrogateur, et se dirige de lui-même vers le bourreau. C’est un très terrible, très sinistre criminel, une sombre brute, ce Stebliansky. L’exécuteur à la chemise rouge, aux jambes torses, ramasse le linceul de calicot blanc qui était tombé par terre, et tout boitant, se met en marche avec le condamné, vers l’échelle de bois neuf qui se voit appuyée sur la potence en forme de grêle escarpolette. Le fruste cercueil est allongé à terre, béant. « Avant tout, il faut lui lier les mains, crie quelqu’un. - C’est juste, on ne sait jamais, » ajoute un autre. Durant l’opération, l’homme fixe le bourreau qui évite habilement son regard. Mais soudain leurs yeux se rencontrent, et Stebliansky, de sa voix enrouée, dit à la chemise rouge : « Alors, c’est toi qui vas m’étrangler, espèce de cochon ? - Pourquoi m’insultes-tu ? répond le bourreau. Est-ce moi qui te touche ? On me l’a commandé, voilà tout. - Commandé ? répète moqueusement Stebliansky, contrefaisant la voix de l’autre. Tiens, tiens ! Et combien as-tu pris pour mon âme de bandit ? Dis-le un peu ? - Finis, crie l’autre en colère, et toujours le linceul à la main. Finis ou je vais tout laisser. - Allons, mets-le-moi, coquin... Ah ! tu vas tout laisser ? » Le bourreau lui pose le capuchon de toile sur la tête. « Attends, monstre ! Donne-moi le temps de faire les adieux. Tu ne connais pas l’ordre des choses, et tu te charges de la besogne. C’est un homme qui va mourir, le comprends-tu, cochon ? Un homme qui veut dire un dernier mot aux hommes. Imbécile, tu auras bien le temps de m’étrangler. » Se tournant vers les soldats de l’escorte, Stebliansky leur dit simplement, de la même voix enrouée, mais sincère et apaisée : « Adieu, camarades. Pardonnez-moi. » Les cœurs s’ouvrent à ces pauvres paroles humaines. Les cœurs s’ouvrent au pardon et à la réconciliation. « Dieu te pardonne ! » répondent les soldats. Or, subitement, il n’est plus ni temps, ni espace, pour Pierre-André. Son âme qui souffre s’est détachée de lui et comme un manteau enlevé par la tempête, tourbillonne éperdue. Cet assassin là-bas, là-bas, il le voit gravissant l’échelle. Le bourreau a traîtreusement enlevé l’escabeau sous les pieds de l’homme, qui pend maintenant dans son linceul de calicot blanc, là-bas, là-bas, quelque part en Sibérie, il y a bien longtemps, bien longtemps. ... L’haleine de la nuit de printemps agité les cimes des arbres, secoue les rideaux, tourne dans ta chambre. Et tu respires l’haleine tendre du printemps nouveau, Pierre-André. Elle pénètre ton cœur et y voit sourdre des pleurs pour le pendu inconnu. Homme du Christ, tu souffres. Tu te remues fiévreusement sur ton matelas. Tu ne pourras plus dormir cette nuit. Ton sang qui bouillonnait d’amour, se glace de douleur pour l’assassin du bon vieux prêtre sibérien, pour la brute qui a dit au bourreau : « Cochon ! » et aux soldats : « Adieu ! camarades. Pardonnez-moi ! » Mais demain, Pierre-André ? Mais demain, y penseras-tu encore ? Et puis penseras-tu aussi à tous les pendus et à tous les morts et à tous les souffrants et à tous les malheureux ? Quoi, tu ne le pourrais ?... Pour vivre, dis-tu, tu dois secouer ces tristesses et ces horreurs de la vie ? Les tristesses et les horreurs de la vie des autres, Pierre-André ?... Va ! Tu oublieras le pendu, Pierre-André. Autant vaut donc, crois-moi, t’endormir tout de suite et ne pas perdre une heure de sommeil. Demain, tout ne reviendra-t-il pas au même ? Écoute. Dans le jardin, derrière ta fenêtre, la terre s’émeut sous les caresses du renouveau. Écoute. Comme ton cœur bat ! Goûte le sel des larmes qui coulent dans ta barbe. Tu jouis déjà de ta douleur. Tu as déjà tout oublié. Tu es bien, homme, le fruit de cette terre molle de larmes et de sang qui prépare, dans la nuit, les fleurs et les bourgeons. Stebliansky... Qui peut penser encore à toi ? « Adieu, camarades ! Pardonnez-moi ! » ... Ou bien, sors à l’instant de la couche de ton repos. Joins les mains et jette-toi à jamais au Dieu de la douleur et de l’amour.
la Fête à l’Hôpital
PIERRE-ANDRÉ s’éveille dans l’hôpital où il est arrivé, la veille, par la grosse auto du service. Avec une surprise désagréable, il avait de loin découvert, dans l’harmonieux paysage de la West-Flandre, l’éparpillement sans grâce des baraquements de bois. Parmi la vie végétale qui ruisselait, pour l’heure, des rayons cuivrés du soleil couchant, ces tristes pavillons avaient la silhouette sèche de fabriques industrielles. Debout sur le siège du véhicule, Pierre-André, du regard, cherchait la haute cheminée qui devait mettre le comble à la hideur de l’ensemble. Cependant il a passé la nuit dans un de ces abris résonnant comme une caisse. De sa couchette aux rêches couvertures de coton, il a, par la fenêtre ouverte, entendu l’aboi des chiens des fermes prochaines, le cri des orfraies et des fouines, les sonneries mesurées de l’église d’Hondschoote – la France, de l’autre côté du mur – le hourvari des fraudeurs en fuite, et le claquement des armes des douaniers. Il a goûté la douceur voluptueuse du sommeil bercé dans la vie qui veille, et à la prime clarté de sa pensée ressurgie, tout ici a pris fraîche allure et cordiale saveur. A peine vêtu, Pierre-André franchit la fenêtre à rez des champs. Dans la buée du petit matin demeuré laiteux d’un peu de nuit, il parcourt l’enclos de l’hôpital somnolent. Au pignon du pavillon principal, flottent les trois couleurs. C’est Fête nationale. Sur cette partie sacrée du sol de la patrie que jamais ne foula l’ennemi, devant la glorieuse loque qui vole au vent, Pierre-André naïvement frappe du talon et hume l’air à larges narines. Le soleil dans le ciel nacré apparaît. Aux baraques, les portes s’ouvrent. Passent en courant les infirmières à coiffe blanche, les mantes noires des religieuses. L’œuvre de pitié a recommencé. Le cœur du voyageur subitement reconnaît le triste hôpital, et compose ses traits en conséquence, comme l’amant son visage devant sa bien-aimée, pour accueillir la souffrance humaine. Tout s’anime à ses yeux qui cherchent. Au bout de la plaine gazonnée et traversée en tous sens par les passerelles de lattis, un petit homme apparaît qui déambule d’une étrange allure, à menus pas relevés et faisant sauter, sur ses épaules, une grosse tête rouge, la face rasée toute ronde. Il approche, et Pierre-André distingue un vieillard, un grand paquet de vêtements roulés dans une pièce de lustrine sous le bras. A hauteur de Pierre-André, le passant soulève sa casquette, salue jusqu’à terre en pliant tout le buste et s’écrie d’une voix claire, heureuse de la rencontre : « Bonjour, bonjour, Monsieur ! Quelle belle journée ! Quelle belle journée ! Bonjour, Monsieur ! » Il passe courant et sautillant, les yeux brillants, la bouche large et Pierre-André intrigué lui emboîte le pas. Comme on approche du baraquement des enfants, une porte s’entr’ouvre, et un petiot se glissant à quatre pattes par l’entrebâillement, descend la marche de bois, dégringole, se relève sur la passerelle en agitant les bras. Il a reconnu le vieillard. « Papatche ! Papatche ! » Le vieux de loin agite sa casquette : « Oui, oui, j’arrive, j’arrive ! » Un à un les enfants du pavillon ont formé un groupe bariolé devant la porte. « Papatche ! Papatche ! - Ah ! ah ! C’est la fête aujourd’hui, mes amis ! Le drapeau est pendu au pavillon du docteur. Vous irez voir tout à l’heure, comme il est beau ! C’est la fête et voici pour vous. » De la poche de son veston, il extrait des morceaux de sucre blanc qu’il dépose un à un soigneusement, comme s’il voulait les y enfoncer, dans les paumes tendues. Il y en a pour tout le monde, et deux cubes pour les plus petits. C’est le délire. Les jambes tordues, les hanches ankylosées, les torses emprisonnés dans les appareils de plâtre s’agitent, oubliant la douleur sous le bon sourire du grand-père, tandis qu’à petits pas, faisant tressauter ses épaules, celui-ci court aux plus éloignés, aux timides qui se cachent, la face tournée contre les planches. ... Regarde, Pierre-André, le vieux tailleur de Hondschoote à la grosse tête ronde, étincelante de plaisir comme un soleil bien ciré. Il vient à pied, de l’autre côté de la frontière. Il s’est levé comme l’Angelus de l’aube sonnait ses neuf coups : « Petits hommes de Dieu, levez-vous de vos lits pour la journées des bons cœurs ! » Il s’est levé et a fait sa barbe au carré de glace de sa fenêtre donnant sur la place. Dans l’armoire, il a pris le sucre qu’il avait économisé durant la semaine, et s’est gaillardement mis en route pour être ici au réveil des enfants de l’hôpital. Regarde bien, dans les yeux du vieux tailleur, brille la jeunesse de tous les enfants du monde. Mais une dernière fillette sort du pavillon. N’aura-t-elle pas reçu sa part de friandise ? Papatche l’a vue ; il revient sur ses pas. « Liske, vite, ma petite ! Il y a du bonbon pour vous. » Le teint pâle, les yeux du gris-bleu des violettes fanées, elle semble un lambeau de l’âme de la patrie encore hésitante à vivre. Mais déjà, par la coquetterie, elle est femme. Sur son front, un nœud de tissu d’un jaune éclatant réunit une mèche de ses cheveux couleur de chanvre un peu verdâtre. D’un doigt délicat, elle écarte le bout du ruban et elle tend ses regards au plus haut pour le voir flotter. C’est un cadeau que lui a fait une malade de la grande salle : trente centimètres de gaze iodoformée, à l’occasion de la fête nationale.
la Cloche et l’Alouette
AU petit jour, Pierre-André s’éveille dans la chambre aux murs chaulés où le vent du matin déferle ses flots d’air froid. Le murmure des feuilles du jardin compose une sorte de tapis sur lequel sa conscience, tombée du monde des rêves, et encore meurtrie de sa chute, traîne paresseusement les pas avant de s’élancer sur les gros chevaux de trait de la journée. Montaigne enfant était, chaque jour, tendrement éveillé par son père à la musique des flûtes. Pierre-André, avant même d’ouvrir les yeux, se sent porté à deux bras, sur les ondes sonores. Ce sont les bruits qui forcent d’abord, à son réveil, la maison fermée de son âme. Dans la vallée, la cloche de la petite église sonne l’heure. Le bronze, en une coulée de vibrations, tombe du clocher, se gonfle en vagues hautes comme des collines qui se poursuivent dans le ciel, s’écroulent dans la chambre en secouant l’homme dans son lit. Pierre-André n’est pas un corps mort. Ce n’est pas seulement sa chair qui tremble au brimballement des cloches ; sa pensée, sous chaque coup, bondit dans la tour du clocher. Du métal qu’on martelle là haut, au cœur qui bat ici, sa pensée va, vient, emportée par les forces en mouvement à travers le ciel. Sur ces arches retentissantes, c’est une unique matière qui s’ébranle dans l’espace. L’objet qui sonne et l’homme qui entend, ne sont qu’une chose. Pierre-André participe de la cloche dans le ciel ; la cloche est vivante du sang de Pierre-André. Encore n’est-ce rien de dire que Pierre-André entend la cloche. Sous chaque coup du battant, Pierre-André pénètre la cloche plus avant et, plus intimement avec elle, ne fait qu’un. Avec une avidité développée à mesure qu’elle est satisfaite, l’ouïe bandée de l’homme travaille à recueillir jusqu’à la moindre vibration de ces bruits qui déferlent. Cœur aux écoutes, où trouver le repos ? Cœur qui tends l’oreille, cœur possédé de toute chose, comment te posséder toi-même ? Dans le vacarme de la nature, le sage bouche ses oreilles ; mais Pierre-André n’est pas sage. Par une après-midi grise de printemps boudeur, il muse au hasard dans la ville. Tout à coup, au-dessus de sa tête, prélude un chant d’oiseau. Une petite voix douce d’abord jette quelques notes brèves et se tait ; puis subitement reprend plus forte, se hausse bégayante et précipitée, monte, monte encore, monte éperdûment et se met à planer. Là-haut, dans la splendeur du bleu, c’est un roucoulement, un gloussement, un gémissement immense qui tire le cœur de l’homme. C’est un tournoiement de vie toute nue, l’âme à vif dans la joie ; un élancement dans le bien-être, la réussite totale et définitive ; un chant de triomphe, une ode de reconnaissance ravie. Dans l’espace libre, sans obstacle et sans poids, l’homme a rejoint l’âme de l’oiseau. Il écoute en extase et ses genoux ploient. Derrière ses paupières closes, ses yeux brûlent. Lentement en zigzags à angles sonores, il entend maintenant les ailes redescendre du ciel... Le chant se replie ; c’est comme si Dieu, dans sa main, avait repris l’infini de la lumière. Une dernière note tombe encore. Le silence, comme un vide douloureux, se rétablit. Un suprême gémissement. La plainte du poète qui dépose sa plume. Et le bruit assourdissant de la ville reprend aux oreilles de Pierre-André, car il se trouve en réalité dans une sombre venelle qui descend de la rue Haute vers la place du Jeu-de-Balle. Ce qu’il vient d’entendre c’est, au fond noir de la boutique d’un marchand de charbon, une pauvre alouette en cage. La bestiole du soleil, le joyau des terres de blé piétinant sa motte de gazon sous le toit qui garnit sa prison de fils de fer, a brûlé comme une flamme devant ses yeux. La pelote de plumes grises a, durant une minute, pour Pierre-André, éclairci le jour, rejeté au large le pavois des nuées. « Laisse-toi aller, Pierre-André. N’aie point de honte de ton geste dans la ruelle des pauvres gens. Soulève ton chapeau et bénis l’alouette. C’est un peu de ton âme resté dans le bleu. »
le Trou dans le Ciel
POUR sauver, dans son jardin, le néflier qui s’étiole, Pierre-André a décidé d’abattre le vieux poirier dont les frondaisons tiennent [toute] une pelouse dans l’ombre. « J’en ai assez de ses fruits durs comme des balles et sans goût. Et quel tronc ? Pourri, chancreux, tordu comme une crossette de sorcière. Sans compter que ses racines doivent épuiser un are de bonne terre, pour le moins. » Ainsi Pierre-André sentant qu’il va faire un mauvais coup, s’excite contre sa victime. Quand on veut noyer son chien... D’ailleurs, l’affaire est décidée, voici l’homme à la hache. Il jette sur l’herbe sa veste de velours et avec une agilité inattendue, grimpe des pieds et des mains au sommet de l’arbre. Là-haut, l’outil fait bientôt voler en pluie les éclats de bois étincelants. La branche frappée craque, se détache, dégringole. La voilà qui pend au bout d’une autre, s’y balance un instant et achève sa chute sur le sol. Alors l’homme aux larges semelles descend d’un étage. L’arbre dépouillé prend peu à peu un air étrange. Est-ce que le bûcheron voudrait se moquer ? On avait bien décidé d’abattre le poirier, mais non de le rendre ridicule ? Ce tronc verdâtre plaqué de grandes plaies se tient, au milieu de ses branches emmêlées à terre, comme un miséreux qu’on aurait dénudé par malice. « Et maintenant je vais le faire crouler par ici ! » déclare catégoriquement l’homme à la hache. Il n’y a rien à répondre. Pierre-André, quelques minutes avant, aurait pu lui donner l’ordre de cesser, de s’en aller. Mais à présent l’arbre n’est plus qu’un cadavre, une dépouille compromettante dont il faut se débarrasser à tout prix et au plus tôt. « Faites donc ! » crie Pierre-André, furieux de se sentir, à part lui, lié au meurtrier. Au sommet du tronc est nouée une corde qui doit servir à tirer le mort en terre, tandis que l’homme frappe la victime au pied. Les coups portés à tour de bras sonnent, mats, douloureux. L’oreille sent qu’une matière vivante saigne sous le fil de l’arme acharnée. Déjà une échancrure entame le fût en quartier et la blessure fait mal à voir. Au plus vite, qu’on l’achève ! Arc-bouté, Pierre-André tire à la corde, et la cime secouée marque sur le ciel des anneaux de plus en plus larges. « Ça y est-il ? » Mais non, il ne tombe point. Les hommes pestent. « A-t-il la vie dure ! Ah ! une dernière racine ! Cette fois, ça y est. Mais après celle-ci, c’est une autre griffe qui empêche le fantôme de crouler. - Ah ! le bougre ! A-t-on idée de résister ainsi ? » Les fronts ruissellent ; les têtes fument dans l’air froid, quand la mère Pierre-André, docile au rite du travail masculin, paraît au bout du sentier, le pot d’étain à la main, deux verres sur un plateau. Humant la bière mousseuse : « Regarde, dit Pierre-André. Il ne tient quasiment plus. Dans un instant, tu vas le voir s’étaler. Ah ! l’entêté, ce n’est pas trop tôt ! Tu ne te figures pas comme ç’a la vie dure, un arbre. Mais cette fois... » Pierre-André, attelé à la corde, fait craquer le bois sinistrement. « Laisse-moi partir, mon « fi ! » crie plaintivement la vieille femme. Je ne veux pas voir cela. Ah ! pauvre poirier, pauvre vieux ! » Et elle fuit à petits pas incertains, comme un dernier déchirement monte, crie, éclate ; un bruit qui arrache quelque chose dans le ventre. La masse, à travers la pelouse, avec une lenteur étrange, vient s’abattre. C’est fini, on a tué un arbre. Dans le ciel où naguère chantait un monde de feuilles murmurantes, il y a un grand trou vide. Rêveries
AU matin d’hiver, il fait nuit encore, et déjà le petit oiseau, au creux du houx vert, crie son chant pénétrant comme la bise. Chaque hiver, au même coin, un nouvel oiseau.
*
* * Mon tabac est trop fort. Le bout de ma pipe me brûle la langue. Je veux pourtant, autour de moi, une fumée plus épaisse encore. Ne plus y voir, et que ma tête là dedans tourne, s’éparpille, laissant à nu mon âme bien serrée sur elle-même, dure comme un noyau, lisse comme un œil.
*
* * Au déjeuner, sur la nappe rouge, j’ai battu l’œuf d’or dans le bol de faïence à fleurs bleues, et toute la chambre s’est mise à rire.
*
* * Je suis monté au fruitier sous les toits, voir les pommes que j’avais cueillies en octobre. En tas, glacées, je ne retrouve plus les petits visages aux joues rouges qui me souriaient entre les feuilles vertes.
*
* * La neige a fondu aux branches des arbres. Au sommet du rosier, une fleur apparaît à demi-épanouie et tremblante. Il est bien tard, petite rose, pour te montrer.
*
* * Sur la nappe blanche, se prélasse le beau fruit d’or. Sait-il que je vais le manger ?
*
* * A la même place, c’est toujours le même livre que je trouve sur la planche ; et qui s’ouvre à la même page. Je voudrais lire un livre nouveau. Dans la chambre de mes hôtes, j’ai entrebâillé indiscrètement l’armoire aux vitres aveuglées de rideaux de serge verte. Des rangées de bouquins reliés en veau me sont apparues, et j’ai senti un souffle de mauvaise haleine.
*
* * Cher et savant ami, bonsoir. Que ces belles musiques qui m’ont ravi au ciel bercent ton sommeil. Que ton âme pelotonnée dans ta poitrine murmure, en ton rêve, sa plus tendre chanson. Moi, je voudrais rêver que je suis, au village, le petit paysan en sabots qui glissait l’hiver dans la neige, de haut en bas du préau de l’église.
*
* * Le balancier de l’horloge tique-taque dans le coin de la chambre chaude. Au rythme de mon cœur, parfois l’heure bondit, s’élance. « Doucement, doucement, te dis-je ! Tu vas trop vite. Et que ferons-nous, une fois arrivés ?
*
* * Dans le miroir au tain piqué, j’ai vu mon visage. Suis-je si pâle ? Et tant de cheveux gris ? Cependant il me semble cacher sous celle-ci une jeune et fraîche figure.
*
* * Sous les lumières du bal, les danseurs vont, viennent, se poursuivent. Ils jouent sournoisement sur le parquet, une partie d’échecs bien embrouillée. Il n’y a que les musiciens qui avouent leur jeu.
*
* * Il a neigé cette nuit. Ouvrant ma fenêtre au large, je vois, sur la terre, à perte de vue, la feuille blanche immaculée du temps. Je voudrais recommencer ma vie et faire ma nouvelle copie d’une fine plume anglaise, d’une écriture à pleins et déliés bien marqués, avec beaucoup d’espace entre les lignes, et de grandes marges : « Que sert à l’homme de conquérir le monde, s’il perd son âme ? Écrit à Fontaine-l’Évêque, à l’école communale du Trieu des Bois, le 24 juin 1876. »
*
* * Un pesant chariot roulant dans la rue m’a réveillé. Sur une planche, le verre de Venise tinte une seconde en tremblant, et je rentre dans mon sommeil par la fine fente de cette musique qui meurt.
*
* * L’eau frémit dans la bouilloire. Elle chante longuement une triste complainte du temps passé. Veux-tu porter mon cœur, il est fatigué ?
le Fumier
PIERRE-ANDRÉ a reçu, d’un ami mégissier, une pleine charrette de déchets de peaux pour fumer son jardin. « La denrée est arrivée, lui dit sa mère, ce soir. Les hommes l’ont déchargée dans le coin sous les sorbiers. C’est si blanc et si léger ! Crois-tu que cela puisse servir ? » Joyeux de la nouvelle, Pierre-André qui, de sa vie, n’a encore reçu un cadeau de l’espèce, veut aller y voir. Il allume la lanterne à l’huile et sous la pluie de cette tiède nuit de janvier, il court à travers les pelouses. « Mais c’est que ça sent ! Humph ! Ma parole, ça pue ! C’en est ! » s’écrie l’homme de loin, humant la forte odeur de vie pourrissante. Il y en a un haut tas. Le mégissier s’est montré généreux, et Pierre-André plonge la main dans cette masse de râclures spongieuse, légère et douce comme un gant. « Si cela peut servir ? Mais c’est du consommé, de l’ox-tail pour les plantes ! Quelle aubaine, ô mes plates-bandes ! » Le lendemain à l’aube, il commence la distribution. Il y en aura pour tout le monde. Encore dans le sommeil hivernal, toutes les plantes en ont besoin dès avant leur réveil : les rosiers comme le pommier, la vigne comme la glycine. Ces bouches fermées dans la terre glacée, aspireront avec délices la force vivante de la bonne nourriture, quand l’heure sera venue, l’heure qui ne diffère jamais, fixée suivant le rythme éternel. Voilà les tiges nues, ruisselantes d’eau, des arbres ; les grêles baguettes des buissons effeuillés ; les serpents roidis des plantes grimpantes, collés au mur. Pas une pointe de verdure pour y témoigner d’un reste de vie vaillante. A terre, le fumier ; et dans le cœur d’un homme, la forte assurance en la loi de l’univers, l’espoir enivrant du grand refleurissement. A l’œuvre ! Pierre-André, de sa bêche, au pied de chaque plante, creuse une fosse. A deux mains, il jette la pitance à même les entrailles du terreau, la tasse et en rajoute. Une rose fleurira ce rosier, de son cœur rose, le bord de ses grands pétales blancs comme des lèvres qui pâment. Mange, gorge-toi, Madame Sancy de Parabère ! Au peuple des végélias, des berbéris, maintenant ! A genoux, l’homme les sert, comme valet en gants blancs jamais ne servit l’invité sis à la droite de la belle maîtresse aux épaules nues, à la table luxueuse. « Pierre-André, dit la Dame gracieuse, prenez avec moi un verre de Gruaud-Larose et faites m’en vite une belle histoire. Contez, dit l’hôtesse au profil de marquise futée. - Au pommier de court-pendus, une pleine manotte, mon vieux. C’est une friandise que je t’offre là, pour te ragaillardir ; pour que les belles dents de mes amis croquent tes fruits à l’automne, ô valeureux ! » Et l’homme inclut le trésor. Au creux de la terre noire apparaissent les fines radicelles, les millions de lèvres invisibles par où s’exécute le prodige de la transmutation. « Regarde, Pierre-André. Tu ne vois rien ? Et moi, je te dis que de ce rien invisible éclora la merveille de la fleur, le prodige du fruit. Plonges-y les mains, verse et brasse la pâte de la vie infinie ; pétris, arrose, féconde. Heureux homme, la sueur qui perle à ton front donnera, aux cerises du Petit Verger, le goût d’une conquête. - Pierre-André, ils ont oublié le paradis qui est à leurs pieds, le paradis qu’ils peuvent battre de leurs mains, arroser de leur vie, et ils meurent de sécheresse pour avoir choisi de vivre trop haut. Demeure en bas, Pierre-André. Il y a encore les fraisiers qui n’ont point reçu leur part. Et tu sais que ta mère, ses lunettes sur le nez, cueille encore la fraise aux beaux jours, à genoux dans l’herbe, comme la petite fille d’il y a soixante-dix ans, du bois de Samrée. - Tu en mets trop ! Crois-tu donc, par ton incontinence, avancer l’heure ? Un bon jardinier est réglé comme les astres. » Mais Pierre-André n’est qu’un mortel. Harassé, heureux, la tâche terminée, il se laisse aller sur la terre mouillée. Couvert de boue, saturé du fumet de l’engrais, il gît, comme si, de son corps immobilisé, devaient sourdre aussi les merveilles végétales. « Allons, se dit-il, lève-toi, mon vieux. Au fait, ta chair n’est pas à point pour les nourrir, et les plantes sont plus délicates que les bêtes ; elles ne mangent que du froid. Attends, tu y viendras ; elles t’auront, Pierre-André. La terre n’a-t-elle pas déjà recouvert le plus pur de ton cœur, là-bas, au village ? » Lève-toi. Un jour, tu te coucheras ainsi à nouveau de tout ton long. Tu n’en as point peur ? Tant de fois tu fus toutes les choses du monde ensemble, que ton sang a gardé le parfum et comme le regret de l’univers entier ? » A cette heure, prends ton bain et rentre dans la société de tes amis. Laisse dormir le Petit Verger tassé dans sa paix, comme un feu d’artifice qui n’attend que l’étincelle. » Vienne bientôt le soleil ! Que la terre s’ouvre, que le salut y fructifie et qu’il en sorte à la fois la Délivrance ! »
le Hareng
AH ! certes ! raconte Pierre-André rentrant d’un voyage au-delà des monts, j’ai revu les grands musées avec l’émotion qui convient, et docilement suivi le mot d’ordre. En ai-je poussé des cris d’admiration dans ces galeries sans fin, au long de kilomètres de Visitations, d’Annonciations, de Crucifixions et d’Assomptions ! » Si l’on ne savait qui commandait et qui payait ces toiles, on se ferait une idée bien glorieuse du zèle religieux des artistes du temps passé. En réalité, il n’y a pas un peuple de fond plus païen que ce mélange de mille races qui occupe l’Italie depuis des siècles. Pas un peuple de caractère plus rude, sous son masque de politesse. » Alors, au bout de quelques semaines de commerce avec ces Madones, ces Christs, le commun des saints et des saintes, je me sentais parfois le cœur malade. Dans ces somptueux palais regorgeant de chefs-d’œuvre, j’éprouvais une fringale d’art plus humble, une soif de choses plus simplement humaines. » Tournant le dos aux murailles couvertes de nudités héroïques et divines, il m’arrivait de rester accoudé à quelque baie donnant sur une petite cour verte d’humidité, puante de marmaille et de détritus, où glougloutait une fontaine. » Combien me parut belle la grenade mûre que je tenais en main, dans cette lugubre chapelle Sixtine, où les plus hauts esprits on fait leurs dévotions ! » Enfin, m’en revenant au pays à petites journées, j’avise dans un dernier musée, un tableautin de Van Aelst, une nature morte : un hareng et des raisins. » Qui n’a vu cent fois cette peinture ou son équivalent ? Un plat d’étain gris bleu, avec un bord qui reluit. Un poisson coupé en trois morceaux, une chair de nacre sous des écailles d’argent avec la tache rouge des ouïes. La laitance jaunâtre, grasse, redondante. Un verre à haut pied où la fenêtre de la chambre reflète la croix de ses meneaux. Une grappe de raisins violets sous leur poudre fine comme une buée. » Mais la netteté franche et naïve de tout cela ! La perfection heureuse de se montrer et de s’applaudir elle-même ! » Il me semble sentir l’odeur des quais d’Ostende. Mon âme se gonfle, comme des poumons à l’air vif et salubre de la mer du Nord. Je sens, sur mes lèvres, le goût de sel que le vent jette quand, venant du large, il pousse vers la Flandre l’escadre de ses ronds et puissants nuages. » Bien plus que le ciel d’azur sans tache, c’est la brume violette à l’horizon, c’est la bousculade des nuées qu’il me faut, à moi, l’homme du Nord. C’est l’art flamand qui réjouit le plus sincèrement mon âme quand trop de beauté et trop haute l’a étonnée comme je ne voyage que pour savourer la joie du retour et rentrer dans la vérité natale de ma petite maison. » Après Michel-Ange, les montagnes de chair héroïque, les lieues de divinités majestueuses, ah, le hareng sur son plat d’étain ! »
la Rose d’Hiver
PIERRE-ANDRÉ, va donc voir au fond du jardin. Il y a une rose éclose, figure-toi. - Une rose, ma mère ? Une rose, par ce jour d’hiver ? Tu n’entends donc pas, sous tes sabots, sonner la terre durcie par la gelée ? De la cime du noyer, le merle lance son cri d’abandon. Tu te seras trompée, ma mère. - Oui-dà ? - Tu auras pris pour une fleur quelque feuille fanée, blanchie de givre, crispée par le gel. - Oui-dà ? Alors je ne saurais plus distinguer une rose fraîche ouverte, une belle petite rose du bon Dieu, qui vient de naître, d’un reste de fumier de la saison passée ? Mais rien qu’au battement de cœur qui m’a pris, j’ai reconnu la fleur de cette nuit. Et tu ne veux pas apprendre à ta mère ce que c’est qu’une Gloire de Dijon, je suppose ? » Cependant Pierre-André qui n’a pensé qu’à taquiner la bonne femme un petit, a chaussé ses galoches et court au fond du courtil. Il est vrai. Proche le vieux noyer, du plus loin, l’homme aperçoit, guindé en haut de la verte branche barbelée d’épines, un mignon visage qui lui sourit, lui fait signe et l’appelle. A cette vue, tout le ciel cotonneux, serré comme un capuce sur la terre, pour lui se relève, et il sent son cœur libéré bondir comme de dessous une pierre. « Mais, mais... Que fais-tu là, par un temps si sévère, gentille créature ? - Je ne sais pas. Personne ne m’a rien dit. Je suis sortie de ma prison, poussée irrésistiblement à la lumière, par une force terrible et délicieuse. Ah ! je suis bien heureuse ! Dans cette joie éclatante que je respire et qui me pénètre, je sens mon cœur... Approche donc, Pierre-André, il se fond d’amour... Tu ne me cueilles pas, dis ? » Mais Pierre-André éprouve un étrange scrupule. Une réserve inattendue le tient immobile devant la fleur qui s’offre. « Blanche rose, je ne suis qu’un jardinier, dit-il. Excuse ma simplicité. Je ressens devant toi une émotion mêlée de tendresse et d’émerveillement. Ta chair délicate exhale un peu de cette âme que tes sœurs, il y a quelques mois, répandaient à flots dans ce coin de jardin, comme une traînée d’amour. Tu es si belle, si pâle ; belle à mériter de t’écraser mollement sur le sein de femme le plus parfait. Cependant, pardonne-moi de ne point porter sur toi une main qui te blesserait. Demeure sur ta tige tremblante, petite rose. Ta grâce, ton sourire même m’attristent autant qu’ils m’émerveillent. C’est que je ne t’attendais pas. Et le bonheur aussi, l’homme ne le veut goûter qu’à son heure... - Eh bien, ma foi, n’était-ce pas là une jolie rose ? Quoi ? Tu ne l’as point trouvée ? Tu ne l’as point cueillie ? - Non, ma mère. Ce n’est pas le temps de couper les roses quand la terre est gelée. - Voyez donc le « béart », monsieur le difficile ! Attends, on t’en servira encore des roses au milieu de l’hiver. Nous verrons plus tard ! - Peut-être. Mais pas aujourd’hui. » C’est ainsi qu’il y eut, au fond du jardin, une petite rose qui se flétrit et se fana sans être cueillie, pour être venue trop tard, ou trop tôt.
le Patron du Village
POUR Pierre-André, saint Christophe est un ami d’enfance. Sa fruste image taillée au-dessus du portail de l’église d’en bas, au village, domine dans sa niche le préau verdoyant où gamin, il cherchait les os des morts du vieux cimetière sous les pavés déchaussés. Devant, se tortille la rue de Binche, aux maisons de travers, cahin-caha. Sous les yeux du saint, Joachim Siska a battu ses coquemards tant d’années et le fermier Loiseau a tant de fois ramené ses vaches de la pâture ! Christophe a vu combien des amis de Pierre-André en leur temps, s’en revenir du baptême en costume de reps blanc, sur les bras de la sage-femme Frasie, à travers les batailles des gamins lancés à la poursuite des liards rouges ? Et combien de caisses portant en terre, au son des cloches, de chers yeux fermés ? Et maintenant qui veut savoir l’histoire de saint Christophe, comme M. Leclerc, le vieux sacristain, la disait tout en tirant d’une main la cloche du Salut et de l’autre se bourrant le nez de tabac qu’il prenait à même la poche de son gilet ? Christophe était un Chananéen d’énorme stature. Il avait douze coudées de haut et un visage effrayant. Un jour, il se mit en tête de quitter le chef qu’il servait pour chercher le plus puissant prince du monde. Accueilli à la cour prochaine pour sa belle taille, il vit le roi qui se signait, une fois que, devant lui, on parlait du diable. Comme il demandait l’explication de ce geste, le roi lui répondit : « C’est de peur que le diable ne me nuise. - Ah ! repartit Christophe, le diable est donc plus fort que toi ? Tu n’es donc point le prince le plus puissant du monde ? Adieu ! » Il va plus loin et au milieu d’un bois, rencontre un homme à la tête d’une troupe de bandits à la mine féroce, qui lui demande ce qu’il faisait dans ces parages. « Moi ? répond Christophe tout à son aise, je cherche le diable. On m’a dit qu’il était le prince le plus puissant du monde. - Suis-moi donc, car je suis celui-là même que tu cherchais, » lui dit le chef. La bande se mit en marche, mais au prochain carrefour, Christophe voit le capitaine et ses hommes se détourner tout à coup et presser le pas d’un air épouvanté. - Eh diable ? demande Christophe. Qu’est-ce donc qui te fait si peur et pourquoi t’enfuis-tu ? Le diable montre une croix de bois érigée au bord de la route : « C’est ce laid homme, Christ, que tu vois là pendu et dont je ne peux supporter la vue sans trembler. - Quoi ? répond le géant à Satan. Tu te prétends le prince le plus puissant du monde et tu crains un homme cloué à une poutre ? Adieu ! C’est Christ plus fort que toi, que je veux désormais servir. Où le trouverai-je ? » Mais le diable et sa séquelle avaient disparu. Le géant chercha longtemps qui pouvait le renseigner. Un jour au bord d’un fleuve, il rencontra un ermite qui lui dit : « Construis-toi, ici même, une cabane et tu porteras sur tes épaules les voyageurs qui désirent passer l’eau. Ainsi tu serviras le Christ, et peut-être te sera-t-il donné de voir ton Maître. » Un grand nombre d’années s’écoulèrent. Un tronc d’arbre à la main en guise de bâton, Christophe transportait, d’une rive à l’autre, ceux qui voulaient traverser le fleuve. Une nuit qu’il dormait dans sa cabane, le géant entendit une petite voix qui l’appelait : « Christophe ! » Le passeur se jeta à bas de sa couche et ouvrit sa porte. Un tout petit enfant était là dans la nuit. Il le plaça sur ses épaules, et son gros bâton à la main, entra dans le fleuve. Or, si mignon qu’était le voyageur, à chaque pas, le passeur sentait son fardeau s’alourdir. Il enfonçait et croyait se noyer. Enfin, après de terribles efforts, il atteignit à l’autre rive. « Ah ! s’écria-t-il, déposant l’enfant à terre, que tu m’as paru lourd à porter, petit enfant ! Le monde entier n’aurait pas plus pesé sur mes épaules. - Ne t’étonne pas, Christophe, repartit le chétif pèlerin. Non seulement tu viens, sur ton dos, de porter le monde, mais aussi celui qui l’a créé. Connais-moi enfin, mon bon serviteur ! Je suis le Christ que tu sers depuis tant d’années de ton triste métier. Plante ton bâton auprès de ta cabane. En signe de ma parole, demain, tu le verras reverdi, couvert de fleurs et de fruits. » L’enfant disparut, et le bon géant ayant fiché le tronc d’arbre en terre, il le trouva, au matin, devenu un beau palmier chargé de dattes. Ainsi parlait le sacristain du village, à la blouse luisante de la cire des cierges, tandis qu’avec ses compagnons, Pierre-André l’écoutait, persuadé de sa véracité et contemplant le grand saint représenté dans la pierre au moment de sombrer sous sa charge divine. « Vieil homme, ou à peu près, ajoutait Pierre-André, j’en demeure tout aussi certain. Ce n’est en trop vive lumière, près des puissants ; ni dans les ténèbres de la force cruelle, que l’homme atteint la paix du cœur. C’est sa bêche à la main, ou son marteau, qu’il trouve le chemin du bonheur. » Heureux qui, sur la route difficile, ayant déjà longtemps marché, en s’approchant de la vieillesse retrouve quelque douce image du temps de son enfance ! Il continue son voyage avec plus de confiance. Entre celui qui le précède et celui qui le suit, il est resté fidèle à lui-même. » A ses reins fatigués, c’est la boucle demeurée brillante qui scelle les bouts de la ceinture ». Sous le Noyer
AU-DESSUS de Pierre-André, les pigeons bleus avaient roucoulé quelque temps leur plainte ardente. Tout à coup, perdant pied dans ses pensées croulantes comme le sable des dunes, il avait sombré au fond du sommeil. Et il dormait au bout du verger, étendu sur la pelouse, à l’ombre mouchetée du noyer à petites noix. Enfin sortant du néant qui n’a ni goût, ni bruit, ni odeur, avec la facilité de la grenouille fuselée qui se hisse à la surface de l’eau, il se sentit dominer le résidu fragile qu’était devenu sa vie et entrer triomphalement dans le monde d’à côté. Il rêvait. Il avait perdu sa forme individuelle, mais autour de lui, tel un homme introduit dans une chambre de glaces, il apercevait, de sa personne, des reflets sans nombre. Parmi ces images, quelques-unes lui paraissaient plus proches et plus nettes. Il distingua qu’elles étaient différentes les unes des autres par certains détails, quoique concordantes par une parfaite similitude des gestes simultanés, et il voyait parfois l’une d’elles se couler dans la forme d’une autre, comme une découpure de puzzle dans son entaille. Et ces figures le dévisageaient, puis longuement se regardaient entre elles de la façon naïve et timorée de personnes qui se préparent à faire quelque chose, mais ne savent par où commencer. Souriant à leur sourire, Pierre-André leur dit enfin : « Je vous comprends. Vous êtes mes enfants sortis de moi, et je suis le vôtre sorti de vous... C’est pourtant bien simple ! » Les visages ouverts acquiescèrent de l’air doux de tournesols épanouis. « Vous venez de sortir de moi, il y a un instant, comme chacun en votre temps, vous étiez sortis l’un de l’autre, et comme j’étais sorti du dernier de vous. » Maintenant les faces rayonnaient et comme des lampes baignaient Pierre-André d’une sorte d’émanation huileuse et nourrissante. « Vous êtes le troupeau et moi le bercail avec le toit et la paille, et aussi le berger avec sa foi dans l’heure du jour. » Ensemble les figures firent signe que oui. « Et pour manifester votre présence en moi, continua Pierre-André, vous avez attendu le jour où parmi tant de choses de la vie que j’avais longtemps refusées, j’aurais accepté la souffrance. » Quelque chose d’indéfinissable s’émut alors en chacune de ces ombres si bien qu’apparut subitement, en toutes, le même front bombé, le même nez busqué, enfin les mêmes yeux bleus, fixes, dévorants. Déjà même Pierre-André distinguait dans leur contenance, dans leurs attitudes, tels indices qui allaient, il en avait la certitude, lui permettre de séparer leur personnalité, peut-être de les reconnaître... quand elles disparurent brusquement. Et Pierre-André s’éveilla. D’abord, ouvrant les yeux, il vit la couleur du ciel comme une dentelle éclatant à travers les feuilles du noyer. Il se sentit couché sur le flanc tenant, serrée à pleins bras, une jambe fortement musclée, posée debout et revêtue d’un pantalon de coutil bleu à carrés blancs, d’où sortait un pied dans une chaussette de laine épaisse. Or ce vêtement, la forme du pied long et mince, la couleur d’un gris vineux du tricot lui étaient si intimement connus qu’il n’avait pas eu à les retrouver dans son souvenir. Il en possédait une si profonde notion que sa conscience n’avait pas eu à y apporter son appui pour les lui faire accepter. Et il y appuyait sa joue comme un enfant sur le sein de sa mère. Car c’était Lui, son père mort, assis sur ce banc sous lequel il avait dormi. A l’instant, avec défiance, avec avidité, ne pensant qu’à garder son trésor, Pierre-André se dit : « Pas un mot, pas un geste. » Et voilà que peu à peu remuèrent les orteils en lui pressant la joue. La chaussette sentait bon cette essence de wintergreen dont l’odeur si souvent s’était répandue, durant des semaines, dans la chambre du père, quand il souffrait de la goutte et que la mère l’oignait de salycilate de méthyl. En mesurant la contraction de chaque fibre de son cœur, tel un sauvage à l’affût, avec la lenteur d’une petite aiguille d’horloge, Pierre-André commença enfin à tourner la tête pour voir le revenant : il était assis sur le banc, les deux bras longuement étendus sur le dossier du siège, avec ses mains potelées aux doigts effilés, aux ongles bien taillés et d’un rose délicat, qui pendaient ; la face levée ; les regards fixés droit devant lui ; la bouche mollement fermée, pensive et souriante. De son grand front chauve au contour arrondi, de son nez recourbé, de ses joues larges et rouges, de son vaste ventre, de sa poitrine se haussant en arc d’ogive vers les épaules, ruisselait sur Pierre-André l’impression divine de la bonté et de la force qui avaient fertilisé sa vie. Quelle influence obligea le fils d’oublier sa prudence ? Pourquoi ne put-il plus longtemps garder le silence résolu ? D’une petite voix que Pierre-André n’avait encore auparavant ouï sortir de sa gorge ; d’une voix qui lui parut fraîche et nette comme une fleur-de-beurre dans l’herbe verte, il murmura en contemplant son père, et buvant son image comme un lait crémeux : « Grand Poupli... » « Les grands Pouplis » : ainsi se nommait la métairie familiale, au creux du vallon, où la haute plaine de blé du Hainaut recueille les sources qui descendent, au nord vers la Senne et à l’ouest, vers la Haine. Les peupliers devant la grand’porte, la petite chapelle de Notre-Dame dans la haie, les toits de chaume noir des étables, la cour et son fumier, les noyers autour du puits, quand son père lui parlait de son enfance là-bas parmi ses frères, Pierre-André les voyait ainsi que par un trou dans la paroi du monde, il aurait vu le Paradis. « Grand Poupli... » Le père ne baissa pas les yeux, mais le sourire s’étala plus largement sur la bouche close. Une buée nimba la tête ombragea les pommettes et la pointe du nez, estompa enfin tout le visage qui s’effaça. Son père avait disparu. Sans ressentir douleur ou regret, Pierre-André se leva du sol. Dans la pièce pavée ouvrant par la porte-fenêtre sur le jardin, sa mère, devant un petit feu où chantait l’eau pour le café de quatre heures, ravaudait ses bas. « D’où viens-tu comme cela ? lui demanda-t-elle, un poing dans le tissu, l’aiguille en l’air, et le dévisageant par-dessus son pince-nez à verres fendus. Tu as l’air si animé ? » Mais ce mot fit aussitôt sourdre à l’esprit de l’homme qu’il avait sans doute à être, devant sa mère, plus réservé qu’il n’avait cru nécessaire, au sujet du prodige sous le noyer. Il flottait en lui, mince comme un fil de vierge, une pensée qu’il aurait eu grand’honte d’exprimer clairement : « Je suis « Grand Poupli » comme mon père ; elle, pas... » « Tu as donc couru pour rentrer ? - Non, ma mère. Mais au fond du verger, sur le banc des petites noix, ma mère, Il m’est apparu. Je l’ai touché. Il paraissait bien heureux, tout brillant dans sa paix. J’ai senti, à la pression de son pied, qu’il me reconnaissait. » A mesure que Pierre-André parle, une tendresse inaccoutumée semble détendre et fondre les traits de sa mère. Ses paupières se ferment, ses mains s’allongent sur ses genoux. Or le fils sottement, s’avise de lire, sur le visage maternel, une expression de doute ou même de commisération pour sa crédulité : « Tu ne me crois pas ? reprend-il. Il était sur le banc ainsi, les deux bras ouverts, la tête nue, avec son air pensif et perçant. Je pressais sa jambe et son pied bougeait. - Mon fi, dit enfin la vieille femme, tu ne sais donc pas qu’il vient ainsi tous les jours ? » Et il semble à Pierre-André que sa mère, ouvrant sa poitrine à deux mains, pieusement, les yeux baissés, lui montre son cœur.
le Rouge-gorge
L’HORTICULTEUR avait dit à Pierre-André : « Vous creuserez une fosse arrondie d’un mètre de diamètre et d’autant de profondeur. Vous la remplirez à moitié de bonne terre. Là-dessus, vous placerez votre taxus baccata aurea marginata. Je vous réponds d’une reprise superbe. » Au petit jour, le soleil rouge encore passant ses premiers rayons au-dessus de la colline, Pierre-André a chaussé ses sabots et saisi sa bêche, sa bonne bêche au fer luisant, vaniteusement entretenue au papier de verre. A la place choisie, il a mesuré, sur le sol, un mètre juste, ni plus, ni moins. A petites entailles, il a tracé un cercle dans le gazon, avec une précision qui l’a émerveillé lui-même – voyez un peu ! – et lui a fait dire : J’aurais fait un fameux architecte aussi ! Aussi ! Car pour le moment, dans l’air vif et l’euphorie de la première tasse de café, Pierre-André s’est déjà décerné au préalable un brevet de terrassier d’élite, avec les palmes d’horticulteur de premier ordre. En vérité, le matin l’enivre. Il creuse. La couche de gazon est d’abord débitée en jolis prismes, tels des petits fours persillés de pistache. On en mangerait. Dans la terre noire, les radicelles brillent comme des brins de fil emmêlés. « Regarde, Pierre-André, chacun de ces cheveux follets a sucé, dans les ténèbres, les sucs de la terre, nuit et jour, pour que brille à la lumière sa jolie feuille d’émeraude. » Chaque brin d’herbe a sondé le mystère d’en bas et le mystère d’en haut. As-tu meilleure réponse que le végétal à l’énigme de la terre et du ciel ? - Je ne sais, murmure l’homme à la bêche. Il est vrai que je voudrais, comme Maurice de Guérin, me placer à la dernière pointe des racines. Je contemplerais l’action puissante des pores qui aspirent la vie. Je regarderais la vie passer du sein de la molécule féconde dans les pores qui, comme autant de bouches, l’éveillent et l’attirent par des appels mélodieux. Je serais témoin de l’amour ineffable avec lequel elle se précipite vers l’être qui l’invoque, et de la joie de l’être. J’assisterais à leurs embrassements. - Mais, Pierre-André, c’est la folie de l’orgueil dont tu es atteint ? Comme cela, tout simplement, tu voudrais être Dieu ? Et ivre d’amour, contempler le baiser de toutes les choses ? - Attends, Pierre-André, attends. Une expression populaire t’instruit de ce que l’avenir inéluctable t’offrira dans ce genre de connaissances. Tu y viendras, Pierre-André, quand tu suceras les pissenlits par les racines. « Alors ton âme, à chaque mois de mai, montera dans les pétales étincelants du florion d’or, et juin la dispersera. « Oh ! la follette ! La vois-tu sous la forme des aigrettes réunies en cette sphère soyeuse, transparente et si légère, que les enfants soufflent pour chercher l’heure qu’il est ? Telle la jeune dame sur les brochures Larousse, qui dit : « Je sème à tout vent ! » » Tu sèmeras pour lors à tout vent et cela ne te changera guère. » Or, il bêche, il bêche. Ayant jeté de côté cette terre noire et fine comme la suie, ce terreau que des siècles de travail ont pu seuls purifier à ce point, à présent, il tranche la glaise, la lourde glèbe marneuse des champs de blé et de betteraves ; et ses sabots s’y enfoncent et copieusement s’engluent. Une odeur fraîche et forte monte de la fosse. « Un mètre dix centimètres, s’écrie l’homme, son mètre à la main. Ma parole, je n’ai pas souvenir de plus belle fosse ! Dans la pâte compacte, quelles marques nettes et luisantes laisse mon louchet ! En me courbant déjà je peux m’y cacher tout entier. - Pierre-André, réponds donc ? » Quel est celui qui bâtit plus solidement que le maçon, le constructeur de navires et le charpentier ? Combien de temps un homme peut-il être en terre avant de... ere he rot ? demande Hamlet. - Non, non, ne réponds pas ? C’était pour rire. Le printemps qui s’annonce nous aura excités, vois-tu... Secoue tes sabots et sors de ton trou. Remonte sur la pelouse, voici la charrette portant ton if. » Vu à travers la grille de fer, l’homme a peine à reconnaître, dans cette masse informe de feuilles ligottée de paille d’avoine ; dans cette motte de racines serrée dans une bourriche, le conifère qui lui semblait avoir hier, en terre, les nobles contours d’une montagne. Le feuillage pourtant d’un si beau vert où l’or étincelle, a l’air de pleurer une prospérité ancienne. « Y a-t-il des hommes pour m’aider ici ? demande l’ouvrier jardinier campé sur le seuil. - Il y a moi, répond Pierre-André. - Mais nous ne saurions jamais à deux porter le paquet ? - C’est ce que nous allons voir, mon garçon. C’est le premier conifère que j’ai, vous savez, et je le porterais bien tout seul dans son trou, s’il le fallait. Car je l’aime. Vous ne savez pas ce que c’est que la passion, jardinier ? » Alors ensemble, à petits pas brusques, soufflant, ahanant, criant : « Par ici ! Par là ! » ils ont porté l’arbuste qui se laisse faire, apathique et lourd, tel un cadavre. C’est bien autrement pesant que la vie, la mort. Mais enfin le voilà en place, la souche au creux de la fosse, gisant à même le fin terreau remblayé. Et du coup démaillotté, redressé vers le ciel, l’if redevenu libre, redondant et moelleux, arrache un cri d’admiration à Pierre-André. « A nous deux, mon vieil if ! Désormais, nous ne nous quitterons plus. » Regarde autour de toi. Dévisage bien tes voisins, tilleuls, noyers, rosiers et cornouillers ; nous en avons ensemble pour longtemps. Me reconnaîtras-tu, au moins, quand je viendrai enfoncer ma tête dans tes rameaux ? Auras-tu, pour ma cervelle brûlante – ils disent brûlée – toujours la même fraîcheur ? » Ne dis rien, ne bouge pas. Je ne te demande que d’être ici. Vis et persiste en ta beauté muette, les pieds dans cette terre où je suis allé voir tantôt de quoi il retourne. » Quand tout s’agitera en tempête dans mon âme folle ; que tout se tourneboulera en orage dans mon cœur, n’y manque pas, au moins, sois là. Car tu m’es déjà nécessaire. En ta forme divine, ô dôme plein de lumière calme, il me semble retrouver l’harmonieuse, la silencieuse musique des rêveries de mon enfance. - Mais quoi ? Qu’est cela ? Oh ! ces petits cris, ces pépiements ? L’if qui chante ? Oh ! doux grisolement ! Est-ce le vent dans le chaume des blés ? Ou le glou-glou monte-t-il d’un ruisseau roulant sur les cailloux ? Qu’est-ce ? » Pierre-André appuyé sur sa bêche, le cœur qui bat, écoute, sondant du regard la masse de feuillage. En vérité, un oiseau chante dans l’arbre qui vient à peine de se dresser au jour ; un oiseau qui tout à coup paraît sous les branches les plus basses, trottinant sur le sol nouvellement battu. Gros comme le pouce, de couleur fauve animé de roux, la gorge délicatement carminée, il s’avance en sautillant, s’arrête, lève la tête, tourne un œil qui brille vers l’homme immobile et continue sa danse : un chant, une graine, une roulade, un vermisseau. Jusque sous les pieds de Pierre-André, le rouge-gorge va, vient, joyeux et tout à son affaire qui est de manger et de chanter. « Mon Dieu ! s’écrie l’homme, mais alors les passereaux, eux aussi, savent ? Ils connaissent, ils participent, ils ont conscience ? La splendeur chaude qui coule en moi ; mon émotion, mon désir de serrer le monde dans mes bras, l’oiselet ici, à mes pieds, en éprouve une part ? Une part que je ne puis mesurer, mais une part qui est réelle ? » Car s’il peut y avoir, entre deux êtres vivants, un rapport certain, celui-ci l’est : Je suis ami pour cet oiseau qui célèbre la paix de son cœur entre mes sabots ; un cœur grand comme un bouton de pâquerette ». Pierre-André s’est assis par terre et essuie la sueur de son front ; tandis qu’à nouveau, rentré au sein du feuillage et monté à hauteur de l’oreille de l’homme, l’oiselet reprend son ramage. « Je dis que sous cet if, le rouge-gorge et moi, nous goûtons le même bonheur. Je dis qu’en ce moment, nous jouissons l’un de l’autre. Terre, arbre, oiseau, nous ne sommes donc qu’un ?... Un ?... Mais celui-là qui me dira son nom ? » Et le rouge-gorge dans les branches grésille sa chanson menue et fraîche comme un bruit de baisers. « Nous l’appellerons Amour, » dit l’homme. |
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2007 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2006 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Sub-domains
CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -
Other Domains
https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com