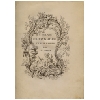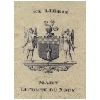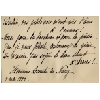Miguel de Cervantes y
Saavedra - Don Quijote de la Mancha - Ebook:
HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP
Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006
HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP
Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006
CLASSICISTRANIERI
HOME PAGE - YOUTUBE
CHANNEL
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
A. Badin : Madame Edmond Adam, Juliette Lamber (1882)
Static
Wikipedia 2008 (no
images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2007 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2006 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Sub-domains
CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -
Other Domains
https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
| BADIN,
Adolphe (1831-19.) : Madame Edmond Adam :
Juliette Lamber.- Paris :
Charavay
frères éditeurs, 4 rue Furstenberg, 1882.- 32 p.-1f.
de pl. en front.
; 13,5 cm.
Saisie du texte et relecture : O. Bogros pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (18.II.2005) Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros] obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire d'un collection particulière. Madame
Edmond Adam
Juliette Lamber par
Adolphe Badin
[Notice
extraite des Etrennes aux Dames pour l’an 1882.]
MADAME
ADAM
Un des jeunes peintres les plus
justement
célèbres de ce temps-ci, à qui
l’on disait : « Vous devriez faire le portrait de
Mme Adam », répondit : « Mme Adam ?
Jamais ! Mme Adam appartient à Bonnat ou à
Carolus Duran . »
Je serais volontiers tenté de faire comme le spirituel artiste, et de m’écrier à mon tour : « Pour esquisser cette physionomie originale et complexe, très fine et très puissante à la fois, très grande dame et en même temps très femme, il faudrait la plume d’or d’un Théophile Gautier, ou d’un Paul de Saint-Victor, ou d’un Goncourt. » A défaut de ces éminents docteurs de beauté, voici un léger croquis assez prestement troussé par le chroniqueur en titre d’un de nos grands journaux parisiens : « La première fois que je vis Mme Adam, je fus vivement frappé par sa grande beauté. Cette beauté est restée la même : l’oeil, d’un gris bleuté et plein de lumière, est aussi éclatant, la bouche aussi ferme et l’ovale aussi pur ; elle a dans les joues ces deux fossettes qui font que, quand elle rit, elle semble rire deux fois. Mince et très élancée, la taille est tellement souple que la femme semble plus grande qu’elle ne l’est en réalité. La voix est douce et métallique. Quand elle parle, le mot sonne ferme et bien timbré. Elle raconte avec un charme infini. Je ne sais pas qui lui a vendu de l’esprit, mais, à coup sûr, on ne lui a pas volé son argent ; ce sont ses auditeurs qui redoivent. A travers tout cela, une façon de se pencher en arrière et de regarder très haut qui lui sied à merveille. » Le portrait ne laisse pas d’être assez fidèle ; tout au plus a-t-il besoin d’être complété et rehaussé par quelques retouches. Ce que surtout le peintre ne semble pas avoir suffisamment mis en relief, c’est cette sorte de crânerie élégante et spirituelle particulière à son modèle, et qui est comme la marque de sa personnalité. Quand Mme Adam entre dans un salon ou dans une loge de théâtre avec cette allure rapide qui lui est familière, et qu’elle répond aux saluts empressés qui l’accueillent par un geste de la main et quelques paroles gracieuses et imagées, tous ceux qui sont là se retournent ; et, s’il en est qui ne la connaissent point, on les voit aussitôt se pencher sur leurs voisins pour demander qui elle est ; instinctivement, tout le monde sent que c’est quelqu’un. Ajoutons qu’elle a les plus bras du monde, les épaules et la taille d’une déesse de marbre, et que personne ne porte plus haut et plus loin l’art de s’habiller, ce qui n’est pas sans rendre son voisinage terriblement redoutable pour ses ennemies, - car une femme aussi en vue a toujours quelques bonnes petites ennemies. *
** Cette crânerie de bon
goût et de bonne compagnie,
que nous donnions comme l’attrait le plus piquant de la
physionomie de Mme Adam est également un des
caractères les plus frappants de son talent
littéraire.
On sait, en effet, que Mme Adam a publié sous le nom de Juliette Lamber, - son nom de jeune fille, - un nombre assez considérable d’ouvrages d’un genre élevé et délicat. C’est en 1858 qu’elle débuta, avec ses Idées anti-proudhonniennes sur l’amour, la femme et le mariage, courageuse et spirituelle réponse aux brutales théories du célèbre polémiste, bientôt suivie de brochures de circonstances, pleine de verve et d’enthousiasme juvénile : La Papauté dans la question italienne, et Garibaldi, sa vie d’après des documents inédits. Toutefois ce ne fut qu’en 1860 que Mme Juliette Lamber prit pied définitivement sur le territoire purement littéraire, avec Mon Village, tableau fidèle et original des moeurs, des préjugés, des petites passions, des joies et des larmes du village, avec une note philosophique et finement pratique qui le relève singulièrement. Le Mandarin, qui parut la même année, est un voyage humoristique à travers Paris et les idées parisiennes, rempli de fines remarques et d’aperçus originaux. Les Récits d’une paysanne, qui vinrent après, nous offrent une suite de petits poèmes rustiques, écrits par une femme qui aime la nature et la comprend. Mme Juliette Lamber, en effet, - et ce n’est pas le côté le moins piquant de cette Parisienne achevée – est une paysanne, une paysanne picarde, comme elle le rappelle volontiers. Elle est née à Verberie, dans l’arrondissement de Senlis, et elle a passée toute son enfance à Chauny, chef-lieu de canton du département de l’Aisne, où son père exerçait la profession de médecin. Vers 1862, une dangereuse affection des voies respiratoires étant venue compromettre gravement sa santé, on l’envoya passer la mauvaise saison à Cannes. Le pays lui sembla si beau, qu’elle y retourna chaque hiver et finit même par l’adopter à peu près exclusivement. Et comme, pour cet esprit à la fois prime-sautier et laborieux, l’admiration se traduisait par un besoin impérieux de confier au papier ses impressions, elle fit pour le ciel éclatant de la Provence et les flots bleus de la Méditerranée ce qu’elle avait fait naguère pour les horizons brumeux des plaines picardes. De là ces deux charmants volumes du Voyage autour du Grand-Pin et de Dans les Alpes, dont Paul de Saint-Victor a dit : « Ce qui donne un attrait tout particulier à ces deux ouvrages, c’est que l’auteur a vécu de la vie des champs, qu’il en a réfléchit la calme lumière, qu’il en exhale les parfums salubres. » L’Éducation de Laure, qui suivit, est un roman philosophique, mais un roman philosophique qui n’a rien de lourd ni de pédantesque. Saine et sauve, au contraire, est une étude de moeurs mondaines et en même temps une leçon de haute moralité, donné avec beaucoup de bonne grâce. Nous arrivons maintenant au Siège de Paris, journal d’une Parisienne, ouvrage de circonstance, dont l’accent sincère et ému, tout vibrant de patriotisme, assura le succès. Personne n’était plus désigné que l’auteur pour écrire l’histoire de ces tristes évènements, car personne n’avait été en meilleure position pour les bien voir. En effet, Mme Juliette Lamber avait épousé, quelques années auparavant, un homme politique aussi connu que respecté dans le parti républicain, M. Edmond Adam, qui devint préfet de police du gouvernement de la Défense nationale, puis député de la Seine, et mourut sénateur inamovible en juillet 1877. Ainsi placée dans les coulisses du grand drame, elle assista, témoin discret mais non point impassible, à tout ce qui fut fait, ou plutôt à tout ce qui fut tenté, et vit défiler devant elle tous les hommes qui jouèrent un rôle au gouvernement ou dans la presse, durant ces cruels jours d’épreuve. Aussi a-t-on pu dire du livre de Mme Juliette Lamber que c’était la peinture la plus originale et la plus saisissante qui ait été faite de l’héroïque et douloureux siège de Paris. Après cette excursion en dehors de la littérature pure, son véritable domaine, Mme Juliette Lamber publia les Récits du golfe Juan, recueil de nouvelles ciselées avec amour et tout imprégnées des délicieux parfums de la campagne provençale. Puis vint Jean et Pascal, roman d’une vigueur et d’une puissance incomparables, à travers les pages duquel, comme le vent dans les chênes, passe le souffle de la patrie. Dans Laide et dans Grecque, qui vinrent ensuite, Mme Juliette Lamber explora de nouveaux filons avec une merveilleuse souplesse de talent ; le premier de ces deux remarquables ouvrages est un hommage à l’amour du beau, que l’auteur possède à un haut degré ; le second est un véritable poème dramatique en prose, où les plus nobles sentiments sont exposés dans le langage le plus élevé. Le théâtre, cette mise en oeuvre des fantaisies les plus osées de l’imagination, devait attirer un esprit aussi hardi que celui de Mme Juliette Lamber : aussi saisit-elle avec empressement la première occasion qui s’offrit à elle d’aborder la scène. Sa Galathée, adaptation très savante et très réussie d’après le texte de Basiliadis, un jeune poète grec contemporain, fut jouée avec un succès retentissant au théâtre des Nations par Mounet-Sully, Paul Mounet, son frère, et Mlle Baretta. Mise en goût par l’heureuse issue de cette première introduction en France d’une littérature à peu près complètement inconnue jusqu’alors, l’auteur de Galathée écrivit ensuite toute une série d’études sur les poètes grecs contemporains, qui fut comme une révélation, non seulement chez nous, mais dans toute l’Europe. Ce volume est le dernier qu’ait publié Mme Juliette Lamber ; mais, s’il faut en croire les bruits discrets des coulisses littéraires, nous verront paraître prochainement sous la même signature une oeuvre nouvelle, d’une délicatesse et d’une originalité toutes particulières, et qui fera certainement une grande sensation. L’heure n’est donc pas encore venue d’asseoir un jugement définitif sur cet éminent écrivain, et nous devrons nous contenter, après avoir rapidement passé en revue les nombreux ouvrages sortis de sa plume, de dire quelques mots des principales qualités qui lui ont conquis un rang distingué dans notre littérature contemporaine. Mme Juliette Lamber, ainsi qu’on l’a vu, a successivement abordé les genres les plus divers, mais partout elle a porté les mêmes ressources et la même finesse d’imagination, la même sensibilité délicate et toujours simple du coeur, le même amour passionné de la nature, la même pureté, la même ardeur des élans patriotiques. Comme écrivain, personne ne possède une langue plus chaude, une plus grande justesse, une plus grande propriété de l’expression ; chez personne, nous ne voyons, en plus heureuse abondance, ces mots trouvés plutôt que cherchés qui font images et évoquent les choses devant les yeux du lecteur. Comme penseur enfin, on ne saurait trop louer chez elle la noblesse, parfois bien hardie, des sentiments et des idées, et cette manière, à la fois intrépide et gracieuse, de penser et d’écrire à la française, avec infiniment d’esprit et plus encore d’émotion. *
** Le genre élevé et
délicat, dont
l’auteur de Grecque
s’est fait une loi de ne pas
sortir, ne s’adresse qu’à un public
d’élite ; aussi pouvons-nous dire qu’en
dehors du monde littéraire, la personnalité de
Mme Adam est plus généralement connue que celle
de Juliette Lamber.
C’est en 1871, au lendemain de la guerre, que Mme Adam ouvrit son célèbre salon, dans ce somptueux appartement du boulevard Poissonnière, tout rempli de meubles anciens, de tableaux, de gravures et de bibelots précieux, qu’elle habite encore aujourd’hui. Mme Adam n’avait pas seulement les rares qualités personnelles indispensables pour jouer ce rôle difficile : un esprit incomparable, une affabilité parfaite, un charme exquis et – sa beauté ; elle possédait en outre au plus haut degré le sens rapide des choses de la politique, et un dévouement complet, absolu, aux idées de progrès. Aussi le salon du boulevard Poissonnière devint-il rapidement l’un des centres d’action les plus vivants du parti républicain. Sous le règne de l’ordre moral, il prit même l’importance d’un ardent foyer de résistance : c’est là qu’aux heures les plus critiques les esprits troublés accouraient reprendre leur équilibre, que les irrités venaient chercher du calme et les découragés du courage. Le triomphe éclatant de ses idées et de ses amis, tout en ajoutant considérablement à l’influence personnelle de Mme Adam, ne laissa pas de modifier sensiblement la composition de son salon. Un de ses principaux attraits ne tarda pas en effet à lui être enlevé par suite de la dispersion des plus éminentes personnalités du parti ou de leur absorption par les situations officielles qui retenaient les uns dans leur cabinet ministériel, les autres dans leurs ambassades plus ou moins lointaines, les autres sur leur fauteuil présidentiel. En revanche, le monde artistique et littéraire, attiré par la réputation d’esprit de Mme Adam, par son amour bien connu pour les arts, prit peu à peu dans la maison une place prépondérante, sans distinction de parti. Certes, on trouverait difficilement à Paris et en Europe un pareil milieu, dont tous les hôtes aient un nom célèbre, ou tout au moins fort connu ; où l’on puisse coudoyer, le même soir, à côté de nombreux hommes politiques, députés, sénateurs, ministres, restés fidèles quand même à l’amie des mauvais jours, des hommes de lettres, des poètes, des auteurs dramatiques comme Tourgueneff, Dumas, Daudet, Leconte de Lisle, de Banville, de Bornier, Paul Déroulède, Jean Aicard, Henry Gréville, Ulbach, Theuriet, Claretie ; des peintres comme Bonnat, Henner, Laurens, Carolus Duran, Jules Breton, Detaille, Bastien-Lepage ; des sculpteurs comme Paul Dubois, Guillaume, Chapu, Falguière, Mercié, Millet ; des savants comme Janssen, Robin, Berthelot, Lauth, Pouchet, Dr Labbé, Trélat ; des grands industriels ou des grands financiers comme les Heine, les Arlès-Dufour, les Koechlin-Schwartz, les siegfried, les Turgan, les de Reinach, et tant d’autres que nous oublions. Et cependant, nous ne serions point surpris que quelques vieux amis de la maison ne regrettassent parfois l’ancienne intimité des fameux mercredis, où l’on pouvait pénétrer dans le grand salon rouge sans risque d’être étouffer dans l’antichambre incessamment encombrée par la foule des allants et des venants, et où l’on avait, entre onze heures et minuit, l’inappréciable bonne fortune de voir le plus illustre de nos hommes d’état sous l’aspect quelque peu inattendu du plus simple, du plus spirituel et du plus naturellement gai des mortels. *
** Mais, plus que ses travaux
littéraires, la direction de son
salon ne pouvait suffire à satisfaire
l’activité intellectuelle et morale de Mme Adam :
il lui fallut chercher un aliment à cet amour du travail,
qui est chez elle non seulement une passion, mais un besoin. Cet
aliment, elle ne tarda pas à la trouver dans la fondation
d’une grande revue politique et littéraire,
largement ouverte aux idées de progrès et de
liberté.
Certes, il fallait une rare intrépidité pour entreprendre d’élever autel contre autel, à côté, sinon en face , de la Revue des Deux Mondes, et l’on conçoit que les amis les plus dévoués de Mme Adam aient tout fait pour l’en détourner. Mais le principal caractère de cette nature essentiellement intrépide, ainsi que nous avons eu plus d’une fois l’occasion de le constater au cours de cette étude, c’est précisément de ne point s’arrêter aux difficultés, non plus qu’au côté périlleux des choses. Mme Adam ne brave pas le danger, elle le dédaigne. Là où les hommes du métier les moins timorés eussent reculés avec terreur, elle passa outre sans hésitation ; et, chose vraiment étonnante, elle réussit pleinement, absolument, du premier coup, là où les gens les plus habiles et les plus expérimentés eussent peut-être échoués piteusement. La Nouvelle Revue, dont le premier numéro parut le 1er octobre 1879, vient d’entrer dans sa troisième année, et son avenir est assuré désormais. C’est qu’indépendamment de son grand talent d’écrivain et de sa haute influence, Mme Adam semble avoir été naturellement douée pour la direction d’une pareille entreprise : non seulement elle possède un coup d’oeil d’une sûreté, d’une rapidité merveilleuses, une intelligence, une puissance d’assimilation et de pénétration véritablement extraordinaire ; mais elle a encore et par-dessus tout, l’art de manier, de gouverner les hommes, d’une main à la fois ferme et très douce. Ce que M. Buloz père obtenait avec sa brutalité légendaire, Mme Adam l’obtient avec un mot aimable, avec un sourire : et tel auteur qui sortait jadis de la Revue des Deux Mondes furieux, humilié et ne respirant que par vengeance, sort aujourd’hui de la Nouvelle Revue charmé, plein d’espoir et tout prêt à remercier, alors même que sa copie lui a été rendue. Enfin Mme Adam porte avec elle dans toutes les entreprises qu’elle tente un bonheur tout particulier qui en assure infailliblement la réussite ; pour nous servir d’une expression familière mais topique, elle a la veine, cette capricieuse divinité sans laquelle les chances les plus sérieuses de succès avortent misérablement. C’est ainsi qu’après s’être assuré, par ses hautes relations, des collaborateurs de premier ordre, parmi lesquels nous citerons seulement les noms de Littré, de Berthelot, de Flaubert, de Sacher-Masoch, d’Henry Gréville, de Ouida, de Sully-Prud’homme, d’Henry de Bornier, de Leconte de Lisle, il lui est tombe du ciel des bonnes fortunes exceptionnelles, comme cette étude anonyme sur la guerre turco-russe, dont la publication eut un si grand retentissement dans toute l’Europe ; comme les lettres inédites de Mérimée à Panizzi ; comme cette étonnante correspondance , également inédite, de George Sand sur les évènements de 1848, qui révéla au monde littéraire une face complètement inconnu de notre grand romancier ; ou encore comme cette piquante étude biographique sur Alphonse Daudet par son frère. Il est vrai que ces bonnes fortunes-là n’arrivent qu’à ceux qui les méritent et qui les attirent. Mme Adam remporte victoire sur victoire, non pas seulement parce qu’elle est née sous une heureuse étoile, mais surtout parce qu’elle cherche, parce qu’elle force, parce qu’elle conquiert la chance – ou la veine – et que personne mieux qu’elle ne sait en tirer parti. *
** Nous avons essayé de
peindre Mme Adam sous ses trois aspects
d’écrivains, de femme du monde et de directeur de
revue ; mais on ne la connaîtrait pas toute
entière, si nous n’ajoutions qu’il
n’est point de femme plus délicatement obligeante
et plus généreusement charitable. Le nombre de
gens à qui elle a rendu service, nous pourrions dire de ceux
qu’elle a sauvés, dépasse toute
croyance ; et sa réputation, est si bien établie
sur ce point, qu’il n’est pas de budget ni de bonne
volonté qui pussent suffirent aux demandes qu’on
lui adresse des côtés les plus divers.
N’est-ce pas pour cela que cette femme supérieure
à tant de points de vue, et que sa
supériorité même désignait
davantage aux attaques, a toujours été
respectée dans sa personne et dans sa vie par les
adversaires les plus acharnés de ses idées ? Et
n’aurait-on quelque raison de répondre
à ceux qui s’étonneraient de ce
singulier privilège : « C’est que Mme
Adam n’est pas seulement la femme la plus
véritablement et la plus complètement remarquable
de Paris, mais qu’elle en est aussi la meilleure ? »
|
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2007 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2006 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Sub-domains
CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -
Other Domains
https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com