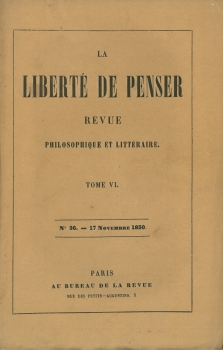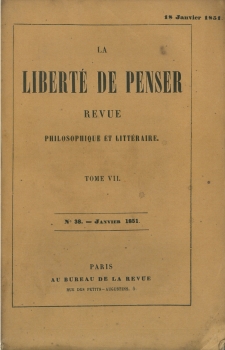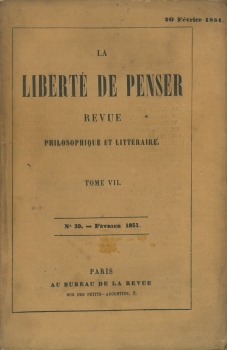Miguel de Cervantes y
Saavedra - Don Quijote de la Mancha - Ebook:
HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP
Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006
HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP
Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006
CLASSICISTRANIERI
HOME PAGE - YOUTUBE
CHANNEL
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
E. Sue : Études sur le prolétariat dans les campagnes –
Jean-Louis le journalier (1850-1851)
Static
Wikipedia 2008 (no
images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2007 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2006 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Sub-domains
CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -
Other Domains
https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
| SUE,
Eugène
(1804-1857) : Études
sur le prolétariat dans les campagnes – Jean-Louis le journalier
(1850-1851). Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (20.III.2015) Texte relu par : A. Guézou. Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros] obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur un exemplaire (Bm Lisieux : nc) de La Liberté de penser : revue philosophie et littéraire [puis revue démocratique], n° 36 ( mars 1851), n°38 (janvier 1851), n°39 (février 1851). RÉALITÉS SOCIALES.
____ ETUDES SUR LE PROLETARIAT DANS LES CAMPAGNES. ____ PREMIÈRE ÉTUDE. ____ JEAN-LOUIS LE JOURNALIER par EUGÈNE SUE ~ * ~PREMIER ARTICLE
___ INTRODUCTION Ce récit est réel de tous points, ainsi que l’indique le titre de ces études ; ce que je raconte, je l’ai vu ; un long séjour à la campagne, où m’appelaient un besoin croissant de retraite, de solitude et de travail, m’a mis à même de connaître des misères, des douleurs, et parfois des vices, fatalement inhérens à la condition sociale du prolétaire des champs ; ce sont, pour ainsi dire, des chiffres moraux que je pose ; une sorte de bilan de l’état physique et intellectuel d’une population que j’ai attentivement étudiée ; attiré vers elle, par l’attrait du malheur d’abord, puis par l’attrait des bonnes et vivaces qualités que n’étouffent jamais entièrement ces vices auxquels ces populations sont parfois forcément condamnées, oui, forcément condamnées ; pour qui a réfléchi, pour qui a sans passion, sans préjugés, observé en pratique l’humanité, il est incontestable : « que l’homme par instinct, par nature, est bon, sensible, généreux, et selon la mesure de son intelligence et de l’instruction qu’il a reçue, accessible à tous les sentiments délicats et élevés ; la mauvaise éducation, le milieu où nous vivons, l’ignorance, et surtout la misère et l’abandon, seuls, nous dépravent, nous rendent criminels, mais jamais assez cependant pour que l’excellence originelle de notre nature soit complètement étouffée. » Cette vérité est niée avec autant d’opiniâtreté que de fureur par les gens du parti prêtre et par les gens de gouvernement ou d’autorité, comme ils s’intitulent en ces temps-ci ; ces gens, afin de se faire croire indispensables et donner un prétexte à la plupart de ces lucratives et hautes positions dont ils sont si jaloux lorsqu’ils les possèdent, et si envieux lorsqu’ils ne les possèdent point, affirment que l’homme est fatalement, originellement né méchant, voué au mal, à la révolte, et se proclament gardiens et dompteurs de cette immense ménagerie de bêtes féroces qui, selon les sauveurs ordinaires de la société, compose l’humanité. Donc, l’homme est une bête féroce, une manière de tigre, cela a été officiellement dit ; muselez la bête, chargez-la d’entraves, ayez toujours pointée contre elle une artillerie chargée jusqu’à la gueule, sinon la société sera dévorée. Bêtes féroces, soit ; voici les bêtes féroces des campagnes, elles sont trois ou quatre fois plus nombreuses que les bêtes féroces des cités, elles ont été, par un exécrable calcul des gens d’autorité, laissées généralement dans une ignorance égale à leur misère, elles sont pour ainsi dire livrées à leurs seuls instincts, et, de plus, elles connaissent à peine de nom ces formidables et innombrables instrumens de toute autorité, mouchards, sergens de ville, gendarmes, geoliers, prisons, bagnes et bourreaux ; elles sont mille, dix mille, vingt mille contre un fonctionnaire, ces bêtes féroces ; cent mille contre un riche, comme on dit ? Sûres de l’immense supériorité du nombre, aiguisent-elles dans l’ombre leurs ongles et leurs dents ? A cela je répondrai : J’habite une commune peuplée de ces mêmes bêtes féroces, qui peuplent les quarante-quatre mille autres communes de France ; souvent attardé dans ma promenade, je traverse la nuit ce village, et toujours je suis aussi frappé que touché du calme, de la confiante sécurité dont jouissent les habitans de ces maisons rustiques ; au temps du battage, leur modeste récolte de seigle ou de froment, arrosée de tant de sueurs, reste sur l’aire de leurs granges ouvertes ; les légumes et les fruits du petit jardin, sans clôture, sont à la portée du passant ; le bois sec, péniblement ramassé par les femmes durant les rudes froids de l’hiver, est empilé le long des masures ; le foin ou quelques racines destinées à la nourriture de la vache sont abrités sous un hangard ouvert à tout venant ; ce sont là tous les biens de ces pauvres gens, biens humbles et précieux à la fois, car ils représentent l’unique capital du pauvre : son temps et son travail. Cette propriété est-elle violée ? une poignée de froment, un fruit, un légume, un morceau de bois, sont-ils quelquefois dérobés ? non, jamais, et cependant où sont les gendarmes ? les mouchards ? les commissaires de police ? où sont-ils donc enfin ces indispensables instrumens de répression et d’autorité ? ces innombrables fonctionnaires qui dévorent les revenus de la France, et que nos bonnes gens, pour leur quote part d’impôt, soldent, vêtissent, arment, brodent, entricornent et empanachent, sans jamais, Dieu merci, user d’eux ni les voir ; sinon en la triste personne du percepteur, représentant fiscal de cette légion de grugeurs de budget ? Oui, ces bêtes féroces, qui les contient dans leurs mâles et saines habitudes d’ordre, de travail et de probité ? Est-ce le gendarme caserné à la ville distante de quatre lieues d’ici ? Est-ce le prêche de M. le curé ? Quant au prêche, hélas ! je l’avoue, dans ma commune ainsi que dans beaucoup d’autres, il règne une extrême indifférence en matière de religion ; et un saltimbanque s’établissant, à l’heure de la messe, sur la place de l’église, attirerait, je le crains, la majorité des croyans. Quant au gendarme de la ville, si bêtes féroces il y avait chez nous, elles s’assembleraient en grand’bande et se soucieraient du gendarme, environ comme les loups de nos pays se soucient du berger quand la faim les pousse hors du bois. Oh !... mais les bêtes féroces des champs sont des agnelets comparées aux bêtes féroces des citées… C’est là surtout où il faut les terrifier par l’aspect des baïonnettes, des canons, et autres doux procédés d’autorité, sinon, vous verrez la bête se déchaîner et faire rage. Cependant nous les avons vues déchaînées en février 1848, les bêtes féroces de Paris et des grandes villes de France ! Et sauf quelques rares excès malheureusement inséparables des violentes commotions populaires, toujours soulevées d’ailleurs par l’impéritie, l’aveuglement ou la trahison de l’autorité, où a-t-on vu le pillage, l’incendie, le massacre ? Les ennemis les plus acharnés de la Révolution et de la République n’ont-ils pas cent fois proclamé eux-mêmes l’admirable attitude de ce peuple, tout frémissant encore de sa victoire, mais aussi pénétré de ses devoirs que de ses droits ! Ne l’a-t-on pas vu, gardien vigilant, impitoyable, des richesses publiques et privées, prêt à les défendre si une poignée de misérables avaient tenté de ternir par quelque acte criminel la gloire de ces grandes journées ! Non, non, les instincts de l’homme tendent naturellement vers le beau et le bien ; les âmes les plus dégradées par l’inexorable influence de cette trinité maudite (dont aucune autorité n’a voulu jusqu’ici délivrer l’humanité) : abandon, misère et ignorance, restent toujours involontairement sympathiques à l’expression des sentimens généreux, de même que, selon le poète, l’ange déchu se souvient du ciel. – Veut-on des preuves à l’appui de cette thèse ? En voici de plusieurs sortes. Il y a quelques années, j’ai donné, dans les Mystères de Paris, un spécimen des contes particulièrement affectionnés des prisonniers, et des prisonniers dont les antécédens sont souvent les plus épouvantables : le fond de ces contes est presque invariable, la forme seule change. Il s’agit presque toujours d’une créature faible, inoffensive et douce, tourmentée par un méchant, puis un vengeur, plus fort que le méchant, surgit soudain et punit brutalement l’oppresseur. Ce dénouement, simple comme la justice, est toujours couvert d’applaudissemens par les prisonniers les plus endurcis. Et non-seulement il y a dans l’homme d’irrésistibles tendances vers ce qui est juste, mais aussi une répulsion instinctive à l’endroit de ce qui est immoral et grossier. Allez à un théâtre de vaudeville, que la gravelure dépasse certaines limites, la toile baissera devant les huées du public ; et pourtant, ces spectateurs indignés ont sans doute, individuellement, cent fois dit ou écouté des gravelures pareilles, sinon pires, sans rougir ou sans se révolter. Est-ce donc fausse pruderie, hypocrisie ? Non ; c’est que les hommes réunis en masse possèdent l’admirable vertu de dégager je ne sais quelle puissante électricité morale qui exalte spontanément en eux toutes les délicatesses, toutes les susceptibilités de l’âme, et surtout le respect humain, autre sublime instinct que la plus audacieuse perversité ne comprime jamais. Une femme éhontée avouera-t-elle ses amans devant sa fille ? Non, par respect humain ! Un père coupable d’une action honteuse en instruira-t-il son fils ? Non, par respect humain ! Je me souviens d’une scène de bagne où deux forçats condamnés pour meurtre s’accablaient de récriminations devant leurs camarades. Enfin, l’un dit à l’autre : « Tu as donné un coup de couteau à ta mère ! – Tu en as menti ! » ̶ s’écria le forçat. Et pourtant, conduit au bagne pour d’autres crimes, il avait en effet frappé sa mère ; mais ce misérable, par une sorte de respect humain, reculait devant cet aveu public (un public de bagne !) : J’ai frappé ma mère. Veut-on une dernière preuve de cette tendance de toutes les âmes vers les principes éternels, empruntons encore cet exemple aux représentations dramatiques ; il est frappant. Allez à un théâtre où l’on joue des mélodrames, observez l’attitude, les impressions de cette VILE MULTITUDE occupant les petites places. Ce sont des spectateurs de toutes conditions : des ouvriers honnêtes et laborieux venant avec leur famille chercher une innocente distraction ; de pauvres enfans abandonnés, flétris par un vice précoce, et apportant au théâtre quelques sous gagnés à ouvrir les portières des voitures ; des gens sans aveu, appartenant à cette population oisive, sans feu ni lieu, dépravée dès le berceau par l’ignorance, la misère ou la contagion des mauvais exemples ; là se trouvent aussi des repris de justice, car le goût passionné des libérés pour les émotions scéniques est un fait singulier ; eh bien ! cette foule hétérogène, si diverse par ses mœurs, par ses habitudes, par ses passions, semble n’avoir qu’un seul cœur, qui palpite, s’émeut, s’épanouit, se serre ou s’épouvante selon les péripéties du dame classique en son dénouement, comme le conte de la prison : le faible vengé du fort, la vertu persécutée, puis enfin triomphante par la punition du crime. En un mot, quel que soit le fond du drame, il est de nécessité absolue que le dénouement consacre, exalte le triomphe des sentimens généreux, et flétrisse les sentimens criminels. Les auteurs dramatiques les plus enclins aux nouveautés, les plus oseurs, n’osent et n’oseront jamais, non pas seulement au point de vue de l’art, mais au point de vue de la moralité humaine, montrer l’infamie triomphant à la fin du drame ; non, les huées, les cris des spectateurs feraient crouler la salle, et les plus indignés, s’armant de projectiles vengeurs, lancés au scélérat, critiqueraient à leur façon l’impunité de la scélératesse. Oh ! je le sais, les esprits superficiels, blasés ou sceptiques, n’ont pas assez de moqueries, de dédains, pour cette naïve et éternelle fable d’une action éternellement puissante, soit sur l’antiquité païenne, soit sur la société chrétienne. – La vertu persécutée, puis triomphante, et le crime châtié… – Je vois, moi, dans l’action invariable de cette fable sur les âmes, une des preuves les plus saisissantes des impérissables instincts de justice et de bonté naturelle à l’homme. En vain dira-t-on : qu’est-ce que cela prouve ? Voilà des gens qui, réunis en masse, pleurent sur l’oppression du faible par le fort, applaudissent à la punition du scélérat, trépignent d’enthousiasme à la représentation d’une action touchante ou héroïque, et en sortant de cette belle école de moralité, ils iront commettre quelque lâche brutalité, ou fouiller la poche de leur voisin. Soit ; mais quelle éducation, quelle instruction ont-ils reçues ? Quel est le milieu où ils ont vécu ? où ils vivent forcément ? Qui a pris soin de cultiver, de développer en eux ce sublime instinct du beau et du bien, si primordial, si vivace, je ne saurais trop le répéter, que les passions les plus désordonnées, les plus mauvaises, ne peuvent l’annihiler dans ces âmes pourtant corrodées par le vice ?... Oui, voyez-les ces âmes coupables, échappent-elles momentanément à la pression fatale de l’atmosphère corrompue où elles vivent, aussitôt, et si cela peut se dire, la force ascensionnelle de leurs vertus natives les emporte dans les régions les plus pures de l’idéalité, et là, en communion de nobles émotions avec les honnêtes gens, ces âmes coupables oublient le mal pour admirer le beau, pour aimer le bien !! Et cette créature marquée de ce sceau divin : conscience et amour impérissable du beau et du bien, les gens d’autorité, flanqués de Basile et de Tartufe, osent la dire originellement, éternellement marquée du sceau de la réprobation, de la misère et de la férocité ! Vous vous moquez de nous, sycophantes ! Votre temps est passé, le monde a marché, la raison du siècle est une belle et robuste fille, vous voudriez l’attirer dans quelque recoin de sacristie pour la traiter à peu près comme le doux frère Léotade a traité Cécile Combette ; mais de sa main vierge et virile la raison du siècle vous soufflettera, Basile et Tartufe, vous en serez pour la honte bue ! JEAN-LOUIS LE
JOURNALIER.
Jean-Louis *** est âgé de quarante-cinq ans ; c’est un homme de haute et robuste taille. Avant les cruels malheurs qui l’ont frappé, sa physionomie était, m’a-t-on dit, joyeuse, ouverte et intelligente ; elle est aujourd’hui encore intelligente, mais triste et abattue ; ses cheveux sont devenus presque blancs. Appelé sous les drapeaux en 1825, il servait, lors de la dernière campagne d’Espagne, dans le 34e régiment de ligne, qui prit part à l’attaque du Trocadéro. Nous avons souvent causé, Jean-Louis et moi, de Puerto-Real, où je me trouvais alors en même temps que lui sans le connaître. Journalier, avant que d’être soldat, il est redevenu journalier en rentrant au pays avec le grade de caporal de grenadiers, humble distinction qui attestait, du moins, sa bonne conduite au régiment. Pendant son absence, il avait perdu sa mère ; son père, journalier comme lui, était devenu impotent, par suite d’un lombago invétéré, contracté en allant le soir, après sa rude journée de travail, pêcher à la lumière dans les ruisseaux des écrevisses dont il tirait un petit profit ; il souffrait aussi depuis longtemps d’une affection chronique du foie, maladie fréquente dans nos contrées, surtout il y a quelques années, le pays très-marécageux étant à cette époque beaucoup moins assaini par les cultures ; ce pauvre homme mourut à l’hôpital d’Orléans, laissant quelques guenilles pour tout héritage à son fils, encore au service. Jean-Louis, après un séjour d’environ deux ans dans la commune, suivit l’exemple de presque tous les journaliers, il se maria. Le mariage est une des conditions presque indispensables de la vie de l’homme des champs ; il lui faut une femme pour préparer son repas du soir, blanchir son linge, raccommoder ses vêtemens, aller au bois ramasser les branches mortes ou à la bremaille couper des bruyères sèches pour alimenter le foyer et chauffer le four. Au temps de la moisson, de la fenaison et des vendanges, les femmes dont les enfans ne sont plus à la mamelle ou au berceau peuvent glaner et trouver à gagner quelques journées, qui varient comme salaire de six à huit sous, avec soupe, pain et fromage ; mais la fenaison et la vendange ne durent guère que cinq à six jours chacune. Jean-Louis épousa Rose Moisant, orpheline et domestique dans une ferme, où elle avait servi pendant cinq ans ; je connais son ancien maître, bon fermier du val ; voici ce qu’il me dit de Rose Moisant, lorsqu’après des tristes événemens que je dois raconter je lui ai parlé d’elle : « - Ah ! monsieur, qui aurait jamais cru cela de la Rose ! elle a resté cinq ans chez nous comme pôque (domestique), et pendant ce temps là ni moi ni la mère (la femme du fermier) nous n’avons eu l’ombre d’un reproche à lui adresser, à cette enfant, car lorsque nous l’avons choisie à la louée (1) de la Saint-Jean, elle avait quinze ans ; sa mère était morte depuis longtemps, ainsi que son père, elle avait trouvé une rétirance (2) chez son oncle, charron à Saint-Laurent des Eaux, elle y gardait la vache et les enfans, la taute restant toujours alitée, par suite d’une maladie de couche ; lorsque la Rose a eu quinze ans, son oncle lui a dit : - Mon enfant, tu travailles ici comme un cheval (et c’était vrai, monsieur, c’était un cheval pour le travail, que la Rose), tu gagnes plus que ta rétirance, car je ne te donne pas de gages ; voici ma fille aînée, assez grandelette pour soigner ses frères et sœurs ; je ne veux plus te voler ton temps ; il faut te mettre domestique quelque part, tu gagneras dix ou douze écus de gages, sur lesquels tu pourras toujours en mettre cinq à six de côté par an, après t’être nippée ; voici la louée de la Saint-Jean, tu es brave fille, forte au travail, courageuse à la besogne, tu auras peut-être la chance de te placer. La Rose pleura beaucoup, monsieur, ça lui saignait le cœur de quitter son oncle, sa tante, et surtout les enfans, car elle était comme une déchaînée pour aimer les enfans ; mais l’oncle tint ferme et conduisit la Rose à la louée. C’est là, je vous l’ai dit, monsieur, que moi et la mère nous l’avons choisie ; d’abord elle nous avait attiré l’œil, comme très-forte fille, nous lui aurions donné dix-huit ans, et puis, elle avait l’air tout honteux, et pleurait dans un coin de la place, assise au pied d’un orme, paraissant plutôt vouloir se cacher aux loueurs que de les affronter comme les autres pôques ; elle espérait ne pas être engagée et retourner auprès des enfans de son oncle. La mère me dit ! - Papa, vois donc cette forte fille qui pleure là-bas, dans son tablier, c’est pas celle-là qui broncherait sous une triple hottée d’herbes, ou qui serait gênée pour curer, à elle seule, notre grande étable… quelle fameuse fille ! et puis son visage est doux comme celui d’une sainte Vierge. Le fait est, monsieur, qu’en ce temps-là, si vous aviez vu la Rose, avec ses deux bandeaux de cheveux blonds sous sa petite coiffe blanche, ses yeux bleus baissés, ses joues rondelettes, son joli visage et son œil modeste, vous l’auriez, ainsi que tout le monde, trouvée très-avenante ; enfin, monsieur, nous avons engagé la Rose comme pôque, et, je vous le disais tout à l’heure, jamais, au grand jamais, la mère ou moi nous n’avons eu à la gronder ; elle passait le dimanche à raccommoder son linge ou à coudre pièce sur pièce sur ses vieilles nippes, car elle avait, par exemple, le défaut d’être avaricieuse pour son corps ; l’été toujours pieds nus, l’hiver jamais de bas dans ses sabots ; les autres pôques, vous le savez, se pendraient plutôt que de ne point avoir un gentil habit du dimanche, un fichu à ramage, un tablier de soie, un fin bonnet ; la Rose ne donnait pas dans ces colifichets, aussi sur quinze écus et plus tard vingt écus de gages que je lui payais, et qu’elle gagnait fièrement, faut être juste, elle en économisait au moins huit ou dix par an ; seulement, d’après ce que me disait la mère, cette pauvre fille était, pour son linge, d’une grande propreté ; à part cela, elle avait l’air d’une mendiante ; je l’ai vue par des froids terribles avoir les jambes, les bras et les mains bleus et presque saignans de froidure, c’est égal, elle était têtue comme une mule pour ne rien dépenser. - Mais, la Rose, – lui dit un jour la mère, – que veux-tu donc faire de tes écus ? - Maîtresse, je veux me marier quand j’aurai vingt ans : je n’ai qu’une idée, c’est d’avoir des enfans à moi, et d’être à mon ménage ; aussi, en amassant quelques sous, je trouverai à me marier plus aisément. - Te marier, – lui disait la mère en haussant les épaules – te marier ! Les voilà bien toutes ! ces têtes à l’envers avec leur rage de se marier, d’avoir leur ménage, et de prendre le collier de misère ; mais qu’est-ce qui te manque ici, voyons, la Rose ? Si tu n’étais pas si avaricieuse, tu pourrais, comme les autres pôques, avoir ton habit des dimanches, pour aller à la danse à Saint-Laurent ; mais non, tu aimes mieux rester ici comme un vieux loup, être vêtue en pauvresse, et l’hiver amasser parfois des rhumes si terribles, si terribles qu’on ne t’entend plus parler et que tu tousses à déchirer la poitrine aux autres ; tu préfères enfin te priver de tout, être à toi même la marâtre, et empiler sou par sou. A ce que lui disait la mère, savez-vous, monsieur, ce que répondait la pôque ? toujours la même chanson. - Maîtresse, je veux me marier pour avoir des enfans et être à mon ménage. La Rose ne sortait pas de là, et elle a fait comme elle se l’était promis, la malheureuse. A vingt ans, elle avait amassé soixante et deux écus et quelques sous ; Jean-Louis était revenu de l’armée depuis près de deux années ; je l’employais comme journalier tant que j’avais de l’ouvrage ; c’était et c’est encore, sauf le malheur que vous savez, monsieur, le plus franc travailleur de la commune ; jamais de ribotte, soignant tout ce qu’il fait, comme s’il le faisait par amour ; glorieux de son ouvrage, quand même il s’agit d’écarter le fumier sur les guérets, travaillant à la journée comme un homme à la tâche, c’est tout dire ; il n’y a pas besoin de le surveiller, celui-là ; il croirait se voler lui-même en mésemployant son temps ; c’est, enfin, un journalier bon… bon… mais bon exprès. Donc, cet hiver-là, j’avais eu pas mal de froment et de seigle à battre ; j’ai pris Jean-Louis comme batteur, car il est aussi fin batteur que fin faucheur ; le soir, à la veillée, au lieu de s’en aller chez lui, où il s’ennuyait comme un mort, il restait souvent avec nous jusqu’à la couchée ; je lui donnais la soupe, et comme il avait une manière de fierté à lui, en retour du souper, il nous fabriquait des fourches et des rateaux de bois pour le fanage. Tout en travaillant, il nous racontait sa campagne d’Espagne et des histoires de moines du temps de l’autre guerre sous l’Empereur, qui nous donnaient la chair de poule. La Rose écoutait aussi, tout en allant et venant, écurant la vaisselle, lavant l’évier, car elle avait encore cela, qu’elle était aussi propre autour d’elle que sur elle, malgré ses guenilles. Son ouvrage fini, elle venait s’asseoir sur son escabeau, en face de Jean-Louis, et, tout en rapiéçant ses loques, sans souffler mot et sans lever le nez, elle ne perdait rien de ce qu’on disait ; la mère et moi nous étions là comme deux bêtes, ne nous doutant pas de la chose. Cependant, un soir, je me le rappellerai toujours, c’était un samedi, jour de marché, voilà-t-il pas que la Rose, jusque-là muette, selon son habitude, ni plus ni moins qu’une tanche, se met à dire sans lever le nez de dessus sa couture : - Jean-Louis, est-ce que vous aimez les enfans, vous ? - Oh ! pour ça oui, la Rose ! et, si j’en avais, ils pourraient se vanter ceux-là d’être aimés. Mais, pourquoi me demandez-vous si j’aime les enfans, la Rose ? - Oh ! pour rien, Jean-Louis, pour rien… répond-elle en devenant rouge jusqu’aux oreilles, en s’efforçant de tousser, et baissant davantage encore le nez sur sa couture ; après quoi, elle reste muette toute la soirée. En se couchant, la mère me dit : - Papa, as-tu entendu la Rose ? - Pardi, si je l’ai entendue, ça y est, va ! la mère, ça y est ! encore un ménage où il y aura plus de soucis que de bon temps, et plus de faim que de pain. Huit jours après cette soirée, la Rose dit à ma femme : - Maîtresse, je me marie avec Jean-Louis, mais nous attendrons après la Saint-Jean, afin de vous laisser le temps de trouver à la louée une domestique pour me remplacer. Le même jour, Jean-Louis me dit de son côté : - La Rose et moi, nous nous marions à la Saint-Jean ; c’est une bonne et brave fille, nous nous convenons en tout, je ne peux mieux choisir, n’est-ce pas, maître Brossard ? - Ce soir, à la veillée, mon garçon, nous causerons. La veillée vient ; après souper, je dis à la Rose et à Jean-Louis : - Ainsi, mes enfans, vous voulez absolument vous marier ? - Oh ! oui, maître Brossard, c’est décidé, bien décidé. - Vous faites une grosse sottise, dont vous vous mordrez plus d’une fois les pouces jusqu’au sang ;je vas vous le prouver, après quoi vous aviserez. Dis-moi, Jean-Louis, combien gagnes-tu en bon an mal an (3) ? - Environ vingt-cinq sous par jour, maître Brossard ; car si, en temps de moisson, il y a des journées de trente-cinq et quarante sous, il y en a de vingt et de quinze en la morte saison. - Bon, ça ferait environ 450 fr. par an si tu travaillais tous les jours ; mais, tu le sais, il faut là-dessus déduire les dimanches, les fêtes, les jours de mauvais temps, ou l’on peut même en belle saison aller aux champs, et surtout les jours de gelée, de neige et de dégel durant l’hiver ; de sorte qu’en supposant, y compris les dimanches et fêtes, trois mois de chômage forcé sur douze mois, c’est plutôt tabler sur moins que sur trop. Est-ce vrai ? - C’est vrai, maître Brossard. - Donc si sur 360 jours tu en ôtes 90, il t’en rester 270. Or, à vingt-cinq sous par jour, c’est environ 337 fr. par an ; mettons 340, mettons 360, si tu veux… te voilà donc en ton ménage, à la tête de vingt sous par jour, en admettant que tu trouves toujours de l’occupation en la saison, et que tu ne sois jamais malade… - Oh ! le coffre est bon, maître Brossard, et je tâche de contenter de mon mieux ceux qui, comme vous, me donnent de l’ouvrage ; j’espère ainsi ne pas chômer tant que le travail est possible… - Je l’espère aussi, mon garçon, et je compte non moins que toi sur la solidité de ton coffre. Maintenant calculons, mes enfans ; car les chiffres, voyez-vous, les chiffres sont bourrus en diable, et n’ont point souci des amourettes. Vous voilà donc mariés, avec l’espoir, avec la certitude si vous voulez que Jean-Louis gagnera, bon an mal an, de quoi dépenser vingt sous par jour, et que jamais il ne sera malade… Venons à ces diables de chiffres ; vous ne pouvez vous loger à moins de 50 à 60 fr. par an ? - Non, maître Brossard ; j’ai arrêté pour la Toussaint la maison de Claude Belnou ; il y a une belle grand’chambre, avec four et fournil, une petite étable… un toît à porc, un puits et un carré de jardin, bonne terre à légumes, plantée de cinq gros noyers et de trois superbes pommiers ; nous en aurons moi et la Rose pour 56 fr. Il fallait voir, monsieur, me dit le fermier, la mine de la Rose quand son Jean-Louis parlait de la maison, de l’étable, du toit à porc, des noyers et des pommiers. Bonne fille ! elle rougissait, elle ne se possédait pas d’aise sur son escabeau et semblait avoir des fourmis dans les jambes ; elle allait enfin avoir son ménage, sa maison, son jardin, ses arbres à elle, ou quasiment à elle… Cela me touchait, monsieur, car les plus pauvres gens sont glorieux d’avoir leur petite retirance ; c’est si naturel de désirer son chez soi, quand on a servi longtemps chez les autres ; cependant j’eus le courage de dire la vérité à ces deux fous : - Bien, Jean-Louis, te voilà logé pour cinquante-six francs par an, avec l’impôt soixante francs, c’est un peu plus de trois sous par jour ; tu en auras vingt à dépenser, reste à dix-sept ; tu es fort travailleur, la Rose aussi ; qui dit fort travailleur, dit fort mangeur. Mettons trois livres de pain pour toi et deux pour ta femme. - Ce n’est pas trop, mais c’est assez, maître Brossard ; n’est-ce pas la Rose ? - Oh ! moi, Jean-Louis, pourvu que j’aie une livre de pain, je serai assez nourrie. Dame ! il faut savoir rester sur sa faim, quand on est à son ménage et que le pain est cher. - Mettez cinq livres, maître Brossard, – s’écria Jean-Louis, ̶ Je ne veux pas que ma femme reste sur sa faim ! - Tu as raison, mon garçon ; car la nourriture, c’est la force, la force fait le bon travail, et les bons travailleurs chôment moins que les chétifs. Cinq livres de pain par jour, que vous le cuisiez ou que vous l’achetiez, vous reviendront toujours à deux sous la livre. C’est donc dix sous, et trois de logement, ça nous fait déjà treize sous… - Déjà treize sous ! maître Brossard, s’écria la Rose en ouvrant de grands yeux et joignant les mains. Hélas ! – mon Dieu ! déjà treize sous… - Oh ! ce diable de pain, – reprit Jean-Louis en se grattant l’oreille, – ce diable de pain, c’est la mort aux ménages ; mais enfin on a deux bras, et quand on les manœuvre rudement du matin au soir, il vous pousse du pain dans les mains ! - Brave Jean-Louis ! tu es un honnête garçon… Maintenant, mes enfans, on ne vit pas de pain sec ; je ne vous parle pas d’acheter un porc qu’on choisit bien gras, parce que ça écœure, et qu’on en mange moins : non, un porc serait trop cher pour vous ; mais il vous faut au moins un morceau de fromage, et entre vous deux un fromage de quatre sous par jour, est-ce trop ? - Oh ! un fromage peut faire deux jours, maître Brossard ; n’est-ce pas Jean-Louis ? Pourvu que ça sale un peu le pain, c’est tout ce qui faut. - Oui, oui, la Rose ; que ça vous égaye un brin le palais, ça suffit. - Ça n’est guère, mais enfin va pour un demi-fromage par jour… Mes enfans, c’est deux sous ; ajoutons-y les autres treize sous de dépense, il vous reste cinq sous. Si peu qu’on brûle de chandelle l’hiver, à la veillée, qu’on mette de graisse dans l’eau de la soupe, le sel, le savon, le fil, les aiguilles pour raccommoder les hardes….. ça vaut il bien deux sous par jour ? - Oh ! oui, au moins, maître Brossard… au moins. - Ça fait dix-sept. Ne mangeant pas de viande, il faut bien que ton mari boive un peu de vin ; en l’achetant à la pièce, dans les bonnes années, Jean-Louis en boira pour un sou par jour, à peine une bouteille, ça nous fait dix-huit sous ; restent donc deux sous par jour ou trois fr. par mois pour vous vêtir et vous entretenir. Pour ne parler que des sabots, il vous en faut au moins six paires à chacun : ils vaudront quatorze sous pour Jean-Louis, douze sous pour la Rose, en voilà pour sept à huit fr. chaque année. - Oh ! moi, maître Brossard, je n’en porte jamais l’été des sabots. Mais vous parlez toujours des vingt sous de Jean-Louis ? Est-ce que vous croyez que moi je resterai là comme une borne ? Et mon gain, donc ? - Ton gain, ma fille ; je vais le compter : tant que n’auras pas d’enfant, tu iras ramasser du bois mort, couper de la bremaille… Vous aurez donc votre chauffage gratis ; tu pourras de plus, de ci, de là, trouver quelques journées de sarclage ; vienne la moisson, tu auras le glanage ; au temps du foin, le fênage ; au temps des raisins, la vendange ; hormis ça, vous le savez, mes enfans, les travaux de femme sont rares. Mais enfin, mettons, et c’est beaucoup, que tu fasses, bon an mal an, cinquante à soixante journées à dix sous, c’est vingt-cinq à trente fr., il vous en reste environ une trentaine, c’est près de soixante fr. pour vous vêtir et vous fournir de linge : c’est tout juste… Mais enfin… tant que vous n’aurez pas d’enfant, vous pourrez joindre à peu près les deux bouts ensemble… Je pourrai même vous donner une vache à moison (4) pendant la belle saison, car, durant l’hiver, vous n’auriez pas de quoi la nourrir… - Une vache, – s’écria la Rose, aussi surprise, aussi joyeuse, monsieur, que si j’avais fait sa fortune, – une vache… à moi ! ou enfin comme dirait à nous, puisqu’elle sera chez nous, soignée par moi… Ah ! maîtresse, si ça pouvait être la Bélotte que vous nous donnerez à moison dans notre étable ! Un roi, monsieur ; ne dirait pas glorieusement mon palais, que la pauvre fille ne disait notre étable. - Va pour la Bélotte, elle vous donnera ses cinq à six litres de lait. Ainsi mes enfans, moyennant la Bélotte à moison, vous pourrez, pendant sept à huit mois de l’année, économiser le fromage et la graisse, puisque vous aurez le lait et beurre ; la Rose ira faire paître la vache à la corde le long des haies… - Et chercher de fameuses charges d’herbe dans vos blés du val, maître Brossard ; ça nettoiera vos récoltes, et notre Bélotte sera comme une fontaine à lait. Oh ! elle ne pâtira pas dans notre étable, pour sûr. - Je le sais bien. De plus, ma fille, tu bèches comme un homme ; pendant que Jean-Louis sera aux champs, tu cultiveras et tu arroseras le jardin. - A quoi nous servirait donc notre puits, sinon à arroser ; aussi, vous le verrez, notre jardin, maître Brossard ; vous le verrez avec le fumier de notre vache, nos légumes seront superbes… - Je le veux bien : et de plus, vous récolterez quelques boisselées de pommes de terre, quelques mesures de noix et de pommes quand vos pommiers et noyers donneront drû ? Enfin, je vous le répète, vous pourrez vivre… à peu près… mais toujours et surtout à la condition que ton mari ne sera jamais malade… et ne chômera jamais d’ouvrage… Maintenant, la Rose, écoute-moi : Un enfant vient, te voilà en couches… et plus tard un marmot au sein et sur les bras !! - Oh ! maître Brossard, – s’écria la Rose, ne pouvant se contenir d’aise, – des enfans à moi : ah ! si j’avais ce bonheur-là ! sont-elles heureuses ces mères… nourrir son enfant ! le bercer dans ses bras, ne le quitter ni jour ni nuit, être là… toujours à le regarder ! ah ! maître Brossard, ah ! maîtresse… Et elle ne savait plus ce qu’elle disait, la pauvre fille, tant elle était contente, c’était plus fort qu’elle, aussi, monsieur, il me fallut, allez, un grand courage pour continuer ma morale. - Tu auras un enfant à toi, bon, la Rose, mais sais-tu que pendant dix-huit mois, au moins, tu ne pourras plus ni aller au bois, ni à la bremaille ; est-ce que ton enfant n’aura pas besoin de téter, est-ce que tu peux l’emmener aux champs avec toi ? ou le laisser seul à la maison ? donc, plus de bois, il faudra l’acheter, plus de vache… car tu ne pourrais la mener aux champs, avec ton enfant dans les bras, vous voilà donc encore obligés d’acheter le fromage et le beurre ; tu pouvais glaner après la moisson et gagner quelques journées aux sarclages, aux vendanges, à la fenaison ; tu ne le peux plus, c’est fini, ton enfant te retient à la maison ; vous voilà réduits aux vingt sous par jour de ton mari, et votre dépense augmente de plus en plus ! Et encore je ne parle que d’un enfant ! Mais, s’il en vient deux, mais s’il en vient trois ! et quatre ? et cinq, et six ? Enfin, ça s’est vu ! te voilà clouée chez toi, du soir au matin, pendant des années ; ce n’est pas tout, ces enfans, comment les nourrir avec les vingt sous par jour de ton Jean-Louis qui vous suffisent à peine à vous deux ? car avant neuf ou dix ans, un enfant ne peut pas gagner le pain qu’il mange, et encore… ne trouve-t-il pas souvent à le gagner ! sinon au temps des semailles, à chasser à coups de pierre les corbeaux qui déterrent le grain des guérets, c’est une pièce de cinq sous par ci par là qu’ils attrapent ces petits, pas davantage ; ou bien encore ils vont au crottin sur la route, au bois mort, ou à la bremaille, mais ça n’est pas lourd la chargée que rapporte un enfant… et pourtant en rentrant à la maison, ça en mange du pain, ces petites gueules fraîches… oui, ça en mange… quand il y en a. - Maître Brossard, il n’y aurait qu’un morceau à la maison, il serait pour les enfans ! - Jean-Louis, tu me dis là des bêtises, mon garçon. Si tu ne manges pas où trouveras-tu des forces pour travailler ? qu’est-ce que le meilleur cheval sans l’avoine, tu sais le proverbe : Ventre creux n’est bon à rien… - Maître Brossard a raison Jean-Louis, s’il y a à se priver je me priverai, moi… - Toi, ma fille ? et si tu nourris un enfant ? est-ce que tu crois qu’en ne mangeant pas, ton lait ne tarira point ? est-ce que si le ratelier de la vache était vide, son pis ne serait pas vide aussi ? Ce ne sont point là, voyez-vous, des raisons, et si Jean-Louis tombait malade, et s’il était quinze jours, un mois, deux mois sans pouvoir travailler, ou sans rencontrer d’ouvrage ? dites-moi donc un peu qu’est-ce que vous répondriez aux enfans qui vous crieraient : – J’ai faim ! Je sais qu’après tout la commune a du pain pour ses pauvres. - Maître Brossard, – s’écria Jean-Louis les larmes aux yeux, – je me saignerais les quatre veines plutôt que de voir mes enfans manger le pain de l’aumône ! - Tu me dis là, mon garçon, encore des bêtises ; tu t’ouvrirais les quatre veines ?... après ? cela donnerait-il du pain à tes enfans ? Si tu ne peux travailler, de deux choses l’une, ou tes enfans mourront de faim ou ils seront à l’aumône ? C’est ainsi ; ah ! vous me prenez pour un oiseau de mauvais augure, mes amis, et pourtant j’ai raison et j’irai jusqu’au bout ; deux mots encore et j’ai fini. Avec tes vingt sous par jour, il ne faut pas compter faire des épargnes pour les cas de maladie ou de chômage ? Voyons, réponds, avec quoi allez-vous entrer en ménage ? La Rose a cinquante-deux écus, et toi, mon garçon, en fait de meubles tu as une paillasse sur trois planches, un escabeau, un coffre et tes vieilles épaulettes de grenadier pendues à un clou, avec ton étui de congé en fer blanc. Je ne t’en fais pas un reproche, tu es un garçon, tu ne rentres chez toi que pour dormir, tu emportais ton pain aux champs dans ton bissac et puis tu allais souper chez les Bellenou ; mais vous voici en ménage, il faut vous meubler, acheter un vrai lit, des matelas, une table, une armoire, des chaises, de la vaisselle, un peu de linge, aussi les cinquante-deux écus de ta femme suffiront à peine à vous emménager, et encore je ne parle point du repas de mariage et de la robe de noce de ta femme ; si vous voulez à toute force vous mettre la pierre au cou, je me charge du repas qu’on fera ici, et la mère se charge de la robe de noce et du bonnet ! - Maître Brossard, – s’écria ce garçon, qui, je vous l’ai dit, monsieur, avait une manière de fierté à lui, – je vous remercie de votre bonne amitié et intention, mais… - Il n’y a pas de mais, repris-je en haussant les épaules, tu es laborieux et brave garçon, la Rose est une excellente fille, la mère et moi nous ferons pour vous ce que nous pourrons, non ce que voudrions, car nous aussi, notre fermage payé, nous joignons à peine les deux bouts ; mais, enfin, ce qu’on peut, on le fait, et je le ferai, si malheureusement, malgré mes conseils, toi et la Rose, vous vous obstinez à vous mettre de gaîté de cœur la pierre au cou. Pendant que je leur parlais ainsi, monsieur, en leur disant d’ailleurs, vous le savez, ni plus ni moins que la pure et simple vérité, Jean-Louis et la Rose semblaient tout de même un peu battus de l’oiseau… ils ne savaient trop que répondre, de temps en temps tous deux se regardaient en dessous en soupirant ; je voyais de grosses larmes rouler dans les yeux de la pauvre fille ; elle avait le cœur gros… mais gros à étouffer , et tortillait sans mot dire un coin de son tablier ; Jean-Louis baissait la tête, sifflotait entre ses dents, ou de temps à autre tambourinait du bout des doigts sur la table ; enfin il fit hum… hum… d’une voix étouffée, et puis il dit : - La Rose… il en sera ce que vous voudrez… vous avez en nous mariant plus à perdre que moi, vous êtes placée chez de bons maîtres, ils ne demanderont pas mieux que de vous garder ; ils nous montrent par amitié la vérité, ce n’est pas de leur faute si elle n’est pas belle… Il paraît que le mariage et les enfans, ça n’est point fait pour tout le monde ; il faut choisir… crever de misère en famille ou vivre seul comme un ours… Que voulez-vous ? j’aurais aimé, ainsi que tant d’autres, voir, le soir en rentrant bien las, une femme et des enfans accourir à moi et m’embrasser… ce n’est pourtant pas une mauvaise ambition… c’était la mienne… je me serais carnagé pour donner du pain à tout mon petit monde… c’était une folie, selon maître Brossard, ce serait nous mettre la pierre au cou… n’en parlons plus, la Rose… n’en parlons plus… c’est fini… allons… n’y pensons plus… Et Jean-Louis passa sa main sur ses yeux et se tourna du côté de la porte pour qu’on ne vit pas qu’il pleurait. - Jean-Louis, dit la pauvre fille d’une voix que l’on entendait à peine ? est-ce à cause de moi ou de vous, que vous craignez maintenant de nous marier ?... - Oh ! c’est à cause de vous, la Rose !... – s’écria Jean-Louis en se retournant et essuyant ses yeux du revers de sa main ; – si je m’écoutais, je répondrais : Bah ! marions-nous tout de même ! je ne dis pas que maître Brossard ait tort, mais, s’il fallait penser au mauvais côté de tout, l’on serait toujours en peur, comme un lièvre au gîte… Il y a bien d’autres gens dans la commune qui ne sont pas mieux lotis que nous, ils se sont mariés cependant, et ils vivent tant bien que mal, eux et leurs enfans, dans leur ménage ! A ces mots : d’enfans et de ménage, me dit le fermier, la Rose perdit la tête, c’était plus fort qu’elle, monsieur, elle se mit à pleurer comme une Madeleine, et dit à ma femme, comme pour lui demander excuse de se marier malgré nos avis. - Vous verrez, maîtresse… vous verrez que Jean-Louis et moi nous ne serons pas plus malheureux… que les autres ! Alors, monsieur, moi et la mère, nous avons vu que c’était peine perdue que de vouloir encore raisonner Jean-Louis et la Rose et les empêcher de se marier ; ils en ont fait à leur tête, nous les avons aidés selon notre pouvoir, et vous savez le reste……………………………………………………. Ce sont les conséquences fatales de ce mariage que je vais raconter ; drame étrange et cependant profondément humain, qui montre la terrible réalité de ces paroles de Jean-Louis : – Il faut choisir : vivre seul comme un ours ou crever de misère en famille. » EUGÈNE
SUE.
NOTES : (1) Nous reviendrons sur cette singulière coutume ; disons seulement ici que la louée est une sorte de marché aux domestiques qui se tient sur une place publique. Les serviteurs et servantes qui se trouvent sans condition, ou qui désirent en changer, s’offrent à qui veut les louer pour l’année. (2) Un asile. ̶ Heureux qui trouve une retirance pour ses vieux jours – dit-on dans notre pays. (3) Nous affirmons l’exactitude des calculs suivans ; ils peuvent être appliqués à l’immense majorité des départemens de la France. (4) Dans nos pays, un propriétaire de vaches donne temporairement une vache pleine à un ménage qui nourrit la vache et profite de son lait avant et après le velage, mais le veau appartient au propriétaire de l’animal ; c’est ce qu’on appelle AVOIR OU PRENDRE UNE VACHE A MOISON. Pratiqué sur une grande échelle, c’est un placement fort avantageux, car une vache de 150 à 180 fr. peut donner chaque année un veau vendu à six semaines de 20 à 25 francs. *
* * DEUXIÈME ARTICLE (1)
___ Jean-Louis épousa la Rose. Lorsque, plus tard, ce courageux martyr de l’insuffisance et de l’incertitude des salaires me raconta ses malheurs, il me dit avec une naïveté navrante : - Je n’ai peut-être pas le droit de me plaindre de mon sort ; car, pendant plus d’une année, j’ai été le plus heureux des hommes ; tout le monde ne saurait en dire autant. » J’ai vu la maison où Jean-Louis alla s’établir avec la Rose après leur mariage ; cette humble demeure se composait d’une grande chambre carrelée, luxe généralement inusité dans nos pays ; au-dessus de la chambre était un grenier, à côté une petite étable en pisé, le tout couvert en chaume ; un jardinet entouré d’une haie vive et planté des fameux noyers et pommiers, attenait à la maison ; le propriétaire de ce logis me dit, en me montrant la chambre éclairée par une petite fenêtre et par le vantail supérieur de la porte, lequel s’ouvrait à volonté : - Ah ! monsieur, du temps de cette pauvre Rose (hélas ! qui se serait alors douté qu’elle devait tourner ainsi, car chaque fois que je rencontre le père Brossard, chez qui elle a été pôque, nous ne pouvons nous empêcher de nous dire : Hein ! qu’est-ce qui aurait jamais cru cela ?), enfin, monsieur, du temps de la Rose, c’était un miracle de propreté que cette maison ; tous les jours le carreau de la chambre lavé à grande eau, les vitres nettoyées, et les meubles donc, il fallait les voir ! Dans ce coin, il y avait une grande armoire en noyer avec des ferrures tortillonnées à chaque gond, ainsi qu’autour de la serrure, l’armoire reluisait à s’y mirer, les ferrures brillaient ni plus ni moins que de l’argent, et le lit ? toujours fait au point du jour, et si nettement bordé que c’était un charme !! la mè où l’on serrait le pain était non moins reluisante que l’armoire ; au-dessus de la mè, la Rose avait cloué le congé de Jean-Louis, avec ses épaulettes de grenadier, de chaque côté du papier ; c’était l’ornement de leur retirance, et, au fait, il y a bien des riches demeures où l’on ne retrouverait pas un ornement pareil ; Celui-là prouvait du moins que Jean-Louis avait fait la guerre en brave soldat. Quant au jardin, monsieur, c’était un petit paradis, tant c’était soigné, fumé, arrosé, sarclé ; il poussait là dedans, voyez-vous, des choux, des carottes, à effrayer ! La petite allée du milieu était sablée de beau sable jaune que la Rose allait chercher, dans une brouette, à la sablière des vignes ; au bout de l’allée il y avait, s’il vous plaît, une jolie tonnelle, que Jean-Louis avait fabriquée, pendant ses dimanches, avec des échalas et des branches de marsaule, le jardinier de M. Raymond lui avait donné de la graine de volubilis, et, en été, cette tonnelle était comme une chambrette de verdure, couverte de clochettes de mille couleurs ; aussi, dans le village, on disait : « Qui n’a pas vu la tonnelle de la Rose au mois de juin n’a rien vu. » Ce n’est pas tout, monsieur, de chaque côté de la tonnelle, Jean-Louis avait planté deux beaux églantiers qu’il était allé chercher dans les bois, et le jardinier de M. Raymond les avait greffés, l’un de roses blanches, l’autre de roses rouges remontantes, pendant tout l’été, ils foisonnaient de fleurs et embaumaient ; aussi, le secrétaire de la mairie, garçon plein de moyens, nous faisait toujours rire en nous disant : « Il n’y a que la Rose pour avoir de beaux rosiers. » Vous comprenez, monsieur, ce garçon disait cela à cause du nom de la Rose ; mais, n’allez pas croire au moins qu’elle ne faisait que s’amuser à son jardin, ah bien oui ! je ne sais pas comment diable elle s’y prenait, mais elle trouvait du temps pour tout ; tenez, monsieur, jugez-en. Au petit point du jour, elle commençait par laver sa chambre et faire le lit ; après ça, vite à l’étable, pour traire la vache que la Rose avait à moison. Ensuite elle s’en allait à l’herbe dans les champs et s’en revenait si chargée, si chargée, qu’un homme fort n’aurait pu porter une pire charge ; elle affourageait alors sa vache avec cette bonne herbe fraîche, et faisait sa seconde traite, après quoi, selon les jours ou la saison, elle battait son beurre, faisait ses fromages, ou les changeait de cagerons, allait savonner au rû (petite rivière), ou bien elle repassait son linge, raccommodait ses nippes et celles de son homme, ou bien encore elle allait ramasser du bois mort ou couper des bruyères, et en rapportait tant, et tant, sur son dos, qu’il y aurait eu de quoi éreinter un bon âne… mais elle était si courageuse ! Vers le fin de la journée, elle prenait sa vache à la corde, et s’en allait la mener paître au long des haies. Il n’y avait personne comme la Rose pour dénicher les cachettes de fine herbe, mais elle ne ménageait point ses jambes et faisait parfois une lieue pour trouver les bons endroits, et sa vache ne se plaignait point de la promenade. Au retour des champs, la Rose faisait sa troisième traite et préparait la potiche aux légumes pour le souper de son homme. Fallait voir, monsieur, leurs deux couverts de fer ! j’en ai connu en argent qui ne brillaient pas autant, et les verres et les deux assiettes ! comme c’était clair et propre. Enfin, on soupait, après le souper la Rose rangeait tout, curait la vaisselle, allait donner une dernière affouragée à sa bête et se couchait… après l’avoir bien mérité, comme vous voyez… Ce n’est pas tout, vous croyez peut-être, monsieur, qu’étant si occupée déjà de son ménage, de sa vache et de son homme, la Rose se refusait à gagner des journées quand elle en trouvait, soit pour le sarclage, soit au temps de la vendange et de la fenaison ? Non, monsieur, la Rose savait encore s’arranger. Mais, me direz-vous, et sa vache ? car enfin elle ne pouvait la nourrir qu’en allant chercher l’herbe aux champs, ou en la conduisant à la corde, ça lui prenait au moins quatre ou cinq heures par jour ? Comment pouvait-elle faire des journées malgré cela ? Oh ! oh ! la Rose ne s’embarrassait point de si peu : obligée de ne pas aller à l’herbe pour sa vache, savez-vous, monsieur, comme elle s’en tirait ? Elle prenait sur sa provision de pommes de terre, ou en achetait au besoin pour quatre ou cinq sous, les coupait en tranches avec des feuilles de choux et des froûles de carottes, du jardin, jetait sur le tout une poignée de sel pour affriander sa vache, et après l’avoir traite avant de partir pour la journée, elle lui donnait la moitié de cette provende, et le restant le soir en rentrant, avant de la traire ; la Rose y perdait, il est vrai, un peu de lait, parce qu’elle n’avait que deux traites au lieu de trois, mais, en fin de compte, elle gagnait ses douze sous. Ces soirs-là, comme elle ne rentrait pas plus tôt de sa journée que Jean-Louis et qu’elle n’avait pas le temps de lui préparer la potiche, on soupait avec du pain et du fromage. Si la Rose devait faire quelque raccommodage ou repassage, dont elle n’avait pu s’occuper pendant la journée, elle travaillait bravement à la chandelle, et veillait jusqu’à des onze heures, des minuit, et était pourtant sur pied à trois heures du matin pour la fenaison. Voici son calcul : elle disait : « Pour pouvoir aller en journée, faut que je nourrisse ma bête à l’étable, ça me coûte quatre à cinq sous de pommes de terre, un sou de chandelle pour la veillée, c’est donc six sous, j’en gagne douze, c’est donc six de bénéfice, et six sous… ah ! ah ! mais six sous…. c’est le pain de mon homme pour tout un jour. » Le dimanche, après avoir été à l’herbe, elle passait avec Jean-Louis à sarcler, biner, éplucher, arroser, ratisser, sabler le jardinet, à faire la chasse aux buirons, ces vilaines bêtes qui viennent manger le cœur des roses, et elle tenait tant à ses deux rosiers ! Jean-Louis, de son côté, palissait les volubilis de la tonnelle sous laquelle on soupait le soir, dans la belle saison, et il accompagnait la Rose à l’heure où elle sortait sa vache. En hiver, comme il n’y avait pas à travailler au jardin, Jean-Louis et la Rose passaient leurs dimanches à fabriquer des fourches et des rateaux de bois, dont ils tiraient un petit profit, ou à chercher ensemble des taillis des églantiers qu’ils revendaient aux jardiniers des environs. Il faut avouer, monsieur, que Jean-Louis et la Rose n’avaient jamais été bien acharnés sur la messe et les vêpres. Jean-Louis disait : « Chacun son goût : je comprends qu’un brave garçon, ou qu’une brave fille, qui, toute la semaine, ont rudement travaillé, se donnent leurs dimanches, s’ils ont d’avance gagné le pain de ce jour-là, ou s’ils sont certains de le gagner pendant les autres jours de la semaine. Après ça, faut être juste, pour les jeunes filles, aller à la messe, c’est se donner le plaisir de montrer leur corset neuf, pour les hommes, c’est l’occasion de mettre leur belle veste de velours et de coiffer leur chapeau tromblon ; et puis, l’on se trouve là en assemblée de connaissances, on entend jouer du serpent, on entend la grosse voix des chantres et la voix flûtée des enfans de chœur, c’est toujours une musique ; ensuite on voit brûler des cierges en plein midi, ce qui est une rareté, on flaire l’odeur de l’encens, on voit promener la procession dans l’église, avec M. le curé tout flambant sous les galons d’or de sa chasuble des dimanches, marchant sous le dais d’un air superbe ; enfin l’on a la chance d’attraper à la fin sa petite bouchée de pain bénit, qui est souvent de la brioche. Que voulez-vous, la messe, c’est le seul spectacle des pauvres gens, et, à défaut d’autres, je comprends fort qu’on aille à celui-là, mais il ne faut disputer ni des goûts ni des couleurs ; moi, quand j’ai le bonheur de trouver à travailler le dimanche, je ne rate pas l’occasion. Diable ! il n’est que trop de jours qui, faute d’ouvrage, deviennent pour nous jours fériés ; toute ma peur est d’avoir toute ma semaine de dimanches ; aussi, dès qu’on m’offre du travail, je ne consulte pas le calendrier, je prends ma pioche, et la maniant bravement, je me dis : voilà encore une journée au bout de laquelle il y aura du pain pour la Rose et pour moi. Mais si je suis malgré moi bourgeois le dimanche, ma foi, j’aime mieux jardiner que de rester les bras croisés dans l’église ; je préfère l’odeur de nos deux rosiers à l’odeur de l’encens, le chant des oiseaux du bon Dieu aux fron-frons du serpent, le soleil aux cierges, et ma tonnelle fleurie sous laquelle je fume ma pipe, aux murailles grises de la paroisse ; la Rose est de mon avis : chacun prend son plaisir où il le trouve. » Voilà, monsieur, quelle a été la vie de la Rose pendant qu’elle a demeuré ici, du moins, tant qu’elle n’a pas eu d’enfans, car, hélas, monsieur… c’est du moment où elle a eu des enfans qu’elle a été perdue… la pauvre créature !!. le père Brossard le lui avait prédit… Mais que voulez-vous, ces jeunesses, ça n’en fait qu’à leur tête ; quant à Jean-Louis, c’était la fleur des bons journaliers. Après, comme avant son mariage, jamais de ribotte, toujours content, toujours joyeux, quand l’ouvrage donnait (je ne parle pas du temps où il a eu des enfans) ; je demeurais ici, en face ; dès l’aube j’entendais Jean-Louis chanter en s’en allant à l’ouvrage, son bissac au dos, sa bouteille de grès en sautoir, et sa pioche ou sa coignée sur l’épaule ; je n’avais pas besoin de réveille-matin pour savoir l’heure ; je me disais : Voilà Jean-Louis qui part, c’est qu’il fait à peine petit jour. S’il s’en allait en chantant, ce brave garçon, il revenait de même ; la Rose, qui l’entendait de loin, accourait au seuil de sa porte, sautait au cou de son homme, et le débarrassait de sa pioche et de son bissac. Pauvre femme ! toujours aussi aise et amoureuse de son Jean-Louis, après un an de mariage, que le lendemain de ses noces. Aussi, tenez, monsieur, si la Rose et son homme n’avaient pas eu ces maudits enfans… ils seraient encore à cette heure tranquilles et heureux dans cette maison ; en supposant que l’ouvrage ne leur ait jamais manqué ils auraient continué de me payer exactement leur loyer à la Toussaint comme ils l’avaient payé pendant la première année, et je n’aurais pas été obligé, bien à regret, de les renvoyer. C’est en sortant d’ici qu’ils ont été demeurer dans cette espèce de tanière isolée, tout là-bas à la lisière du bois Rêné, eux et leurs deux enfans, car alors ils n’avaient encore que deux enfans. Mais, monsieur, ne parlons pas de ce mauvais temps-là, c’est à faire saigner le cœur. ………………………………………………………………………………………………………………………. Ce naïf récit peut donner une idée de ces jours de bonheur dont me parlait Jean-Louis, jours de bonheur, hélas ! bientôt écoulés, mais qui, me disait-il, lui ôtaient presque le droit de se plaindre de ses jours d’adversité ! J’entends d’ici un fervent catholique s’écrier : - « Votre Jean-Louis et sa femme, s’ils deviennent malheureux, subiront la peine de leur impiété ; ils n’allaient le dimanche, ni à la messe, ni à vêpres ; là, ils auraient trouvé ces consolations morales,ce rafraîchissement de l’esprit et de l’âme, si admirablement, si religieusement dépeints, l’autre jour, par notre illustre Montalembert, qui enjoignait si fièrement, au pouvoir, de décréter l’observation forcée du dimanche au nom de la foi de Clovis et de Jeanne d’Arc ! » Nous prouverons par la suite de ce récit que l’instruction religieuse (à la façon dont l’entend et la donne le parti clérical) eût empiré, s’il est possible, la position de Jean-Louis et de la Rose ; mais, sans sortir de notre sujet, nous dirons deux mots de l’orateur catholique à propos de la loi sur l’observation du dimanche. Oui, M. de Montalembert a osé invoquer la foi de Clovis, le roi des Franks ! ce bandit, ce pillard, ce meurtrier couronné, ce féroce conquérant de la Gaule, notre mère-patrie, favorisé dans cette conquête sanglante, dévastatrice, par l’infâme complicité des évêques gaulois ; puis choyé, caressé, loué, béni, baptisé par ces prêtres renégats, avides de partager avec ce roi barbare les terres, les richesses et le gouvernement de la Gaule conquise, ravagée par le pillage, l’incendie et le massacre ; honte et exécration sur eux ! répétons-le sans cesse. Ces évêques et leurs successeurs, ces prétendus apôtres du Christ, ont eu dès lors des esclaves ; des esclaves, Gaulois comme eux, qu’ils ont vendus, achetés, exploités, puisque l’église catholique a possédé des esclaves, des serfs et des vassaux depuis le cinquième siècle jusqu’en 1789. Oui, M. de Montalembert a osé prononcer sans rougeur au front le nom de Jeanne d’Arc, l’immortelle fille du peuple, cette héroïne qui, en expiation de son patriotisme et de sa gloire, fut torturée, puis brulée vive par le clergé… cela va de soi ; l’Eglise a chanté les louanges de Clovis, l’abominable conquérant de notre sol, et elle a brûlé Jeanne, qui a délivré la patrie du joug des Anglais. Ces monstruosités, débitées avec la grâce ingénue et l’ardeur virginale d’un jeune inquisiteur soupirant après son premier auto-da-fé, ne m’ont point étonné, Rome n’a point été bâtie en un jour, et de l’observation forcée du dimanche à la loi du sacrilége, il y a tout au plus la largeur d’un bûcher ; mais, moins rompu que je le suis aux roueries de sacristie (les plus diaboliques de toutes), je me serais laissé aller à quelque surprise, lorsque l’orateur catholique vint à s’apitoyer, dévotement, chrétiennement, s’il vous plaît, sur le sort des classes laborieuses, indignement exploitées, écrasées, disait-il, par l’égoïsme, par la cupidité des privilégiés, riches endurcis, qui s’opiniâtrent à ne voir dans le travailleur qu’une bête de somme, et ne prennent aucun souci de son intelligence et de son âme. Si séduisantes que me parussent ces prémisses, j’attendis leur conclusion, et fis bien ; l’orateur catholique déplorait, flétrissait, condamnait, il est vrai, au nom de la fraternité chrétienne, l’égoïste et cupide exploitation des classes laborieuses ; mais il ne la déplorait, il ne la flétrissait, il ne la condamnait qu’un jour sur sept, à savoir le dimanche, parce qu’elle empêchait le travailleur d’aller à la messe ; de sorte que M. de Montalembert aurait sa fraternité des dimanches, de même que les bonnes gens ont leur habit des dimanches ; oui, écrasez, abrutissez votre prochain le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc., l’orateur catholique s’en soucie peu ; mais le dimanche, oh ! oh ! le dimanche, c’est autre chose. Mieux que cela. M. de Montalembert, qui l’autre jour s’essayait à une homélie quasi-socialiste prêchée avec la conviction que vous savez ; M. de Montalembert s’est toujours montré l’un des plus impitoyables adversaires de toutes les réformes qui tentaient à affranchir les travailleurs du servage, industriel ou agricole, où ils végètent ; à assurer leur travail, à élever le taux de leurs salaires, et à leur donner ainsi le loisir d’éclairer leur esprit, de développer leur intelligence par l’instruction ; liberté de réunion, liberté d’association, liberté d’écrire, liberté de penser, liberté d’enseigner, droit au travail ou à l’instrument de travail, droit à l’éducation, crédit foncier, abolition de certains impôts, progression de certains autres ; répétons-le, toutes les mesures qui pouvaient, qui devaient moralement et matériellement émanciper le prolétaire des villes ou des champs, et l’arracher à la cruelle fatalité de la misère et de l’ignorance, M. de Montalembert les a combattues, repoussées, insultées ; bien plus, lui aujourd’hui, si pitoyable pour la vile multitude, n’a-t-il pas été l’un des plus fanatiques promoteurs de la loi contre le suffrage universel, loi d’exclusion, qui atteint dans leur droit imprescriptible, souverain, la majorité de ces travailleurs, en faveur desquels l’orateur catholique se montre si subitement épris de la tendresse des dimanches… Et pourtant, ce droit souverain, légalement, dignement exercé, ainsi qu’il l’avait toujours été jusqu’alors, pouvait seul… seul affranchir un jour le travailleur de ce joug écrasant, qui, selon les ultramontains, ne devient odieux, inique, impie, qu’au jour et à l’heure de la messe. En un mot, M. de Montalembert ose à la face du pays se permettre la détestable plaisanterie cléricale que voici : « Grâce à six mois de catéchisme et à deux heures de messe en latin, les victimes d’un labeur écrasant et d’une ignorance odieusement calculée, entretenue par le parti prêtre et les gouvernans, trouveront, dans la pratique des offices divins, de telles consolations, un tel rafraîchissement de l’esprit et de l’âme (sic) qu’ils retourneront allégrement chaque lundi reprendre leur joug hebdomadaire ! Leur misère atroce, celle de leur famille, les dures souffrances d’un travail sans merci ni pitié, l’incertitude du lendemain, le chômage forcé qui ôte le pain, tous les maux enfin qui pèsent si douloureusement sur les travailleurs des champs et des villes, seront conjurés par l’audition des offices, et les exploiteurs pourront désormais continuer de trafiquer en paix de la chair et de l’âme de leur prochain, à la condition de le laisser aller à la messe. » - Mon Dieu ! monsieur de Montalembert, nous concevons, nous apprécions comme il convient les devoirs, les engagemens de toute nature que vous a imposés votre titre officiel et récent de sacristain de Rome, de grand sacristain si vous voulez ; nous comprenons votre belliqueuse impatience à l’endroit de cette campagne de Rome à l’intérieur, dont vous nous avez si intrépidement menacés, pauvres libres penseurs que nous sommes. Hélas ! nous avons grand peur, oui, grand peur nous avons. Voici pourquoi. L’on nous dit que vous haïssez également la branche cadette et la branche aîné des Bourbons ; nous le croyons sans peine, vous haïssez fort et beaucoup, l’on ajoute que vous rêvez une RÉPUBLIQUE THÉOCRATIQUE composée ainsi qu’il suit : Pour président, un CARDINAL ; Pour assemblée nationale, un CONCILE ; Pour préfets, les ÉVÊQUES ; Pour maires, les CURÉS ; Pour tribunal suprême, l’INQUISITION ; Pour force armée, une manière de SAINTE-HERMANDAD, gendarmerie inquisitoriale chargée d’appliquer les arrêts de ladite inquisition. Cette société, dans le goût de celle que les bons pères jésuites ont fondée au Paraguay, est votre idéal : la fameuse campagne de Rome à l’intérieur aurait pour but l’établissement de cette adorable république théocratique ; aussi, nous vous le répétons humblement, grand peur nous avons, car nous n’ignorons point que, généralissime de l’armée noire, vous disposez d’une force régulière d’environ quarante quatre mille goupillons, sans compter d’inombrables troupes de partisans, comme qui dirait les cosaques catholiques. C’est formidable, et quoique vous ayiez tout récemment eu le malheur de perdre le brave capitaine Gothland, et cet autre vaillant frère ignorantin qui eut, il y a trois jours, le désagrément d’être condamné aux galères pour avoir violé un enfant, nous savons que vous réparerez facilement ces pertes douloureuses ; le combat va donc s’engager : votre loi dominicale est une affaire de tirailleurs, le premier acte de cette belle guerre sainte où vos hommes noirs s’en vont aller avec la croix et la bannière à la conquête de la république théocratique ; cependant, tout en concevant parfaitement l’ardeur batailleuse qui doit bouillonner au cœur d’un grand sacristain tel que vous, il nous afflige de vous voir commencer une si grande, une si sainte croisade par un acte où les méchans pourraient voir une misérable querelle de boutique entre la sacristie et le cabaret. Vraiment, à nous autres hérétiques, il répugne de voir mêler l’auguste nom de Dieu à ces querelles, qui finiraient par trop ressembler à ces jalousies de trafiquans cherchant qui l’un, qui l’autre, à s’enlever leurs pratiques. Nous respectons toutes les religions ; quel que soit leur dogme, elles correspondent à un invincible besoin de l’âme ; mais, à l’inverse des ultramontains, nous pensons que si les religions améliorent les gens assez éclairés pour en extraire les vérités saines et pratiques, les religions mal digérées, mal comprises, empirent les ignorans, en faisant d’eux d’aveugles ou de dangereux fanatiques. Commencez donc par assurer aux travailleurs l’instruction et un salaire assez certain, assez élevé, pour qu’après leur labeur quotidien ils aient le loisir d’étudier, d’apprendre, de comparer, de méditer, de mûrir leur raison, d’exercer leur esprit par le libre examen ; alors, et à mesure que leur intelligence se développera, grandira, tous abandonneront d’eux-mêmes les cabarets pour les bibliothèques ; et bientôt, le sentiment véritablement religieux viendra pénétrer leurs âmes ; du fini, ils marcheront forcément vers l’infini, vers l’idéal, progressant toujours dans ces recherches si salubres pour l’âme, qui nous conduisent tôt ou tard à l’affirmation raisonnée de la divinité, qui n’est autre chose que la VÉRITÉ… Ce peuple, ainsi éclairé, convaincu, ne sera pas religieux à la façon des gens de Rome, car son bon cœur et son bon sens se révolteront contre cet abominable blasphème : « Dieu a créé ses créatures pour la misère et la douleur. » Non, ce peuple aura une foi profonde à l’amélioration continue, progressive, infinie de l’humanité, dans l’ordre moral et dans l’ordre matériel. Cette foi, le peuple la pratiquera en s’employant corps et âme à faire disparaître du monde cette horrible trinité du mal : l’IGNORANCE, la MISÈRE, et l’OISIVETÉ. Alors, honorant Dieu par le travail, par la diffusion du bien-être, par le développement des facultés de tous, pratiquant le bien, l’homme, enfin, délivré de l’hébêtement ou d’ambitieux et cupides hypocrites tenaient son esprit enchaîné, suivra pour toujours la divine inspiration de ses instincts naturels et de ses vertus originelles. Ceci dit, revenons à la Rose et à Jean-Louis. EUGÈNE SUE.
NOTE : (1) Voir la Liberté de penser du mois de novembre 1850. *
* * ___
TROISIÈME ARTICLE (1) ___ Jean-Louis quitta la petite maison, où il avait connu quelque bonheur durant deux années de sa vie, et alla demeurer, avec sa femme et ses enfans, vers la lisière du bois Réné ; il occupait une masure dépendant d’une ancienne métairie tellement délabrée, que le fermier l’avait quittée pour aller habiter d’autres bâtimens d’exploitation. « - Ce logement que j’abandonne – dit le cultivateur à Jean-Louis – est devenu presqu’inlogeable, faute de réparations ; le propriétaire ne peut pas les faire, elles sont trop coûteuses ; il a préféré me donner deux chambres dans l’une de ses granges neuves. Veux-tu habiter ici ? Tu me paieras quinze francs par an, ça n’est pas lourd ; je te demanderai seulement de veiller sur un grenier où je continuerai de mettre mes fourrages, de même que je conserve la bergerie pour mon troupeau. » Jean-Louis accepta cette offre ; car, à mesure que sa famille augmentait, il voyait sa position devenir de plus en plus pénible : les tristes prévisions de maître Brossard se réalisaient : la Rose luttait avec une vaillance héroïque contre les envahissemens de la misère ; lors de la naissance de son premier enfant, elle avait eu le courage d’aller à l’herbe, au bois ou en journée (lorsqu’elle trouvait du travail) jusqu’à son huitième mois de grossesse. - Ah ! Monsieur – me disait plus tard Jean-Louis, les larmes aux yeux – combien de fois j’ai vu ma chère femme, enceinte de sept ou huit mois, revenir à la maison, courbée sous le poids d’une lourde charge et pouvant à peine marcher ! – Mais ça n’a pas de bon sens ! – lui disais-je – c’est risquer de te tuer. – Alors la Rose me répondait : – Mon pauvre homme, faut se dépêcher de jouir de notre reste… et amasser notre provision de bois pour l’hiver ; car, lorsque je serai accouchée, mon enfant me prendra tout mon temps, me retiendra à la maison ; faut donc que j’aille tant que je le pourrai. » La Rose, en effet, alla tant qu’elle put, comme elle le disait : les heures qu’elle passait au logis, elle les employait à préparer et à coudre sa layette, taillée dans des chemises à elle ; sa pauvreté l’empêchant d’acheter du linge neuf. La naissance de son premier-né faillit la rendre folle de bonheur. Elle avait enfin un enfant à elle !... selon le vœu le plus ardent de son cœur. Ce bonheur, Jean-Louis le partagea : il y trouva presque l’oubli des privations croissantes de sa vie, déjà si rude ; un seul chagrin se mêlait aux premières joies maternelles de la Rose, c’était l’inactivité forcée où elle se voyait souvent réduite durant la journée, tant que durait le sommeil de son enfant qu’elle couvait des yeux. Ce fut un beau jour pour elle que celui où elle eut la pensée d’apprendre à filer ; elle y réussit ; on lui confia du chanvre : elle put ainsi gagner quelques sous par semaine… Vint une seconde grossesse, un second enfant ; malheureusement, Jean-Louis resta quelque temps sans trouver d’ouvrage, et, pour la première fois depuis son mariage, il fut obligé d’acheter son pain à crédit. En me parlant de ce temps de chômage prolongé, Jean-Louis me disait plus tard : - Ah ! Monsieur ! si vous saviez combien c’est triste ! se sentir plein de bonne volonté, plein de courage ! ne demander qu’une seule chose au monde : du travail ! et en manquer ! Le cœur vous saigne, quand on se voit forcé de rester les bras croisés à côté d’une femme et de deux enfans qui n’ont que vos bras pour vivre. Comment donc faire ? On ne peut pas se faire voleur, pourtant ? » Ce fut en suite de ce chômage et des petites dépenses nécessitées par les deux accouchemens de sa femme que Jean-Louis, n’ayant pu payer le loyer de la maison qu’il avait d’abord occupée, se vit obligé d’aller s’établir dans cette ferme à demi-abandonnée sur la lisière du Bois-Réné. Ce fut là qu’environ huit à neuf ans après son mariage je vis pour la première fois la Rose et Jean-Louis ; cette scène m’est encore présente à l’esprit. Je revenais chez moi, vers la fin d’une froide journée d’automne, laissant à ma gauche une immense plaine de bruyère coupée çà et là de pièces de terres récemment défrichées ; à l’horizon, une ceinture de grands bois de sapins s’étendait à perte de vue ; à ma droite était un épais taillis de chênes, et non loin de là, cette ferme abandonnée où demeuraient Jean-Louis et sa famille depuis plusieurs années. Selon l’usage, ces constructions rustiques entouraient de trois côtés une cour dont les pentes rapides aboutissaient à une cavité où séjournaient les eaux pluviales, et où l’on entassait le fumier de la bergerie. Les bâtimens de pisé, aux toitures de tuiles moussues ou de chaume devenu verdâtre par la vétusté, étaient dans un état de délabrement complet ; les murailles ici éboulées en un monceau de décombres, ailleurs crevassées, lézardées, ne se soutenaient qu’à l’aide d’étais formés de grands troncs de sapins encore couverts de leur écorce. Pourris par la pluie, les chevrons du toit des greniers fléchissaient sous le poids des tuiles disjointes ou brisées ; en d’autres endroits, les bâtimens, absolument découverts, n’avaient plus pour faîte que la charpente et son lattage à demi-détruit ; la bergerie seule paraissait moins en ruine ; les ais des portes vermoulues, renforcés de quelques planches neuves, offraient une fermeture capable de résister aux entreprises des loups rôdeurs, si nombreux dans notre pays. Un humide bouillard d’automne, voilant ce tableau, lui donnait un aspect lugubre. Il pouvait être cinq heures de l’après-midi ; mais l’atmosphère était si brumeuse, que le jour semblait toucher à sa fin ; je passais à quelque distance des bâtimens, lorsque soudain j’entendis les cris perçans de plusieurs enfans. Quittant aussitôt le sentier que je suivais, j’entrai précipitamment dans la cour ; quatre enfans hâves, décharnés, à peine vêtus de guenilles et dont le plus âgé avait sept ans au plus, le plus jeune deux ou trois ans, sortaient d’une petite porte, d’où s’exhalait une épaisse fumée, les uns se culbutant, les autres courant, et tous criaient en se sauvant : - Le feu !... le feu !... Lorsque j’arrivai à cette porte, je fus un instant aveuglé par la fumée ; mais le danger était moindre que je ne le soupçonnais. A quelques pas du foyer, où flambaient encore quelques bruyères sèches, une femme, adossée à la muraille, gisait étendue sur un tas de bremailles auxquelles le feu venait de se communiquer sans doute par l’imprudence des enfans. Saisissant sur un lit une vieille couverture, j’étouffai en une seconde la flamme des bruyères embrasées, qui commençait à s’approcher des pieds de cette femme ; mais, à ma grande surprise, elle ne bougea pas. Je me baissai pour lui toucher la main, cette main était moite ; et elle retomba lourdement aux côtés de cette femme ; elle semblait profondément endormie. Je l’examinai plus attentivement : elle pouvait avoir trente ans au plus ; ses cheveux blonds, déjà mêlés de quelques cheveux blancs, sortaient en désordre, poudreux, emmêlés, d’une vieille coiffe déchirée ; elle portait une camisole d’indienne en lambeaux et un jupon dont je ne saurais dire l’étoffe et la couleur, il se composait de toutes sortes de haillons rapiécés ; les jambes et les pieds de cette malheureuse étaient nus ; heureusement le feu ne les avait pas atteints ; son sommeil semblait si lourd, si profond, que rien ne l’avait troublé, ni les cris des enfans, ni l’âcre épaisseur de la fumée, ni l’approche des flammes. Sa figure, hâve, maigre, tannée par le soleil, conservait quelques restes flétris d’une ancienne beauté. Cependant l’expression de ses traits, empreints d’une sorte d’hébétement morbide, était presque repoussante. Ce sommeil invincible m’inquiétait ; en vain je m’approchai d’elle, l’appelant à haute voix, prenant sa main, la secouant, tout fut inutile ; cette malheureuse ne sortit pas de sa torpeur ; elle tourna seulement sa tête du côté de la muraille en murmurant quelques paroles inintelligibles ; lorsqu’elle entr’ouvrit les lèvres, il s’en exhala une forte odeur d’eau-de-vie. Je n’en doutai plus, cette femme était ivre-morte. Cette femme, ainsi que je l’appris quelques instans après, cette femme, c’était la Rose ! J’entendis des pas dans la cour ; je vis entre Jean-Louis, son bissac sur le dos, sa pioche sur l’épaule, accompagné, de son fils aîné, âgé de huit ans, pieds nus et à peine couvert de quelques guenilles. Ce pauvre enfant, d’une douce et pâle figure, tâchait de gagner déjà le morceau de pain qu’il mangeait. Moyennant quatre à cinq sous de salaire, il chassait à coups de pierre les bandes de corbeaux qui venaient déterrer les semailles d’automne à peine enfouies dans les champs voisins de ceux que défrichait son père ; derrière Jean-Louis et son fils aîné, s’avançaient timidement les quatre autres enfans, craignant d’être grondés pour l’imprudence qu’ils s’attendaient à me voir révéler. Ils restèrent en dehors, groupés sur les pierres disjointes qui servaient de marches à la porte. Jean-Louis ne me connaissait pas ; à ma vue, son visage s’assombrit ; son premier mouvement fut de chercher sa femme du regard ; en la voyant immobile et couchée sur le monceau de bruyères, il devina tout ; son visage, se couvrant d’une vive rougeur, exprima l’amertume, la honte : une larme lui vin[t] aux yeux… L’âge, l’étude, l’expérience des hommes m’ont rendu quelque peu physionomiste. La loyale figure de Jean-Louis trahit une douleur si poignante qu’il m’inspira tout d’abord un vif intérêt. - Le hasard m’a conduit ici, – lui dis-je. – Les cris de vos enfans m’ont appris que le feu était dans cette chambre. La flamme a été étouffée en un instant ; heureusement votre femme n’a pas été atteinte. A ces mots, qui lui apprenaient le péril couru par la Rose, Jean-Louis prit mes deux mains, les serra dans les siennes avec reconnaissance et courut auprès de sa femme s’assurer qu’elle avait échappé aux brûlures. Il la contempla en silence pendant quelques minutes, en proie à un abattement douloureux. Il me parut plus affligé que surpris de la voir dans l’état d’hébêtement où elle se trouvait plongée ; puis, revenant à moi, il me dit d’une voix pénétrée : - Monsieur, je vous en conjure, ne méprisez pas ma pauvre femme !... Hélas !... si vous saviez ? – Puis, après avoir porté ses mains à ses yeux humides, il répéta d’un air presque suppliant : – Je vous dirai tout… Mais, pour l’amour de Dieu, ne la méprisez pas !... – Et comme je le regardais, surpris de ces paroles, qui me semblaient incompréhensibles, il ajouta tristement : – Vous ne me croyez pas, Monsieur ? - Je vous vois aujourd’hui pour la première fois, – lui dis-je, – mais je vous crois incapable de mentir. - Monsieur, puisque vous êtes du pays, vous devez connaître maître Brossard ? - Je le connais, en effet. - Eh bien !... avant de mépriser ma pauvre femme… demandez à maître Brossard s’il a jamais eu à se plaindre de la Rose tant qu’elle a été pôque chez lui. En disant ces mots, Jean-Louis alla vers le lit, composé d’une énorme paillasse, écarta quelques haillons qui la couvraient…, prit sa femme entre ses bras robustes, la déposa sur cette couche, ramassa la vieille couverture dont je m’étais servi pour éteindre le feu, l’étendit aux pieds de Rose, toujours inerte, et qui, pendant que son mari la transportait du coin du foyer sur le lit, avait murmuré quelques paroles sans suite. Les enfans, peu à peu rassurés, rentrèrent dans la chambre. Ils allèrent s’asseoir sur un autre grabat, où ils couchaient tous ensemble. Je ne vis d’autres meubles dans ce misérable logis qu’une table boiteuse, un escabeau, une chaise, un vieux coffre, une hûche pour le pain, au-dessus de laquelle étaient cloués le congé de Jean-Louis et ses épaulettes de grenadier : pauvre soldat ! après avoir, ainsi que tant de ses frères, qui presque seuls la paient… payé la dette du sang à son pays, comme eux aussi, il ne devait trouver au retour de l’armée que douleur et misère ! Au coin de l’âtre, je vis encore une marmite en fonte ; sur une planche, quelques écuelles en faïence et deux ou trois pots de grès ; en plusieurs endroits le plafond, si bas que je pouvais à peine me tenir debout, eût été à jour sans une épaisse couche de bottes de genêts qui, reposant sur les solives, mettait à peine cette demeure à l’abri des injures du temps. Le toit, complétement effondré, ne la protégeait plus ; car, une pluie battante ayant succédé au brouillard d’automne, j’entendis l’eau ruisseler au dehors, et, filtrant bientôt à travers les genêts entassés qui, en plusieurs endroits, remplaçaient le plâtrage du plafond défoncé, elle tomba goutte à goutte çà et là sur le sol terreux de la chambre. Je ne saurais dire la morne tristesse de cette scène : ces enfans silencieux, inquiets ; ce malheureux journalier, rentrant chez lui après ses durs labeurs, trouvant sa femme dans un état voisin de l’idiotisme et sa famille à l’abandon. Je le répète, cette scène était nâvrante. Jean-Louis jeta sur le foyer à demi éteint quelques poignées de bruyères, et me dit : - Monsieur, attendez ici la fin de l’averse ; il pleut trop fort pour que cela dure longtemps. Je m’assis au coin du foyer sur l’escabeau ; Jean-Louis quitta son bissac, ôta ses sabots usés, approcha du feu ses pieds nus bleuis par le froid, et s’adressant à ses enfans : - Nous allons souper, vous devez avoir faim, apporte le pain et le fromage, ma petite Jeanne, et toi, Jacques, va tirer au puits un seau d’eau. Jeanne, la fille aînée de Jean-Louis, âgé d’environ sept ans, était pâle, décharnée comme ses frères et sœurs, pieds nus comme eux et comme eux à peine vêtue de quelques guenilles ; elle alla vers la mé, l’ouvrit, rapporta sur une assiette de terre ébréchée un petit morceau de fromage dur, et le plaça sur la table auprès de son père. - Où est le pain ? – lui dit Jean-Louis, – tu oublies le pain… ma petite Jeanne. - Papa… il n’y en a pas. - Comment ! est-ce que tu n’es pas allée, ce matin, au bourg chercher un pain ? J’avais donné pour cela seize sous à ta maman ? - Maman m’a dit : veille sur tes petits frères et sur tes sœurs, j’irai au bourg chercher le pain, mais elle n’a rapporté qu’une bouteille. - Tonnerre de Dieu !... voilà ces enfans sans pain ! – s’écria Jean-Louis en frappant du pied. Puis, regrettant sans doute ce mouvement de colère, il murmura avec abattement : - Mon Dieu ! mon Dieu ! Après un nouveau moment de silence, il parut se ressouvenir, et dit à son fils aîné : - Jacques, donne-moi mon bissac. L’enfant apporta la poche de grosse toile grise ; Jean-Louis y fouilla, en tira un morceau de pain bis d’une demi-livre environ, restant de son repas de midi, le coupa en six parts, s’en réserva une et distribua les autres aux enfans avec autant de petits morceaux de fromage ; en un instant ils dévorèrent cette maigre pitance qui, loin d’apaiser leur faim, dut l’irriter. Le cruel égoïsme de cette mère, qui, pour satisfaire à un vice odieux, affamait ses enfans, me révoltait, Jean-Louis m’avait supplié de ne pas mépriser sa femme (je ne savais encore rien des antécédens de La Rose), mais je ne voyais dans cette recommandation qu’une preuve de fâcheuse faiblesse ; devinant ma pensée, le journalier me dit : - Vous ne voudriez pas me croire, monsieur ? si je vous disais que la pauvre femme que vous voyez là, était un miracle de bonne conduite et de courage avant qu’elle se soit adonnée à l’eau-de-vie… il y a de ça trois mois au plus. - Mais comment une si funeste habitude lui est-elle venue ? - Par hasard, ou plutôt par ma faute. - Par votre faute, à vous ! - Oui, monsieur, faute involontaire, sans doute, je vous avouerai même, et je vas vous sembler bien coupable, que je n’ai peut-être pas fait ce que j’aurais dû faire pour guérir ma pauvre femme de sa mauvaise habitude ; maintenant, il est trop tard pour l’en corriger. - Mais quelles circonstances ont pu vous rendre d’abord indulgent pour un penchant si fâcheux ? - Hélas, monsieur, le chagrin de la voir souffrir, car elle a souffert, voyez-vous, comme pas une mère n’a souffert ! Elle aimait tant ses enfans ! je dis qu’elle les aimait, parce que maintenant, je parle d’elle comme d’une morte… ̶ ajouta Jean-Louis en portant sa main à ses yeux. – Quand elle n’a pas bu, elle est presque comme idiote ; elle s’accroupit dans un coin, ses coudes sur ses genoux, son menton dans ses deux mains, et elle ne décesse pas de pleurer. Au moins, quand elle a bu, elle ne pleure pas, elle oublie tout. - Mais cette malheureuse femme est donc folle ? - Non, monsieur, pas tout à fait ; elle me reconnaît, elle reconnaît aussi ses enfans, mais elle est comme brisée, puis elle a des absences. - Vous la disiez autrefois si vaillante au travail ? si bonne mère… ? comment ce changement dans sa conduite s’est-il opéré ? - Tant que nous n’avons eu que deux enfans, monsieur, notre sort, quoique très-dur, était supportable, le pain ne manquait pas à la maison ; mais à mesure que notre famille s’est augmentée, notre misère aussi a augmenté. Pour comble de malheur, le chômage est venu à plusieurs reprises, sans compter la morte saison ; enfin, il nous a souvent fallu mesurer nos bouchées ; sauf une mauvaise blouse et un pantalon de toile pour moi, un jupon et une camisole pour la Rose, le peu d’effets que nous possédions a été employé par elle à vêtir ses enfans ; ce sont les derniers lambeaux de ces vêtemens qu’ils portent aujourd’hui. - Dans une si extrême détresse, n’auriez-vous pu vous adresser à quelqu’un ? - Chacun a sa fierté, monsieur… j’ai la mienne, jamais je n’ai tendu la main à personne… pour emprunter, il faut pouvoir rendre, et comment pouvoir rendre lorsque l’on gagne à peine vingt sous par jour ? et que l’on est six personnes à vivre là-dessus ? Nous avons passé de durs momens ; mais le courage de ma pauvre femme ne faiblissait pas… Enfin est venu un jour où il ne lui servait plus à rien, son courage !... c’est ce qui l’a perdue, oui, monsieur, car enfin, tant que les enfans ont eu quelques guenilles de rechange à savonner, quelques haillons à recoudre, ma femme a travaillé tout en allaitant son dernier-né et en veillant sur les autres : mais lorsqu’ils n’ont plus eu sur le corps que leurs dernières guenilles, qui n’étaient même plus raccommodables, elle passait son temps à embrasser ses enfans et à pleurer… elle ne pouvait faire autre chose ! pour aller au bois, il lui aurait fallu les laisser seuls, ils étaient encore trop petits, elle n’osait sortir. Trop pauvre pour vivre d’autre chose que de pain et de fromage, nous ne mangions que cela, aussi la cuisine était finie quand ma femme avait détrempé pour les plus jeunes de nos enfans un peu de mie de pain dans de l’eau tiède… Ni moi, ni elle, nous ne possédions d’autres hardes que celles que nous portions… elle n’avait pour ainsi dire rien à laver, rien à raccommoder, rien à faire ! Enfin elle se trouvait bourgeoise…. – ajouta Jean-Louis avec un accent qui me navra, parce que jamais je n’avais réfléchi à cette effrayante oisiveté forcée, dernière et horrible conséquence de la misère. - Le peu que je gagnais, – poursuivi le journalier, – je le gardais pour acheter du pain, de crainte d’en manquer un jour ou l’autre, et pour payer le loyer de notre masure… vaut encore mieux avoir une retirance et un morceau de pain que des habits ; j’étais tout le jour dehors, ma femme gardais les enfans. Elle avait dans les commencemens trouvé un peu de chanvre à filer… ça n’a pas duré longtemps : – « Ah ! mon pauvre homme ! – me disait-elle souvent, – c’est mourir à petit feu que de vivre ainsi ! J’ai encore de bons bras, du courage, je suerais mon sang à gagner quelques sous pour acheter de quoi vêtir ces chers petits qui grelottent sous des haillons, et je ne trouve rien à gagner… d’ailleurs, on me donnerait de l’ouvrage au dehors, que je ne pourrais pas l’entreprendre… qui garderait nos enfans ? l’aîné n’a pas encore six ans, et je nourris le dernier… Enfin, je ne peux pas seulement aller couper des bremailles ou ramasser du bois pour nous chauffer l’hiver ; il faut encore que ce soit toi qui ailles quelquefois, pendant les clairs de lune, faire notre provision, après t’être carnagé toute la journée ; à moins que tu n’aies pas d’ouvrage, alors c’est du bois trop cher, puisque ces jours-là tu ne gagnes pas de pain. » – Cela, monsieur, me fendait le cœur, d’entendre ainsi parler la Rose ;… mais que faire ? Enfin, il y a six mois, un de nos enfans tombe malade d’un gros rhume : ma femme, je vous l’ai dit, nourrissait son dernier… c’était à la fin de l’hiver, il faisait grand froid ; elle fut toute une nuit levée, pieds nus, comme toujours… elle eut un accident de lait, il tarit tout d’un coup. D’abord, nous avons cru que ça ne serait rien, d’autant plus que la Rose songeait à sevrer l’enfant ; elle avait si peu de lait, faute d’une bonne nourriture ! Cependant, depuis cet accident, peu à peu le caractère de ma femme a changé ; elle restait des heures sans rien dire et comme engourdie, ou bien elle pleurait ; si le soir, en rentrant, je lui parlais, elle me répondait à peine ou d’un air égaré ; souvent aussi elle me disait : « Jean-Louis, à quoi donc ça sert-il que je sois au monde ? Je ne suis bonne à rien pour mes enfans ? mon temps se passe à les voir souffrir ! » – D’autres fois, elle regardait autour d’elle comme si elle eût été dans un endroit nouveau et me demandait : « Où sommes-nous donc, Jean-Louis ? – Mais, chez nous, la Rose… pourquoi t’étonner ainsi ? – « Je ne sais pas, – me répondait-elle, – j’ai parfois comme des absences. » - Vous jugez, Monsieur, – reprit Jean-Louis après un moment d’abattement, – quel crève-cœur pour moi ! Rentrer ici, et voir ma femme en larmes, ou dans un silence plus triste encore que ses larmes. Heureusement, j’étais si fatigué, que je dormais presque toute la nuit. Il arriva qu’un jour, M. Roussel, pour qui je défrichais, me donna une bouteille de l’eau-de-vie qu’il distille chez lui avec son marc de raisin, et me dit : « Tiens, Jean-Louis, accepte-ça d’amitié, tu pourras boire la goutte le matin, avant l’ouvrage ça te donnera des bras et des jambes. » Je n’ai pas refusé, car depuis bien longtemps je ne buvais pas de vin ; mais de la boisson que nous faisions avec de l’eau et des graines de genèvrier, quand j’avais le temps d’en aller chercher. J’emporte la bouteille ; le lendemain matin, au moment de partir, je bois une goutte, et je dis à ma femme : – « Tiens… prends un peu d’eau-de-vie, çà te reconfortera… toi qui te plains toujours de ta faiblesse d’estomac. » La Rose boit à peine une gorgée d’eau-de-vie, et me dit : « C’est trop fort… ça brûle ! » Je n’ai pas été surpris, Monsieur, que ma femme trouvât ça trop fort… elle n’en avait jamais bu. Je m’en vas aux champs, le soir je reviens, j’entends de loin chanter la Rose… cela m’étonne ; car depuis bien longtemps elle ne chantait plus… J’entre ici, qu’est-ce que je vois…? Les enfans riant aux éclats, et ma pauvre femme riant plus fort qu’eux en leur faisant mille singeries. – « Jean-Louis, – cria-t-elle en me voyant, – nous allons danser comme à ma noce ! » et sans attendre que j’aie seulement ôté mon bissac, elle me prend d’une main et mon aîné de l’autre, afin de commencer une ronde. Cela, Monsieur, m’effraya… la Rose était comme folle. Une idée me vient, je cours à la mé où j’avais serré la bouteille, je la regarde… ma femme en avait peut-être bu deux petits verres… il ne lui en fallait pas tant pour la griser… Alors, je devine tout… Je tâche de la calmer, mais la voilà qui parle, qui parle, et se met à discourir sur les premiers temps de notre mariage ! sur deux beaux rosiers que nous avions dans notre ancien jardin ? sur une petite tonnelle que nous avions aussi. Enfin, elle se met à parler de notre bon temps passé comme s’il durait encore. Chacune de ses paroles était un coup de poignard pour moi ; plus la Rose paraissait contente, plus je me sentais, moi, la mort dans l’âme ; je savais ce qui l’attendait, lorsqu’elle retrouverait sa raison ; ça n’a pas tardé, peu à peu, elle a cessé de discourir ; puis, à mesure que sa tête se calmait, elle redevenait de plus en plus triste. Enfin, elle s’est endormie… J’ai couché les enfans. Vers le milieu de la nuit, la Rose s’est éveillée, alors elle m’a dit en pleurant : « Ah ! mon pauvre homme ! j’ai grand’honte. Je ne veux pas te mentir… la petite goutte d’eau-de-vie que tu m’as donnée ce matin m’avait d’abord brûlé les lèvres ; mais après, je me suis sentie étourdie et ensuite si gaie, si gaie, que j’ai eu envie de chanter… je ne pensais plus à mes enfans ni à toi alors, j’ai été à ta bouteille, j’ai bu à même, et je ne sais plus ce qui s’est passé. » – Que voulez-vous, Monsieur ? je n’ai pas eu le cœur de gronder ma femme. Je lui ai seulement dit : – « La Rose, tu as eu tort de boire de l’eau-de-vie, ça aurait pu te faire beaucoup de mal, promets-moi de ne plus recommencer. – Je te le promets, Jean-Louis, m’a-t-elle répondu ; » pendant quelques jours elle m’a tenu parole ; mais elle ne faisait que pleurer en regardant ses enfans, ou bien elle restait quelquefois des jours entiers sans prononcer un mot et semblait regretter quelque chose : je vous le jure, Monsieur, j’étais si nâvré de la voir en cet état que, vingt fois, j’ai été sur le point de lui dire : – Tiens, bois, pauvre femme, bois et oublie ton chagrin ! Enfin, il y a trois mois, en pleine moisson, j’avais reçu dix francs pour ma semaine, la plus forte que j’aie touchée ; je prends quatre francs pour le boulanger, j’enveloppe les autres six francs dans un chiffon et je le mets dans la mé, au fond d’un pot de grès (cela devant la Rose). Je gardais cet argent pour payer une partie de notre loyer à la Toussaint ; le matin, je m’en vas aux champs ; le soir, je reviens, je trouve ma pauvre femme dans un vrai délire, elle avait encore bu. Je me doute qu’elle aura acheté de l’[e]au-de-vie. Je cours à la mé, je cherche mon argent au fond du pot, plus rien ! La Rose ne pouvait pas avoir bu pour six francs d’eau-de-vie en un jour, ça l’aurait tuée. Aussi, quoiqu’il me chagrinât d’interroger mes enfans sur leur mère, je leur dis : – « Est-ce que votre maman est allée au bourg et en a rapporté quelque chose ? – Oh ! maman avait emporté son panier vide pour aller au bourg, – me dit ma petite fille, – et elle l’a rapporté vide aussi. – Est-ce que votre maman était bien gaie en revenant, mon enfant ? – Non, papa, – me répondit Jeanne, – seulement, deux heures avant que tu ne rentres, elle est sortie… et puis après, elle est revenue en chantant et elle nous a fait bien rire. » – Je n’en pouvais plus douter, Monsieur, ma femme avait fait sa provision d’eau-de-vie et l’avait cachée avant de rentrer à la maison. Vous le savez, ici, l’eau-de-vie de marc coûte de 12 à 13 sous la bouteille. – J’attendis le jour pour fouiller partout aux alentours de la maison et dans les décombres. Je ne pus rien trouver. Je rentrai ; la Rose, honteuse sans doute, était allée se cacher dans la bergerie, attendant mon départ, de peur d’être grondée. Le soir, je revenais bien malheureux, me disant : Ma pauvre femme aura encore bu ce soir, pour s’étourdir et ne pas me répondre à propos de l’argent qu’elle a dépensé. Je ne m’étais pas trompé ; mais vers le milieu de la nuit, elle s’est jetée à mon cou en sanglotant ; je lui ai parlé raison, très-doucement, sans me fâcher, la suppliant de me dire la vérité ; elle restait muette. En vain je lui disais : – « La Rose, si tu n’as pas dépensé tout l’argent, rends-moi le reste, je le donnerai en à compte à la Toussaint pour notre loyer, sinon l’on nous mettra dehors, et nous n’aurons plus même cette masure pour retirance. » – J’aurais parlé à un mur que ça aurait été la même chose… elle pleurait, elle sanglotait… Voilà tout. Je cherchai, de nouveau, la cachette de ses bouteilles ; impossible de la découvrir. Depuis ce temps-là, il ne s’est pas passé deux ou trois jours, sans qu’elle se mette dans l’état où vous la voyez ce soir ; sans doute, elle aura vidé sa dernière bouteille, puisque ce matin elle a employé l’argent du pain à acheter de l’eau-de-vie. Mes peines sont grandes, Monsieur ; l’esprit de ma pauvre femme, déjà comme ébranlé par le chagrin et par son accident de lait, s’est affaibli de plus en plus ; elle est maintenant presque hébêtée. Je me dis : – du moins, elle ne souffre plus de la vue de la misère de ses enfans – mon aîné vient maintenant aux champs avec moi… c’est ma seule consolation, il est plein de bon cœur, de courage, ma petite fille veille de son mieux sur ses frères et sœurs ; mais vous le voyez, sans vous, il arrivait un malheur. – Ma femme, mes enfans pouvaient être brûlés… la grange voisine incendiée… aussi, je tremble qu’on sache le malheur qui a failli arriver aujourd’hui : le fermier me renverrait d’ici, apprenant que le feu aurait pu prendre à ses fourrages et à sa bergerie… Je ne saurais plus où aller loger ! Ah ! Monsieur ! ce qui est fait est fait ; mais j’aurais dû écouter maître Brossard lorsqu’il me disait : – « Jean-Louis, reste garçon… le mariage est un collier de misère pour les pauvres gens. » – Et pourtant, ajouta le journalier, – si les pauvres gens ne faisaient pas d’enfans, qui est-ce qui serait soldat ? Journalier ? artisan ? laboureur ?... Nos enfans font la terre, cultivent les champs, peuplent les ateliers, tissent les vêtemens, bâtissent les maisons… et c’est à peine s’ils sont nourris, vêtus et logés !... Mais pardon, Monsieur, – reprit Jean-Louis, après un moment de douloureuse réflexion, – pardon, Monsieur, de vous avoir parlé si longuement de tout cela… seulement, vous le voyez, ma pauvre femme est encore plus à plaindre qu’à blâmer… C’est la douleur de voir ses enfans pâtir qui l’a perdue… Interrogez sur elle et sur moi maître Brossard… il vous dira que la Rose était la meilleure, la plus courageuse, la plus honnête fille qu’il ait jamais connue… Aussi, je vous en conjure, Monsieur, ne la méprisez pas ! pour l’amour de Dieu ne la méprisez pas ! - Il ne faut pas mépriser les gens – dis-je à Jean-Louis – il faut tâcher de les guérir. - Guérir ! la Rose !... Hélas, Monsieur, il est trop tard… il est trop tard ! - Qui sait ?... Il ne faut jamais désespérer. Adieu, monsieur Jean-Louis, la pluie a cessé ; la lune se lève de bonne heure, je retrouverai facilement mon chemin. La sincérité de l’accent de Jean-Louis m’avait convaincu. Le lendemain, j’allai voir maître Brossard et le propriétaire de la petite maison du village d’abord occupée par Jean-Louis ; ils me donnèrent sur cet excellent homme et sur sa femme les détails qui commencent ce récit. Maître Brossard avait rarement revu Jean-Louis depuis qu’il était allé demeurer si loin de la commune, et aux questions de son ancien maître sur sa position, le journalier, fier comme un homme honnête et laborieux, avait toujours répondu que son travail lui suffisait. Jean-Louis, à son insu, cédait peut-être aussi à la crainte d’entendre le fermier lui dire : – « Je t’avais averti… tu n’as pas voulu m’écouter » – toujours est-il qu’il tint secrète sa cruelle misère. Maître Brossard et sa femme furent aussi surpris que consternés de ma révélation ; aussi, lorsque je leur confiai mon projet, l’accueillirent-ils avec empressement sans cependant compter beaucoup sur sa réussite. Evidemment, selon moi, l’espèce d’anéantissement physique et moral de la Rose avait trois causes : Sa douleur navrante de s’être vue si longtemps réduite à une inaction forcée, elle si active, en présence de la misère et des privations de ses enfans qu’elle était impuissante à soulager. L’affaiblissement et les absences d’esprit qui suivirent la brusque suppression du lait de la femme de Jean-Louis, phénomène malheureusement fréquent en suite de pareils accidens. Enfin, l’abus de l’eau-de-vie qui, tantôt jetait cette infortunée dans un accès de délire, tantôt dans une sorte d’idiotisme. Il me parut donc qu’une soudaine et heureuse secousse pourrait peut-être sortir la Rose de la torpeur où elle était plongée après ses jours de surexcitation factice. Vers les midi, et le surlendemain du jour où j’avais vu cette famille pour la première fois, maître Brossard, sa femme et moi, nous nous dirigeâmes vers la demeure de Jean-Louis, et nous descendîmes de la carriole du fermier, derrière laquelle suivait une de ses vaches, attachée par une corde. Le journalier était aux champs avec l’aîné de ses enfans ; les autres, entassés sur le grabat, se serraient les uns contre les autres pour se réchauffer, car la journée était pluvieuse et froide. Jean-Louis, de crainte d’un nouveau malheur, n’avait pas allumé de feu avant son départ ; la Rose, accroupie sur l’escabeau, son front dans ses mains, se tenait auprès de la cheminée, l’œil fixe, presque hébété ; à la vue du fermier, les enfans effarouchés se rencognèrent dans l’angle de la muraille où s’appuyait le lit. - Ah ! quelle misère, mon pauvre papa ! – dit la fermière à son mari – ces pauvres petits n’ont que la peau et les os… vois donc, quelles guenilles !... Ils n’ont pas seulement de chemise. - Ne songeons pas à cela maintenant, la mère – répondit maître Brossard, en déposant à terre un gros paquet qu’il venait de déballer de derrière sa carriole, ainsi qu’un chaudron et un panier dont il déficela le couvercle ; pendant ce temps-là, maîtresse Brossard, qui ne pouvait retenir ses larmes, s’approcha de la femme de Jean-Louis, et lui dit, en lui mettant la main sur l’épaule : - Eh bien ! la Rose… c’est comme cela que tu m’accueilles ? La pauvre créature leva les yeux sur la fermière et resta muette… - C’est moi… la maîtresse Brossard ; est-ce que tu es aveugle ?... Tu ne me reconnais donc pas, ma fille ? - Ah ! si… ̶ répondit la Rose. Et sa tête retomba sur sa poitrine ; la fermière se rapprochant alors de son mari, qui déballait divers objets d’habillement et les étalait à mesure sur le sol, prit deux ou trois petites robes d’enfant et les montrant à la femme de Jean-Louis, lui dit : - Vois donc, la Rose… les bonnes petites robes… les bonnes petites chemises ? - Ah ! oui, – répondit la Rose. Et son regard morne sembla s’animer un peu. - Et ces béguins d’indienne – reprit la fermière. – Vois donc comme ils sont gentils ! - Oh ! oui, – reprit-elle encore – ah ! oui, c’est vrai ! - Et ces petits pantalons de droguet avec la veste pareille ? et ces bons bas de laine ?... et ces sabots mignons… hein, ma fille ? – ajouta maître Brossard, en déposant aux pieds de la Rose ces différens objets. – Et ces petites blouses… et ces bons petits bonnets de laine ?... vois donc ! ma fille ! vois donc ! La Rose, d’abord affaissée sur elle-même, s’était redressée sur son escabeau ; puis, se levant soudain, elle joignit les mains avec ébahissement en s’écriant : - Oh ! combien en voilà de bons petits effets !... combien en voilà ! - Pardi !... pour habiller tes cinq mioches… - Sans compter un rechange pour chacun, il en faut des effets, ma fille !... La Rose regardait la maîtresse Brossard sans comprendre encore, et elle répondit machinalement : - Ah ! oui, il en faut des effets ! - Ma pauvre fille, tu ne me comprends donc pas ?... Ces habits, c’est pour tes enfans ! mais il faut d’abord les bien débarbouiller, après ça, nous les rhabillerons, et puis nous savonnerons leurs chemises de rechange pour rendre la toile moins rude… ; ensuite, nous ferons la potiche au lard pour Jean-Louis, ce soir, au retour des champs…, puis nous trairons la vache. La Rose regardait autour d’elle d’un air abasourdi, presque effaré. - Maîtresse Brossard, – dis-je à la fermière, - parlez brusquement à la Rose, comme vous lui parliez lorsqu’elle était votre servante… Il se peut que cela frappe et réveille son esprit. La fermière me fit un signe d’intelligence, et s’écria d’une voix brève et un peu criarde : - Allons, la Rose !... de la bremaille et du bois au foyer ! vite, vite, ma fille !... Est-ce que l’on reste engourdie comme cela… allons donc ! allons donc ! La Rose, à cette voix, à cet accent si connus d’elle, se leva soudain et obéit machinalement ; elle courut au foyer, le remplit de bruyères sèches et dit : - Et les allumettes, maîtresse ? - En voilà, – reprit le fermier en ouvrant l’étui de sa pipe et donnant une allumette à la Rose qui l’approcha des bremailles ; aussitôt le feu flamba. - Eh bien ! ma fille ? reprit impétueusement la fermière, te voilà encore les bras croisés, ne faut-il pas mettre le chaudron sur ce feu ? - Le chaudron, maîtresse ? - Oh ! quelle tête !... quelle ustuberlue !... Eh ! oui, ce chaudron ! Et la fermière montra à la Rose le chaudron dans lequel maître Brossard, sur un signe de sa femme versait le contenu d’un seau qu’elle était allée remplir au puits. - Allons, vite, vite ! - Voilà, maîtresse, voilà ! – répondit la Rose en prenant l’anse du chaudron… mais elle ne put le soulever de terre. - Pauvre fille ! – dit tout bas maîtresse Brossard à son mari, – faut-il qu’elle ait pâti ! Elle, autrefois si forte ! elle, qui vous aurait enlevé de chaque main un chaudron pareil sans broncher… Puis, prenant l’anse du vase de cuivre afin d’aider la Rose, elle ajouta : - Allons, je vas t’aider… mais tu es joliment chiffe, aujourd’hui ! - Dame !... maîtresse. - Ta, ta, ta ! pas tant de raisons !. Vite le chaudron au feu, et, pendant que l’eau va chauffer, tu vas aller traire la vache, car voici midi, et la traite est en retard. Oh ! quelle pôque j’ai là !... une vraie tortue ! - Dame !... maîtresse, donnez-moi le temps aussi ! - Oh ! le temps… le temps ! on a toujours du temps de reste quand on sait bien l’employer. Passe devant, ma fille, et plus vite que ça ! Bon ! Et ton seau que tu oublies ! – ajouta la fermière en mettant à la main de la Rose le seau du puits. Maître Brossard avait attaché près de la porte la vache qu’il avait amenée derrière sa carriole ; la Rose, son seau à la main, s’accroupit devant la belle génisse laitière, et commença de la traire… lentement d’abord, s’arrêtant parfois pensive, cherchant sans doute à relier le fil de son incertaine pensée, ne sachant si elle veillait ou si elle dormait ; on voyait facilement sur ses traits qu’ayant à peine conscience de ses actions, elle obéissait machinalement à ses habitudes d’autrefois ; sa raison, encore à demi-engourdie, ne se réveillait pas encore ; deux ou trois fois les mains de la Rose cessèrent de presser les trayons de la vache… elle regarda de côté et d’autre d’un air surpris, leva ensuite les yeux au ciel comme si elle eût cherché à rassembler ses souvenirs, puis sa tête retomba sur sa poitrine, et elle continua de traire, tantôt lentement, tantôt avec une activité fiévreuse. - Et maintenant, – dit la fermière, – ce bon lait chaud et crêmeux, je sais bien qui est-ce qui va le boire lorsque j’y aurai mis tremper quelques tranches de pain. Maîtresse Brossard, avisant une vieille terrine de grès, prit de l’eau dans le chaudron, la lava, la remplit de lait après que maître Brossard y eut rangé des tranches de pain qu’il coupait à une miche dont il s’était muni. Les enfans battirent les mains de joie et s’assirent à l’entour de la terrine ; la Rose les suivait des yeux sans mot dire… mais bientôt cependant son regard se mouilla ; elle sourit amèrement, et murmura : - Comme ils ont faim, mon Dieu ! jamais je ne les ai vus manger comme ça !... comme ils ont donc faim ! - Et quand ils auront bien mangé, ma fille – reprit la fermière, – nous les vêtirons ; en attendant, aide-moi à ranger les effets sur le lit ; lorsque tes enfans seront habillés, nous irons avec eux promener ta vache à la corde ; nous rentrerons pour le savonnage, et mettre au feu le potiche au lard pour Jean-Louis ; j’ai apporté ce qu’il faut. - Oui, maîtresse, – répondit la Rose d’un air pensif, – mais comment ça se fait-il que vous soyez ici et que mes enfans mangent du lait ?... comment est-ce que j’ai une vache à présent ? car enfin… hier… hier… et s’interrompant, en portant ses deux mains à son front, elle ajouta : – Hélas ! mon Dieu, la tête me fend… est-ce que je deviens folle ? - Allons, vite… l’eau est chaude, – dit la fermière, – débarbouillons les mioches ; nous les habillerons après. A mesure que l’un des enfans était proprement habillé, la Rose l’embrassait avec des élans de joie et de tendresse mêlés de larmes, murmurant à demi-voix : - Comment ça se fait-il ?... qu’est-ce qu’il m’arrive ? je ne m’y reconnais plus ! Mais lorsque la femme du journalier vit autour d’elle tous ses enfans proprement et chaudement vêtus, l’excès du bonheur opéra sans doute une révolution dans son esprit ; ses souvenirs jusqu’alors confus devinrent lucides, et, pour la première fois depuis l’arrivée de la fermière, les traits de la Rose exprimèrent une honte profonde et douloureuse ; elle cacha sa figure entre ses deux mains et fondit en larmes. - Eh bien ! ma fille – lui dit la fermière, de plus en plus attentive – pourquoi pleurer ainsi ?... Il n’y a pourtant rien d’attristant à ce qui se passe. - Ah ! maîtresse, ça me saignait si fort le cœur de voir mes enfans souffrir sans y pouvoir rien… que je m’en suis ressentie comme hébêtée… depuis la nuit où mon lait s’est arrêté… Les forces me manquaient. Mes enfans seraient tombés dans le feu, que je n’aurais peut-être pas eu ni la force le ni courage de les en retirer… Et puis est venu le jour où, pour la première fois, par hasard, j’ai bu de l’eau-de-vie… ça m’a étourdie. Tant que durait l’étourdissement, j’étais comme morte… Je n’entendais ni ne voyais rien… Quand je revenais à moi… et que je me retrouvais avec mon pauvre Jean-Louis et mes enfans, leur vue me faisait si grand mal, si grand mal, que je n’avais d’autre idée que de redevenir comme morte en buvant encore de l’eau-de-vie… et, pour en acheter, j’ai volé mon pauvre homme. Ce matin, quand vous êtes venue, maîtresse, et que vous m’avez commandé comme autrefois à votre ferme de mettre le chaudron sur le feu… de traire la vache… de savonner, c’était pour moi comme un rêve ; ça m’a porté un coup, j’allais, je venais sans savoir pourquoi et comme si on m’avait menée par la main ; je sentais que je n’étais plus votre pôque comme autrefois, cependant il me semblait que vous étiez encore ma maîtresse. Enfin, que voulez-vous que je vous dise ? ça bouillait si fort dans ma tête, que je croyais à chaque instant qu’elle allait se fendre… pourtant j’avais par-ci, par-là, comme des éclairs de souvenance ; je me rappelais le temps où, avant que mon lait n’ait tari, j’étais si malheureuse à cause de mes enfans ; mais quand tout d’un coup je les ai vus si bien manger, et si gentiment vêtus, ce qui avait toujours été mon idée depuis que je les ai… on m’aurait dit qu’on m’enlevait une taie de dessus les yeux… mon sang n’a fait qu’un tour, je me suis souvenu de tout, de tout… et j’ai honte… grand honte, car, je le vois bien, je ne suis qu’une malheureuse… Hélas mon Dieu ! j’ai dû causer beaucoup de chagrin à mon pauvre homme. ……………………………………………………………………………………………………………………………… De ce moment, la guérison de la Rose fut en bonne voie et s’acheva. Très-peu de temps après ces événemens, j’eus le bonheur de pouvoir placer Jean-Louis comme journalier à l’année chez un excellent homme de mes voisins. La Rose fut chargée du soin de l’étable ; elle gagna 15 fr. par mois ; son mari 30 fr. Ils eurent de plus le logement et la jouissance d’un jardin. Le ménage était sauvé ; car, avec 45 fr. par mois, le logement et un quartier de terre, la famille, tout en subissant encore de grandes privations, pouvait du moins matériellement vivre et attendre le temps où, les enfans grandissant, arriveraient successivement à l’âge où ils gagneraient leur pain… si le travail ne leur manquait pas. Maintenant, quelques réflexions sur ce simple et triste récit : Je fais appel au cœur, à la raison de tous les gens de bonne foi : Est-il vrai que la moyenne du salaire des journaliers des champs soit à peine de vingt sous par jour dans la plus grande partie de la France, en tant qu’ils n’aient pas : à subir de chômage ? Est-il vrai que généralement les familles des prolétaires des campagnes se composent du mari, de la femme et de deux ou trois enfans ? Est-il vrai que, même en acceptant ce chiffre de deux enfans (chiffre si restreint, qu’il devient presque exceptionnel), il est radicalement impossible, à quatre personnes, de se loger, de se vêtir, de se nourrir avec vingt sous par jour, sans subir des privations, lentement, mais sûrement HOMICIDES ? Est-il vrai que telle est l’élévation de l’intérêt des capitaux pour l’agriculteur, qu’il se voit forcé de renoncer à une culture perfectionnée, à des travaux d’assainissement, de défrichemens, d’irrigations, de reboisemens, etc., etc., travaux très-fructueux pour le propriétaire ou pour le fermier, qui suffiraient à assurer en toute saison du travail aux prolétaires des champs ; de sorte que leur salaire s’élèverait en proportion de l’accroissement et du nombre des travaux ? Est-il vrai que le taux exorbitant, usuraire du loyer des capitaux, ne permettant pas à l’agriculteur d’étendre, de perfectionner ses cultures et d’employer ainsi un grand nombre de bras inoccupés, devient la seule cause du chômage ou de l’abaissement du salaire, sources de la misère atroce qui décime les populations rurales ? Est-il vrai que le créateur a fait l’homme non-seulement matière, mais encore esprit, et que l’homme a droit, moyennant travail, à l’éducation, à l’instruction, qui satisfait aux besoins de l’intelligence, comme le pain satisfait aux besoins du corps ? Est-il vrai que ces jours de rudes, d’incessans labeurs, regardés par JEAN-LOUIS et par LA ROSE comme les jours les plus heureux, ou plutôt les moins malheureux de leur triste vie, ne leur donnaient qu’un bonheur matériel, relatif et incomplet ? Est-il vrai que LA ROSE, pleine de cœur, de courage, d’honnêteté, se levant à l’aube, allant à l’herbe ou au bois, portant des fardeaux comme une bête de somme, jusqu’au septième mois de sa grossesse, et se jetant le soir sur son grabat, brisée par la fatigue, n’aurait pas trouvé un seul moment de repos pour recueillir et élever son âme, si l’éducation eût développé son intelligence, ou pour chercher d’utiles distractions dans les pures jouissances de l’esprit ? Est-il vrai que ce soit un outrageant défi jeté à la raison, à la dignité humaine que d’oser prétendre : – « que deux heures de messe et de vêpres en latin, écoutés chaque dimanche par des populations écrasées de travail durant la semaine, et laissées à dessein dans une déplorable ignorance, suffisent au développement de leur intelligence et au rafraîchissement de leur âme, – ainsi que l’a déclaré M. de Montalembert dans son discours sur l’observance forcée du dimanche ? Est-il vrai que l’ivrognerie, vice déplorable qui abrutit, énerve ou tue lentement tant de travailleurs des campagnes et des cités, ait presque toujours sa cause soit : – dans leur impérieux besoin de s’étourdir sur les conséquences présentes ou à venir d’une misère cruelle, – soit dans une LÉGITIME besoin de distraction, de plaisir, après une semaine consacrée aux plus durs travaux ; distractions, plaisirs que ces infortunés ne peuvent demander qu’à la détestable surexcitation du vin, dans l’impuissance où ils sont, matériellement et moralement, de trouver et de goûter des distractions salubres pour l’esprit et pour l’âme ? Est-il vrai que, non-seulement au point de vue de la raison, de la justice, mais de l’hygiène, le savant, l’artiste ou l’industriel laborieux aient impérieusement besoin, non-seulement de repos, mais de distractions, de plaisirs qui satisfont les yeux, le cœur ou l’esprit ? Est-il vrai que l’artisan, le journalier, dont les labeurs incessans sont incomparablement plus pénibles, éprouvent non moins légitimement le même besoin de distraction, de plaisir, et qu’ils les satisfont quand ils le peuvent et comme ils le peuvent, selon la mesure de leur intelligence et de leurs moyens pécuniaires ? Est-il vrai qu’en blâmant, qu’en déplorant, qu’en détestant le vice de l’ivrognerie, l’on doit surtout tenir compte des causes qui le produisent et le combattre, le détruire, en améliorant assez la condition morale et matérielle de ceux qui se livrent à la funeste passion du vin, pour que l’éducation, l’instruction, le bien-être aidant, ils n’aient plus à s’étourdir sur leur misère et puissent employer, à de saines distractions, ces heures quotidiennes de repos, indispensables à l’homme après un labeur physique ou intellectuel prolongé ? Pour ces questions, c’est je crois les résoudre affirmativement, et en conclure ceci : LE CREDIT FONCIER largement, démocratiquement organisé, ainsi qu’il doit l’être dans notre État républicain, en donnant aux agriculteurs la faculté d’étendre, de perfectionner presque indéfiniment leurs cultures, leur permettrait d’employer en toute saison les bras et souvent inoccupés ; le chômage cesserait, et le salaire s’augmenterait en raison de l’accroissement et du nombre des travaux. En veut-on deux exemples entre mille ? Pour peu que l’on se soit occupé d’agriculture, on sait que l’élève du bétail à l’étable résume le mode de production le plus coûteux, mais aussi le plus fructueux, le plus fécond, le plus avancé. La première condition de cette industrie agricole est la culture des plantes ou racines, telles que betteraves, carottes, pommes de terre, navets, maïs, choux-cavaliers, etc., etc. Cette culture, dite des plantes sarclées, demande beaucoup de main-d’œuvre, en raison, non-seulement du plantage, du repiquage des plantes, etc., mais encore en raison des fréquens binages ou sarclages nécessaires à la destruction des mauvaises herbes qui, épuisant le sol, nuisent à la végétation ; or, ces sarclages, ces binages, souvent réitérés, emploient une grande quantité de bras, travail d’autant plus précieux qu’il est accessible aux femmes ou aux enfans de quinze ans. Maintenant, que l’on compare les résultats de la culture qui manque de capital – et de la culture qui en possède ou qui pourrait s’en procurer à un taux raisonnable. Voici un agriculteur trop pauvre pour acheter des bestiaux et supporter les dépenses nécessaires pour nourrir son bétail à l’étable ; il ensemencera, je suppose, un hectare en seigle, en avoine, en sarrasin ou en froment. Quelles seront les façons à donner à la terre ? et conséquemment combien de bras emploiera-t-il pour cultiver la terre ? Ces façons consistent – en un premier labour, – un hersage, – un second labour, – l’ensemencement, - un second labour, – puis – la récolte. Un homme et une charrue par hectare suffisent à tous ces travaux. La moisson, seulement, occupe un plus grand nombre de bras. S’agit-il, au contraire, de la culture d’un hectare de plantes sarclées ? la main-d’œuvre est considérable ; les labours sont les mêmes ; mais comme il faut fumer abondamment la terre, l’on a besoin d’un grand nombre de bras pour écarter le fumier ; puis, comme il ne s’agit pas d’ensemencer en marchant et à la volée, ainsi que cela se pratique pour les céréales (travail si prompt qu’un bon semeur suffit à ensemencer un hectare par jour), mais de repiquer les plantes une à une, ou d’enfouir trou à trou les pommes de terre, les graines de maïs, etc. il faudra, par exemple, dix personnes pour ensemencer en un jour un hectare de ces plantes ou racines ; puis viennent les binages, les sarclages. Réitérés jusqu’à quatre, cinq et six fois dans la saison, ces travaux occupent encore au moins dix personnes chaque fois par hectare et par jour ; puis enfin vient la récolte, dont l’emmagasinement, soit dans les bâtimens, soit en silos, exige beaucoup plus de bras qu’une récolte de céréales. En résumé : La culture d’un hectare en céréales coûtera UN de main-d’œuvre. Un hectare de plantes sarclées coûtera DIX. Donc les journaliers qui vivront dans un pays de culture perfectionnée, trouveront neuf fois plus de travaux à faire que ceux qui vivent dans un pays où, faute de capitaux, la culture appauvrie est devenue presque stérile, ruine l’agriculteur et laisse chômer les travailleurs. Veut-on d’autres exemples de l’importance du CRÉDIT FONCIER au point de vue de l’intérêt des propriétaires, des fermiers ou des travailleurs ? L’hiver est la morte saison pour les journaliers, s’en suit-il qu’il n’y ait aucuns travaux à effectuer à cette époque de l’année ? – Loin de là ; mais les capitaux manquent, – aussi les agriculteurs sont obligés de se borner aux travaux rigoureusement indispensables ; pourtant, dans ces contrées innombrables en France, où les assainissemens sont d’un effet si puissant sur la fertilité des terres, l’entretien des évières et des fossés, durant l’hiver, serait une dépense des plus fructueuses et occuperait une foule de bras forcément oisifs pendant deux ou trois mois ; parlerons-nous surtout d’un autre travail d’hiver, le DRAINAGE, système d’assainissement et d’assolement aujourd’hui la base de l’agriculture anglaise, qui en retire des avantages prodigieux, cependant la main d’œuvre du drainage est si considérable que pour drainer (2) un ACRE de terre (40 ares) il faut employer chaque jour à ce travail TRENTE-CINQ PERSONNES ADULTES ; de sorte qu’en supposant que le travailleur représente une famille de quatre personnes, chaque acre de terre drainé assure l’existence de 120 PERSONNES PAR JOUR, sans compter la fabrication des tuyaux de drainage, et le défoncement du sol nécessaire après leur pose, travaux dont la main-d’œuvre s’élève à une somme pareille (3). La sylviculture offre encore de nombreuses occupations d’hiver ; on le sait, la végétation des futaies ou des bois taillis récemment RECÉPÉS s’améliore considérablement, lorsque le sol est profondément remué par la pioche. Ce travail est toujours possible, malgré les plus grands froids, car la terre recouverte d’un lit d’humus d’un pouce ou deux d’épaisseur, composé de feuilles mortes et de mousse, reste à l’abri des fortes gelées ; ce n’est pas tout ; l’ébranchage du bois mort des hautes futaies est encore un utile et fructueux travail d’hiver ; en un mot, je le répète, lorsque les capitaux, au lieu d’affluer à la Banque ou à l’achat de rentes pour y trouver un revenu assuré, sans aucune non-valeur et cependant net d’impôts, tandis qu’ils écrasent la terre, cette nourricière de tant de travailleurs, lorsque les capitaux alimenteront le crédit foncier, largement, démocratiquement organisé, l’on ne verra plus de bras inoccupés, les salaires augmenteront, et conséquemment la consommation et la production s’étendront presque à l’infini. Est-ce à dire que le SALARIAT soit et doive être le seul et dernier mode de la rétribution due aux travailleurs des campagnes, en échange du puissant concours qu’ils prêtent à la production ? Non, sans doute. Dès que le crédit foncier sera constitué, le salariat, dans un temps donné, se transformera nécessairement peu à peu, de gré à gré, et à l’avantage de tous, en une participation résultant de l’association agricole. Déjà dans nos pays, des agriculteurs que je pourrais nommer, gens de cœur et d’intelligence, ont très-heureusement modifié le salariat en y introduisant, dans une certaine mesure, le mode de participation proportionnelle au produit, au rendement ; or, l’une des conséquences de toute équitable répartition étant l’avantage réciproque des contractans, ces innovateurs se sont parfaitement trouvés de CETTE INNOVATION SOCIALISTE. A l’appui de ceci, je citerai entre autres deux exemples qui ne sont malheureusement que des faits encore exceptionnels, mais concluans. L’un de ces agriculteurs envoie à Paris, chaque jour, une grande quantité de lait par le chemin de fer ; le transvasement et le rafraîchissement nécessaires pour que ce lait arrive convenablement à Paris est une opération fort délicate, elle demande des soins minutieux, très-intelligens ; l’agriculteur dont je parle, voulant intéresser au bon et constant succès de son entreprise le nombreux personnel attaché à sa vacherie, a assuré, en outre du chauffage, du logement et de la nourriture, à chacun des membres de ce personnel, un minimum de salaire fixe, et de plus une PARTICIPATION proportionnelle au nombre de litres de lait vendus. Qu’est-il arrivé ? Les personnes attachées à l’exploitation ayant le même intérêt que l’agriculteur à ce que son entreprise continuât de prospérer, leurs soins, leur zèle ont augmenté en raison même de l’intérêt qu’elles avaient à apporter ce soin, ce zèle dans leurs travaux. Un autre agriculteur a dit à chacun de ses bergers : « En outre de la nourriture, du logement et de vos gages fixes, je vous accorderai une participation proportionnelle au nombre de mes têtes de bétail, afin que vous soyez ainsi que moi intéressés à veiller soigneusement à l’aignelage, à l’élève des agneaux, etc., etc. ; en un mot, par chaque CENTAINE de moutons, je vous en donnerai UN à la Noël ; de sorte que, selon qu’à cette époque mon troupeau se composera de quatre, cinq ou six cents têtes, les quatre, cinq ou six moutons qui rentreront les premiers à la bergerie, la veille de la Noël seront vôtres, et vous les vendrez à votre profit. » Qu’est-il arrivé ? Grâce à cette participation, le troupeau de l’agriculteur est aussi devenu la chose du berger ; il a été de son intérêt de donner tous ses soins à l’entretien, à la bonne condition du bétail, afin de le sauvegarder contre les maladies, contre la mortalité, qui pouvait d’autant réduire le nombre des moutons, et conséquemment diminuer son droit proportionnel de un par cent. Le berger avait encore intérêt à ce que tous les moutons fussent en bonne santé, car tous devenaient pour ainsi dire les siens, en cela que, la veille de Noël, chacun pouvait être l’un de ceux qui les premiers rentreraient à l’étable, et conséquemment devenir sa propriété. Ces faits isolés, ne se rattachant point à un système d’association intégrale fortement organisé, ne peuvent sans doute servir de règle, de mesure à la participation des travailleurs dans les futures associations agricoles, volontairement consenties, que le crédit foncier pourrait seul faire éclore et féconder ; mais ces faits prouveront, je l’espère, quelles puissantes ressources on trouve dans l’intérêt collectif et personnel lorsqu’il est bien combiné, bien dirigé. Nous regarderons toujours comme un droit, comme un devoir, de dévoiler tant de plaies douloureuses que l’avénement de la République démocratique et sociale, sincèrement, largement pratiquée, pouvait et devait seul cicatriser, guérir ou prévenir à jamais. Ainsi que nous l’avons toujours fait, depuis que dans notre humble sphère nous nous occupons de questions sociales ; – à côté du mal, nous tâchons d’indiquer le remède ; – or, nous répondrons à nos critiques, qui, nous en sommes convaincus, ne nieront pas la réalité des misères auxquelles sont en proie les journaliers, qui, comme JEAN LOUIS, doivent vivre, eux et leur famille, avec un salaire incertain de vingt sous par jour, de deux choses l’une : - Ou ces misères sont exceptionnelles ; - Ou elles sont générales (ainsi que nous le croyons fermement). Si elles sont exceptionnelles, – c’est-à-dire rares et accidentelles, – rien ne doit être plus facile que d’y remédier. Si elles sont générales, elles sont la condamnation la plus formelle, la plus flagrante, d’un état social dans lequel l’immense majorité des citoyens est exposée à une misère homicide ; or, le mal ne devant pas être, ne pouvant pas être la condition fatale, inexorable de l’humanité, évidemment, cet ordre social est iniquement constitué ; le devoir de chacun, selon la mesure de ses facultés, est donc de travailler à la reconstitution normale et progressive de la société, à cette fin glorieuse, sainte, vraiment divine : que sans violenter, sans dépouiller personne, mais par le seul attrait de l’intérêt personnel et collectif mis en jeu par l’association, ainsi que par la force expansive de la vertu originelle de l’homme, qui, n’étant pas faussée, comprimée, le porte instinctivement vers le juste et le bien, l’humanité tout entière, jouisse enfin des trésors de la création incessamment, indéfiniment augmentés par l’intelligence et par le travail de chaque génération. EUGÈNE SUE
Représentant du peuple. NOTES : (1) Voir les livraisons de novembre 1850 et janvier 1851. (2) Rappelons ici sommairement que l’opération du drainage consiste à enfouir dans le sol, à une profondeur de 3 pieds et demi ou 4 pieds, des tuyaux de terre ou d’argile d’un pouce au plus de circonférence. On les espace l’un de l’autre à une distance de 15 à 20 pieds dans toute la longueur de la pièce de terre. Ces drains aboutissent à un tuyau transversal beaucoup plus gros appelé maître drain, qui déverse à son tour dans un fossé l’eau absorbée par la seule porosité des petits drains ; le drainage a non-seulement pour but d’assainir les terres et de quintupler ainsi leur fécondité, mais de les azoter, si cela se peut dire, l’air pénétrant aussi le sous-sol en s’échappant à travers les légères fissures des drains ; les champs drainés acquièrent une puissance de production extraordinaire. (3) L’on comprend ‘autant plus l’indispensable nécessité du crédit foncier que l’on est plus convaincu de cette vérité qui a force d’axiôme. – Plus l’agriculture se perfectionne plus elle emploie de capitaux et de bras. – Ainsi, en 1814, il fût constaté par une enquête du parlement britannique due pour l’exploitation d’une ferme de 300 acres (120 hectares 32 ares), il fallait au fermier un capital de roulement de 4,000 livres sterlings (88,000 fr.). Cette somme était le double de celle que la même exploitation exigeait 20 ans auparavant, et cette progression a continué, non pas dans les mêmes proportions, mais cependant d’une manière très-sensible ; dans nos pays, au contraire, le cultivateur qui fait valoir 120 hectares ne dispose pas généralement d’un fond de roulement supérieur à 10 ou 12,000 fr. au plus. Aussi la majorité des cultures est-elle déplorable. |
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2007 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2006 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Sub-domains
CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -
Other Domains
https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com