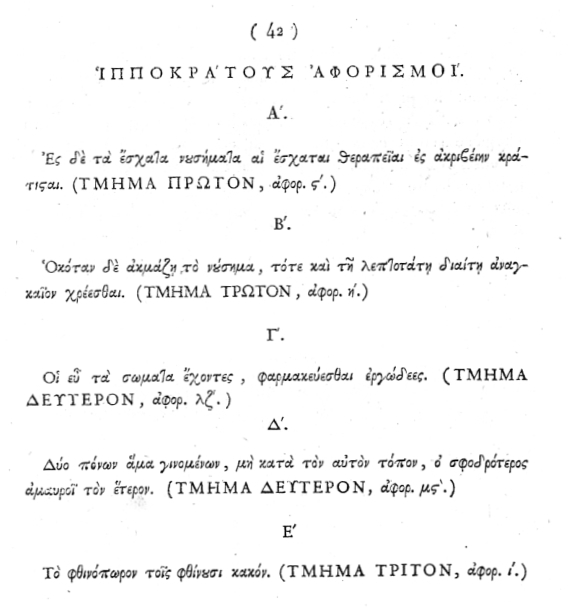HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP
Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006
SITEMAP
Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
| QUESNEL, François-Charles, docteur en médecine : Recherches relatives à l’influence de la continence sur l’économie animale : thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 29 août 1817.- Paris : de l’Imprimerie de Didot Jeune, imprimeur de la Faculté de Médecine, rue des Maçons-Sorbonne, n°13, 1817.- 42 p. ; 27 cm.
Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (04.II.2004) Texte relu par : A. Guézou Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros] obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire de la médiathèque (BM Lisieux : 2728). RECHERCHES
RELATIVES A L’INFLUENCE DE LA CONTINENCE SUR L’ÉCONOMIE ANIMALE ; THÈSE
Présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 29 août 1817,
PAR
FRANÇOIS-CHARLES QUESNEL, de Lisieux,
Département du Calvados. DOCTEUR EN MÉDECINE.
_________________________
Sublatâ causâ, tollitur effectus. _________________________ A MON PÈRE,
ET A MA MÈRE. Comme un témoignage de mon éternelle reconnaissance pour tous les sacrifices qu’ils ont faits pour mon instruction. A MONSIEUR LE DOCTEUR PICCARD, MÉDECIN A LISIEUX. Témoignage d’estime et d’attachement. F. C. QUESNEL. AVANT-PROPOS ~~~~~~
SUR le point de terminer leurs études, les élèves ont un dernier devoir à remplir, afin d’exercer l’art auquel ils se destinent. Ils sont obligés de choisir un point quelconque de médecine, de le travailler et de le discuter devant les illustres professeurs qui ont formé leur éducation. C’est un compte qu’ils viennent leur rendre de l’emploi qu’ils ont fait du temps consacré à leur instruction ; c’est la dernière preuve qu’ils donnent de leur force ou de leur faiblesse. A peine imbu des principes de la science, l’élève qui présente sa thèse à ses examinateurs ne peut leur offrir ni le fruit de ses réflexions, parce qu’il n’a point assez médité, ni le fruit de ses observations, parce qu’il n’a pas assez vu. Peu confiant dans les résultats des unes, dépourvu des autres, il doit se borner à réfléchir sur les leçons qu’il a reçues de ses maîtres, et à faire de justes applications des principes qu’ils lui ont enseignés, au sujet qu’il se propose de traiter. Faire une thèse, c’est donc moins construire un ouvrage qu’en démolir plusieurs dont on s’approprie les matériaux, qui, placés différemment, changent la face de l’objet sans en dénaturer le corps. L’élève doit donc laisser aux praticiens la tâche glorieuse de poser les fondemens d’une science que l’expérience seule peut éclairer. Ce ne sera qu’au bout d’un temps assez long qu’il lui sera permis de s’unir à leurs travaux et de contribuer pour sa quot-part aux progrès de l’art qu’il va exercer. La matière de la dissertation que j’ai l’honneur de présenter à cette école n’a point encore fait le sujet d’une thèse ; on ne trouve même les faits qui s’y attachent que répandus çà et là dans les différens auteurs ; aucun n’en a fait le sujet de ses recherches particulières. C’est la tâche que je me suis proposée ; je ne me flatte pas d’y avoir réussi, je l’ai seulement essayée, et ce sera déjà un succès pour moi d’avoir appelé l’attention des observateurs sur une série d’affections aussi funestes, et à laquelle se rattachent la plupart des maladies qui moissonnent les jeunes gens à l’époque de la puberté. Dans le plan que j’ai suivi, je donne quelques considérations générales relatives à l’état de continence, sans prétendre attaquer les institutions sublimes du christianisme ; ensuite, j’entre dans quelques détails sur les maladies produites par cet état ; enfin je tire des conclusions relatives au sujet que j’ai traité. Je me suis principalement attaché à être clair et précis, heureux si j’ai pu atteindre à ce but, et s’il ne m’est échappé que quelques-unes de ces fautes légères qui doivent être pardonnées à ceux qui ne possèdent pas encore l’habitude d’écrire ! « On peut, dit Labruyère, exiger beaucoup de celui qui devient auteur pour acquérir de la gloire ou par un motif d’intérêt ; mais un homme qui n’écrit que pour satisfaire à un devoir dont il ne peut se dispenser, une obligation qui lui est imposée, a sans doute de grands droits à l’indulgence de ses lecteurs. » RECHERCHES
RELATIVES A L’INFLUENCE DE LA CONTINENCE SUR L’ÉCONOMIE ANIMALE.
~~*~~
INTRODUCTION.
LE mot continence dérive du verbe continere, retenir. On peut définir la continence, un effort par lequel on résiste au penchant qui nous porte aux plaisirs de l’amour. On a souvent confondu la continence avec la tempérance et la chasteté. La tempérance, dans son sens propre, est cette sage modération qui retient dans de justes bornes nos désirs, nos sentimens et nos passions, et qui porte les hommes à se passer du superflu. La chasteté, comme la tempérance, ne nous défend point les plaisirs de l’amour ; elle exige seulement que nous en réprimions les abus qui constituent l’impureté ; elle nous défend les plaisirs illicites. Tel est chaste qui n’est pas continent, et réciproquement tel est continent qui n’est pas chaste. La chasteté et la tempérance existent hors et dans le mariage ; la continence n’est que du célibat. On doit être chaste et tempéré ; il n’y a pas d’obligation à être continent. L’âge, qui rend les vieillards nécessairement continens, ne les rend pas toujours chastes. Quiconque est conformé de manière à pouvoir procréer son semblable a droit de le faire ; c’est le droit ou la voix de la nature : mais il doit agir chastement. Si l’on a prodigué tant d’honneurs à la virginité, qui exige un état de continence parfaite ; si toutes les nations civilisées semblent avoir pour elle un si grand respect, c’est moins dans l’intention d’honorer cette vertu, qui par elle-même est purement idéale, que pour veiller à la propagation de l’espèce, et à la santé des individus qui constituent le corps social. Il est en effet d’observation que, si on se livrait aux plaisirs de l’amour aussitôt que la nature semble nous le permettre, il en résulterait de très-graves inconvéniens. Les organes n’acquerraient point ce développement si nécessaire à la santé, la constitution resterait faible et débile, et les individus qui naîtraient de ces liaisons prématurées seraient plutôt à charge qu’utiles à l’état. Si au contraire on peut, par cette espèce d’illusion morale, réprimer pendant quelque temps le désir qui tend à unir les deux sexes, il arrive que la constitution s’affermit, prend un certain degré d’énergie, et qu’on peut alors devenir le père d’enfans forts et vigoureux. Mais malheureusement il est plus facile d’obéir aux passions que de leur commander. L’homme n’existe pas seulement pour lui-même, il est destiné à créer des êtres qui lui ressemblent, et à leur transmettre tous les attributs de son organisation, afin d’éterniser son espèce. La nature, qui a fait concourir tant de ressorts pour la rendre à jamais impérissable, a joint à l’acte qui nous reproduit le plaisir le plus vif, comme pour y attirer ceux qui auraient de la tendance à s’en écarter. Malgré cette sage prévoyance, on a vu, et l’on voit encore tous les jours des hommes rester sourds à sa voix, lutter contre les désirs qu’elle fait naître, et même, par une philosophie ténébreuse, proclamer le célibat comme l’état le plus parfait de la créature. Mais, piquée de l’outrage qu’on lui fait, la nature les punit de leur ingratitude, en les accablant de maladies dont elle ne les débarrasse que lorsqu’ils obéissent à ses lois. Semblable à une bonne mère qui sait punir ses enfans lorsqu’ils sont rebelles à sa voix, elle sait aussi leur pardonner lorsqu’ils rentrent dans le chemin qu’elle leur a tracé. Ce n’est pas néanmoins toujours par de grandes maladies que l’individu qui observe la continence est puni de sa désobéissance ; il ne connaît ni l’attrait du plaisir, ni les charmes de l’amour, ni les douceurs de la paternité ; il vit isolé sur la terre, et vieillit abandonné. Pas un regret ne l’accompagne à ses obsèques, pas une larme ne coule sur sa tombe. Tout atteste qu’il a commis un attentat contre les droits de l’homme moral et de l’homme physique. Lorsque l’on cherche à approfondir la cause qui a déterminé les hommes à préférer cet état d’isolement au mariage, on observe que l’égoïsme est la raison qui les y porte le plus ordinairement. « Quand on ne connaîtra plus de nation barbare, dit le chancelier Bacon, et que la politesse et les arts auront énervé l’espèce, on verra dans les pays de luxe les hommes peu curieux de se marier, par la crainte de ne pouvoir pas entretenir une famille, tant il en coûtera pour vivre chez les nations policées. » L’Histoire romaine ne nous présente-t-elle pas un fait analogue à la remarque du philosophe anglais ? Qui ne connaît la magnifique harangue qu’Auguste fit au peuple romain afin de le déterminer à se choisir des compagnes ? «Pendant que les guerres et les maladies, dit-il, nous enlèvent tant de citoyens, que deviendra la ville, si l’on ne contracte plus de mariages ? La cité ne consiste point dans les maisons, les portiques, les places publiques ; ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne verrez point, comme dans les fables, les hommes sortir de dessous la terre pour prendre soin de vos affaires. Ce n’est point pour vivre seuls que vous restez dans le célibat : chacun de vous a les compagnes de sa table et de son lit, et vous ne cherchez que la paix dans vos dérèglemens. Citerez-vous l’exemple des vierges vestales ? Donc, si vous ne gardez pas les lois de la pudicité, il faudra vous punir comme elles. Vous êtes également mauvais citoyens, soit que tout le monde imite votre exemple, soit que personne ne le suive. Mon unique objet est la perpétuité de la république. J’ai augmenté les peines de ceux qui n’ont point obéi ; et à l’égard des récompenses, elles sont telles, que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu de plus grandes : il y en a de moindres, qui portent mille gens à exposer leur vie ; et celles-ci ne vous engageraient point à prendre une femme et à nourrir des enfans. » Les célibataires ne sont pas seulement nuisibles à la société en l’appauvrissant, ils la corrompent également ; car, comme l’a judicieusement observé l’illustre auteur de l’Esprit des lois : «C’est une règle tirée de la nature, que plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages ; comme, lorsqu’il y a plus de voleurs, il se fait plus de vols.» A quel mépris ne devons-nous donc pas vouer cette classe de parasites qui cherche à profiter de tous les avantages que présente la société, en éludant toutes les peines qui s’y trouvent attachées ! N’est-il pas fâcheux de voir les lois protéger également le célibataire et le père de famille, quoique pourtant ils n’aient pas les mêmes droits à la reconnaissance publique. Comme toutes ces considérations appartiennent plutôt à la politique et à la philosophie qu’à la médecine, je passe de suite aux considérations relatives à cette dernière. L’influence que la continence exerce sur l’économie porte spécialement sur la sensibilité et la contractilité animale. Tous les phénomènes que nous aurons occasion d’observer ne seront le plus souvent que des altérations de ces propriétés : presque tous en effet tiennent à leur exaltation. Aussi, la plus grande partie des maladies que nous verrons appartiennent à la classe des névroses. Cette accumulation de la sensibilité, portée sur les organes de la génération, réagit sympathiquement sur le cerveau, et donne aux passions un empire que l’on parvient assez difficilement à vaincre. C’est aussi dans ces crises difficiles que les personnes du sexe résistent avec peine aux attaques de l’amour, qui cherche sans cesse à livrer assaut à leur vertu. En admettant même qu’un sentiment profond de leur devoir les fasse parvenir à surmonter la tendance de la nature qui agit continuellement pour arriver à son but, que d’écueils n’ont-elles pas à redouter ! Elles n’y parviendront que par une attention soutenue et une persévérance de réflexions qui les plongeront bientôt dans un état de tristesse et de langueur que l’on remarque si fréquemment chez les jeunes filles. La femme, douée d’une sensibilité généralement plus grande que l’homme, passe aussi pour être plus voluptueuse que lui ; si les jouissances sont plus grandes chez elles, les efforts que l’on fait pour les comprimer doivent être nécessairement plus multipliés, et les maladies, qui naissent de cet état de contrainte beaucoup plus fréquentes. C’est aussi ce que l’observation confirme journellement dans la pratique ; non-seulement parce que la susceptibilité nerveuse est plus prononcée, mais encore parce qu’elle observe avec plus de rigueur les lois de la pudeur et les convenances de la société. La nécessité dans laquelle une jeune personne se trouve souvent de contraindre sa passion, et de paraître devant une mère sévère avec un visage tranquille et une émotion vive dans l’âme, ne contribue pas moins à troubler sa santé. C’est surtout à l’époque de la puberté que la femme commence à gémir sous le poids de sa position sociale ; c’est aussi à cette époque que les maladies semblent choisir leur victime. Les organes de la génération, qui jusqu’alors étaient restés dans un profond sommeil, s’éveillent tout à coup, exercent une nouvelle fonction, et répandent la plus grande influence sur toute la machine animale. Un nouveau sens lui inspire de nouveaux désirs, et de l’impossibilité de les satisfaire naît une partie des maladies qu’on observe chez elle dans les premières années de la puberté. Cet état de gêne ne peut persister long-temps sans donner lieu à un état morbifique bien caractérisé. La chlorose est souvent la première qui paraît sur la scène. Chlorose. Cette maladie, dans laquelle la peau devient pâle, décolorée, et quelquefois terne, est aussi caractérisée par un état de bouffissure générale, d’asthénie, de langueur des organes digestifs, et, par ses dépravations, connues sous le nom de pica. Quoiqu’elle accompagne généralement la rétention des règles, leur diminution ou leur suppression, je ne crois pas cependant, comme beaucoup d’auteurs, qu’elle soit toujours une conséquence de ces dérangemens. Les exemples de filles abondamment réglées doivent faire entrevoir que cette maladie n’est pas essentiellement liée aux phénomènes de la menstruation. Le défaut de menstruation serait plutôt le premier degré d’asthénie, et la décoloration de la face, la bouffissure, etc., le deuxième. L’état de langueur, de tristesse dans lequel se trouve plongée une jeune fille contrariée dans ses inclinations, éloignée de l’objet qu’elle chérit, la privation qu’elle s’impose souvent de toute espèce d’alimens, l’état de débilité dans lequel elle tombe, expliquent assez de quelle manière la chlorose peut être une suite de la continence. Je vais citer une observation de chlorose simple bien caractérisée que j’ai recueillie : Une demoiselle, âgée de dix-sept ans, était sur le point de s’unir à un jeune officier ; des raisons majeures entravèrent leur mariage : les parens s’y opposaient formellement. Aussitôt elle éprouve un état de langueur et de tristesse qui s’accroît journellement ; elle est tourmentée par de violens maux de tête, par un embarras gastrique muqueux ; il survient une légère bouffissure de la face ; les paupières sont cernées, les yeux battus : la peau, qui était vermeille, devient pâle et comme plombée ; elle finit par prendre un aspect jaunâtre, comme dans l’ictère. La sclérotique n’avait point participé à cette coloration générale du corps ; elle était au contraire très-blanche. Les hypochondres étaient tendus et douloureux, les règles suspendues, les déjections difficiles et accompagnées de cardialgie. Cette maladie fut inutilement combattue par tous les moyens de l’art, et la jeune personne eût probablement succombé à cet état de dépérissement, si les parens n’eussent consenti à leur union. Mais, dans les cas où le mariage est le mieux indiqué, il n’est malheureusement que trop ordinaire de voir des raisons de convenances mettre un obstacle que l’on appelle insurmontable à une union qui ferait le bonheur de deux coeurs déjà réunis par l’amitié. J’ignore encore ce que l’on entend par cette épithète raisons de convenances. Est-ce que la nature a admis différens degrés parmi les hommes ? Ne sont-ils pas tous les mêmes à ses yeux ? L’intérêt ni les dignités ne peuvent l’arrêter dans sa marche. Ne serait-il pas à souhaiter que toutes les liaisons conjugales fussent assorties d’après le choix de la nature ou l’instinct secret des sympathies ? Il arrive souvent que l’état de faiblesse et de débilité dans lequel une jeune personne se trouve plongée met une contre-indication dans le mariage, qui serait alors plus nuisible qu’utile, parce qu’il épuiserait le peu de forces qui restent à la malade. Il faut les ranimer en lui faisant espérer qu’elle épousera l’amant qu’elle chérit ; il faut lui recommander l’exercice pris à la campagne, l’exciter au mouvement par le plaisir, soit de la danse, soit de la promenade ; ce qui aura double avantage de la distraire des idées mélancoliques si fréquentent dans une pareille maladie. Il est enfin des cas où l’on est obligé d’avoir recours aux moyens pharmaceutiques, surtout chez les personnes que des voeux ont contraintes à observer la plus sévère continence. Mais il faut se garder d’imiter la pratique vicieuse de quelques médecins, d’ailleurs très-recommandables, qui commencent le traitement de cette maladie par la saignée. Rien n’est en effet plus pernicieux que les méthodes, tracées dans tant de livres, de procéder d’abord par la phlébotomie ; d’évacuer les humeurs peccantes par les linitifs, les atténuans, les incisifs et les clystères ; de rendre au sang ses parties balsamiques : Dieu sait combien les sirops, les potions, et tout le luxe pharmaceutique sont mis en oeuvre ! C’est ainsi qu’on débilite de plus en plus l’économie animale, et qu’on l’amène par degrés au plus déplorable affaissement. En effet, ce traitement est tout-à-fait contraire à l’état de la maladie, et ne peut avoir été prescrit que par des hommes qui n’ont jamais bien connu son vrai caractère. L’observation ayant démontré que cette maladie avait spécialement son siége dans l’estomac, et que, d’une part, elle était produite par la faiblesse, l’atonie de ce viscère, c’est donc spécialement sur lui que les médicamens doivent exercer leur action. Tous doivent être pris de la classe des toniques et des fortifians. On commencera avec avantage le traitement par un vomitif, qui, en dégageant l’estomac des mucosités qui le tapissent, disposera cet organe à éprouver l’effet d’un médicament pris dans la classe indiquée ci-dessus, tels que les martiaux, les eaux ferrugineuses de Vichy, de Spa, de Plombières, etc. ; le vin de kina, la centaurée, etc. Les moyens hygiéniques, tels que l’exercice, les frictions, etc., seront également employés avec beaucoup d’avantage, comme je l’ai déjà dit. Après la chlorose, l’hystérie est une des maladies que l’on rencontre le plus souvent chez les personnes qui ne peuvent satisfaire les désirs que l’amour fait naître chez elles. Hystérie. La description la plus ancienne qui nous soit parvenue sur l’hystérie se trouve dans les livres sur les femmes que l’on attribue à Hippocrate. L’esquisse qu’il en trace est extrêmement imparfaite ; il ne donne aucune histoire particulière de cette maladie ; il cherche plutôt à expliquer quelques phénomènes qu’à donner un tableau exact de tout ce qu’elle présente. Celse est tout aussi diffus, quoiqu’il n’ait pas rempli les lacunes de sa description par des explications frivoles. Galien est le premier qui apprécia avec justesse une partie des causes qui produisent cette maladie. Convenit inter omnes hunc affectum magnâ ex parte viduis evenire, iisque maximè, quæ quùm anteà probè propurgarentur, ac parerent, atque virorum gauderent, omnibus his fuerint privatæ. Il en conclut que l’hystérie vient, ou de la privation des règles, ou de la rétention de la semence. Cette dernière cause lui paraît devoir produire des effets bien plus violens, surtout chez les femmes qui, étant habituées aux plaisirs de l’amour, en sont tout à coup privées. Il cite, à l’appui de ce qu’il avance l’observation que voici : Mulier ex longo vidua……… quùm enim et aliis malis et nervorum quoque distensione vexaretur, dicente obstetrice uterum esse retractum, remediis ad hujusmodi affectus consuetis uti visum est ; quibus adhibitis, partim ob ipsorum calorem, partim etiam, quòd inter curandum manibus tractarentur partes muliebres, obortâ titillatione, cum labore et voluptate (veluti per coïtum) excrevit crassum plurimumque semen, atque ita à molestiâ liberata est mulier. Arétée, Ætius, Paul d’Égine, en signalant les causes de cette affection, n’en rapportent point d’observation. Mercurialis, dans ses consultations, ne donne qu’une seule histoire d’hystérie simple, chez une veuve de trente-huit ans, à laquelle il conseilla de se remarier. Parmi les observations précieuses que nous a laissées Forestus, il y en a dix ou onze sur l’hystérie. Dans la plupart, il nous dit que cette maladie a été produite, ou par la suppression des règles, ou par la rétention de la semence. J’en rapporterai trois. Une jeune fille très-jolie, voluptueuse, de beaucoup d’embonpoint, et d’une stature, fut attaquée d’un accès d’hystérie très-violent. Ses menstrues coulaient très-irrégulièrement. Cet accès durait depuis un jour et une nuit, lorsqu’on appela Forestus. Elle entendait, mais ne pouvait pas répondre ; elle riait et pleurait de temps en temps. Il ordonna des frictions aux extrémités inférieures ; il lui fit respirer l’odeur de plumes de chapon brûlées, de l’assafoetida : ces moyens furent inutiles. Alors il se décida à lui faire frotter la vulve avec un liniment composé d’huile de lis, de musc et de safran. L’accès finit peu de temps après. Il lui prescrivit aussitôt un peu de castoréum dans une infusion de fleur de camomille, et il la purgea ; enfin, il donna à sa mère le conseil de la marier. (Observation 26.e) Forestus pense que cet accès était déterminé en partie par la suspension des règles, et en partie par la rétention de la semence. Quoique l’on sache aujourd’hui que l’humeur que les femmes sécrètent en assez grande abondance ne soit point une semence, puisque l’anatomie ne démontre aucun organe sécréteur de ce liquide, à cette erreur près, l’observation de Forestus n’en est pas moins exactement recueillie. Dans la scholie suivante, il établit très-bien les différences qu’il y a entre l’hystérie et la nymphomanie ; il décrit les accès, leurs signes précurseurs, et les phénomènes qui accompagnent leur déclin, d’une manière assez complète. Dans son prognostic, il avance que l’hystérie causée par la rétention de la semence est plus dangereuse que celle produite par la rétention des règles. « Au mois de janvier de l’an 1565, la domestique de Henri Mermunster, pharmacien à Delft, eut un accès d’hystérie très-violent, causé par la rétention de la semence ; il durait depuis quatre heures. Cornélius Ericus, mon collègue, avait fait placer sur l’hypochondre gauche, vers la matrice, un emplâtre de galbanum. On sentait dans cette partie une tumeur ; on eût dit qu’elle était formée par le soulèvement de l’utérus ; aussi cette malheureuse engageait-elle une fille, qui était présente, à repousser avec sa main l’utérus vers la partie inférieure. Le hasard fit que, dans cette nuit même, j’eus besoin dans cette pharmacie, où j’entrai, afin de prescrire des médicamens pour une semblable maladie. Lorsque je vis cette fille se tourmenter aussi fortement, j’ordonnai qu’on enlevât l’emplâtre, et qu’on le plaçât sur les parties génitales. A peine y fut-il que le mal cessa comme par enchantement. Lorsqu’elle fut revenue à elle-même, je priai l’épouse du pharmacien de lui demander si ses règles venaient au temps ordinaire ; ayant répondu qu’elle était bien réglée, je conclus de suite que cette affection tenait à coup sûr à la rétention de la semence. J’ai appris qu’elle s’était mariée peu de temps après, et que depuis elle n’avait éprouvé aucun accès. » (Obs. 32.e) La trente-troisième observation est sur le même sujet. La malade dut sa guérison à une friction que l’on fit à la vulve avec un liniment composé d’huile de lis, de musc et de safran. Vix digito imposito in vulvam cum confricatione, ad miraculum ad se rediit et ab Orci faucibus quasi revocata est…………………………………………………………………………………………………………………… Cæterùm, ne morbus rediret, quoniam tales præservari debent, cùm hic morbus periodos habebat, quia et semine originem trahebat, consului ut potiùs nuberet .Schmidius rapporte l’observation d’une jeune fille, à la fleur de l’âge, éprouvant alternativement des maux de tête, des distorsions et des douleurs très-vives à l’abdomen ; elle restait quelquefois sans mouvement et sans connaissance ; tout son corps était affecté de roideur tétanique : d’autres fois ce spasme n’affectait que le bras, les mains ou les pieds ; ou bien elle éprouvait des convulsions partielles ou générales ; ses membres s’agitaient de côté et d’autre, le dos s’arquait en voûte, de manière que ses pieds touchaient presque sa tête. Elle se maria à une jeune homme, et guérit radicalement. Hoffmann rapporte l’observation d’un jeune homme attaqué d’une maladie absolument semblable à l’hystérie, mais qui ne peut évidemment porter ce nom chez un sujet mâle. La voici. « Un jeune homme âgé de seize ans, d’une haute stature, d’un extérieur robuste, charnu, pléthorique, se plaignant d’une douleur vive dans la région des lombes, le long du trajet des vaisseaux spermatiques, éprouvait en même temps des érections involontaires, et son esprit était obsédé de désirs qui le sollicitaient à l’acte vénérien. Peu de temps après il eut une attaque de fièvre, qui dura quelques jours. Au bout de quelques semaines, il fut de nouveau tourmenté par les mêmes incommodités, mais avec beaucoup d’autres symptômes absolument semblables à ceux de l’hystérie. Des spasmes affreux, précédés de palpitations du coeur, s’étendaient du pubis au dos, à l’épigastre, au diaphragme, au coeur, à la gorge, au cerveau, et déterminaient un sentiment de strangulation à l’arrière-bouche, la difficulté de respirer, la perte de connaissance, un état comateux, des tiraillemens convulsifs des membres. Cet accès se renouvelait presque chaque mois. Le jeune homme conservait toujours un appétit vorace. La constipation était si opiniâtre, qu’elle résistait aux plus violens purgatifs. Les vaisseaux étaient gorgés de sang ; le pouls, très-inégal, et déprimé pendant l’accès, devenait grand et fort après sa terminaison. Après avoir fait inutilement usage des antispasmodiques et des antiépileptiques, etc., il demanda conseil à Hoffmann, qui lui prescrivit une saignée de six onces presque tous les mois, de l’eau de fontaine pour boisson ordinaire, des poudres de nitre à doses assez fortes. Il l’engagea à faire un exercice modéré, et à suspendre les méditations auxquelles il avait l’habitude de se livrer avec ardeur. Sa santé fut rétablie en peu de temps. » La cause de cette maladie est bien celle que les anciens appelaient rétention de semence. Hoffmann pense qu’elle dépend de l’afflux du sang dans les vaisseaux spermatiques et les testicules ; de là les douleurs qui s’étendent dans les aines et ensuite à d’autres parties. Il dit avoir vu quelques exemples semblables, soit chez d’autres jeunes gens, soit chez des hommes faits, vivant dans le célibat, chez lesquels cette maladie se manifestait par trop de continence. Si de telles observations devenaient plus fréquentes, il n’est pas douteux qu’il faudrait substituer au mot hystérie un nom générique qui pût convenir à l’un ou l’autre sexe. M. le professeur Pinel rapporte aussi une observation d’hystérie qui paraissait dépendre d’une continence long-temps prolongée. Les accès ne disparurent entièrement qu’après le mariage, sur la nécessité duquel il avait fortement insisté. Je rapporterai une dernière observation d’hystérie dont la cause dépendait de la répression des désirs vénériens : elle est de M. le docteur Esquirol. « Une fille bien née, âgée de dix-neuf ans, grande et forte, est prise d’un accès d’hystérie avec des convulsions violentes et presque continuelles. Après un traitement fort long et tout-à-fait infructueux, cette jeune personne disparut un jour de la maison paternelle, et toutes les recherches que l’on fit pour la retrouver furent tout-à-fait inutiles : on n’en entendit plus parler. Au bout de quelques mois, M. Esquirol, passant le soir dans un quartier assez retiré de Paris, fut arrêté par une femme qu’il reconnut pour être celle qu’il avait traitée sans succès. Que faites-vous là ? lui dit-il : Je me guéris, répondit-elle. Cette malheureuse, victime d’un tempérament trop ardent, a continué pendant dix mois le métier de courtisane de la dernière classe ; elle a eu deux fausses couches, et enfin elle est rentrée dans la maison paternelle parfaitement guérie. Cette femme est aujourd’hui mariée, mère de famille, et tient la conduite la plus régulière. » De tous les moyens employés dans le traitement de l’hystérie, il en est peu dont l’efficacité soit aussi bien constatée que le mariage, qui est en quelque sorte comme le spécifique de cette maladie. Lorsque des accès se manifestent spontanément chez des jeunes filles d’un tempérament ardent, sans qu’on puisse en attribuer exclusivement la cause à un dérangement manifeste dans la menstruation, il produira de très-bons effets, comme on peut le voir d’après toutes les observations que je viens de rapporter. Ce moyen ne sera pas moins utile aux jeunes veuves ; mais il s’en faut qu’il soit toujours suivi du succès qu’on en attend : il est absolument sans effet, et quelquefois même il augmente les accidens, lorsque la maladie est invétérée. Néanmoins, l’on peut dire que l’hystérie qui reconnaît pour cause la répression des plaisirs de l’amour sera souvent combattue avantageusement par le coït, tandis que les moyens pharmaceutiques que l’on emploie ordinairement pour faire cesser les syncopes exaspéreront les accès qui proviendront de cette cause : la saignée même n’empêchera pas leur retour ; seulement elle modérera leur violence. Enfin, quand les malades ne peuvent se permettre d’obéir aux lois de la nature, lorsque des voeux religieux leur en ont imposé l’obligation, il faut alors leur prescrire une diète végétale, un travail pénible, et faire en sorte qu’elles évitent tout ce qui pourrait réveiller en elles le désir qu’elles ne peuvent satisfaire. Si pourtant tous ces moyens ne réussissaient pas, si la malade n’éprouvait aucun soulagement ; si, par exemple, un vice de conformation des parties génitales était un obstacle qui s’opposât au mariage, ne serait-il pas alors permis d’imiter l’heureuse témérité de Rolsink, qui, ne voyant d’autre ressource pour guérir une fille dangereusement malade que de procurer une espèce de pollution, au défaut d’un mari, se servit, dans ce dessein, d’un moyen artificiel, et la guérit. Ce moyen ne sera peut-être pas goûté par des censeurs rigides, qui croient qu’il ne faut jamais faire un mal dans l’espérance d’un bien. J’indique ce moyen sans lui donner ni approbation ni improbation ; je laisse aux hommes sensés à décider si, dans un pareil cas, un attouchement qui ne serait nullement déterminé par le libertinage, mais par le besoin pressant, est un crime ; ou s’il n’est pas des circonstances où de deux maux il faut éviter le pire. Comme le moral est particulièrement affecté chez les femmes hystériques, même dans l’intervalle des accès, principalement chez celles qui joignent à un tempérament ardent une grande susceptibilité nerveuse, il est important que le médecin emploie les moyens les plus convenables pour combattre ces altérations. Un des plus efficaces et des plus féconds en résultats est sans contredit le pouvoir de la distraction. Puisque la force pensante ne peut se présenter vivement et clairement plusieurs idées à la fois, surtout lorsqu’elles sont disparates ; puisque l’homme ne peut être dominé en même temps par deux passions véhémentes ; enfin puisque la vie ne peut être portée à un haut degré dans un organe sans qu’elle ne soit diminuée dans un autre, il faut distraire ces sortes de malades, soit de la passion qui les domine ( c’est le plus souvent l’amour), soit des idées tristes qui les affligent, surtout lorsqu’elles sont livrées à elles-mêmes, en produisant sur les organes des sens une suite d’impressions douces qui les occupent sans trop les fixer, qui leur soient agréables, mais ne puissent les émouvoir trop fortement. Un des moyens les plus efficaces pour guérir l’hystérie sera donc d’éviter avec le plus grand soin toutes les causes capables de décider la répétition fréquente des accès ; causes qui semblent se multiplier en raison de la durée de la maladie, et de la susceptibilité nerveuse qui augmente avec elle. Nymphomanie. Il est une maladie dans laquelle les symptômes sont bien plus alarmans que dans l’hystérie ; on y entrevoit déjà le commencement d’une espèce d’aliénation dans les facultés intellectuelles, et les excès d’un amour le plus déréglé : elle est connue sous le nom de fureur utérineou nymphomanie. C’est une espèce de délire, dont la dénomination indique qu’elle appartient exclusivement au sexe. Elle s’offre fréquemment à l’oeil de l’observateur en comparaison du satyriasis, qui est la maladie à peu près analogue chez l’homme. Dans cette déplorable affection, les femmes cherchent sans pudeur à satisfaire leurs désirs vénériens ; elles tiennent les propos les plus obscènes ; elles font les actions les plus indécentes, afin d’exciter les hommes qui les approchent à éteindre l’ardeur dont elles sont dévorées. Elles ne parlent, elles ne sont occupées que des idées relatives à cet objet ; elles n’agissent que pour se procurer le soulagement dont le besoin les presse ; elles vont jusqu’à vouloir forcer ceux qui se refusent au désir qu’elles témoignent ; et c’est principalement par le dernier de ces symptômes que cette sorte de délire peut être regardée comme une espèce de fureur qui tient du caractère de la manie, puisqu’il est sans fièvre. On chercherait vainement des traces de cette maladie dans les ouvrages de l’antiquité ; Hippocrate, Galien n’en ont rien dit, soit qu’elle leur ait été entièrement inconnue, soit qu’un trop grand respect pour les moeurs leur ai imposé un profond silence sur un genre d’affection qui atteste le désordre et la dépravation du sexe. Cette dernière opinion acquerra quelque fondement, si l’on considère que le pays (la Grèce et l’Italie) où ces médecins ont vécu était très-propre au développement de cette maladie. Aristote paraît ne l’avoir point ignorée. Soranus est le premier qui en a donné une description, que l’on retrouve dans Aétius. Zanoras rapporte, dans ses Annales, qu’Eusébie, épouse de l’empereur Constantin, fut atteinte et mourut de cette maladie. La dissolution de Messaline remonte probablement à la même source. Resupina jacens, multorum absorbuit ictus. Ce ne peut être vraisemblablement que par l’effet de cette maladie que Sémiramis, cette reine des Assyriens, après s’être rendue digne des plus grands éloges, tomba dans la débauche la plus effrénée, jusqu’à se livrer à un grand nombre de ses soldats, qu’elle faisait après cela périr par les supplices les plus cruels. Martial fait aussi mention des énormes débauches d’une Coelia, qui ne pouvaient être aussi, selon toute apparence, que l’effet d’une fureur utérine, puisqu’elle n’était pas une prostituée de profession : Das cutis, das Germanis, das, Coelia, dacis, Cléopâtre ne fut-elle pas tourmentée par une semblable maladie ? Hujus ferinæ etiam fuit Cleopatra Egypti regina superba, luxuriosa et salacissima, quæ, sub unâ nocte sumpto cucullo, in lupanari prostibulo, centum et sex virorum concubitus pertulit, in tantum enim, ut professa est, in tentigine rigidiæ vulva erat accensa, quòd à lupanari quidem delassata, sed non satiata rediret. Plutarque rapporte que les filles de Milet étaient tellement tourmentées par cette cruelle maladie, qu’elles se pendirent toutes sans que les prières ni les remontrances ne pussent les en empêcher. On en trouve une observation très-imparfaite dans Horstius ; les symptômes en sont assez bien décrits, mais la cause et la terminaison de la maladie sont entièrement négligées. Schurgius, après avoir assez bien décrit les causes et les symptômes de la maladie, en trace plusieurs histoires particulières. Une jeune femme, mariée depuis peu, d’un caractère gai et porté au plaisir, avait été unie à un homme faible. Elle éprouva bientôt après un état de langueur, et tomba dans la tristesse la plus profonde, enfin dans une fureur utérine des plus marquées. Elle était souvent très agitée, et appelait à grands cris son mari, sa soeur, ses proches ; quelquefois même elle entrait en fureur, et pouvait à peine être retenue par six hommes des plus robustes. Ces accès finissaient ordinairement après un torrent de larmes, ce qui se renouvelait à des intervalles plus ou moins longs. - Gaudentus Merula, dit avoir connu à Turin une jeune fille très-jolie, qui vit trente-cinq hommes dans une soirée. Joannes-Benedictus Senibaldus dit également avoir guéri d’une semblable maladie une jeune femme de distinction, en lui conseillant de se remarier. Maltheus-Franciscus Hertodius rapporte qu’il fût consulté, en Moravie, par une femme honnête, âgée de vingt ans, assez jolie, d’un tempérament tellement ardent, qu’elle fit toutes les instances possibles pour l’engager à faire l’office de son mari ; mais il ne dit pas ce qu’il en fit. M. de Buffon en rapporte une observation très-intéressante. « J’ai vu, dit-il, et je l’ai vu comme un phénomène, une jeune fille de douze ans, très-brune, d’un teint vif et très-coloré, d’une petite taille, mais déjà formée, avec de la gorge et de l’embonpoint, faire les actions les plus indécentes au seul aspect d’un homme ; rien n’était capable de l’en empêcher, ni la présence de sa mère, ni les remontrances, ni les châtimens ; elle ne perdait cependant pas la raison ; et son accès, qui était marqué au point d’en être affreux, cessait dans le moment où elle restait seule avec des femmes. » Enfin, l’on peut voir, dans le Traité de nymphomanie de M. Bienville, d’autres histoires particulières de cette affection. Une jeune fille parvenue depuis peu à l’époque de la puberté, menant une vie inactive, et se nourrissant d’alimens échauffans, avait des liaisons secrètes avec un jeune homme d’une basse extraction, en trompant la surveillance de ses parens. Son inclination étant contrariée, elle éprouva des rêves très-pénibles. Peu de temps après elle tint les propos les plus obscènes, et simula les gestes et les actions d’une bacchante ; on eut même besoin de la retenir dans son lit avec de forts liens, afin de l’empêcher de sortir nue, de prendre les postures les plus lascives, et de provoquer le premier venu à l’union des sexes. Regard étincelant, point de sommeil, aliénation des plus marquées, avec écoulement d’une matière visqueuse, âcre, et même corrosive, par les parties sexuelles ; le pouls était d’ailleurs vif, la langue sèche, et toute l’habitude du corps dans un état de marasme. Un médecin peu instruit l’épuisa de saignées, et la conduisit au tombeau. La fureur utérine est susceptible d’une guérison facile à procurer, si l’on y apporter remède dès qu’elle commence à se montrer, et surtout avant qu’elle ait dégénéré en une manie continuelle. Car, lorsqu’elle est parvenue à ce degré, il est arrivé quelquefois que le mariage même ne la calmait pas. On doit être d’autant plus prompt à arrêter cette maladie, qu’elle peut avoir non-seulement les suites les plus fâcheuses pour la personne qui en est affectée, mais encore parce qu’elle établit un préjugé déshonorant à l’égard de la famille à qui elle appartient ; préjugé toujours injuste, s’il n’y a point de reproches à faire aux parens concernant l’éducation et les soins qu’ils ont dû prendre de la conduite de la malade, qui, d’ailleurs, avec toute la vertu possible, peut être tombée dans le cas de paraître en avoir entièrement secoué le joug, parce que l’âme ne se commande pas toujours à elle-même, et que les sens lui ravissent quelquefois tout son empire, et enfin parce qu’elle est réduite alors à n’être que leur esclave. Les indications à remplir doivent être tirées de la nature bien connue de la cause de la maladie, et du tempérament de la personne affectée. Si elle est naturellement vive, sensible, voluptueuse, qu’elle puisse se satisfaire légitimement par l’usage des plaisirs de l’amour, c’est sans contredit le plus sûr remède que l’on puisse employer contre les fureurs utérines, selon l’observation des plus fameux praticiens, qui pensent que la méthode, souvent défectueuse, quò natura vergit, eò ducendum, doit être appliquée dans ce cas ; aussi n’en trouve-t-on aucun qui ne propose cet expédient, lorsqu’il peut être mis en usage. Si la maladie est attribuée principalement à des causes morales, il faut être extrêmement sévère à les faire cesser ; il faut éloigner tout ce qui peut échauffer l’imagination de la malade en lui présentant des idées lascives, ne la laisser nullement à portée de voir des hommes, lui procurer la compagnie de personnes de son sexe, qui ne puissent lui tenir que des propos sages, réservés, qui lui fassent de douces corrections, qui lui rappellent ce qu’elle doit à la religion, à la raison, aux bonnes moeurs, à l’honneur de sa famille. Les médicamens ne conviennent guère dans le traitement de la maladie dont il s’agit ; c’est au médecin de choisir les moyens à employer, conformément à l’idée qu’il s’en est faite, d’après les conséquences qu’il a judicieusement tirées de sa nature, de ses causes et de ses symptômes combinés avec la constitution de la malade. Érotomanie. Il est une maladie commune aux deux sexes, qui a quelque analogie avec celle-ci et le satyriasis, mais qui cependant en diffère essentiellement sous bien des points : elle est connue sous le nom d’érotomanie. Elle diffère de la nymphomanie et du satyriasis, en ce que ces dernières viennent des organes reproducteurs, dont l’irritation réagit sur le cerveau : dans l’érotomanie, au contraire, le mal est dans la tête. La nymphomane et le satyriaque sont victimes d’un désordre physique : les érotomaniaques sont le jouet de leur imagination ; les premiers ont perdu toute pudeur, les seconds en ont encore, souvent même accompagnée d’un sentiment très-respectueux, et quelquefois déplacé. Le délire érotique a différens degrés ; quelques-uns de ceux qui en sont affectés aiment passionnément un objet dont ils ne peuvent pas se procurer la jouissance. Cependant ils conservent la raison, et sentent parfaitement l’inutilité de leur passion ; ils avouent leur égarement, sans pouvoir s’en corriger, parce qu’ils sont portés malgré eux à s’occuper de leurs désirs impuissants, par la cause de leur mélancolie amoureuse : ils éprouvent toutes les suites de cette maladie, ils ne pensent ni à manger ni à boire, ils refusent de subvenir aux besoins les plus pressans, et ils périssent en se voyant périr, sans pouvoir se défendre de l’affection d’esprit qui les entraîne au tombeau. D’autres ressentent cette passion d’une manière encore plus fâcheuse ; ils sont agités, tourmentés jour et nuit par les inquiétudes, le chagrin, la tristesse, les larmes, la jalousie, la colère même et la fureur, sentimens auxquels ils se livrent en réfléchissant sur leur malheureuse passion : et il arrive souvent qu’ils perdent l’esprit, et qu’ils se donnent la mort, lorsqu’ils désespèrent de pouvoir se satisfaire. Au contraire, lorsqu’ils s’imaginent qu’ils seront heureux, et que leurs désirs seront remplis, ils se laissent aller à des sentimens de contentement, de joie immodérée, accompagnée de grands éclats de rire, lorsqu’ils sont seuls ; et quand ils se trouvent avec d’autres personnes, ils tiennent des propos extravagans : ils s’exposent souvent à des dangers, dans l’espérance de mettre le comble à leur bonheur. Mais cet amour démesuré ne s’annonce pas toujours par des signes évidens ; il se tient quelquefois caché dans la coeur ; le feu dont il brûle dévore la substance de celui qui est affligé de cette passion, et le fait tomber dans une vraie consomption. Ce n’est souvent qu’avec la plus grande difficulté que l’on parvient à reconnaître la cause qui a produit cette fâcheuse maladie. Il faut user de beaucoup de ménagemens pour remonter à la véritable source. Tout le monde sait de quelle manière Erasistrate reconnut l’amour d’Antiochus pour sa belle-mère Stratonice, en touchant le pouls de l’amant en présence de l’objet de sa passion ; l’émotion trahit son secret. Ce fut par le même moyen qu’Hippocrate découvrit la passion de Perdicax pour Phyla ; que Galien annonça à Justa qu’elle était éprise du danseur Pylade. Jouadab ne se laissa pas tromper à la tristesse, à la langueur et au dépérissement d’Ammon, second fils de David, devenu amoureux de sa soeur Thamar. Les signes que fournit le pouls méritent, comme on peut le voir, la plus grande attention. Je vais rapporter quelques observations d’érotomanie, recueillies par M. le docteur Esquirol, et consignées dans le Dictionnaire des Sciences médicales. « Une demoiselle âgée de trente-deux ans, accablée de la perte d’une fortune très-considérable, par conséquent devenue triste, assiste à une leçon d’un professeur de la capitale : dès ce moment elle ne cesse de parler de lui ; les menstrues se suppriment, ce qui la confirme dans l’idée d’une grossesse ; les coliques que cause la suppression sont de nouvelles preuves de la présence de l’enfant ; elle maigrit beaucoup , elle a mille illusions de l’ouïe, elle entend ce professeur qui lui parle, qui lui donne des conseils ; souvent elle refuse toute nourriture, et ce n’est qu’en lui rappelant que c’est par son ordre qu’elle se décide à prendre des alimens ; alors elle mange beaucoup. Pendant dix-huit mois elle fut occupée à faire des layettes pour l’enfant, à lui préparer de petits vêtemens pour le temps où il sera sevré ; souvent elle marche nu-pieds sur le pavé, afin de provoquer les douleurs de l’enfantement ; douleurs qu’on lui a dit être nécessaires pour que l’enfant vienne à bien. Fréquemment elle s’agite, appelle à grands cris le père de l’enfant qu’elle porte dans son sein ; elle a de longs intervalles de raison, mais le plus souvent elle déraisonne sur toutes sortes d’objets : quelquefois elle devient furieuse, parce qu’on l’empêche de voir ou d’aller trouver son amant qu’elle appelle. Il est remarquable que cette demoiselle n’a jamais parlé à ce professeur qu’elle n’a jamais vu qu’une fois, et qu’elle a toujours eu la conduite la plus régulière. » L’érotomanie se complique quelquefois avec la manie ; l’observation suivante du même auteur en fournira un exemple remarquable. « Un jeune homme, âgé de vingt-trois ans, amoureux d’une jeune personne, concentre sa passion pendant plus d’un an : un jour, après avoir dansé avec son amie, il est pris de convulsions qui se renouvellent pendant trois jours ; les intervalles de rémission laissent entrevoir du délire. Après que les convulsions eurent cessé, il devint maniaque, violent, agité, colère, etc. ; voulant toujours s’échapper. Après deux mois, il est confié à mes soins. Quoique son délire fût général, quoiqu’il fût très-agité, il traçait sur le sable, sur le pavé, sur les murs, le nom de son amante ; il courait, marchait dans l’espoir de la trouver. Au bout de six mois il eut une fièvre angéioténique, qui jugea sa manie érotique. » Le traitement de l’érotomanie consiste à faire cesser la cause qui a déterminé cette singulière maladie. Il est difficile de tracer la conduite que l’on doit tenir en pareille circonstance ; c’est au médecin à juger, d’après la position du malade, des moyens qu’il croit utiles d’employer. Il faut qu’il sache s’attirer la confiance du malade, qu’il entre dans ses idées, qu’il s’accommode à son délire, qu’il paraisse persuadé que les choses sont telles qu’il se les imagine, et qu’il lui promette avec assurance une guérison parfaite. Cette assurance avec laquelle on leur parle ne contribue pas moins à ramener à la santé ces malheureux, dont les facultés intellectuelles sont fortement lésées. Un peintre, au rapport de Tulpius, croyait avoir tous les os ramollis comme de la cire ; il n’osait en conséquence faire un seul pas. Ce médecin lui parut pleinement persuadé de la vérité de son accident, et lui promit des remèdes infaillibles ; mais il lui défendit de marcher pendant six jours, après lesquels il lui donnait la permission de le faire. Le malade pensant qu’il fallait tout ce temps aux remèdes pour agir et pour lui fortifier et endurcir les os, obéit exactement, après quoi il se promena sans crainte et avec facilité. Un maniaque, croyant avoir une loupe au côté de la face, sollicita un chirurgien à lui en faire l’extirpation ; celui-ci simula l’opération convenable, et le malade guérit. On ne parvenait à faire uriner un autre maniaque, qui s’en abstenait, dans la crainte de produire un nouveau déluge et d’inonder l’univers, qu’en venant lui annoncer, avec un air effarouché, que la ville qu’il habitait allait devenir la proie des flammes, s’il n’urinait ; ému par cette raison, il le faisait aussitôt, et croyait fortement avoir arrêté l’incendie. Il est cependant quelquefois à propos de contrarier ouvertement leurs sentimens, d’exciter en eux des passions qui leur fassent oublier le sujet de leur délire. C’est au médecin ingénieux et instruit à bien saisir ces occasions. Un homme croyant avoir des jambes de verre, de peur de les casser, ne faisait aucun mouvement ; il souffrait avec peine qu’on l’approchât ; une domestique avisée lui jeta exprès un morceau de bois sur les jambes : il se mit dans une grande colère, au point de se lever et de courir après elle pour la frapper. Lorsqu’il fut revenu à lui, il fut tout surpris de pouvoir se soutenir sur ses jambes et de trouver guéri. L’assurance avec laquelle on nous persuade la confiance que nous mettons dans une personne qui nous est attachée, a même quelquefois fait cesser le délire qui accompagne les fièvres ; comme l’observation suivante, qui m’est propre, peut en fournir un exemple. Dans l’hiver de 1812 j’eus une fièvre bilieuse continue, accompagnée de délire assez violent pendant l’accès. J’avais vu passer une revue peu de jours auparavant ; on avait fait faire différentes évolutions aux troupes qui s’y trouvaient. L’imagination remplie de ces différentes manoeuvres, je me figurais voir, dans mon délire, un régiment d’infanterie posé dans mon antichambre, la bayonnette croisée, et attendant l’ordre du colonel pour marcher sur moi et m’anéantir. Cette idée me poursuivait continuellement, et m’eût été probablement funeste, sans la sage prévoyance de mon portier, qui, connaissant la cause de mon agitation, vint à moi avec un ton d’assurance et de gaîté : « Monsieur, me dit-il, le gouverneur, instruit de la mauvaise conduite du régiment qui était dans votre antichambre, a fait arrêter le colonel ; il est à l’Abbaye, et les soldats sont licenciés ; ainsi, calmez-vous, et cessez de vous inquiéter, votre vie est actuellement sans danger. Le ton ferme, la gaîté avec laquelle il vint m’annoncer cette nouvelle, la confiance que j’avais en lui, me persuadèrent que ce qu’il me disait était exact ; je le crus, et le délire cessa sur-le-champ. J’ai fait cette espèce de digression sur le délire, afin de faire voir combien il est avantageux, dans le traitement de l’érotomanie (qui est un délire amoureux), que le médecin s’identifie en quelque sorte avec son malade, et qu’il jouisse entièrement de sa confiance. Il faut avoir, vis-à-vis d’eux, l’attention de ne rien dire qui soit relatif au sujet de leur maladie. On doit également écarter de leur vue tous les objets propres à la rappeler. Un homme qui s’était figuré qu’il était lapin raisonnait cependant en homme très-sensé dans un cercle ; lorsque malheureusement un chien entrait dans la chambre, alors il se mettait à fuir, et allait se cacher promptement sous le lit, afin d’éviter les poursuites de cet animal. Étant débarrassé des idées qui causaient sa maladie, on engagera le malade à faire de fréquentes promenades à la campagne, etc. En général, on lui conseillera tous les exercices qui ont le plus d’attraits pour lui, et qui seront le plus capables de captiver son imagination. Satyriasis. Pour compléter le tableau des principales maladies que détermine la continence sur l’économie animale, il me reste encore à parler du satyriasis, affection qui, suivant l’étymologie du mot, met les hommes dans un état de salacité qui caractérisait les satyres. Les individus que frappe cette cruelle maladie sont ordinairement tourmentés par un appétit violent des plaisirs vénériens, qui s’exalte quelquefois jusqu’à la fureur. N’est-ce pas en effet une véritable fureur qui porte un jeune homme à violer une vieille femme, dont il eût certainement obtenu les faveurs, s’il les eût demandées ? L’érection de la verge est un symptôme constant de cette maladie ; cet état est le signe d’un besoin pressant de satisfaire les désirs vénériens que l’on a long-temps combattus, et qui deviennent de plus en plus difficiles à vaincre. L’imagination est obsédée par des idées lascives ; le sommeil, troublé par des rêves érotiques, est interrompu par de fréquentes pollutions. Un délire doux et tranquille, ou bien marqué par les emportemens les plus furieux, s’empare des malades ; les désirs augmentent de violence ; pour les satisfaire tous les moyens sont bons, tous les objets indifférens. Une fièvre lente se joint à l’aliénation mentale ; la face est rouge et animée, les yeux sont saillans ; la physionomie, comme le remarque M. Duprest-Roni, offre une expression assez semblable à celle des animaux en rut. La fureur diminue par intervalles : alors le malade est triste et abattu, honteux de ses excès. Parvenue à son dernier période, la maladie est caractérisée par la continuité du délire, la violence des emportemens, et la fougue incoercible des désirs. Alors les organes génitaux s’enflamment, et sont souvent frappés d’une gangrène subite ; et la mort vient mettre fin aux tourmens les plus cruels. Il est plus ordinaire cependant de voir les symptômes, moins alarmans, continuer quelque temps, diminuer progressivement, et cesser enfin après un court traitement. Je vais rapporter quelques observations qui serviront à éclairer l’histoire de cette maladie. La première appartient à Balthasar Timeus. « Un musicien, d’une structure athlétique, ayant les cheveux et la figure rouges ; d’un tempérament ardent, était tellement tourmenté de désirs amoureux, que l’acte vénérien répété plusieurs fois en peu d’heures ne pouvait le satisfaire. Odieux à lui-même, et craignant les châtimens que la colère divine réserve aux luxurieux, il vint implorer mon secours. Je lui fis pratiquer une saignée, et le mis à l’usage des rafraîchissans et des calmans ; je lui conseillai la diète, ce qui ne procura aucun soulagement. Mon avis fut alors qu’il eût recours au mariage. Effectivement, il épousa une jeune villageoise d’une constitution forte et robuste. D’abord il parut s’en trouver bien ; mais, peu de temps après, il lassa sa femme par des embrassemens trop répétés, et redevint aussi satyre qu’auparavant. M’étant venu demander d’autres secours, je lui recommandai la prière et le jeûne. Ne s’en trouvant pas soulagé, il voulait se soumettre à la castration. Je pensai qu’il ne fallait point pratiquer cette opération par rapport aux suites funestes qu’elle pourrait avoir, et qu’au moins il fallait la différer. Le malade, au contraire, me pressait vivement, et cherchait à gagner par les présens ceux qui s’opposaient à ses dessins. Il me promit même un cheval qui allait l’amble, dont la beauté n’était pas à dédaigner, dans le cas que je voulusse me rendre à ses désirs. «J’avoue que mes domestiques m’ont souvent fait rougir, ne connaissant pas la fureur satyriaque de ce musicien, et me demandant ce qu’il venait si souvent faire chez moi, lui qui, non-seulement n’avait pas l’air malade, mais qui présentait tous les signes de la santé la plus robuste. « Peu s’en fallut, dit ce médecin, que je ne lui fisse couper son membre importun.» Procédé barbare qu’il n’eût employé qu’afin de ne pas paraître échouer dans le traitement d’une maladie dont la durée semblait attester son ignorance. Ce malheureux musicien, qui, quelque temps après fut guéri entièrement en prenant des doses de nitre dans l’eau de nymphéa, faillit être victime d’un amour-propre déplacé et de la présomption la plus ridicule ; car, comme le conçoivent très-bien les hommes sensés, la médecine ne guérit point indistinctement toutes les maladies. La sphère de nos moyens est trop bornée, les anomalies de la nature trop variées pour que l’on puisse jamais se flatter d’y parvenir. Le médecin est plutôt le spectateur que le guide de la nature : les effets de la polypharmacie sont des preuves convaincantes de ce que j’avance. « En 1572, nous fusmes visiter un pauvre homme d’Orgon, en Provence, atteint du plus horrible et du plus épouvantable satyriasis qu’on sauroit voir ou penser : le faict est tel. Il avoit quartes pour en guérir ; prend conseil d’une vieille sorcière, laquelle lui fait une potion d’une once de semence d’orties, de deux drachmes de cantharides, d’un drachme demi de ciboule et autre, ce qui le rendit si furieux à l’acte vénérien, que la femme nous jura son Dieu qu’il l’avoit chevauchée dans deux nuits quatre-vingt-sept fois, sans y comprendre plus de dix qu’il s’étoit corrompu ; et même, dans le temps que nous consultasmes, le pauvre homme spermatisa trois fois en notre présence, embrassant le pied du lict, et agitant contre icelui comme si c’eust été sa femme. Ce spectacle nous étonna, et nous hasta à lui faire tous les remèdes pour combattre cette furieuse chaleur ; mais quel remède qu’on lui sceust faire, si passa-t-il le pas. » Le même auteur rapporte que Chauvel d’Orange fut appelé, en 1570, à Caderousse, petite ville proche sa résidence, pour voir un homme atteinct de la même maladie. « A l’entrée de la maison, trouve la femme du dit malade se plaignant à lui de la furieuse lubricité de son mari, qui l’avoit chevauchée quarante fois pour une nuit, et avoit toutes les parties génitales gastées, étant contrainte de les lui montrer afin qu’il lui ordonnast des remèdes pour combattre l’inflammation et l’extresme douleur qui la tourmentoit. Le mal étant venu de breuvage semblable à l’autre, qui lui fut donné par une femme qui gardoit l’hôpital, pour guérir la fièvre tierce qui l’affligeoit, de laquelle il tomba en telle fièvre, qu’il falloit l’attacher comme s’il fust possédé du diable. Le vicaire du lieu fust présent pour l’exhorter, à la présence même du sieur Chauvel, lesquels il prioit le laisser mourir avec le plaisir. Les femmes le plièrent dans un linsseuil mouillé en eau et vinaigre, où il fut laissé jusqu’au lendemain matin qu’elles aloyent le visiter ; mais sa furieuse chaleur fut bientôt éteincte et abattue, car elles le trouvèrent roide mort, la bouche riante, montrant les dents, et son membre tout gasté. » L’exemple le plus frappant d’une impulsion puissante et irrésistible d’un sexe vers l’autre est celui que l’on trouve dans un ouvrage périodique qui a pour titre : Espion anglais, ou Correspondance secrète entre mylord Alley, t. 1. Celui qui fait le sujet de cette observation avait acquis, dès l’âge de onze ans, cet accroissement physique, cette force, cette vigueur qui annoncent une puberté prématurée, et éprouvait déjà ces désirs tumultueux, ce penchant irrésistible qui pousse un sexe vers l’autre. Destiné par ses parens à l’état ecclésiastique, nourri dans les préceptes d’une religion qui commande la chasteté, il eut long-temps à lutter entre la crainte de trahir ses devoirs, et le désir de céder au penchant qui l’entraînait. Parvenu à l’époque où des sermens solennels le condamnaient à une continence perpétuelle, il redoubla de zèle et d’attention pour écarter de son imagination tous les objets lascifs qui pouvaient y laisser une impression assez vive, et émouvoir les organes de la génération. Cependant la nuit, durant le sommeil, la nature, reprenant ses droits, le délivrait, par de fréquentes pollutions, de l’irritation seminale. Pour obvier à cet inconvénient, il diminue la quantité de sa nourriture, supprime celle qu’il soupçonnait augmenter la sécrétion spermatique, et veille sur ses sensations avec plus de soin. Ce régime le réduit à un état de maigreur extrême. Arrivé à sa trente-deuxième année, un matin, il s’éveille, l’imagination échauffée par des images les plus voluptueuses, les organes de la génération fortement ébranlés. Il se lève, et, par de puissantes distractions, il trompe la nature. Cependant une vivacité, un feu jusqu’alors inconnu, s’emparent de lui ; ses sens acquièrent une sensibilité, une pénétration étonnantes. L’après-midi, en entrant dans un salon, il porte ses regards sur deux personnes du sexe, qui font sur lui une telle impression, qu’elles lui paraissent lumineuses et comme si elles étaient électrisées. Frappé d’un pareil phénomène, et en ignorant la cause, il l’attribue au prestige du démon, et se retire. Pendant le reste de la journée, ayant rencontré d’autres femmes, il éprouva la même illusion. Le lendemain, voulant se rendre dans sa maison, il monte en voiture, et croit qu’à chaque instant elle verse ; dans une auberge où on lui sert à manger, le pain, le vin, et tous les objets qu’on lui présente lui paraissent en désordre. Arrivé dans sa famille, il se trouve d’abord plus tranquille ; mais le lendemain, environ deux heures après le repas, il sent tout à coup ses membres s’étendre et se roidir, tout son corps frémir et s’agiter par un mouvement violent et convulsif ; il éprouve à la tête la douleur la plus vive, il lui semble que cette partie tournoie et fait une volute ; il se livre à des actions puériles et ridicules. Dans cet état on le saigne, ce qui ne le soulage nullement ; on le plonge dans le bain, soulagement momentané. Bientôt les symptômes reparaissent avec plus d’intensité : le délire se montre sous les formes les plus bizarres ; tantôt il croit que le gouverneur de sa province lui offre toutes les beautés de la cour de Louis XV pour le faire renoncer à la continence ; tantôt il se croit Alexandre, Achille, Pyrrhus, ou Henri IV, et se retraçant les principales actions de ces grands hommes, il assiége les villes, force les camps, remporte des victoires, et, dans les transports de son humeur guerrière, il brise les colonnes de son lit, enfonce les portes de sa chambre, en prononçant avec force ce vers de Virgile : Cecidit Ilion Priamique domus. Le bruit que cause ce vacarme attire ses parens, qui s’emparent de lui et le garrottent. Peu de temps après, il s’endort, la tête pleine des images les plus terrible ; il croit voir les spectres des plus fameux guerriers environnés de vieilles armes rouillées : cette image s’empreint si fortement en lui, que long-temps après il ne peut fixer une arme sans que son odorat ne soit désagréablement affecté d’une odeur de cuivre ou de rouille. Devenu plus tranquille, ses parens le rendent à la liberté ; ce qui lui fait éprouver les jouissances les plus délicieuses. La nuit ensuite, il dort d’un sommeil doux et paisible ; mais aux approches du jour et de son réveil il a un songe qui donne lieu à un dernier et troisième accès. Il lui semble voir un roi puissant venir, à la tête d’une armée formidable, renouveler la cruelle journée de la St.-Barthelemy ; en même temps il se croit destiné à s’opposer à ses cruels desseins. Dans un endroit que lui désigne son imagination, une pique s’offre à ses yeux ; il doit s’en emparer comme d’une armure qui le rendrait invincible. Plein de cette idée, il sort de la maison, entre dans le jardin, est sur le point d’en franchir la haie, lorsque ses parens accourent, et le ramènent : il ne fait aucune difficulté. Cependant l’imagination toujours pleine du projet de secourir les protestans, il s’occupe à lever des troupes, à les discipliner, à fortifier les villes, etc., etc. ; il dessine, fait des plans, des campemens, et a le coup-d’oeil si juste, que, sans autres instrumens que ceux qui lui tombent sous la main, il exécute le tout avec une grande précision. Des idées plus agréables viennent s’emparer de lui. Tout ce que les femmes de tous les pays ont de plus agréable et de plus ravissant, tous les appas dont la nature les a ornées viennent tour à tour émouvoir ses sens : il croit les soumettre toutes à ses désirs et à son pouvoir. Cependant il est un objet pour lequel il a une prédilection marquée, c’est une jeune demoiselle qu’il a vue quatre jours avant de tomber malade. Dans cette singulière maladie, tous les organes des sens sont portés à un tel degré de sensibilité, qu’ils lui font éprouver les tourmens les plus affreux et les plaisirs les plus vifs. La lumière affecte certaines fois la rétine avec tant d’éclat et de vivacité, qu’elle ne peut en supporter la présence ; d’autres fois, les points de vue les plus agréables, les perspectives les plus variées s’offrent à ses regards, et ravissent son âme. Le son le plus léger, les moindres vibrations de l’air lui causent dans l’oreille une douleur intolérable, ou bien cet organe, mieux disposé, lui procure les sensations les plus délicieuses ; il lui semble que l’univers est un orchestre immense, dont les sons harmonieux jettent son âme dans l’extase la plus complète. Le goût et l’odorat ont aussi leurs vicissitudes de peines et de plaisirs. Le tact lui-même est affecté de ces deux extrêmes, mais il paraît le dernier sur la scène. Un délire aussi complet et tour à tour reproduit sous les formes les plus variées finit par une évacuation naturelle, que l’auteur rappelle avec les termes les plus emphatiques. A la suite de cette crise le malade recouvre la raison, et bientôt après la santé. M. Alibert, dans sa Thérapeutique, rapporte l’observation d’un homme de soixante ans, connu dans plusieurs sociétés de Paris, qui aimait éperdûment une jeune dame. Dans une circonstance, il fut pris d’un tel accès de satyriasis, qu’il se précipita sur l’objet de ses feux, et outragea scandaleusement sa pudeur. Une fièvre brûlante, à laquelle l’individu succomba, remplaça cet état extraordinaire de fureur et d’alinéation : les parties génitales furent successivement frappées de phlegmasie et de grangène. M. Duprest-Ronsy rapporte un fait tout aussi remarquable par ses phénomènes ; c’était un jeune homme âgé de vingt ans, d’une constitution assez vigoureuse, qui, d’après son rapport, s’était livré dans son enfance aux excès de la masturbation ; il avait prodigieusement altéré son intelligence et sa mémoire : mais, depuis deux ans, il avait totalement renoncé à cette funeste habitude ; sa vie était sage et régulière. Il fut placé à Paris dans une maison de commerce, et il se livrait à ce nouveau genre d’occupation avec un zèle et une activité infatigable. Chéri de ce négociant et de son épouse, il s’abusa sur le genre d’attachement que la femme avait pour lui, et s’imagina en être tendrement aimé ; de son côté, il la payait d’un retour sincère. Placé entre la crainte de violer les devoirs de la reconnaissance et le désir de posséder cette femme, qui cependant n’était ni jeune ni jolie, sa situation devint de jour en jour plus pénible et plus embarrassante. Quand par hasard elle jetait un coup-d’oeil sur lui, il entrait en érection et ne tardait pas à éjaculer ; la nuit, il avait des pollutions fréquentes. Bientôt on s’aperçut d’un dérangement dans les facultés de son entendement : ce dérangement lui survint après la lecture de la Phèdre, de Racine. Il s’identifia tellement avec les personnages, qu’il s’imagina être Hippolyte, regarda sa maîtresse comme Phèdre, et fit un nouveau Thésée de son époux. Plus amoureux qu’Hippolyte, et non moins vertueux que lui, il conçoit le projet bizarre d’aller se jeter aux pieds de Thésée et de lui avouer ce qui se passait dans son âme. Il y met tout le pathétique que pouvait comporter le sujet : Thésée, lui dit-il, le crime n’est pas encore consommé ; votre femme n’est pas coupable ; jusqu’ici j’ai résisté à ses prières et à ses larmes ; mais je ne suis plus le maître de moi-même, et si vous ne m’éloignez de sa présence, il faudra que je succombe. Il n’est pas besoin de dire quel fut l’étonnement du prétendu Thésée. Il prit le parti d’éloigner le jeune homme : cet éloignement dissipa le délire ; cependant les érections suivies de semence continuèrent ; l’estomac et le tube intestinal étaient frappés d’atonie. Le malade désirait des alimens avec avidité ; mais dès qu’il les avait pris, il éprouvait de la douleur dans la région épigastrique et un malaise dans le reste du corps. M. Duprest-Rosny employa, dans cette circonstance, le traitement le plus sage et le plus éclairé. Il fit voyager le jeune homme ; lui fit prendre des bains, des boissons rafraîchissantes ; fit une heureuse association des remèdes calmans et des toniques doux, et le jeune homme, quelques temps après, était dans un état parfait de santé. Le traitement de cette maladie exige, si les symptômes sont alarmans, l’usage des débilitans, des narcotiques, soit à l’intérieur ou sur les parties génitales elles-mêmes. L’usage du nitre, comme l’observation de Balthazar Timeus le prouve, réussit quelquefois, puisque le musicien qui en fait le sujet, après huit jours de l’emploi de ce médicament, se trouva tellement rafraîchi, que lui, qui sans doute eût été un champion digne de l’insatiable Messaline, pouvait à peine satisfaire au devoir que le mariage lui imposait envers sa femme. Si le traitement du satyriasis réclame l’emploi d’une médecine active, à raison de l’urgence des symptômes et du péril éminent que courent les malades, on doit aussi emprunter de l’hygiène les moyens, propres à prévenir la récidive de la maladie. Parmi ces moyens le plus sûr est, sans contredit, l’usage modéré des plaisirs de l’amour et une direction habituelle de la pensée sur les objets étrangers à ce sentiment : l’étude des sciences, la culture des arts, les travaux du jardinage, l’habitation à la campagne, sont alors des moyens d’autant plus précieux, qu’en eux l’agréable se joint à l’utile. Il existe encore quelques affections nerveuses sur lesquelles la continence influe d’une manière désavantageuse, et dont elle augmente souvent l’intensité des symptômes ; telles sont l’épilepsie, la catalepsie, la manie, la mélancolie, la frénésie. Mais, comme ces maladies ne sont point un effet immédiat de cet état, je ne les traiterai nullement ; je dirai seulement que les plaisirs de l’amour ont souvent été très-efficaces dans leur traitement, et qu’on a vu des mélancoliques reprendre la gaîté qui leur était naturelle lorsqu’ils avaient habité quelque temps avec des femmes ; c’est ce qui avait fait donner le nom d’Autievro à la courtisanne Hoéa, parce qu’elle avait, disait-elle, un remède assuré contre l’humeur noire. Ce moyen produit bien plus d’effet sur nous que tous les médicamens que la pharmacie nous fournit. Cet homme dont Galien nous trace l’histoire, qui avait été si touché de la mort de sa première femme, qu’il résolut de n’en avoir jamais d’autres, se trouvant quelque temps après fort incommodé par des indigestions d’estomac, et par une tristesse dont il ne connaissait pas la cause, fut enfin obligé de rompre son voeu et de se joindre amoureusement à une autre femme, entre les bras de laquelle il recouvra la santé. De tous les moyens que la nature a mis en oeuvre pour éteindre l’exaltation préjudiciable de l’instinct qui porte les êtres à se reproduire, on voit qu’il n’en est point dont l’effet salutaire puisse être comparé à celui qui résulte de la consommation même de l’acte vénérien, lorsque la modération y préside et que la fréquence n’est pas fondée sur des besoins factices. L’amour lui-même est alors le remède le plus sûr aux maux qu’il a fait naître, et on a vu souvent les égaremens les plus étranges se dissiper par la possession de l’objet qui les avait fait naître. On peut donc conclure, d’après tout ce que j’ai dit, 1.° que la continence est utile jusqu’à la terminaison de la cure ; 2.° qu’elle est souvent nuisible après cette époque ; 3.° que le mariage est généralement le moyen le plus efficace pour ramener à une parfaite santé les personnes qui sont atteintes des maladies décrites ci-dessus ; 4.° qu’après le mariage, tous les moyens que nous fournit l’hygiène seront ceux qui devront être préférés à tout autre ; 5.° enfin, que la pharmacie peut être un moyen accessoire, utile pour combattre quelques symptômes qui aggravent ces différentes affections, mais qu’elle ne peut jamais les guérir lorsqu’elle agit seule.
|
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2007 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Static Wikipedia 2006 (no images)
aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -
Sub-domains
CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -
Other Domains
https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com