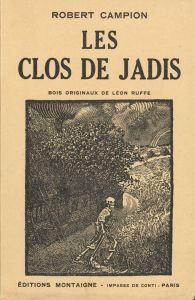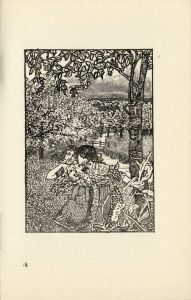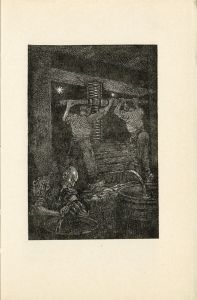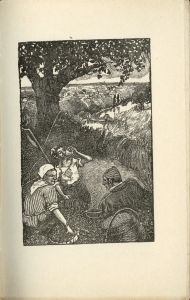A
MES AMIS
Le Poète Fernand Fleuret
et Jean Maillart-Norbert
Gentilhomme-Verrier,
ce petit voirre ouvré d’azur par
dehors à images, entre
flascons, biberons
et aiguières
de l’ouvrage
de Damas,
comme il est dit dans
l’inventaire de Louis d’Anjou
I
LE MANOIR
LE CLOS NEUVILLE
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu,
si calme….
VERLAINE.
Le chemin rural qui mène au clos des Neuville ouvre sa charrière sur la
route unie et claire de Fervacques, au lieudit de la Forge. Ce chemin
est creusé dans le coteau. Les pluies l’ont raviné, le balancement des
hautes cimes a dégradé ses talus, le gel a provoqué l’éboulis de ses
sables. Il est devenu profond, et sa pente est rude, si rude qu’on n’y
monte qu’à « bêtes de somme » qui s’y reprennent par trois fois pour
gagner le clos.
Autrefois, ce chemin, aux arêtes rocheuses, était l’unique raccourci
qui joignait la vallée de la Touques à sa sœur jumelle, la vallée de
l’Orbiquet. Il franchissait le haut plateau au carrefour des
Quatre-Maillots, point où quatre communes se touchent pour s’épandre au
versant opposé.
Dans de vieux actes, où il est fait mention d’obligations rurales, les
riverains devaient fournir des bourrées pour combler ses fondrières,
mais les générations avaient passé sans adoucir son échine, si bien
que, lassés, les paysans s’en détournèrent pour prendre une voie
nouvelle et qu’ils laissèrent croître dans le sentier ingrat la ronce
envahissante, la viorne et l’églantier brutal. Dès lors, dans ses
parties hautes du plateau, l’eau stagna, les bêtes puantes creusèrent
ses rebords, et toutes les herbes d’ombre l’accaparèrent si pleinement
qu’on ne le désigna plus, dans le canton, que comme le « chemin perdu ».
Aujourd’hui encore, en dépit de l’impôt des prestataires, qui ne
s’applique que dans le court espace de sa montée à la ferme Neuville,
il y faut, pour rouler un charretis à vide, l’effort de deux chevaux en
flèche, pousser à hue, tirer à dia, et jurer d’ahan jusqu’au sommet, où
les bêtes arrivent boiteuses et le charretier damné.
C’est par ce chemin qu’ont passé mes grands et arrière-grands-pères ;
ceux-ci habillés d’habits marron et de hauts-de-chausses ; ceux-là plus
modernes, vêtus de blouses à fins liserés et coiffés du chapeau «
castor ».
Par là s’en est allée ma bisaïeule, ornée du haut bonnet normand, jupe
fleurie, fichu croisé. Et tous ont dévalé du clos avec leur monture
sellée de velours rouge, garnie de pompons chatoyants.
La pierre énorme émergeant du talus n’est que le marche-pied de ces
vieux cavaliers.
Une barrière à claire-voie donne accès dans le clos.
La maison regarde l’Orient. Elle est rayée de colombages, garnie
d’espaliers. On l’aperçoit à travers les bâtons penchés des pommiers,
protégée par un immense poirier.
A la vieille maison normande, habillée de rosiers et de vignes, coiffée
de paille vétuste, mon père avait ajouté une aile, à deux étages, dont
les toits pointus se voyaient de la route et donnaient à l’ensemble une
physionomie cossue et gaie.
Le jardin est encadré de néfliers. Entre deux bouquets d’épines rouges,
la porte, surmontée d’un auvent, s’ouvre sur les iris en bordure du
puits où s’égouttent les channes à lait.
Du balcon de bois de la partie moderne, on domine la vallée qui
s’allonge, lumineuse et verte, vers le sud, gagne les lointains violets
de Fervacques.
Dans la robe mouillée de ses aulnes, de ses peupliers, la vallée
s’étale, voluptueuse, aux rives de son ruisseau d’argent, coulée
miroitante, où se réfléchit le jeu des nuages. Eparpillés, les bœufs
font de petites taches brunes. Et l’œil averti discerne Fervacques, son
clocher, le bourg ramassé autour de son château.
Alentour, les fermes épandent leurs innombrables pommiers. Il y en a
jusqu’à la ligne du ciel, où qu’on se tourne. Leurs touffes arrondies,
emmêlées, tassées dans la perspective, forment une forêt murale,
moussue et grisaille. Aucuns semblent s’en être détachés et sont
descendus dans l’herbe des prés, jusqu’à la rivière ; d’autres,
tourmentés par le vent, enjambent les labours, se heurtent, trébuchent
au bord d’un chemin creux.
Le chaume a gardé son caractère.
Dans la cuisine, une dinanderie tient tout le mur. Elle se compose de
bassinoires à trèfles, de trépieds et de réchauds à tripes. Au
vaisselier, les étains ventrus reçoivent les rayons blancs du dehors.
Près de la porte est accrochée une petite glace dont le mercure a
coulé. C’est le miroir commun. Chacun s’y mire au départ, les hommes en
se baissant, les enfants en montant sur une chaise. Il est à hauteur du
visage de la servante.
L’âtre a ses deux chenets et sa crémaillère. La tablette est si haute
que nos gens, debout, la touchent à peine du front. Un fusil barre la
hotte, des pièces de carême dépassent le linteau, et, sur les retours
du chambranle, sont alignés les almanachs, un Code, une ordonnance de
Louis XIV « sur le Fait des Eaux et Forêts ».
On accède dans les nouvelles pièces par deux marches. Une armoire
sculptée, un baromètre doré de style Louis XVI, une horloge à boîtier,
huit chaises à coquilles et un canapé de paille composent l’ameublement
de la salle à manger.
Aux murs, des gravures coloriées relatent les aventures galantes
d’Estelle et de Némorin, le naufrage de Zélie dans le désert. Zélie est
vêtue d’une robe à crinoline, elle est gantée de mitaines. Une
lithographie représente saint Just. On lit : « Saint Just, protégez
toujours contre les douleurs ceux qui auront votre portrait dans leur
maison. » Cette image est dédiée spécialement aux pélerins qui font le
voyage à Fervacques.
Deux autres cadres rappellent le berceau du Petit Prince Impérial et la
remise des clefs de la ville de Nice à Napoléon III. « Sire, dit le
Maire, j’ai l’honneur de vous offrir ces clefs, symbole de liens
indissolubles qui attachent la ville de Nice à votre Auguste personne
et à votre dynastie. »
D’habitude, Mme Neuville se tient dans la cuisine, près de la fenêtre,
à une petite table vieillotte qui lui sert de vide-poche.
On fait alors grand bruit dans la maison. Le va-et-vient des femmes en
sabots, le choc des channes, le parler gras des patoisants emplissent
la pièce de sonorités diverses. Catherine commande le déjeuner à coups
de conque marine. A son appel, qui effare les coqs, Hélie entre suivi
de Harel ; tous deux frappent le seuil de leurs chaussures : «
Serviteur ! la compagnie ! » Hélie se range au bas bout de la table.
Avec une extrême lenteur, il coupe le pain qu’il dispose en pyramides,
de la pointe de son couteau.
Harel, le pichet sur la cuisse, se verse à boire.
PICHETS DE PRE D’AUGE
Les images qu’on haïrait pour
maladroites
Avec leur gaucherie populaire et précise,
Si l’on n’avait la foi du temps des
almanachs…
Fernand FLEURET.
Hélie ! Harel ! deux noms, deux joies, deux faïences peintes du
bas-bout de la table.
Ces deux figures, l’une triste, l’autre gaie, portent le poids léger de
mes souvenirs heureux. Dans le recul des ans – ce lointain où se figent
les formes, où les yeux retrouvés nous regardent fixement – ces deux
serviteurs sont les cariatides du grand âtre de pierre que le temps a
disjoint.
Hélie est un résigné. Il marche le front bas. L’usage de la faulx a
courbé son échine.
Ayant eu, dans sa jeunesse, une épaule démise, il se remue d’une pièce.
– « Manquablement qu’on n’li avait point r’mise, car ed’pis,
disait-il, in’pouvait l’ver san bras pu haut que l’coupiau d’sa tête. »
De fait, Hélie ne lève le bras que pour s’essuyer le front, ne dresse
la tête que pour interroger les nuages, chercher l’orient.
Je le vois, au jardin, en gilet gris-perle, de petits anneaux d’or aux
oreilles ; il est pieds nus dans ses sabots et sa chemise est roulée
aux coudes. Ici, il fait partie des grands carrés de choux et de
rosiers qui attirent la multitude ailée. Les papillons, ces petites
flammes dansantes, s’éloignent à peine de son rateau. « Ils ont entre
les yeux, observe Hélie, comme un ressort de montre », et, quand la
brise incline leurs ailes jointes : « Ça tangue ! dit-il, y a du vent
dans les voiles ! ». Il ne délaisse l’arrosoir que pour la faulx.
Plein de croyances vulgaires, Hélie prétend que le curé de Prètreville
arrête court le feu des incendies, que le père Louis guérit les
entorses au moyen de signes en croix sur la foulure… –
« Manquablement que ces gens-là savaient les mots ! »… Il
affirme avec simplicité que les œufs de nos coqs de bassecour, couvés
par des crapauds, produisent des basilics domestiques.
A l’encontre de Harel, qui est rieur et buveur, Hélie est sobre, il a
le respect des traditions, la crainte des riches. Madame Neuville est
sa « maîtresse ». S’il lui arrive de l’interrompre : « Pardon… excuse…
si j’vous corromps la parole ! ».
D’une humeur égale, il reçoit au jardin la bonne et la mauvaise saison
; d’un même pas il va de ses semis de printemps à ses crassanes de
l’automne. Au surplus, Hélie est de son temps, et, à l’heure de la
méridienne, il consulte l’almanach qui prédit la pluie, le cours des
astres, les cataclysmes et les aurores boréales.
Faune souriant, de la lumière aux cils, Harel est un nez énorme
qu’encadrent de courts favoris blonds, un nez bruyant sur une bouche
gourmande, vaste, lippue, retroussée aux coins. Velu de l’oreille au
talon, Harel se tient arqué à la manière des chèvre-pieds. Il est plein
de volubilité et chante à l’église.
Il avait été tisserand, mais les inventions modernes avaient ruiné son
industrie. Par goût de labeur aisé, il s’était fixé dans le clos des
Neuville et s’y était consolé de la décadence de son art dans la
dégustation des jus et l’exercice de sa fonction de chantre. Harel
connaît la note et retient le latin.
De toutes les corvées, il donne la main à Catherine pour les gros
ouvrages de laiterie et ne laisse la maison que pour l’église. Mais,
quoique dignitaire aux offices, il est simple et gai dans le
domestique. Si la pluie le tient à l’abri des granges, c’est que le
chantre redoute l’enrouement.
Harel part à l’aurore, son barillet de cidre à l’épaule, et, dans son
carnier, un pot de grès qui contient son déjeuner froid.
Il est, aux prés, l’entrain des équipes, une lame large et grasse ; il
couche à terre l’
ondin dans un joli balancement du buste, et connaît
les plantes mystérieuses qui donnent le mordant aux pierres. C’est d’un
geste rituel qu’il aiguise sa faulx.
Dans ses pauses, Harel s’assied sur un fagot ; le rieur interpelle les
faneuses, narre une aventure grivoise, mime son curé, les bonnes
gens-types de la contrée. Le barillet penché : «
Astra Bibit,
déclame-t-il, l’astre boit ;
et terra bibit, la terre boit ;
quare
non biberemus ? Pourquoi ne boirions-nous pas ? »
Et Harel, buvant à intervalles réguliers, voit l’écoulement du temps au
niveau de son barillet. Sondant le cidre d’une tige d’herbe : « Il est
cinq heures au
brin mouillé, observe-t-il ».
Harel doit à l’abondance des tables augeronnes l’habitude des repas qui
durent, à la variété des crus, une sensualité affinée qui lui permet,
les yeux fermés, de distinguer la meilleure eau-de-vie du pays, de dire
son âge. Il préfère au beurre de côteau, le beurre ambre pâle de la
vallée, exempt de plantes nuisibles, et il explique pourquoi l’aloyau
rôti au feu de pommier dépasse en saveur tous les autres. Enfin, Harel
a le secret des salmis, des compotes saoulantes, où le cidre pur se
réduit en sirop caramélisé, un peu âcre, qu’on met en pot pour l’hiver.
- C’est une bouche délicate, dit Hélie.
Ses gaietés sont brusques, ses déconvenues toujours les mêmes.
Un soir, Catherine mit hardiment le feu à cet homme velu qui se séchait
le torse à l’âtre.
Un jour de lessive, il tomba dans la mare avec un veau qu’il avait
coiffé d’un linge mouillé. – Catherine, vous souvient-il de la navrance
de ses traits ? des cent baisers que vous reçûtes pour l’avoir enduit
de la suie d’une andouille dépendue ?
Cependant, vers la Noël, lorsque le gel durcit la terre, Harel descend
dans sa cave, où son métier de bois démodé l’attend. Dans le silence
des jours agonisants, le glissement de la navette s’entend au creux de
la vallée. Herla, herla !... herla herla !..., Harel tisse ! soupirent
les gens, i va tomber d’la neige !...
Pour gagner la maison du garde, je franchis le ruisseau de la ferme sur
une passerelle de bois. A cet endroit, le courant s’évase, forme un
abreuvoir où, l’été, les vaches, à l’ombre des aulnes, se protègent des
mouches bourdonnantes.
Je ne passe jamais ce ravin sans revoir un geste de mon père : il
épuise une fosse et lance sur le rebord la truite tachetée qu’il prend
à la main. Son image m’accompagne par delà l’échalier, où, chez le
garde, mon approche fait aboyer les chiens et s’éparpiller les poules
aux écuelles. Lazare Duhamel est ici
sur sa terre.
La porte de sa cuisine s’ouvre entre deux espaliers. La poutre, au
plafond, est décorée de fusils, de pattes de chevreuils, de collets, de
pièces
à conviction ; un tire-botte dépasse le bas de l’armoire à
linge.
Je trouve rarement Duhamel à son âtre. Un coup de fusil entendu, le
garde se chausse, prend le vent et part. Il a, dans sa haie, utilisé le
tronc d’un frêne pour dominer la plaine. De là, il voit à une
demi-lieue le braconnier dans les taillis. Il pratique alors les
raccourcis, surgit brusquement. Sa violence est soudaine : « C’est vous
qui avez tiré !... » s’écrie-t-il, en saisissant l’arme de l’homme.
Dans la contrée, entre gens de bien, on le choisit pour arbitre. Qu’il
s’agisse de la limitation d’un champ, d’une haie émondée avant terme :
« Y a-t-il un écrit ? » interroge-t-il. Duhamel unit à sa fonction de
garde une intelligence et une activité redoutables.
Il est d’une taille moyenne, large et droit. Un collier de barbe
blanche arrondit son visage exigu d’où saille un nez mince et aquilin,
où luisent deux yeux gris d’acier en perpétuel mouvement. Cet ensemble
de traits lui donne la physionomie du chat-huant. Il est chauve et
reste couvert à la table de ses maîtres.
Neuville et lui avaient greffé la plupart des pommiers de la ferme.
Depuis, il était resté l’homme de confiance de Mme Neuville. Elle
appréciait son sens aigu de la propriété. Tous deux avaient une même
tendresse pour la terre, le même appétit de s’étendre, la même âpreté
dans la défense de leurs droits.
Ils avaient pour les jeunes arbres une même sollicitude ; la même
colère les animait contre le vent et la grêle, contre les oiseaux
lourds qui brisaient les pousses de l’année. Tandis que Duhamel
nettoyait la branche chancreuse, Mme Neuville arquait sur les jeunes
greffes de petits perchoirs d’osier.
J’accompagne Duhamel aux pêcheries de ses gardes, au bois, aux
garennes, où qu’il aille.
Nous entreprenons les sentiers peu fréquentés, écartant les scions pour
pénétrer. Il me nomme les essences toxiques des lisières : l’if, la
bourdaine ; m’apprend que la vallée humide s’enorgueillit des aulnes et
des peupliers géants : le peuplier blanc à feuilles argentées, le
peuplier noir, le peuplier-tremble, le peuplier d’Italie et le peuplier
de Virginie. Tous croissaient rapidement. Il me dit que le manche de la
faulx se prend dans le bois léger du saule, celui du fouet dans la tige
verte des houx ; que l’acacia sert au charronnage ; qu’on cercle les
futailles avec le mérisier. Il m’explique que le sol aride convient aux
pins et aux chênes ; mais l’orme est son arbre de prédilection. Selon
lui, l’orme laisse croître l’herbe grasse à son ombre ; il ne craint
pas la foudre, il est l’arbre des riches et des beaux domaines.
Au reste, les arbres étaient doués de sensibilité et de chaleur, ils ne
pouvaient vivre qu’à la pleine lumière, leurs vaisseaux séveux
correspondaient à nos artères ; à court de sève ils étaient frappés de
stérilité, et, par un phénomène inconnu, leurs tiges tendaient
constamment à s’élever vers le ciel. Enfin, ils croissaient debout et
ne rampaient pas.
A la traverse des clos, nous nous arrêtons au pied de vieux pommiers
dont le cœur est mort. Ceux-là avaient vu la Révolution !... Ils
donnaient des fruits menus pleins de saveur amère.
Il m’initie à la flore de la haie.
La haie franchie, le chemin n’est pour le garde que le promenoir des
convoitises. Parce qu’elle est habitée, nous la côtoyons à pas feutrés
: surpris à l’abri du vent, le merle, dans un vol droit, fuit devant
nous ; le geai criard s’éparpille des troncs chevelus ; nous devinons
le nid sous la grappe odorante d’un sycomore. Aussi, comme le garde «
marche la clôture », l’interroge !... Comme il la sonde de son bâton
ferré !... Avec quelle attentive prudence il en ramène le collet tendu,
le lambeau d’étoffe retenu à la brèche ; comme il identifie l’escalade
!...
Au surplus, la clôture est la limite, elle constitue la défense
domaniale. Et selon que la haie comprend plus ou moins d’essences,
Duhamel prétend qu’elle indique plus ou moins d’aisance : il juge le
maître à l’entretien de sa clôture : « Mauvaise haie, méchant fermier
!... »
C’est avec une joie débordante que je vais au devant du garde. Le voici
! Le canon débronzé de son arme dépasse sa casquette ; il tient une
laitice, un lapereau. Dans la fraîcheur du matin il sent la fleur de
ronce, le mucus du ravin. – Bonjour, Duhamel ! Bonjour !... –
Serviteur… m’sieu Robert !
Duhamel a son ennemi, un ennemi sûr dont la rencontre, à l’angle des
granges, fige soudain les pas du garde. Dominique !... A sa vue
loqueteuse, la main de Duhamel se hausse à la bretelle du fusil.
Leur haine est ancienne. Elle eut pour origine une passion âpre : la
chasse !
Jadis, tandis que Duhamel, par destination fonctionnelle, accaparait,
pour son agrément et celui de ses maîtres, les chasses sur autrui,
Dominique, pauvre de biens et bon fusil, se voyait refuser jusqu’aux
passages sur les clos giboyeux. A telle fin qu’en peu d’années, le
gueux n’eut pour
battue que son courtil et un lopin de labour que,
par dépit, il ensemençait de sarrazin pour attirer les perdrix. Réduit
à ce peu d’espace, Dominique, devenu amer, empiéta sur son voisin ;
d’abord de la portée de son fusil, puis descendit au ravin, gagna la
plaine et braconna avant dans le soir. Pris aux garennes, Dominique
paya ; repris au bois, il fut déféré à des juges terriens qui le mirent
en prison. Il eût été pendu sous Louis, Duhamel le démontrait.
Ordonnances royales en main.
Les prises de Dominique par Duhamel eurent un caractère de grande
violence : le braconnier reçut du plomb, le garde fut réprimandé.
Un incident comi-tragique exacerba leur ressentiment : un soir sans
lune que Duhamel revenait de ses garennes, il fut saisi par des hommes
d’ombre, qui, sans éclat, l’enfournèrent à mi-corps dans un trou de
blaireau. Pour que le garde ne pût se dégager à reculons, les bandits
plantèrent entre ses jambes un bout de lisse déclôturée, de telle sorte
que le garde, dans l’impossibilité de se retourner, devait mourir
envoûté et quasi cloué dans le sable.
On le retrouva défait après huit heures de recherches.
On enquêta. Dominique avait-il soudoyé des braconniers de la ville ?
L’enquête trébucha au premier alibi, s’anémia, s’éteignit faute de
preuves.
Dominique braconna trente ans, jusqu’à ce que, vaincu par l’âge,
presque sans yeux, il eût vendu son peu de terre
à fonds perdus, sa
poire à poudre et son méchant fusil.
Hélie, témoin timide, raconte à la chandelle que les rieurs furent
parfois du côté du braconnier :
- La terre du gueux faisait face à la cour manable du garde. Quand le
vent en était, ils entendaient l’un et l’autre l’éclat de leurs voix ;
à ciel clair leurs coqs, piétant aux prés, se voyaient et se
répondaient. – « Manquablement qu’les jours où chassaient les riverains
de Dominique, cettui-ci rompait les chiens, fusillait l’gibier à la
passée !... »
De sa maison aussi, Dominique épiait la rentrée du garde. Dès qu’il
l’apercevait au coin de sa porte, pan ! pan !... Dominique tirait sur
un lièvre empaillé qu’il avait placé dans un sillon. Au coup de fusil,
Duhamel arrêté net, pénétrait du regard la perspective… Alors, sûr
d’être aperçu, soulevant haut sa peau empaillée, dans une télégraphie
furieuse, l’insulte au dessus du vallon, Dominique
agonisait Lazare :
« Tiens, mauvais Lazare ! Un
lieuvre que tu ne tueras point ! »
Les jours ont passé. Chez Dominique toute flamme est éteinte, hormis sa
rancune. Coiffé d’un bonnet de couleur, vêtu de hardes innommables, sur
l’épaule un bissac, il erre par les chemins étroits ; il repose au
carrefour, où il fait son feu ; dans le passage des clos, il s’écarte
du sentier, traîne son pas oblique sous les arbres fruitiers ; il
ramasse ce qu’il trouve : un outil, une chaîne. On le tolère à cause de
son grand âge. Il vient offrir chez Madame Neuville des églantiers, des
oignons de dahlias et de tulipes, des graines potagères. – « Boujou la
Maîtresse… J’vas vous dire… »
Et Dominique dit qu’au grand dam de ses maîtres, Duhamel a coupé
l’arbre de leurs lisières, trouvé là, de tous temps, le chevron de ses
toitures, la douve de ses futailles. Il répand que Duhamel a séduit la
femme d’Auber, dont il fut le serviteur, et qu’il a épousé – pour
égarer les soupçons – la jeune servante de la maison : – « Faut que
j’vous dise qu’Auber mort, l’mauvais Lazare devint fermier, qu’il fit
tester, à bout d’intrigues, la veuve d’Auber à son profit. Ha, ha !
Faut j’vous dise la vérité ! » Et Dominique ricane. Il insinue que la
veuve n’est pas morte d’un chaud et froid, pris à l’affût, mais d’un
cordial criminel versé par Lazare, « un soir qu’la vieille n’pouvait
pus crachi ni se retourner sur son traversin ». Ha ! ha ! Lazare avait
dépêché la veuve vers les pommiers du cimetière, et elle était partie
entre quatre planches avec, aux lèvres, le secret d’une eau-de-vie
nouvelle.
Dominique donne des détails. Il tient des héritiers déçus que, peu
avant la fin de la veuve Auber, Duhamel avait soulevé les globes de la
cheminée et retiré de dessous les bijoux et les dentelles. La petite
nièce de Mme Auber, venue trop tard, n’avait trouvé dans l’armoire
qu’un schall d’indienne, le testament en faveur de Duhamel, et, sous
les globes qu’un bouquet de mariée, des coquillages et quelques
bibelots en verre soufflé. – « Mon Dieu ! concluait Dominique, je ne
vous demande pas de biens, mettez mé seulement auprès d’ceux qui en
ont. »
La gravité de ces calomnies fondait au souvenir des déconvenues de
Dominique. Il ne rencontrait que des auditeurs méfiants que les
questions d’intérêt rendaient silencieux et prudents. La rancune du
gueux était trop amère. Aucuns avaient pitié, une pitié sans
compassion. Entre eux, les paysans riaient de ses chutes successives
qui l’avaient meurtri, déclassé. On lui avait connu un attelage bizarre
: deux haridelles hâves, arquées, qu’il louait aux jours de presse et
nourrissait le long des talus. Ces pauvres bêtes sans souffle, sans
jarret, rencontrées à genoux dans les montées, avaient symbolisé sa
détresse, excité la raillerie des méchants. Leur piteux assemblage en
flèche, leur peu d’entente à partir d’un même trait les faisaient
désigner sous les noms de Tonnerre et d’Eclair : « Quand l’éclair part,
disait-on, l’Tonnerre tombe toujours ! »
Duhamel est mon ami.
ORDINAIRE DES DIMANCHES
Avril chante un lai à la terre normande. Le soleil se lève dans un ciel
rose, fluide, rayé très bas de brumes allongées, aux contours
cramoisis. Une poudre dorée est tombée sur les cimes et les bois du
levant, et, peu à peu, les brumes glissent derrière l’horizon. Par
degrés le rose se fond, passe à la lumière intense, se perd dans le
bleu radieux des matins clairs.
Les grands poiriers fleuris blanchissent les clos. Un coq défie son
rival lointain. La grive aux lisières, le merle dans la haie, le pinson
près du seuil, sifflent, chantent, pressés, ardents, grisés de sève, et
la mésange, au cri métallique et suraigu, de-ci, de-là, volète, tourne
au bout des branches dont elle fait tomber les fleurs, l’insouciante !
La joie est dans l’air. C’est dimanche !
Le pot à tripes en main, Harel, rasé de frais, cravaté de soie verte,
revient de Fervacques. Sa blouse, finement plissée, laisse voir un
gilet de velours noir broché de petites palmes rouges. Son sourire
large ride ses tempes, met en valeur son nez puissant.
- Me v’là ! » dit-il en posant le pot sur la table. Le sourire du
sylvain est pour Catherine qui déploie à la flambée de l’âtre le linge
frais des dimanches. Et avant que la servante ait pu l’éviter, Harel
l’a saisie et embrassée parce qu’il lui veut donner l’étrenne de sa
barbe. Catherine se dégage à coups de poing et Mme Neuville, que le
bruit attire, survient la canne haute : « Harel ! Voulez-vous aller
chanter vot’messe !
- C’est Catherine qui a commencé ! déclare Harel. Il jure sur les
Evangiles que Hélie en est témoin.
Hélie, une petite lueur friande dans les yeux, regarde Catherine, les
cheveux défaits. Il ne sait trop où se ranger. Il s’est penché sur le
pot de tripes : « Elles sont bien belles ! » murmure-t-il.
Mais Harel s’est versé du cidre. Le chemin l’a altéré. Ce matin, il
tient l’escabeau dans une chape violette, et il explique à Hélie,
distrait, que l’Eglise emploie différentes couleurs dans les ornements
de ses fêtes : le blanc servait pour les Mystères de Jésus-Christ ; le
rouge pour les solennités du Saint-Sacrement ; le vert était employé
pour les docteurs, et le violet en Avent, aux Rogations et aux
Quatre-Temps. Hélie n’écoute guère. Déjà las de son désœuvrement
dominical, il gagne le seuil de la porte ; il suit des yeux les
premiers papillons qui s’élèvent par couples, en droite ligne,
au-dessus des grands poiriers, se joignent, brusquement s’écartent pour
retomber ainsi que de petits feuillets blancs balancés par la brise.
Volontiers il laisserait la grand’messe pour ses semis de pourpiers et
le repiquage d’une aire. – « Voyez-vous, Harel, il fait un temps à
œilletonner les artichauts ! »
Harel a la verve conteuse. Il a lu que les anciens, pour retracer la
fuite de la Vierge en Egypte, introduisaient dans l’église un âne
richement harnaché. La jeune fille qui représentait la Vierge se
plaçait devant le sanctuaire. L’
Introït, le
Kyrie, le
Gloria, le
Credo se terminaient par une imitation du cri de l’âne. A la fin de
la messe, le curé, au lieu de dire :
Ite missa est, chantait trois
fois hi han, hi han, hi han !... – « Ah ! ah ! s’esclaffe Catherine,
l’âne, on l’entendra ce matin au lutrin ! »
Les deux hommes s’en sont allés sous un pommier, dont ils examinent les
bourgeons avec soin : « C’est du fruit, disent-ils, l’année en est. »
Vers l’église, coiffée du haut bonnet déployé que retient l’épingle
d’or à chaînette, Mme Neuville ouvre la marche. Hélie, Catherine, ma
mère et moi la suivons dans le sentier. Pour éviter la rosée, Catherine
s’est retroussée et découvre une jambe décidée. La bride de sa coiffe
claque contre sa joue. Hélie est en blouse à liserets. Sa raideur, dans
ce vêtement bleu verni, lui donne l’air d’être vêtu de porcelaine. Ma
mère, en robe de faille, accroche sa crinoline aux ronces, et, quand
elle se retourne, son visage disparaît sous le cercle de sa capote.
Au chemin, où la vallée s’évase si subitement, émue par la perspective
fleurie, Mme Neuville s’arrête. Ses yeux pâles embrassent ses lointains
accoutumés : « Je la dévale encore un coup ! » dit-elle, en désignant
la pente.
La vallée est pleine de vibrations sonores. Nous entendons les cloches
de Saint-Germain-de-Livet, de Saint-Jean-l’Abandonné ; nous distinguons
le château de Fervacques sanglé dans son bouquet d’ormes.
A l’église, nous occupons le premier banc. Devant nous, un saint Joseph
à longue barbe porte l’Enfant-Jésus ceint d’un diadème orné de saphirs.
Leur autel est fleuri de lys de cuivre, que dépassent, droits, quatre
cierges de métal émaillés de filets bleus. Les chandeliers sont
désargentés. Au ventail du tabernacle, l’Agneau doré saigne sur la
Croix.
Je vois passer, en blouse à boutons de nacre, cravatés de soie, notre
voisin Dominique, Bordeaux l’ivrogne, Ridel le vieux berger, Grand Hue,
qui tend les pièges à taupes. Voici Hyacinthe, le joueur
d’ophicléïde, le petit berger Lancelot, Catin, la quêteuse,
si déhanchée qu’elle donne de l’épaule contre l’autel et notre banc.
Les femmes passent, un peu penchées. Quelques-unes ramènent sur leur
bonnet tuyauté un voile noir, dont les bouts retombent sur leurs mains.
A la chapelle de la Vierge, ornée de roses blanches, les fillettes se
pressent autour de la religieuse. Elles ont des chapeaux de paille
garnis de pâquerettes. Les dames arborent des fruits à leurs capotes :
grappes de groseilles, bouquets de cerises qui font des taches
sanguines parmi les nappes d’ombre des voiles.
Des amis saluent Mme Neuville, lui parlent bas. Ma mère, un peu grave,
porte en médaillon le portrait de mon père, et sa chaîne en sautoir
brille aux pages de son livre.
Les hommes se signent gauchement et se dirigent dans le chœur, traînant
leurs bottes ferrées. Les garçonnets, plus rapides, esquissent une
génuflexion, et, de leur place, lancent leur casquette sur le rebord
incliné du vitrail.
Les frères de charité occupent les stalles. Ils portent le chaperon à
effilés d’argent et tiennent devant eux la haute torche à galerie de
cuivre découpé.
Et c’est un bruit de chaises remuées, de pas mesurés, de bottines qui
craquent.
Par la porte entr’ouverte du bas-côté, le vent entre en de légères
rafales qui remuent le voile des veuves. Dehors, parmi les tombes
perlées, les cyprès balancent leur ombre sur le velours des pensées en
bordure de l’allée sablée.
Et voici qu’en chape violette soutachée d’or clair, Harel se dirige au
banc du maître-chantre. Dans l’onde lumineuse du vitrail, Hyacinthe lui
donne le ton.
Sa voix a de l’éclat. Il lit au grand livre et mène visiblement le
branle.
Exultavit… Je me réjouis. Seigneur !... Les yeux de Harel
vont aux petites étoiles de papier de la voûte. Et quand, d’accord avec
Hyacinthe, il appuie l’antienne, le renforcement de sa voix par le
cuivre cause au vitrail un léger remuement. Le frisson nous gagne,
trouble nos âmes. Son effet obtenu, le chantre se tourne lentement vers
le bas de l’église ; l’arc de sa bouche se détend, son front se plisse,
son œil vague interroge l’assemblée des fidèles… Il semble bien qu’à
cet instant, Harel moissonne les palmes que lui tendent, bras ouverts,
les bons saints polychromes du fond de la nef, aux creux des niches, en
des gestes de complet abandon.
Parfois, le curé précipite une reprise et laisse au verset le chantre
et le
serpent. Hébété, Harel s’arrête, et Hyacinthe, coupé de court,
pose à terre l’ophicléïde. Mais la voix douce des femmes bouche le
creux, et l’incident de pupitre se clôt au premier
oremus. « Le curé
veut avaler sa messe ! » ricane Harel en demi-ton. Et il se mouche
furieusement, puise dans sa tabatière…
Par-dessus mon livre, je suis du regard la boîte de merisier. Elle
passe des mains de Harel aux mains de Hyacinthe, va du bedeau au frère
de charité, gagne la stalle du Maire, s’y arrête pendant
l’
Offertoire, reprend sa course au
Sanctus, fait en zigs-zags le
tour du chœur, pour échoir à l’
Agnus Dei aux mains du petit Lancelot,
qui, par le cordon du couvercle, la tourne ainsi qu’une fronde. Et
quand la tabatière est vide, la messe est dite !...
Dehors, Mme Neuville sarcle ses tombes. Les gens se tiennent sur le
parvis jusqu’à ce que le curé ait traversé les groupes. On s’embrasse.
Par couples, les filles s’effacent dans l’ombre des chemins recouverts,
s’ensauvent par les raccourcis. Et dans la gloire de midi, nous
regagnons la ferme par la montée raide de la Forge, Mme Neuville
commentant les promesses de mariage lues au prône. Elle avait connu
jusqu’aux arrière-grands-parents des promis et se répand en anecdotes
sur chacun d’eux. « Comme le temps passe !... »
- Manquablement ! Oui, Madame, ponctue Hélie. Et tous deux avaient vu,
en petits bonnets à oreilles, culotte et jupon courts, les fiancés
d’aujourd’hui.
Je tiens ma mère par un pli de sa robe. Je la questionne : Pourquoi
chantait-on en latin ? S’était-elle aperçue que Harel était resté au
cabaret en compagnie de Hyacinthe et du bedeau ?
On arrive ainsi à la porte du courtil où Catherine, qui nous a
devancés, se tient accroupie sous l’une de ses vaches. Près la maison,
dans la perspective claire, le garde nous attend, le fusil à l’épaule.
Le ciel bleu des dimanches influence les énergies.
Passé midi, la terre est lasse. Sous la branche plus calme, l’oiseau se
tait, le ruisselet expire. Une heure encore et le silence sensualise la
véprée où le clocher recommence son ombre ; le toit se recueille au
cadre de son jardin, le rayon s’arrête aux tendresses des roses ;
couchés au pied des peupliers, les bœufs ruminent, la tête basse ; aux
murs des granges, le papillon pourpre ferme son aile ardente.
Avec lenteur, Hélie se range à table. Debout, presque dolent, il
consacre d’une croix la
tourte qu’il entame. Mme Neuville soliloque,
par bribes. Elle évoque des semaines saintes, elle précise la semaine
de Pâques, le marché qui, chez nous, précède ce dimanche unique.
D’habitude annuelle on renouvelle à ce marché les robes de l’année, les
vêtements d’été. Cette fois, Hélie fera l’emplette de coutil, d’osiers
pour la taille des espaliers, de plants d’épines ; Catherine achètera
une jupe couleur prune, à guimpes.
La maison sera vide. Mme Neuville conduira ses gens aux marionnettes,
sous la toile des cirques, aux parades folles et bruyantes de la foire.
Et cependant que Hélie cite des « faiseux d’tours, manquablement agiles
comme des singes », Duhamel présage le temps qu’il fera. Il croit à un
changement. Hier, les étoiles lui avaient paru plus grandes qu’à
l’ordinaire, plus près les unes des autres. C’était un signe de pluie.
Mais la couronne blanchâtre qui nimbait la lune avait disparu. Mme
Neuville, ayant remarqué la braise de l’âtre plus ardente, la flamme
plus agitée, croit au vent. Harel s’en réfère à l’almanach. Sous le
chapitre des lunaisons, il trouve le titre de Pâques. La fête de
Pâques, lit-il, se célèbre toujours le dimanche, d’après l’équinoxe. Le
dernier quartier sera le 5, la nouvelle Lune, le 12 à 4 heures 9
minutes du soir. Si le soleil à son coucher est enveloppé d’une nuée
noire, c’est de la pluie pour le lendemain. Les deux premiers jours de
ce mois seront passables ; 3 et 4 pluie ; 5, beau temps ; 9 et 10,
temps pluvieux ; 12 et 13, un peu chaud ; de 14 à 16, continuation ; 17
et 18, temps propre à voyager.
Dieu soit loué ! Nous irons à la ville en carriole découverte. Et,
brusquement, cet espoir souriant anime la table. « Le cri du pleu-pleu,
reprend Hélie, est aussi un signe. Il dit avoir remarqué que
l’abaissement de la température influence le pivert au point de le
faire crier. A la vérité, l’oiseau est un peu stupide, car, après qu’il
a frappé du bec une écorce, le pic contourne l’arbre comme s’il l’avait
troué de part en part. Duhamel objecte que le pleu-pleu ne se déplace
ainsi que pour surprendre le cloporte dans sa fuite sous l’écorce
morte. Harel dit plaisamment que le coucou ramène les beaux jours, que
son retour clarifie les jus. Le coucou est son ami.
C’est un oiseau gourmand, déclare hostilement Duhamel ; il mange les
enfants des nids pour mettre le sien plus à son aise ; ingrat et
fainéant, il pond ordinairement dans le nid du verdier et laisse à
l’étrangère le soin d’élever sa géniture. Mais quoi ? le coucou était
peut-être un petit faucon déguisé !
On ne disait rien de lui dans le traité de vénerie du garde. On se
servait, en fauconnerie, de petits aigles fauves, le plus souvent de
l’émouchet ou épervier, moins lourd à porter au poing, plus courageux
que l’aigle. Le coucou était bien un coucou. « Y jette su les plantes
eune salive qui leur est funeste ! » conclut Hélie.
Et le bonhomme parle d’étourneaux qui aiment tellement la société qu’on
les voit se mêler et vivre avec les corneilles. Ceux qui nichent dans
les trous de pommiers, affirme-t-il, parlent mieux que ceux qui nichent
dans les trembles. Et chacun cite quelque particularité d’espèce. Les
chouettes étaient si ridicules au soleil que les oiseaux s’assemblaient
autour d’elles pour se moquer. L’hiver, on surprenait les effraies dans
les églises où elles mangeaient l’huile congelée des lampes, et Duhamel
explique pourquoi les bécasses se plaisent à terre molle, près de
petites mares où elles se lavent le bec et les pieds qu’elles se sont
souillés en cherchant leur nourriture. Il imite avec ses mains le
claquement de leurs ailes, dit en avoir vu dans les sentiers quand il y
a clair de lune.
Mme Neuville loue les hirondelles des cheminées, de ce qu’elles
guérissent les yeux de leurs petits avec une herbe appelée chélidoine.
Celles qu’on maltraitait allaient piquer les mamelles des vaches et les
tarissaient. Au reste, tous reconnaissent aux oiseaux des facultés
divinatrices surnaturelles.
Revenant au temps probable, Hélie dit, convaincu : « Si l’os du dos
d’une oie est clair, c’est un hiver rude, s’il est manquablement à d’la
terre, l’hiver s’ra mou ! »
Mais à quoi tient la stabilité d’un beau jour ? Hélie connaît un homme
qui fait monter les orages !...
« Durant qu’jétais cheux M. d’Colbert, eune année qu’la maigreur du
temps avait séqué les mares, comme j’coupions l’blé dans la pièce aux
Seines, un homme vint dreit d’la route pou s’embauchi. Salut ! qui dit.
J’viens qu’ri du travail. – J’sommes en nombre que j’li répondis. –
Oui, j’sommes en nombre que dirent nos gens. Et comme l’homme ne s’en
allait pas : Faut vous r’tirer, que j’li dis, vous êtes ici
su m’sieu
d’Colbert ! – Donnez moué à boire reprit l’homme. – Le
boire, j’l’ach’tons, que j’li dis : allez quémander ailleurs… De fait,
c’t’année-là avait tari les arbres ! – Vous vous en repentirez ! qu’dit
l’homme.
A peine l’étranger eut disparu, qu’un vent violent éparpilla les
javelles de Hélie et des siens ; des grêlons, gros comme des œufs de
pigeons, ébranchaient les jeunes arbres, trépanaient les perdrix. « No
voyait les greffes à terre ! No ramassait le gibier à la main !
Manquablement qu’su les grêlons no voyait comme qui dirait des
Saints-Sacrements ! Le curé d’Hermival en a gardé cheux li pendant
trois jours ! ». Et l’orage avait suivi l’homme, et ne s’était apaisé
qu’où ce vagabond avait couché.
Le récit de Hélie engendre le malaise. Se pouvait-il qu’un homme eût un
pareil don de malfaisance ? Catherine ouvre bruyamment la porte du
buffet : « Toutes les fois, gazouille-t-elle, que Hélie a menti, il ne
lui est pas tombé une dent ! »…
Par diversion, Harel passe des pronostics à la partie morale de
l’almanach. Il lit :
Avant tout rends hommage au Créateur suprème.
Après Dieu, de tes jours révère les auteurs,
Honore tes Parents, dans tes maîtres, de même,
Vois tes premiers amis et tes vrais bienfaiteurs.
Le repas tire à sa fin. Au premier coup de vêpres, Madame Neuville
ferme ostensiblement son couteau. Les hommes boivent un dernier verre,
s’en vont de table à petits pas.
Le jardin fleure le buis et les lavandes. Par une ironie souriante à
l’adresse de Mathieu Laensberg, cet après-midi est chaud, le ciel
limpide et stable ; dans un vol droit les oiseaux se hâtent vers les
nids.
Madame Neuville ne va plus à vêpres. Elle s’est assoupie à sa place
ordinaire, près de la fenêtre, devant sa table de repos, dont le tiroir
est plein de graines potagères. Ses lunettes sont posées sur son
formulaire ouvert, une
Introduction à la vie dévote. On lit, à la
première page : « Ce livre appartient à la dame Neuville de
Prêtreville, 1852. » Au second feuillet Saint-François de Sales y avait
préfacé : « Glycera savait si bien diversifier la disposition et le
mélange des mêmes fleurs dont elle faisait ses bouquets, qu’ils
paraissaient fort différents les uns des autres. Et l’on dit que
Pausias, célèbre peintre, voulant imiter cette diversité d’ouvrages, ne
put jamais, avec la variété de ses couleurs, exprimer tant de divers
assortiments. Ce sont, pour ainsi parler, mon Lecteur, les mêmes fleurs
qui ont déjà passé par les mains des autres, que je vous présente ici. »
Par la porte laissée ouverte, le soleil dessine à terre un grand carré
de lumière. Un cinéraire pourpre décore la fenêtre. La rose de mai
grimpe au linteau. Au bord de l’allée, les lys s’inclinent. J’entends
le battement rythmé de l’horloge, le trot lointain d’un cheval sur la
route. Passé la vallée, de légers nuages se forment sur les monts
tandis que deux ramiers rayent le bleu dans un vol silencieux.
Vêpres dites, le vespéral enroulé dans sa soutane, Harel s’est arrêté à
ses « berceaux ombrageux » – au cabaret Persil. – Avec lui, Hyacinthe
et le bedeau, Pelhètre ont réglé le jeu de boules. Ridel, le père
Bouchez, Bordeaux et le Grand Hue sont de la partie. Le petit Lancelot
relève les quilles. Placé au bout de la piste, l’enfant de chœur reçoit
du pied la boule énorme, qu’il renvoie aux joueurs.
Le groupe barre la route. Ils sont tête nue, en bras de chemise.
La servante apporte aux tables de bois le
maîtr’cidre dans des pots
de verre vert. Elle s’appuie aux tables, une main sur la hanche,
l’autre dans la poche de son tablier.
Elle a à se défendre de caresses rudes. Mais les vrais joueurs n’ont
cure de la fille : une !... deux !... trois !... la quatrième en a !...
Aïe donc !...
Harel, le buste en avant, joue le coude arrondi : il porte la boule à
hauteur de son œil et vise les quilles dans un clignement goguenard.
On fait silence, on connaît son adresse.
« Qui qui la rentre ? » clame-t-il, la dernière quille abattue.
Ils jouent ainsi jusqu’à l’approche de l’ombre, jusqu’à ce que le curé
soit venu chercher Pelhètre pour sonner l’Angelus.
Le curé est alors l’objet de politesses vineuses. Entrepris par ses
chantres, il lui faut bon gré mal gré relever sa soutane et
rucher
dans le jeu. Le coup du curé manque le but. Lancée de travers, la boule
sursaute, s’évade dans l’allée voisine et cause aux joueurs une
hilarité extrême.
- Ça n’est pas tout, le latin, il y a les quilles, M’sieu l’Curé !
Confus, le curé se retire, chassant devant lui son bedeau. Mécontent,
Pelhètre s’efface le long des talus ; il marche de mauvais cœur, à
distance de son pasteur. Et c’est de l’église, pour les joueurs pintant
aux chandelles, un Angelus court et maigre de bedeau rageur, parmi les
champs paisibles, une caricature des Angelus fervents.
A LA FOIRE DU JEUDI SAINT
Après
les joyaux d’argent
Qui sont
ouvrés d’orfèvrerie,
Si
n’oublie pas, comment qu’il aille,
Ceux qui
amènent la bestaille.
(Un poète
du XIIIe).
Il est jour à peine. La lueur faible de la chandelle lutte avec
l’ombre. Nous voici devant l’âtre, mal éveillés, en habits des
dimanches, prêts pour la ville. Catherine s’est enroulée dans un épais
tablier de tiretaine qui la gaine jusqu’aux aisselles. Hélie et Harel
ont revêtu deux blouses, l’une pour protéger l’autre.
Pour éviter les cahots et les branches mouillées du chemin, nous
descendons le coteau à pied, par le sentier battu qui mène à la route.
La carriole est là. Hélie et Catherine se placent à l’arrière, Mme
Neuville, ma mère et moi sur le siège du milieu. Harel, qui conduit,
s’assied de quart sur l’ailette. Notre poids appuie la caisse sur
l’essieu, et le brancard, trop libre dans la dossière, entretient un
mouvement de bascule que Harel atténue en se portant tantôt en avant,
tantôt en arrière. Si le cheval s’arrête, nous glissons des sièges
gaîment. Le ciel s’éclaire. A notre droite, l’aurore déploie son
éventail rose, multiplie son prisme aux perles de la haie ; l’eau
s’égoutte des grands arbres ; la terre sent bon.
Nous devançons des paysans vêtus de peaux de chèvre, aucuns, qui
suivent leurs troupeaux, somnolent au creux de leur cabriolet. Par
instant les bœufs tiennent toute la voie, font déborder les moutons sur
les talus, et des débandades se produisent aux carrefours où les
meneurs essoufflés, à l’éclat rauque, étendent les bras, barrent la
route aux bêtes qui s’évadent. A l’accès de la rivière, des bœufs
fatigués se couchent dans l’eau.
A mesure que nous approchons de la ville, les embarras du chemin se
font plus nombreux, nous n’avançons plus qu’au pas du cheval. Harel
s’arrête court pour éviter le poulain qui s’effare et cherche l’abri
sous le col de sa mère. De peur d’un choc, Mme Neuville tend les mains
vers les rènes, tant et si bien qu’aux portes de l’octroi nous
descendons de voiture.
A cet endroit, des maquignons trafiquent à la
passade. C’est entre
deux rangées de carrioles dételées, enchevêtrées à cul et à bras que
nous gagnons l’auberge, le long des murs où des marchands d’estampes
ont aligné leur imagerie.
L’entrée du
Plat d’Etain est tout envahie par des paysans qui
traînent des auges, portent à dos des harnais, reçoivent le foin jeté
des greniers. Nous enjambons, pour gagner les salles basses, des
paniers posés à terre, de petits sacs d’avoine. Nous chassons devant
nous, d’auge à auge, des poules stupides, des pigeons roses qui
s’élèvent avec de grands bruits d’ailes.
Venu du porche, un souffle chaud, relent de foin et d’écurie, nous
surprend au perron. Mais la brise qui emprunte aux cuisines la bonne
odeur des rôts, l’effervescence des jus décantés, assainit vite notre
odorat. D’ailleurs, c’est, par les portes étroites, de jeunes servantes
en tabliers blancs, joues vermeilles et bras nus qui se croisent
propres et fraîches. Et le cuivre rutile aux clanches, le rideau est
clair aux carreaux, un linge bien lessivé est posé sur l’assiette.
Par groupes, dans la cuisine, des écots se chargent de leurs réchauds à
tripes. Les hommes puissants – blouses bleues et casquettes de soie, –
des fermières en bonnet de coton, se rangent avec précaution dans les
corridors et les escaliers. C’est déjà, dans les salles des deux
étages, des appels à la fille, un glissement de souliers ferrés et des
bancs repoussés. Provoqués par le battement des dominos, de larges
éclats de rire s’évadent des encoignures et dominent, au dehors, le «
dia-hue » des valets. Cette fin de carême débride la bonne humeur.
Certains ont une pommette luisante, le nez rouge et mobile. Une gaîté
finaude retrousse l’arc des lèvres minces et rasées. C’est de bon pied
que Harel a poussé son cheval au râtelier.
Le chantre sent renaître sa veine… A la table du casse-croûte où Madame
Neuville fait servir des abatis, Harel, qui a pénétré dans le réduit où
les maritornes plumaient les poulets, en revient couvert de duvet. Il
s’ébroue plaisamment au contact de Catherine qui, dégaînée de son
tablier, jette les hauts cris et se défend contre la plume. Madame
Neuville proteste et couvre de sa main le plat de notre table,
cependant que le duvet monte en spirale, s’éparpille, retombe en neige
lente et menue. « Manquablement, objecte Hélie, que c’est pas des
choses à faire devant le pain ! »
Mais des colporteurs à petits bérets, en blouse courte et rayée, sont
venus nous faire des offres en un parler sonore. Ils portent en
bandoulière, accouplés par des anneaux, des porte-monnaie, des
bretelles, toute une pacotille de menus objets de corne et d’acier ; en
mains des livres estampillés de bleu : la Clef des Songes, l’Art
Vétérinaire, le Grand Albert, les Bons Mots de Piron… Harel nous dit
que ce sont des basques, qu’ils sont surveillés par la police… Un peu
inquiets, nous brusquons notre premier repas et nous regagnons le
perron, où, visiblement, le mouvement de la rue nous attire.
Devant nous s’est formé un cercle autour d’un joueur de vielle, et nous
voici happés par la foule dont les courants se heurtent à la manière
d’une onde contrariée. Chaque remous nous divise, nous entraîne au
déballage d’un camelot, à la table volante d’un pâtissier, aux étalages
des frivolités en papier de couleurs. Nous nous retrouvons devant les
halles, où de hauts étalons hennissent au vent. Ils sont là, le col
superbe, la tête petite, l’œil en éveil, une rose au licol.
Par cette route joyeuse, nous pénétrons au cœur de la ville. Les
vieilles maisons nous regardent passer. Elles ont un même visage.
L’encorbellement leur fait un front ridé, leur fenêtre un œil éteint,
et leur allée, plafonnée de solives séculaires, dégage, vétuste, une
haleine fétide.
D’un étage élevé, des marchands ont laissé tomber de longs tissus
rouges et blancs pour indiquer leurs nouveautés. Ici, des cierges à
collerettes ; là, des livres de messe à couvertures d’ivoire, des
chandeliers d’argent, des images polychromes, tout un chemin du ciel
qui s’avive, contraste avec le faux et le clinquant des voiturettes des
ambulants.
Aux angles du grand espace clair que fait la place du marché, des
chanteurs de complaintes déploient leur toile peinte et nous font
suivre, à la baguette, les phases du dernier assassinat célèbre.
Et, par les avenues qui mènent au champ de foire, des marchands ont
épinglé au cordeau les estampes de la famille impériale, le berceau du
Petit Prince, les portraits de Garibaldi et de Béranger ; le vent
soulève les chansons de Geneviève de Brabant, du Roi Dagobert, de M. et
Mme Denis, replie sur elles les compositions populaires des batailles
de Magenta et de Solférino, l’assaut et la prise d’Alger, et des
dessins de couleurs vives montrent des jeunes femmes décolletées, aux
épaules tombantes, coiffées à bandeaux, un camélia dans les cheveux.
Elles ont des papillottes, sourient, et répondent aux noms de Céline et
de Julie. Leurs tailles, d’une finesse extrême, finissent en pointe
dans l’ampleur des crinolines.
Et nous trouvons notre route joyeuse entre deux rangées de loteries et
de tirs, de musées de cire et de massacres, sans que nous puissions
fixer notre attention par ce qui éblouit nos yeux et étourdit notre
entendement : Temples de toiles, colonnes bleues, fresques sanguines.
Bas reliefs et panneaux peints se juxtaposent, s’harmonisent aux
déesses sans voiles, aux cariatides or et ocre qui, bras hauts,
soutiennent les frontons à caissons simulés.
Légers dans l’éclat des orchestres, attentifs à tous les bruits, nous
nous égaillons des marteaux d’Hercule aux jeux de palets, du déclic des
disques au « tac » percutant des carabines, ravis de l’élégance des
jets d’eau roulant un œuf à leur sommet, et du chariot sur rails qui
apporte une rose au tireur adroit.
Catherine et Harel ont
misé au tourniquet. Ils en reviennent avec un
sucrier de style Louis-Philippe, enguirlandé de myosotis. Hélie,
obligeamment, reçoit l’objet du côté de son épaule démise… Le bonhomme
presse la porcelaine contre sa poitrine, et, de son bras libre, en
maintient le couvercle.
Nous entrons dans une exploitation minière. Les galeries, sablées de
charbon, dévoilent leur activité souterraine. Mû par un mécanisme
invisible, le mineur, d’un pouce de haut, pioche pour de bon ; de
petites bennes remontent les puits, se déversent dans de minuscules
vagonnets, plongent au bout de leur course pour revenir à l’opposé et
recommencer leur court trajet.
Nous passons devant la tente d’une femme impalpable.
A un musée des grands hommes, Hélie reconnaît le buste de M. Thiers.
Nous entendons rugir le lion du mont Atlas !
Et des singes enchaînés se balancent aux barres des ménageries,
cependant que, près de nous, un homme sauvage dévore un lapin cru.
Au carrefour, des chevaux de bois, nous donnons d’enthousiasme. Notre
manège est actionné par un cheval gris pommelé. L’homme commande le
départ du sifflet attaché à son cou, arrête sa bête en lui posant la
main sur la croupe. Nous tournons au-dessus de la foule, les yeux
presque fermés, abandonnés au sillage aérien. Catherine a coiffé de sa
jupe volante la tête d’une sirène. Nous tournons, sans pouvoir repérer
notre point de départ, sans reconnaître aucun des nôtres. Etourdis par
trois tours, ahuris par les sons, nous descendons n’ayant plus l’usage
de nos jambes et nous demeurons un instant stupides à l’audition
brusque d’un homme-orchestre qui rassemble autour de lui les cavaliers
démontés du manège.
Cet homme extraordinaire, surmonté d’un chapeau garni de grelots, porte
à dos une grosse caisse et des cymbales. Le tampon de sa caisse est
fixé à son coude par un bracelet ; ses cymbales sont reliées à son
talon par un fil articulé, de telle sorte qu’elles se frappent et
s’écartent à volonté, selon le rythme que le joueur donne du talon. De
sa droite il tient un flageolet, de sa gauche le bâton de son triangle.
Si bien que, dans l’exécution de son morceau, l’homme orchestre agit de
la tête, des mains, du coude et du pied, en de telles contorsions qu’on
le dirait pris de la danse de Saint-Guy.
Hélie en a changé son sucrier de bras. Harel qui ne sait comment
exprimer son admiration, offre à boire à cet homme étrange qui s’excuse
en secouant ses grelots : « Jé souis Piémontais… Jé né bois que dé
l’eau ! » – De l’eau ! dans la manœuvre de cinq outils… Harel n’en
revient pas.
Mais nous voici aux abords du champ où l’on trafique, et le chemin est
souillé, encombré par les chevaux qu’on fait galoper. Dans l’effroi des
ruades, nous obliquons vers les tentes du champ, où les marchands
boivent et mangent.
Pour y arriver, nous passons devant de grands feux où rôtissent, d’une
seule broche, des moitiés de moutons ; par devant des tonneaux de
cidre, qu’on décante pot à pot.
Au brasier crépitant nous prenons un gigot, et, munis de galettes
sablées, nous remisons au petit bonheur.
Une rumeur de flot qui déferle s’élève de la foule. Mais tous les
bruits de la terre sont ici : le coq chante, le mouton bèle, le taureau
beugle, le hennissant appel des poulinières se croise aux quatre vents,
où, par bouffées venues de proches parades, les bugles et les
trombonnes sèment leurs déchirements.
Loués au matin, de petits valets et des fillettes rousses, de contrées
lointaines, sourient aux buveurs des tentes. Ils vont, par la foule, à
la queue leu leu, leur baluchon accroché à leur fourche faneuse.
Près de nous, des paysans décident de la fermeté de leur marché en se
frappant les mains : « C’est conclu !... » Ils déploient leur bourse de
cuir à terre, comptent par pistoles, nouent en des mouchoirs bariolés
les pièces d’argent.
L’or ruisselle au creux des assiettes.
A l’écart des turbulences, désigné par un écriteau, un écrivain public
donne à une humble servante le délié de son écriture arrondie.
A travers tables, entrant et sortant, passent des paysans en culottes
courtes, des Auvergnats à boucles d’oreilles, des Bretons en chapeau de
velours.
Les femmes d’Ille-et-Villaine ont des brides flottantes à leur bonnet ;
celles du Bessin portent des châles à effilés. La Bayeusaine – au doigt
très fin – place sur deux bandeaux son bonnet sans ailes, froncé devant
et fermé sur le chignon par un nœud de dentelle.
Faute de place en ville, le cirque s’est installé dans le champ, et,
avec lui, différents musées et baraques de joailliers, de confiseurs et
de cordiers.
Son ampleur, l’ondulation des toiles, la silhouette élégante des mâts à
oriflammes donnent à cette partie l’aspect d’une anse marine, et sa
respiration puissante soulève ses bâches, secoue son armature. Par
endroits, la toile déclouée a des battements d’ailes. N’étaient les
pieux circulaires qui le retiennent, il s’arracherait du champ,
anticipant sur son départ, car il est en partance, toujours, étant de
la famille des voiliers d’aventure. Mais il est rivé là : le filin de
fer a cravaté son mât.
De la tente, j’aperçois un maillot rose, une perruque rousse, et, sur
l’estrade, où deux tambours sont accrochés et des cuivres posés à
terre, une affiche, en lettres capitales, annonce en matinée une grande
fantasia arabe : « Fra Diavalo ! »
Violent et faux, l’éclairage artificiel des rampes m’a pénétré de
malaise. Je descends les gradins du cirque, les genoux tremblants.
Dehors, la clarté saine m’éblouit. Dans la vêprée, le soleil oblique
élargit son disque, et le couchant bleu pâle s’est rayé du sillon mince
et rose qui fait présager la nuit calme et froide. Le sillon rose
alterne avec le sillon bleu sur un espace immense, et le rose se
reflète aux nappes d’eau de la vallée, se fixe à la pointe des mâts,
sur la toile des tentes, sur le passant plus rare, sur toute chose qui
lui oppose maintenant un côté d’ombre.
De-ci, de-là, une petite baraque s’allume. La lampe à huile, sur le
velours grenat des vitrines, éveille l’orfèvrerie clinquante du
doublé-or, met un reflet rutilant aux chaînes de cuivre et d’argent. A
l’étal des confiseurs, le rayon éclate aux chromos ovales des sucs de
pommes, se concentre aux cristaux des friandises. Très à regret, je
suis Catherine par delà les montres à disques de papier et les pains
d’épices fourrés d’orange et d’anis. Je devine la pèlerine : elle porte
un écu à une roulotte, pour s’entendre dire qu’elle sera épousée, au
solstice d’été, par un jeune homme blond né, comme elle, sous le même
signe du Zodiaque. Je l’accompagne jusqu’à l’entrée où, par crainte, je
refuse de pénétrer. Je reste là entre les tréteaux d’une estrade et la
magnificence miroitante d’une voiture à panneaux de cristal. Par
fortune, Harel, que le bruit de la parade attire, passe à proximité, et
je le rejoins au moment où Catherine descend les marches du « Temple de
l’Avenir ». Il est visible qu’elle a touché l’oracle.
- C’est-y, gazouille Harel, qu’on n’ peut s’entendre avec les parents
des promis ?
Ironique, il la ramène à petits coups et lui déclare que lui, Constant
de son prénom, savait aussi sa destinée liée au cours d’un astre. – Dam
oui ! son astre brillait dans les yeux de Catherine. Quel « jeteux d’
sorts » le faisait chercher dans les nuages quand il était à portée de
la main ? Visiblement, il était le jeune homme blond. Catherine, qui
s’entend comparer à une étoile, se fâche. – « Ivrogne ! » glapit-elle.
Surpris dans son geste qui désigne le Zénith, Harel reste le bras
tendu, dans l’attitude d’un homme qui gaule des noix. Soudain, un
roulement de tambour remet Harel dans un maintien normal et fige le
mépris aux lèvres de Catherine.
- « Ecoutez bien, clame la voix, je vous parle d’abondance de
cœur. Il n’est pas besoin de mettre les points sur les
i, à bon
entendeur, salut ; il n’est qu’un mot qui serve ; il ne faut pas tant
de beurre pour faire un quarteron ; quiconque fera bien trouvera bien ;
les effets sont des mâles et les paroles des femelles ; on prend les
bœufs par les cornes, les hommes par des paroles, et quand les paroles
sont dites, l’eau bénite est faite ! » (1) « Le sens de ces paroles est
profond, murmure Harel, vous y devez, Catin, reconnaître un
avertissement de l’Oracle ». Et, avec grâce, il offre à Catherine un
minuscule flacon d’élixir enroulé dans le feuillet d’un horoscope.
« C’est un grand malheur, clame un autre, que Galien, Hyppocrate et
Avis, ces médecins de l’Antiquité, n’aient pas connu la nature de la
puce, autrement ils en auraient dit des merveilles et en eussent laissé
de gros volumes à la postérité. Nous avons beaucoup d’obligations à de
grands savants qui découvrent tous les jours quelque chose. Monsieur
Picotin, si fameux par ses ouvrages, assure que le bain du sang de la
puce guérit toutes sortes de gouttes ; le fiel est très souverain pour
supprimer les écrouelles ; le cœur est fort bon pour les inflammations
des yeux ; le poumon soulage les asthmatiques ; la rate, la mélancolie
; et une once de ses œufs, mangée à chaque repas, conserve le corps en
bon état. Les apothicaires tirent de la barbe, du bec et du pied, une
très bonne huile pour fortifier les nerfs, et un sel contre le catarrhe
: C’est un esprit qui chasse les rats de la tête et qui dissipe la
folie. Soyez persuadés que si vous pouviez en remplir trois ou quatre
sacs de muid, vous feriez une fortune, et vous le vendriez au poids de
l’or, tant à Bruxelles qu’à Paris. »
Le boniment est ponctué par le tambour. Des paysans tendent les mains.
Aucuns montent sur la plateforme de la voiture pourpre et or, et se
font arracher un cor, extraire une dent. Oh ! le pied !... la joue !...
le cri dans le bruit des cymbales !
Nous quittons le champ à l’approche de la brune.
Petit à petit la foule s’est écoulée, chacun s’est dégagé du dernier
remous pour regagner la ville, son auberge ou sa voiture.
L’assoupissement pénètre, gagne les hautes cimes des arbres. Une
poulinière hennit au poulain disparu. Au pas de leur roulotte des
comédiens se rangent en rond pour le repas du soir.
Nous croisons, au retour, de petites vieilles accroupies qui débitent
encore, à la chandelle, du miel, des légumes secs et du jambon fumé.
Une dernière fois, nous entrons dans un musée, où, au scandale de
Catherine, Harel est allé droit au salon réservé aux adultes… Et nous
voici à l’auberge où Hélie et Mme Neuville nous ont devancés. Hélie est
chargé de cartons à chapeaux, de robes neuves, dont les cerceaux
crèvent les enveloppes de papier. Silencieux et las, nous montons en
carriole, gênés dans les sièges, par les provisions de Hélie : scions
d’osier pour la taille, pieds d’épines pour regarnir les haies.
Hé quoi ? Harel et moi, nous avons fait l’emplette d’un couteau, d’un
fouet, d’un jonc flexible de Perpignan à main de cuir, garni de peluche
rouge, d’un porte-monnaie et de bretelles. J’ai, à la boutonnière, une
montre en métal doré. Et nous avons pinté au hasard des rencontres ;
nous nous sommes perdus devant les feux, retrouvés sous les tentes… Aïe
donc ! C’est d’un geste sûr que Harel se rassied de quart et donne le
branle du retour.
La nuit est sans lune. La lanterne projette sur le talus le disque
tournant de la roue. Le cheval marche sur son ombre. Harel laisse
baller les rènes, et Mme Neuville sourit aux étoiles, qu’elle désigne
de la main : la Polaire… là-bas, sur notre ferme ; le Chariot de David,
les Trois Mages rangés en quilles. Au delà de la nappe noire où sombre
la vallée, quelques étoiles à travers les chênes apparaissent
vacillantes, comme de petites veilleuses attachées aux branches. Nous
dépassons un homme silencieux qui tire un cheval par la bride, un
ivrogne qui interroge avec éclat un partenaire imaginaire.
Placé entre Mme Neuville et ma mère, la couverture au menton – «
Manquablement que le
relent est à redouter » – Je reprends en pensée
le trajet coloré de la journée ; je me revois aux lunettes
grossissantes, et je m’endors dans l’horrifique vision du radeau de la
Méduse, de l’éruption du Vésuve et de l’incendie du « Grand Opéra » !...
__________________________
(1) Boniments recueillis par Harel.
DINER NORMAND
J’aime,
ô la perle des duchés
Ton cidre
où flambe une topaze…
Ch.-Th.
FÉRET.
Au coin de l’âtre, sur ses trois pieds, la marmite fume à petits jets
de vapeur vite évanouis.
Le parfum poivré du thym et celui du persil, l’arôme des laitues
mouillées, se répandent par les salles, pénètrent la maison.
Trois poulets sont pendus dans la dinanderie. Hélie vaque, le couteau
rouge en main. Et la flamme tressaute au landier, sur l’épée des
broches, se fixe au ventre des étains.
Le ciel est bleu, le matin ardent, la maison claire.
Je subis la virtuosité des pinsons : Je chante !...
C’est Pâques, Mme Neuville traite ses amis.
Dans la salle à manger, la table est couverte d’une nappe dont les
angles sont relevés par des nœuds.
Elle est parée d’assiettes creuses de Rouen, de faïences à tulipe et
d’une verrerie disparate, où se retrouve le verre de Bohême et le
carafon diamanté.
Le pichet en terre verte de Pré d’Auge y avoisine encore la bouteille à
double collier, et, à chaque bout, deux trépieds de cuivre, deux
réchauds, sont en attente.
Les fruits : reinettes de Bretagne et de Caux, crassannes et doyenné
occupent le chemin de table, et, entre chaque compotier, ont été placés
des pots de confitures, les boîtes à cadran des biscuits de Reims et
quelques friandises de Pâques.
Une brioche énorme occupe le centre, domine de son dôme doré les
cruchons de cassis et de framboise.
Les piles de pain
brié s’élèvent à hauteur des bouteilles. La tourte
de seize livres est posée sur une chaise, et trois petits flacons – les
trois couleurs – occupent les intervalles où se dispersent les parts du
chanteau que Mme Neuville donne à l’église.
A ce dîner d’usage, qui correspond à l’époque des semis de printemps,
Mme Neuville reçoit mon oncle Morin, horticulteur, et sa sœur, ma
grand’tante ; convie Duhamel et ses deux fermiers ; garde à sa table
ses gens
d’allou. Elle prévoit dans ce repas la relève des
pépinières, les jours de greffage et les embellissements de son jardin
privé.
Ma tante dépasse mon oncle de la tête. Elle a le front large, des dents
magnifiques, le geste ample. C’est une femme à principes. Mon oncle est
petit. Il parle dans une barbe abondante qu’il caresse de la main.
Il est une heure de relevée quand Catherine apporte la large soupière
de pot-au-feu. Les invités déploient leur serviette. Aucuns, par
discrétion, la gardent sur leur genou, sans la déplier, et la
remplacent par leur mouchoir de couleur. Ma mère, en toilette, s’est
garantie par un tablier blanc, et, souriante, effile une longue lame
qui lui servira à découper.
Tout le monde a son couteau. Celui de mon oncle contient une scie, une
serpette, une spatule d’ivoire pour écussonner. Il en passe, avec
onction, la lame entre ses doigts, ainsi qu’on fait de celle d’un
rasoir. On va et vient de la salle à la cuisine, en se heurtant un peu
à Hélie et à Harel, qui renouvellent sur la table le cidre flamboyant :
« – Y n’y a brin d’eau d’dans ! » assure Hélie.
Ma tante parle haut. Le soleil fait des taches mouvantes aux replis des
rideaux. Sur le mur, en retour de la fenêtre, un marronnier plaque
l’ombre de ses feuilles épanouies. Les coqs chantent. Et les pigeons se
sont abattus du toit sur les marches de la maison.
La couleur du cidre, le léger chapelet de mousse qu’il garde en collier
font l’objet d’une causerie entre Morin et le père Hélie. Ce chaînon
minuscule était l’indice d’un jus nourri de fruits. Les boissons
plates, sans corps, avaient leur surface unie et calme ; elles étaient
sans bulles. « No les véyait point s’ dégramir comm’ cettui-ci ! »
D’autres coloraient le cidre avec de la betterave. C’était pitié ! Si
la pomme amère de Bray, le Blanc-Mollet, si le Doux-Joseph et
l’Ambrette donnent un jus sans couleur, la Reine des Hâtives et le
Martin Fessard font le cidre rouge. Suivant les époques de maturité, on
devait mélanger les unes avec les autres, dans de bonnes proportions.
Les grands crus, affirmait Harel, étaient tous bien orientés. – « Y
faut que l’ pommier soit planté su d’la pierre à fusil ! Le reste,
c’est de la physique !... une physique
à froid qui glace le sang du
cidre !... »
- Le cidre
nif, reprend Hélie, s’brasse avec l’eau des mares ! l’eau
d’ ersouce est trop crue. Durant qu’ j’étais cheux M’sieu d’ Colbert,
no z’allais
pucher d’liau à eune mare couverte
d’canille, et vrai
comme j’ vous l’dis, son cidre flambait pareillement à l’eau-de-vie !
Ma mare, m’ disait m’sieu d’Colbert, all’me vaut plus d’ trois chents
livres de rente !
Mon oncle n’avait qu’une confiance médiocre dans les observations de
Hélie : Une eau vaseuse exédait la bonne
volonté du cidre, en
retardait la clarification. Pour lui, l’eau de fontaine était la bonne.
« Pour les bêtes et pour les gens ! N’est-ce pas, Catherine ? »
La servante était de l’avis de M. Morin, les bêtes aussi, puisqu’elles
laissaient les mares de la ferme pour descendre au ruisseau. « Les
vaches qui boivent de l’eau claire, affirmait Catherine, ont le poil
luisant, elles donnent du beurre en abondance. »
Madame Neuville, à l’endroit des sources, tenait un langage ingénu : «
Elles avaient toutes une origine mystérieuse, et leur eau des effets
bien différents. Sans parler de la fontaine aux Galles, qui tarit
périodiquement, vers la Saint-Clair, non plus de celle de Saint-Main,
qui guérit les enfants pustuleux, elle savait dans la contrée des
sources quasiment chaudes, en hiver, et dont l’eau, quoique limpide,
était impropre aux besoins du ménage. Le savon n’y moussait pas, aucune
légume ne cuisait dedans… »
Mais mon oncle a levé son verre : « Ce cidre est de première !... »
dit-il lentement. – « De première !... » ont répété les invités. Hélie,
qui l’a brassé, interroge du regard les dégustateurs qui font claquer
leur langue et jouer la lumière au travers de leur verre. A cet instant
le « coucou » passe sur la maison : Coucou !... Coucou !... – « Le
cidre est bon ! » clame Harel.
Pour le second service, Catherine apporte un lapin au sang, et la
causerie s’est aiguillée sur les marchés du Jeudi-Saint. A cause de
l’abondance des foins, le bétail s’était vendu cher. Les transactions
avaient été nombreuses. Harel raconte l’histoire de la vieille
Collange, qui voulut échanger son vieux âne perclus contre un plus
jeune.
- Bougez pas ! avait dit Lafosse. Je vais à la foire, j’y mènerai votre
âne et vous le remplacerai par un moins caduc. Le gueux avait son plan
: dans son étable, il avait tondu l’âne, lui avait écourté la queue et
ciré les pieds, de telle sorte que, diminuée de son étoupe, la pauvre
bête n’aurait pu se reconnaître à l’eau de l’abreuvoir.
» Aussi, quand à la brune, Lafosse revint avec le grison bridé de neuf,
ihanant à la vue de son clos, la Collange s’excusa-t-elle de recevoir
un âne peu s’en fallait gracieux et quasi pétulant !... Sûr qu’on lui
reprocherait une coquetterie pareille.
- N’ayez crainte ! avait répondu Lafosse. Y s’fra à vos manières… Il
est pu cher que l’autr’, mais il est plus maniable ! Vous
l’amignonnerez ! »
Et Lafosse, ayant débridé l’âne, celui-ci s’en était allé vers l’auge
où il mangeait d’habitude : « Voyez ! Voyez ! s’extasiait la
vieille Collange, y va dret à la mangeoire ! Çu pauvr’ bêt’, on dirait
qu’il sent l’autre !… »
La méprise provoque un rire sonore, repris à petits coups, selon le
flux et le reflux des méditations naïves. On trouve le tour normand,
et, à propos d’âne, mon oncle dit qu’on ne saurait faire la toilette à
l’officier de santé de la Croupte, parce qu’étant bête et laid, il
resterait bête et laid toute sa vie. – « Et ses confrères
itou », insinue Duhamel. Tous ces gens-là vous entretenaient les
humeurs avec des drogues sans nom, n’y fichaient goutte ! Et Morin, qui
connaissait les simples, en savait plus long qu’eux. C’était sottise de
les aller chercher au prix de deux ou trois écus, pour se faire
administrer une purge. Leur air grave, seul, en imposait. Ils n’étaient
jamais d’accord. M. La Borde qui interdisait aux hommes sains le cidre
pur et l’eau-de-vie, prenait plusieurs «
demoiselles de fine » dans
son café. Ceux qu’il fallait croire, c’étaient les
ossiers. Par
destination, ils remettaient bras et jambes. Ces médecins-là ne
passaient point par les écoles ; ils avaient la pratique. Est-ce que le
père Louis ne guérissait pas les entorses au moyen de signes en croix
sur la foulure ? – Manquablement, s’écrie Hélie, que je n’ma
jamais purgé. Et me v’la co !
Le cidre délie les langues. On parle de tout un peu. De la cuisine, un
arôme brûlant de viande rôtie vient jusqu’à nous. Sur l’invitation de
Mme Neuville, mon oncle s’est levé pour verser le trou normand. Un
flacon à chaque main, il fait le tour en se penchant sur l’épaule des
convives. Il tient aux dames des propos galants. Si elles refusent le
flacon qu’il offre de sa droite, le traître remplit leur verre du
flacon de sa gauche. Et les bras se tendent. « De tout mon cœur !... –
Je vous salue !... – A votre santé !... » Les yeux sont vifs, et les
joues rosées. Et l’on plaisante Harel, obligé d’aller chanter vêpres
avant que le rôti soit débroché. D’ici à ce qu’il soit à point, on fera
un tour de jardin.
Nous nous levons dans un bruit de chaises repoussées, et l’on franchit,
en s’excusant, les marches de la salle.
L’odeur amère du buis, mêlée au parfum des fleurs de poirier emplit la
brise qui nous rafraîchit le visage. Ce mois d’avril est splendide.
C’est de notre coteau à celui d’en face un déploiement de lin blanc.
Près de nous, les corolles du guignier se rouillent, mais les épines
rouges du mur, et les fleurs pourpres du Japon étalent une chair
ardente. Par ailleurs, c’est une profusion de blancheurs écrues et
tendres qui envahit la terre et jusqu’aux cimes des plus grands arbres.
Cette neige descend la colline, semble se fondre au vert tendre des
prés de la vallée, pour renaître en amont jusqu’à l’horizon. Tous les
pommiers ont le charme artificiel d’une féérie.
Mon oncle s’est penché sur un rosier. Il en gratte la mousse. D’un coup
de sécateur, il abat une branche. Mme Neuville parle de variétés de
roses. Les femmes font la toilette aux fleurettes, et, pour un peu,
Hélie quitterait sa blouse neuve et se mettrait à bêcher.
Tout en parcourant les allées, nous avons gagné la porte du jardin,
passé dans l’enclos où se trouvent les vaches.
Celles qui sont couchées se lèvent à notre approche. Elles ont un
ventre énorme, le poil brun et la corne parfois retombante. Elles
sentent le lait, nous regardent d’un œil indifférent. Doucement, les
hommes se sont approchés d’elles, et, le poing fermé, les auscultent au
flanc. Ils proclament les mamelles lourdes, ils disent que les pis
menus et bien écartés témoignent de bonnes bêtes. Les femmes caressent
les amouillantes en les claquant aux cuisses. Catherine circule parmi
ses bêtes, les désigne par leur nom : La Baillette, la Deulé, la
Chandeleur… La Deulé donnait jusqu’à vingt-quatre litres de lait par
jour.
Aux voix connues de Catherine et de Mme Neuville, l’ânesse et les
poules sont accourues ; les chats sont descendus des greniers comme à
l’heure de la traite, tandis que sur le fût renversé d’un vieux
pommier, deux chevreaux se cabrent au grand réjouissement de la
compagnie. On entend, dans le bois voisin, le roucoulement des ramiers
et le bruit des pics. Des mésanges font leur saut léger d’un pommier à
un autre. Hélie traduit leur cri métallique et suraigu : « Qui qui cuit
? qui qui cuit ? – « C’est l’rôti ! » répond Mme Neuville. Et, se
retournant vers la maison, elle engage ses invités à regagner la table.
La bonne chère avive la gaieté de chacun. Catherine verse la poivrière
dans l’assiette de Harel. Le chantre sourit d’une bouche gourmande,
lippue, mouillée au cidre, en homme qui choisira sa revanche.
Ma tante parle politique. Avec Duhamel, il est question des droits
onéreux de l’alcool, de l’inquisition de la Régie.
- On doit être maître chez soi », a déclaré Morin. Nul n’a le droit de
franchir le clos cadenassé, et l’homme qui vient percevoir l’impôt dans
les caves ne peut être qu’un déclassé. On devrait le recevoir…
à
portée !
Et Duhamel fait le geste d’épauler un fusil imaginaire. Tout le monde
est d’accord que la terre est imposée au delà de ses forces et qu’une
concurrence malhonnête fait déprécier tous les produits de fermage.
Enfin, les ouvriers s’en allaient vers les villes et les malheureux,
qui frappaient aux âtres, menaçaient les fermes d’incendie.
- La République était un gouvernement de misère, reprenait mon oncle.
Le respect des citoyens entre eux ne pouvait naître que de l’inégalité
des conditions. – Pardon ! si je vous corromps la parole, s’essayait
Hélie. Une supposition que tout le monde soye aussi bêt’ que mé, qui
qui dirait la messe ? » Harel, le pichet sur la cuisse, synthétise : «
Philippe d’argent ! Napoléon d’or ! République de papier !...
Le nom de l’Empereur a réveillé les souvenirs lointains de ma tante : «
L’Empereur ! le premier !... si cettui-là revenait !... » Et voici
qu’elle se répand sur des faits de l’expédition d’Egypte. Elle nombre
d’autres victoires : Marengo, Iéna, Austerlitz. Elle s’appuie sur des
citations prises dans l’almanach de Mathieu Laensberg. Elle sait par
cœur des paroles de Bonaparte : « Soldats, vous êtes une des ailes de
l’armée d’Angleterre. Vous avez fait la guerre de montagne, de siège,
il vous reste à faire la guerre maritime ». Et ma tante s’est levée,
elle écarte d’un bras retroussé la brioche qu’on lui présente. Elle
chante :
« Salut, grand Empereur de France !
Salut, me reconnaissez-vous ?... »
Morin explique qu’il s’agit de la translation des restes de Napoléon
aux Invalides, et que c’est Joséphine qui reçoit l’Empereur au Ciel :
« Entendez-vous ? le canon gronde…
Vos cendres viennent d’arriver ! »
L’Empereur répond avec tristesse :
« Je vous reconnais, Joséphine,
Pardonnez mon ambition.
Oui, je le sais, femme divine,
J’aurais dû suivre vos leçons !... »
Ma tante pleure. Dans le malaise que cause sa véhémence, Morin coupe la
brioche. Catherine passe les confitures, les pommes et les poires. Les
parts du chanteau sont distribuées aux dames qui se signent. Harel
tourne le moulin à café, cependant que s’estompe au mur, derrière ma
tante, une lithographie représentant Napoléon III et l’Impératrice
penchés sur le berceau du Petit Prince.
Il est six heures. L’ombre envahit la table sur laquelle la nappe
paraît plus blanche, et Hélie place au centre et à ses bouts trois
chandeliers de cuivre, dont deux à branches et à bougies, le troisième
contient une chandelle que Hélie, discrètement, mouche avec les doigts.
Les petites flammes projettent des ronds au plafond. A nouveau la
verrerie s’irise et les flacons étincellent.
Par la fenêtre où je me suis accoudé, je vois le soleil se coucher dans
un ciel bleu pâle, lamé d’ors et de vermillons sur lesquels se découpe
la haute silhouette des peupliers et des ormes. Ils sont à demi
feuillés. A droite, à la ligne d’horizon, les pins d’un vert sombre se
fondent dans les étains du crépuscule. A peine perceptible, une étoile
tremble au Zénith, puis deux, puis trois, et, cependant, ce n’est pas
l’ombre… Le grand disque s’est à peine échancré.
Et j’ai l’impression, retourné vers la salle où le feu flambe, que la
fête ne fait que commencer. Cela est si vrai que Catherine embroche un
couple de poulets pour servir à la bouchée du départ, et que
j’aperçois, à l’écart, un plat d’œufs à la neige…
Et voici que Harel entonne la rapsodie millénaire :
Est-il
permis dans cette maison
De
chanter la résurrection ?
Si c’est
permis, on chantera
Alleluia !...
ECONOMIE DOMESTIQUE
Dans son manteau de velours vert, la Vallée adorable s’étend du Sud au
Nord, la tête appuyée sous les Monts de l’Orne, les pieds baignés par
le flot séquanique. Elle regarde vers le pôle d’où lui sont venus ses
hommes blonds. Pont-l’Evêque, Le Breuil, Lisieux, Fervacques sont ses
parures, les agrafes qui relient les rubans de ses routes claires.
Voluptueuse au creux de ses collines, elle sourit à ses prés diaprés, à
ses pommiers ; elle médite dans ses manoirs, s’agenouille au seuil de
ses clochers de bois. Tous les germes féconds sont dans ses flancs
d’argile. Son épi rare est lourd de farine, ses fruits riches d’alcool.
Chaque saison renouvelle sa toison drue et humide. Mai lui donne les
fleurs du pommier, Juin la peluche de ses fourrages, l’Automne, la
saveur de ses cidres mousseux, et l’Hiver, la nappe verte aux rives de
son fleuve où s’élèvent ses bœufs, le demi-sang normand, bai-cerise,
dont l’ardeur a conquis le marché du monde. Tout cela sans labeur, à
l’ombre des ormes, sous le jeu des nuages, la tiédeur saline des
brises. On ne laboure pas le cœur de la Vallée adorable ; sur elle
point « d’ahan » d’homme qui peine ; mais, dans le calme de ses jours,
le souffle de ses vaches laitières, un appel de faneur, le bruit ouaté
d’un fruit qui tombe…
Et que pourrait, ici, l’activité du paysan ? La vache, le bœuf, fument
le sol qu’ils paissent ; dans le pré, l’herbe se resème d’elle-même ;
l’ondée irrigue le plateau. Que feraient l’emploi d’engrais
artificiels, la main-d’œuvre d’un beauceron, là où la terre végétale a
deux mètres d’épaisseur, où chaque ferme a sa mare débordante, sa
source vive, son ruisseau murmurant ?
Trois éléments de richesse expliquent l’inactivité du paysan de l’Auge
: la laiterie, l’élevage, le pommier. Il confie aux femmes l’industrie
de son lait ; ses deux autres sources de biens n’exigent de lui qu’une
attente patiente. Dans le temps que son bétail et sa récolte
viennent
à bien, le paysan interroge la maturité de ses génisses, regarde
croître son herbe et fleurir ses pommiers. Il est fonction du sol et du
climat.
Je ne veux pas dire que l’Augeron ne collabore pas à l’obtention des
dons de Dieu : il coupe son foin, gaule ses arbres et brasse son cidre.
Au surplus, prévoyant et prudent, aux termes de ses contrats
d’affermage, il limite sa redevance au rapport de ses vaches laitières,
il n’y évalue pas le bénéfice de son élevage et de ses fruits, de telle
sorte qu’en dépit de l’inégalité des saisons, le rendement moyen des
génisses et des pommes compense son loyer. Une année sur deux, ses
pommiers sont si chargés de fruits qu’il les faut épauler au risque de
les voir s’écarteler de haut en bas.
Contrairement au vigneron qui a l’échine courbe parce qu’il bine la
vigne, le paysan de la vallée est droit parce qu’il observe l’horizon.
Il n’est pas ingrat : Dieu merci ! dit-il aux prémices de son pré,
l’année en est, il y aura du regain !...
L’excellence de son milieu explique son esprit conservateur, son régime
dotal et sa préférence pour la propriété plantée et bâtie, arrosée
d’eaux courantes.
Désigner le « Clos Neuville » par la « Ferme Neuville », serait une
désignation fausse. Mme Neuville est sur son bien. En dehors de l’impôt
foncier, de la cote mobilière et des prestations communales, elle ne
paie à autrui que des droits de pêche et de chasse. Elle jouit du
privilège des bouilleurs de cru.
Le Clos comporte un mobilier vif de sept vaches à lait, sept génisses,
une jument percheronne, une ânesse, une chèvre, six petits porcs, trois
cents poules et un pigeonnier.
Son matériel d’exploitation se réduit à un pressoir, une tonne de cinq
mille litres, trois tonneaux de dix hectolitres, une chaudière à
bouillir avec son alambic, une charrette, un tombereau, une carriole de
marché et un cabriolet. Ce cabriolet, considéré comme voiture de luxe,
conduisit Mme Neuville à l’église, le jour de son mariage.
Les produits de la laiterie s’écoulent au marché de la ville, ceux de
l’élevage dans les foires régionales, ou de gré à gré.
Bon an mal an, le beurre se vend un franc la livre ; le couple de
poulets trois francs, la douzaine d’œufs, de soixante à quatre-vingts
centimes.
Le ravitaillement de la table se fait le jour du marché. Le gigot,
l’aloyau, le pot-au-feu, les côtelettes et les bas morceaux, dans une
même pesée, se paient quatre-vingts centimes la livre.
La boucherie consommée vers le milieu de la semaine, la table
s’alimente à la basse-cour et puise au lard en pot et aux réserves des
légumes secs.
En semaine, le cidre pur ne paraît pas aux repas, mais à celui de midi
on sert le café et l’eau-de-vie. On n’eût pu trouver d’aide
à la
journée, sans ce complément.
A cette date, l’homme de journée se paie un franc vingt-cinq.
Hélie et Catherine, qui sont à demeure, gagnent trois cent-vingt et
deux cent quatre-vingt francs par an.
Au privé, Mme Neuville prévoit les dépenses des dîners de Pâques, de
Saint-Jean et de Saint-Michel, le renouvellement de son jardin, les
lessives de printemps et d’automne. Ses dépenses cultuelles sont
représentées par la location de son banc à l’église, le pain bénit et
le bois qu’elle donne au curé, et par le service du bout de l’an
qu’elle continue pour le repos de l’âme des Neuville.
Pour l’intelligence du lecteur, je transcris les clauses essentielles
du contrat de mariage de Mme Neuville. Dans ses termes démodés, il y
trouvera, avec l’évaluation des divers objets mobiliers, la forme et la
substance du contrat dotal, dit aussi régime normand :
Par devant Me Firmin Racine, notaire soussigné,
furent présents le sieur Jacques Neuville, propriétaire, demeurant à
Prétreville, lieu de sa naissance, fils de Sylvain Neuville et de
Catherine Languesseur, d’une part ;
Et Demoiselle Marie-Anne Pesnel, née à la Motte, y demeurant, fille du
sieur Philippe Pesnel et de dame Jeanne-Charlotte Troslet, d’autre part
;
Lesquelles parties majeures, libres de contracter, en la présence et du
consentement du sieur Pierre Neuville, prêtre de Notre-Dame de Courson,
frère dudit sieur Neuville, des père et mère de la dite Pesnel, ont
reconnu avoir fait et arrêté entre elles les conditions civiles du
mariage projeté entr’eux.
ARTICLE PREMIER
Les futurs époux ont adopté le régime dotal avec société d’acquets
conformément à l’article 1581 du Code civil.
Chacun d’eux aura moitié dans cette société, et le survivant même en
cas d’existence d’enfant du mariage projeté, jouira en usufruit pendant
sa vie, sans être tenu de donner caution de la part revenant aux
héritiers du prédécédé.
Mais, si audit cas d’enfant, il vient à se remarier, il perdra la
moitié de cet usufruit à partir du jour du convol.
ARTICLE 2
Le jeune futur prend la demoiselle future avec les biens meubles et
immeubles qui pourront lui échoir des successions de son père et mère,
dont elle est présomptive héritière, pour un cinquième ; en attendant,
ledit sieur Pesnel et ladite Troslet, son épouse, de leur bien, et
dûment autorisés donnent à la future, ce acceptant, la somme de vingt
mille francs, qu’ils promettent lui payer le jour de la célébration de
son mariage. La future rapportera cette somme aux successions de ses
père et mère, ou bien elle y prendra d’autant moins.
La future a ses habits, hardes, bagues, joyaux dont elle fait aussi
apport au futur.
Et des meubles et effets dont le détail suit :
Un bois de lit en acajou, une paillasse, un matelas, un lit de plumes
d’oie, un traversin et deux oreillers remplis aussi de plumes d’oie,
une couverture en coton, une courte-pointe en indienne, un tour de lit,
ciel, pentes, rideaux, aussi en indienne, une armoire en chêne, 24
draps, 18 nappes, 24 serviettes, 24 essuie-mains, 18 taies d’oreiller,
le tout estimé neuf cent-dix francs. Sans que cette estimation en ôte
la propriété à la future épouse.
Tous ces objets et les titres de la créance et des immeubles seront
remis le jour du mariage civil au futur qui en demeurera chargé envers
la future épouse, par le seul fait de la célébration.
ARTICLE 3
Le futur possède différents héritages situés à Prétreville, consistant
en plusieurs cours, terres, herbages, et de plus, un mobilier de valeur
de vingt mille francs, consistant en argent, créances, meubles
meublants, tonneaux, cidre, eau-de-vie de cidre, différents grains,
chevaux, bestiaux, un cabriolet, carriole, charrettes, ustensiles
aratoires et autres objets : les dits héritages et mobilier du futur et
généralement tous biens meubles et immeubles qui pourront lui échoir,
par successions, donations, testaments ou autrement, lui sont et
demeureront biens propres.
ARTICLE 4
Le futur, pour l’affection qu’il porte à la future, lui donne ce
qu’elle accepte au cas qu’il meure avant elle : en premier lieu
l’usufruit et jouissance, pendant sa vie, d’une pièce de terre en cour
et plant, maison manable et divers bâtiments dessus étant, jardin y
enclavé, nommée la Cour Claude, d’une pièce de terre nommée le Jardin
Vallée, joignant ladite cour, et d’une pièce de terre nommée Les Lots,
bornée au Nord par le ruisseau de Querville, le tout situé à
Prétreville, sans que la future soit tenue de donner caution pour son
usufruit aux héritiers du futur.
En second lieu, en toute propriété ledit mobilier de vingt mille francs
que le futur possède ; mais si au décès du futur il y a des enfants
vivants du mariage, la donation ci-dessus sera anéantie et comme non
avenue. Mais, en ce cas, le futur donne à la future, ce acceptante,
l’usufruit et jouissance pendant sa vie, de la moitié des biens meubles
et immeubles propres qui se trouveront lui appartenir à son décès, sans
que la future soit obligée de donner caution pour son usufruit, ce dont
le futur la dispense, et le futur veut et entend que dans la moitié de
ses biens, par lui donnée en usufruit à la future, entrent
nécessairement ladite pièce de terre en cour manable, et lesdites
autres pièces en herbe.
La future, pour l’affection qu’elle porte au futur, lui donne, ce qu’il
accepte, au cas qu’elle meure avant lui, en premier lieu l’usufruit et
jouissance, pendant sa vie, de tous les biens meubles dotaux qui se
trouveront lui appartenir à son décès, excepté la somme de vingt mille
francs donnée à la future par ses père et mère, pour laquelle il est
autrement disposé.
En second lieu, en pleine propriété, ladite somme de vingt mille francs
donnée à la future par ses père et mère. Et, de même, si au décès de la
future il y a des enfants vivant du mariage, la donation par elle faite
au futur sera éteinte et comme non avenue, mais en ce cas, elle lui
donne l’usufruit et jouissance, pendant sa vie de la moitié de tous les
biens meubles et immeubles dotaux qui se trouveront lui appartenir à
son décès, sans que le futur soit obligé de donner caution pour son
usufruit.
Enregistré, etc.
A la mort de Neuville, survenue en 1871, l’inventaire qui eut lieu,
estima la cour manable, plantée et bâtie, à deux mille francs
l’hectare, la vache laitière à 300 francs, l’amouillante à 200 francs ;
la tonne de 5.000 litres à 500 francs, les tonneaux à 100 francs
chacun, le cabriolet usagé à 300 francs : il en avait coûté huit cents.
Harel n’échappe pas aux influences de son milieu. Plus qu’un autre, il
est pénétré de sa douceur, enclin à voir venir, à faire la part de la
Providence ; il a aussi le sens de son intérêt. Il sait, en toute
humilité, que si l’énergie qui provoque l’abondance est du règne
végétal, lui, Harel, comme une sève qui n’a qu’un jet, ne donne, hélas
! que des fleurs. Bédam ! il ne tient pas le coup, arrêté qu’il est,
dans son élan, par la duplicité de sa fonction.
Hélie en convient : « Manquablement qu’on ne pouvait chanter à la note
et être en même temps à l’Eglise et au moulin ! »
A cette ironie bonhomme, Harel répliquait que ce n’était pas le
rayonneux d’Hélie qui faisait pousser les petits pois, que c’était le
Printemps, et, qu’en définitive, il priait pour les biens de la terre
aux jours des Rogations. S’il fallait, ajoutait-il, établir le bilan
des efforts de chacun, la conclusion serait parmi les riches. En cela,
Harel paraphrasait son curé. Cependant, son bon sens l’incitait à
s’assurer plus de stabilité dans le clos Neuville et il rêvait d’y
trouver ses invalides, comme Hélie.
Mme Neuville, qui rit de ses drôleries et redoute son intempérance, l’a
jusqu’à ce jour découragé. Mais Hélie est vieux, et elle prévoit son
incapacité manuelle. Elle s’effraie, tout bas, à la pensée d’introduire
un étranger. Depuis peu, elle accueille avec complaisance les
tentatives discrètes du chantre, et, hier, elle l’a invité à lui
remettre la somme de ses journées dans le clos au cours de l’année
expirée.
A cette demande, Harel s’est mouché longuement, dissimulant son rire
lippu et faisant des yeux idiots, et le soir, au bout de la table,
éclairé d’une chandelle, il a ouvert son carnet.
Ses comptes de salaires qu’il désigne par « ses deux bénéfices », se
réfèrent au temps qu’il passe à l’Eglise et à la ferme. Ss absences du
clos y sont rigoureusement motivées. Les voici :
MES MANQUES
Janvier.
Pour le samedi du 1er de l’An, le dimanche 2 et son lendemain : 3
manques. – Le jeudi de l’Epiphanie 6, et le dimanche 9 : 2 manques. –
Avoir le mardi 11 tiré les Rois chez Hyacinthe : 1 manque ½. – Les 3
dimanches ordinaires restant et un lendemain de celui de Septuagésime :
5 manques.
En tout et pour tout pour le mois : 11 manques.
Février.
Pour les 4 dimanches ordinaires : 4 manques. – Pour le mardi gras du
15 et le jour des Cendres : 2 manques. – Etre allé faire part du décès
du père Croisé : 1 manque ½. – Donné un coup de main au fossoyeur : 1
manque. – Pour une messe d’enterrement : 1 manque. – Un jour de
coliques miserere : 1 manque.
En tout et pour tout pour le mois : 10 manques ½.
Mars.
Pour les 4 dimanches ordinaires et 2 lendemains, dont celui du
dimanche des Rameaux : 6 manques. – Avoir gagné un tour de reins à la
réparation du guichet de la grand tonne : 2 manques.
En tout et pour tout pour le mois : 8 manques.
Avril.
Pour la fête mobile de Pâques et de son lundi : 2 manques. – Pour le
lendemain du dimanche de Quasimodo : 1 manque. – Avoir tenu le pupitre
à la plantation du Calvaire à Auquinville : 3 manques. – Les 3
dimanches ordinaires du mois : 3 manques.
En tout et pour tout pour Avril : 9 manques.
Mai.
Pour les 2 premiers dimanches ordinaires des 1 et 8 : 2 manques ½. –
9, 10 et 11, Rogations : 3 manques. – Jeudi 12, Ascension ; 13 la fête
à Servais : 2 manques. – Pour le dimanche ordinaire ; la fête mobile de
Pentecôte, son lendemain et le mercredi des Quatre-Temps : 4 manques. –
Avoir planté les choux d’hiver à Théodose : 1 manque.
En tout et pour tout pour le mois : 12 manques ½.
………………………………………………………………………………………………………………………
Juin.
Jeudi 2, Fête Dieu : 1 manque. – Vendredi 3 avoir chanté la messe
d’enterrement à ce pauvre Théodose : 1 manque. – Samedi 4, avoir
cueilli la pavée
pour le reposoir à Mme Debiére : 1 manque. – Pour le
dimanche 5, un service anniversaire, l’enlèvement du reposoir Debiére
et une procession à Préaux : 4 manques. – Avoir gagné un coup de soleil
dans le grand pré : 1 manque ½. – Pour les 3 dimanches restant : 3
manques ½.
En tout et pour tout pour le mois : 12 manques.
Le carnet de Harel s’arrête à juin.
Il en est pour sa comptabilité comme pour tout ce qu’il entreprend : la
sève ne dure pas.
Et puis, cette année là, le mauvais temps d’hiver était venu tôt ; le
chantre avait brusquement regagné son métier à tisser.
Qu’il lui soit pardonné ! D’autant que chacun sait que dans les
premiers jours d’octobre, Harel, revenant de la fête à Sosthène Ridel,
fut surpris par une inflammation du foie qui le fixa pendant quelques
semaines. Le pauvre faisait pitié. A ce point que le curé vint un matin
le conjurer de penser à son salut.
A l’entendement des dispositions dernières qu’il devait prendre, Harel
se révolta, et, pour démontrer que son curé se trompait d’adresse, il
soupira vers Mme Neuville et lui demanda une larme de sa très vieille
eau-de-vie, convaincu que ladite liqueur le sauverait des
Saintes-Huiles.
Ayant ainsi rejeté l’ordonnance du médecin et remercié le curé pour ses
prévenances, nous le vîmes à notre étonnement se rétablir en trois
jours – l’espace de la passion du Christ – tant et si bien que nous
nous demandâmes si son indisposition n’avait pas été simulée et sa
retraite organisée pour se tenir au chaud.
Tout compte fait, Harel travaillait deux-cents jours par an. C’était
plus qu’il n’en fallait pour s’attirer la bienveillance des honnêtes
gens de la contrée.
II
L’ÉCOLE
A L’ECOLE
M. Jamet, l’instituteur, nous voyait venir de son perron. Il nous
accueillis d’une voix claire et m’a donné la main. Il est grand et
rasé, coiffé d’une casquette.
Le cœur me bat, et pendant que Catherine enchaîne la roue de la
carriole, nous pénétrons dans la maison. L’accueil de Mme Jamet est
bruyant. Elle découvre en parlant une gencive édentée et agite autour
de sa taille de larges manches bordées de velours noir. Sa fillette et
son petit garçon me fixent avec des yeux étonnés. Sur une chaine,
auprès de l’âtre, la belle-mère de M. Jamet m’adresse un sourire pâle :
« Boujou, mon petiot. V’nez m’embrachi ! »
Tout de suite, assise, ma mère explique à M. Jamet que j’ai douze ans,
que pendant son séjour à la ville j’ai fréquenté le collège. Elle
pensait me laisser ici jusqu’aux vacances, le temps de régler sa
situation de veuve. Elle désirait que je ne perdisse pas l’acquis de
mes premières études, et, à cette fin, elle priait M. Jamet de
s’entendre avec le curé pour que je commençasse le latin qui m’était
nécessaire à la rentrée d’octobre.
Puis, se tournant vers Mme Jamet, avec plus de lenteur, s’excusant de
sa faiblesse, elle énumère mes habitudes de confort : je prenais du
chocolat le matin, des confitures aux heures de la collation. Elle
avait prévu ce complément à ma pension : Mme Jamet trouverait le
chocolat et les confitures dans mon bahut bleu orné de fleurs de
grenadier ; mon linge marqué, mes habits des dimanches étaient dans une
malle à dessus de poils de blaireau, que déposait Catherine sur le
seuil.
Mme Jamet l’ayant rassurée sur la mesure et l’emploi des gâteries dont
je disposais et protestant qu’elle aurait pour moi des attentions
toutes maternelles, ma mère ouvrit son réticule et posa sur la table
six petites pièces d’or de cinq francs, le prix mensuel de ma pension.
Et le silence s’étant fait pendant que M. Jamet paraphait le reçu, ma
mère se leva, visiblement pressée de partir. Plus tard je sus que sa
précipitation voulait épargner à ma sensibilité un arrachement indécis
et prolongé.
Ce fut en vain. Au moment de la séparation mon déchirement fut extrême.
Je m’accrochai à ma mère, à Catherine en pleurs, à la voiture… Je ne me
rendis qu’à la douce violence de l’instituteur : « Voyons ! Voyons !...
commandait-il, il faut être un homme ! »
Le cheval cinglé prit le trot. Bientôt je ne vis plus les signes qu’on
me faisait. Au loin diminuée, disparue dans une descente, la voiture ne
laissait derrière elle que le ruban désert de la route.
Je n’ai pas dormi, moins troublé dans ma pensée que par la nouveauté et
le dénuement de la mansarde que j’habite.
Pas de cadre au mur, mais un débris de glace à la poutre basse. Pas de
fenêtres : une tabatière et, dans les deux angles du lieu, deux lits
étroits en fer : celui de la grand-mère et le mien. Au centre, un broc
sous une petite table boîteuse juste assez large pour recevoir une
seule cuvette. Enfin, venue du grenier dont le sol est d’argile, une
odeur de poussière se mêle au parfum froid de la pommade à la rose ;
cela écœure. Puis la grand’mère a rêvé tout haut, et j’ai eu peur.
Au matin, elle s’est peignée devant le morceau de glace ; elle a mis
son bonnet bayeusin et divisé en deux courtes nattes ses pauvres
cheveux gris dont elle pommade les bandeaux. Elle geint en levant les
bras. Sa toilette finie, elle s’est agenouillée et a prié, le front
appuyé sur le bord de son lit. Venue à moi, elle m’a dit : « Faut vous
l’ver, mon petiot, j’vas vous trachi de l’iau pour vous débrauder ».
Dans le feuillage vert des marronniers de l’avenue, la maison d’école
oppose sa façade blanche à fenêtres cintrées. C’est la première maison
du bourg. Exhaussée du sol de la route par un perron de dix marches,
son élévation, à flanc de coteau, donne accès, à l’arrière, aux salles
de classe et de mairie.
Elle est séparée de l’auberge du Cheval blanc par le chemin de la
Vierge, large sentier impropre au roulage, qui se divise et se perd
sous les pins de la forêt.
Du perron, le regard passe au-dessus des maisons, découvre
l’amphithéâtre opposé de la vallée : à gauche, le trait mince des
collines de Cheffreville ; à droite, estompés par l’éloignement, le
clocher de Prétreville, et, entre deux touffes d’ifs, les toits pointus
du clos Neuville.
Devant soi, une avenue d’ormes centenaires envoûte la courte
perspective, la vue en plongée se heurte à l’ancien pont-levis du
château.
Cette avenue, coupée par la route de Cheffreville et par celle de
Courson, est la parure et la principale artère du bourg.
Placée ainsi, l’école s’anime du va et vient du roulier, de la
maisonnée, des échos de l’auberge. Le silence n’est troublé que par le
marteau d’une enclume, l’envol des pigeons, le choc d’une channe à la
fontaine et par la cloche fêlée, intermittente, des trois angélus.
Avant que l’écolier n’arrive, j’ai promené dans la classe ma curiosité
de nouveau.
Les murs sont tapissés de cartes et de gravures : la France, divisée en
coloris joyeux ; l’Europe, tout emmêlée d’états et de traits noirs,
éclaircie vers l’Asie ; la Mappemonde, grand double cercle où le bleu
domine et semble refléter le ciel océanique.
Voici les sept périodes de la création du monde : Adam et Eve sous
l’Arbre de la Science… Le Paradis perdu ! L’ange du Seigneur chasse
Adam !...
Les épisodes de l’histoire des Hébreux : Moïse descend du Sinaï,
portant les Tables de la Loi. David joue de la harpe devant l’Arche…
Absalon est retenu aux branches par son abondante chevelure…
Le passage de la Mer Rouge, la Terre promise !...
Voici le Nouveau Testament : Jésus se fait baptiser par Jean. Il chasse
les marchands du Temple.. Les noces de Cana, la résurrection de Lazare,
la Passion…
Une dernière estampe montre les apôtres rassemblés. Ils ont le visage
levé vers la colombe qui leur apporte le don d’éloquence.
Les images tiennent l’espace libre entre les trois fenêtres : le reste
du mur est rempli par un tableau noir, une vitrine et une toile
coloriée qui représente les parasites de la pomme de terre et de la
vigne, l’anthonome du pommier, le ver blanc, ses larves, l’insecte à
l’état parfait ; dans la vitrine : un niveau d’eau, l’équerre et la
chaîne de l’arpenteur avec quelques cailloux extraits des carrières
d’alentour.
Les tables sont tachées d’encre, encochées au couteau. Et la salle est
spacieuse… D’après les places, nous devons être soixante garçons.
Ceux-ci arrivent par groupes de trois ou quatre, en sabots bridés,
casquette à oreilles et blouse bleue à liserets. La plupart portent une
besace en sautoir dont la poche de devant contient les livres, celle du
dos le déjeuner. La bouteille dépasse du goulot. Ils vont déposer leur
bissac dans une masure de la cour.
Ils me regardent sournoisement, avec un peu de mépris pour l’habit que
je porte : un tricot de marin et une culotte courte.
Ma gêne cesse à l’arrivée d’un gros gars de quatorze ans, venu de
Prétreville. Je le connais pour l’avoir vu à la ferme – un riverain.
Son entrée m’est une joie. Celui-là vient de l’horizon que j’interroge.
– « As-tu vu maman, Frédéric ? » Frédéric est stupide. A peine s’il
peut formuler sa pensée. « Non ?... Tu ne l’as pas vue ?... »
Brusquement le maître entre. Sur un signe, nous nous mettons sur deux
rangs et nous marquons le pas autour des tables en chantant un air
rythmé par des nombres. M. Jamet bat la mesure sur son estrade, frappe
le pupitre de son signal de buis. Le chant fini nous gagnons nos places
et, à genoux, nous faisons la prière : « Ayez
pié d’nous ! » disent
les petits gars.
Le syllabaire est sans images. C’est une mince brochure que l’élève
épèle en roulant le feuillet dans ses doigts. La salle vibre à la voix
des moniteurs qui occupent les angles de la salle. Un à un, par
division, les aînés vont au tableau. Les ignares vont aux cartes, le
sabot traînant. Deux ou trois – les dissipés – sont tournés contre le
mur et, quelquefois, ce sont des pleurs, car M. Jamet a la baguette
rapide et le pied prompt !
J’aperçois un petit blond au cou très mince, aux oreilles écartées,
dont les larmes ont barbouillé le visage. Son pantalon rapiécé découvre
ses chevilles nues, meurtries par son sabot garni de paille.
Mon voisin, Beaumont Honoré Petithomme, signe d’une main sûre son nom
patronimique et imite assez bien l’écriture à boucles déliées de M.
Jamet. – « Beaumont Honoré, proclame l’instituteur, a du pain sur la
planche ! »
Il est par les divisions des cahiers sans taches, où l’attention
soutenue, le soin incessant témoignent d’une espèce de piété.
Ces cahiers sont appelés à concourir en fin d’année scolaire. M. Jamet
en tire vanité. Certains jours, il sort de son armoire les cahiers du
passé et les bons écoliers sont admis à se pencher sur les écritures
apâlies de leurs devanciers : « Ceux-là s’étaient fait une position :
Nector Pelhètre était devenu comptable, Gruchey premier clerc dans une
étude de notaire !... »
Midi. L’Angélus est récité en latin. La prière est à peine finie que
les garçons s’égaillent, tels les pierrots d’une aire. Les uns dévalent
vers le bourg, à grands coups de sabots, luttent de vitesse, les autres
piquent vers leur bissac.
A crouptons, le dos au mur, ils tirent leur fricot du bol ; le pouce
sur leur viande, ils boivent à goulot que veux-tu. J’ai souvent envié
leurs compotes de ménage, le miel odorant qu’ils creusaient du couteau
dans leurs petits pots de grès.
« A quoi qu’vous jouez ? » m’a demandé Beaumont Honoré Petithomme.
A la ville, ai-je répondu, nous jouons aux barres, à la raquette et aux
billes. On y a un trapèze et des perches pour sauter. On y apprend
aussi l’exercice du fusil.
Je lui explique le jeu de barres : il y a deux camps. Ceux qui
dépassent une limite convenue sont faits prisonniers et mis à l’écart ;
on ne les délivre que par surprise et beaucoup de rapidité.
La raquette exige du champ. On se renvoie la balle à de grandes
hauteurs.
Mais Beaumont fait la moue. Mes jeux n’étaient pas possibles à l’école.
On ne pouvait courir vite en sabots et les raquettes enverraient les
balles dans les pommiers.
Au reste, il trouvait l’exercice du fusil dangereux et disait les armes
à feu défendues.
« Voilà ! conclut-il. Quand vous perdez aux dominos, vous payez avec
des sous. Ici, toutes nos affaires se règlent avec des boutons. Si nous
jouons au bouchon, le perdant paie avec des boutons »… Et, vidant à
terre son sac :
« Guettez ! une tête de sanglier, c’est cinquante ; les beaux de nacre
valent vingt-cinq ; ceux-ci qui n’ont que deux trous valent dix ; un
bouton de culotte compte pour cinq ; on donne cinq boutons de chemise
pour un de culotte. Une supposition que vous ne sachiez pas votre leçon
et que je vous la souffle, çà serait pour vous cinquante boutons ou une
tête de sanglier !... » Et fixant mon habit : « Ben sûr que ceux-ci
valent de vingt-cinq à trente !... » Mes boutons valaient cinquante !...
Mais on se querelle dans les groupes. Les grands pillent les petits qui
se défendent, le sabot à la main, lèvent haut leur sac : « Voleux !
Voleux ! T’es t’un voleux ! »
Dégoûté, un perdant s’isole à l’ombre d’un pommier, où il demeure un
instant immobile. Subitement, il prend le pommier à bras, grimpe aux
branches et se place sur la plus grosse, à califourchon. La rage au
cœur, il lance son sac vide sur un gagnant, et, pour consommer sa
ruine, volontaire, dédaigneux, il laisse glisser de son pied un sabot
qui se brise en tombant.
Dans la suite, je plaçai un trapèze aux branches d’un arbre, et,
encouragé par l’instituteur, j’armai une compagnie de vingt fusils :
vingt bâtons de frêne cueillis dans le bois voisin. M. Jamet décrocha
un chassepot à la réserve des pompiers et nous en montra le maniement.
Mais l’arme était pesante, nous ne pouvions l’épauler. En dépit de
l’attrait de ce vrai fusil, mes camarades se dégoûtèrent. La discipline
les gênait. Bientôt, je n’eus plus de soldats à aligner. Ils jetèrent
leurs bâtons dans le chemin et s’en retournèrent aux jeux de billes et
de boutons. Un d’eux fit un fagot de nos fusils, qu’il emporta faire
des tuteurs à ses rosiers.
Passé quatre heures, les écoliers s’en retournèrent chez eux. Des
groupes se forment et se divisent au chemin de la Vierge, aux
carrefours des rues du bourg. Quelques garçons s’attardent au perron de
l’auberge et y engagent une partie de billes. Ils sont libres !...
A ce moment, mon cœur défaille et ma pensée suit pas à pas les petits
gars qui vont vers Prétreville : ils musent au long des haies fleuries
d’églantines, lèvent les pierres aux passerelles de bois, cueillent des
branches de coudrier. Ils vont chez eux, à leur place à table, près de
leur mère !... Et ils sont heureux, libres, sans le savoir !...
De la barrière de l’école vide où j’ai vu le dernier disparaître, je
n’ai plus, pour appuyer mes yeux, que le sable de la route, le plafond
sombre de l’avenue. Et l’auberge est silencieuse, l’animation rurale
éteinte. Seulement le bruit mousseux que fait la rivière à sa chute
d’eau !...
CHASUBLES ET SURPLIS
Sous les traits réguliers d’un conventionnel, et en dépit d’une
discipline rigide en classe, M. Jamet cache une âme sensible et pieuse.
Au repas, sa famille rangée autour de la table ne s’assied qu’après
qu’il a dit le « Benedicite » ; aucun de nous ne s’éloigne avant «
l’action de grâces ».
Il est l’ami et l’organiste de son curé.
Conduit par lui au presbytère, le curé ne lui a pas caché le plaisir
qu’il éprouvait à m’instruire, et à cette fin, ayant retrouvé dans ses
livres un Lhomond et un De Viris Illustribus, une heure durant, avant
l’angélus du soir, je m’exerce aux déclinaisons.
Tous deux sont de grands amateurs de roses.
Aux belles vêprées je les trouve fréquemment au jardin : le curé –
soutane relevée, calotte en travers – dans le sillon des églantiers, et
l’instituteur, sécateur en main, dans l’allée principale bordée de buis
qui mène à la serre.
Je décline « rosa » sur un banc de milieu, entre un fuschia violet et
un pot de réséda que jardine un papillon blanc en souliers de satin…
Le curé ne m’interroge jamais que par ces mots « Mon enfant… » Et je me
fais au commerce de ces hommes sobres et bons ; je les aide de la pelle
et du râteau ; j’écussonne un sauvageon ; en confiance, je tambourine
l’arrosoir. Enfin, je réponds la messe du matin et je sers les offices
des dimanches.
Les petits soins du culte me sont une diversion heureuse : la
disposition de l’autel, la mise en page du lutrin, le service des
burettes, l’allumage des bougies me gardent attentif et retiennent mes
élans de plein air.
A la tendresse turbulente des miens succède une douceur pénétrante, née
au calme du presbytère, à la pénombre de l’église, au chant et à
l’encens.
Par ailleurs, ma coquetterie s’est éveillée au port du surplis et du
camail, et, à l’instar de Harel, je soigne mes entrées dans le chœur.
Je subis aussi le charme des images. Celles que j’ai sont d’une grande
richesse.
Aucunes, encartées dans le livre du curé, sont bordées de guipures ;
l’ovale parfait des visages roses s’y nimbe du cercle d’or, les robes
mystiques emplissent tous les chemins du ciel…
Et, peu à peu, je me prends à la sensualité des ornements, aux suavités
des grands tiroirs où se déploient comme des ailes la chasuble et
l’étole ; je me délecte au toucher des ceintures éclatantes, et, si je
verse le vin d’offertoire, ma piété se résout aux facettes des pierres
du ciboire !...
Ciboires, patènes, burettes composent pour mon entendement la vaisselle
idéale dans laquelle les saints barbus du rétable boivent et mangent…
Dans les soirs de bénédiction, au rayonnement des bougies, le regret me
vient de ne pouvoir supporter les lourds chandeliers de cuivre.
Cependant, je reste envoûté par mon âtre ; le lis de métal suscite à
mon esprit le lis de mon jardin, la colombe de l’image, le ramier de
mes trembles, et le saint Jean qui caresse l’agneau me fait penser au
petit berger Lancelot.
Le dimanche, le petit bourg s’anime au matin de son marché qui se tient
autour de la fontaine.
Habillées pour la messe, les fermières coiffées de tulle, de rubans
bleus et verts, étalent à leurs pieds, dans des paniers garnis de
linge, le beurre et le fromage, la guigne et la fleur de saison.
Elles vendent pour deux sous des bouquets de roses blanches et
d’œillets pourpres, des bottes d’iris et de lis dont le parfum fait
défaillir.
Leurs bouquets sont arrondis comme ceux de myosotis et de coucous.
Le cerisier trop élevé des clos permettant l’élagage des hautes
branches, des marchandes vendent des cerises attachées au feuillage. Et
la rose n’a pas évaporé sa rosée ; la tige du lis et la branche
saignent encore de la taille et de la rupture à l’arbre.
Les fruits et les fleurs, sur tout le marché, dessinent des sentiers de
fraîcheur qui évoquent la nappe damassée et l’artifice des cristaux de
bohème.
Le jet d’eau de la fontaine éclabousse la galoche vernie qui s’en
approche. Toute fille qui vient puiser à bouteille, tient sa jupe en
retrait dans l’harmonieuse avance du buste et du bras allongé.
A l’angle de la rue, le torse nu, le boulanger dispose ses galettes
chaudes.
Les hommes au cabaret, pintent au cidre pur, et le petit clerc, sorti
du chœur en tapinois, traverse les groupes en camail rouge et surplis à
dentelle.
Aux jours de Pentecôte, le pèlerin vient baiser les reliques de saint
Just.
A l’exemple de saint Ursin qui éloigne la peste, de saint Antoine qui
sauve du mal ardent, saint Just guérit du «
carreau » le nourrisson
et préserve les grandes personnes des douleurs rhumatismales.
Ces jours-là, tandis qu’aux auberges et sur tout espace libre se détèle
le char à bancs venu de la ville, les processions parties du matin des
communes environnantes se rangent, à l’arrivée, au pourtour de l’église
où le clergé trouve place.
Elles donnent lieu à un déploiement inusité d’emblèmes religieux.
Ce ne sont que bannières appuyées aux murs, oriflammes, civières et
dômes de tulle déposés là, croix d’argent et torches à galeries qui
rutilent dans le vert des feuilles, et, jusqu’à l’heure de la
grand’messe, un va-et-vient de chaperons, de soutanes, de chantres à
barettes, qui, dans le bourg, se pressent aux terrasses et sous les
tentes des cabarets.
Chaque procession est saluée par les cloches, et l’animation de la rue
devient extrême dans la cacophonie vibrante du clocher et de
l’ophicléïde du pèlerin.
Ces processions, dont quelques-unes viennent de plus d’une lieue, sont
entraînées à la marche par le battement des «
campunelles ».
Le joueur de
campunelles précède la procession. Une sonnette à chaque
main, il en alterne les coups et les rythmes à son pas.
La malignité rurale n’a pas manqué de définir ce battement par une
onomatopée dont le sens est peu révérencieux pour le joueur.
Elle lui fait dire en marquant le pas :
V’nez vê-nos fill’
J’irons vê-les votr’ !...
Dans cette veine, Harel était passé maître. On lui devait plus d’un
verset de départ…
N’oubliez pas, ô Félicie !
La p’tit’ bouteill’,
je vous en prie !…
et plus d’un de retour :
Ah ! que l’bèr’ de Fervacqu’ est bon !
Ora pro nobis !
Mais le joueur ne tient pas tout le chemin. Il règle le départ. Eloigné
des maisons il passe la main et ne reprend sa place qu’à l’arrivée au
lieu du pèlerinage. A ce moment, il « donne » avec maintien, surtout
s’il est bel homme. Pour peu que deux processions se rejoignent, que le
joueur croise un autre joueur, que chacun rivalise et s’anime, il
devient sensible, toute piété étant absente, que les joueurs de «
campunelles » sourient aux filles et viennent tâter le « bère » !
Voici, par l’avenue, les pèlerins d’Auquinville.
La bannière pourpre flambe au soleil ; gonflé par la brise, le ruban
des étendards s’accroche aux marronniers… Elle approche. D’abord
confuses, les voix prennent un sens ; les robes blanches dessinent
leurs contours, le visage des filles se détaille : teints de roses,
yeux bleus, cheveux roux…
ora pro nobis !... Elles donnent l’illusion
de bouquets d’œillets panachés !...
C’est maintenant le défilé des hommes : deux rangs sonores dont les pas
sont comme entravés. Puis les femmes, plus ou moins penchées, jupes
relevées aux hanches, parapluie et chapelets en main.
Au milieu d’elles, le curé en camail noir, l’étole au surplis.
Les chantres, en soutane trop courte, sont bottés jusqu’à mi-jambe. Et
tout ce monde lance, reprend, se renvoie un verset :
ora pro nobis
!... et soulève une poussière dense, qui, retombée, ternit le vernis
tendre des feuilles de la haie.
Le petit bourg tire grand profit de son Saint et de son pélerin.
Dans sa reconnaissance, il leur consacre la fleur de son jardin ; pour
eux, il orne la face de ses maisons.
Pas de fenêtre, aux jours de Pentecôte, qui n’ait de géraniums, de
fuschias, de cinéraires ; pas de portes, pas de rues sans un tapis de
fleurs effeuillées.
A chaque façade, à hauteur du premier, à chaque mur, l’habitant y
déploie sa nappe, étend en travers ses draps bout à bout, pour y
épingler l’œillet, la tulipe et la rose.
Sur le sol, par une disposition heureuse de roseaux et de l’iris des
marais, il reproduit avec art le rayonnement de soleils de verdure.
De faîte à pignon, de corniche à fenêtre, il attache la guirlande de
papier, y suspend le lustre de lierre.
Et les cabarets élargissent leurs terrasses en y accouplant de longues
tables, en limitent le pourtour avec de jeunes bouleaux coupés dans la
forêt, répètent dans leurs intervalles la tache multicolore des
lanternes vénitiennes.
L’édilité n’est pas en reste. Elle fixe à ce dimanche la revue de ses
pompiers et donne, au bâtis charpenté de la place, le simulacre d’un
incendie.
Cette partie des réjouissances publiques met aux seuils les vieilles
gens et garde attentive la foule des pèlerins.
Le temps du simulacre est court :
« Par fil à gauche !... Par fil à droite !... Halte !... Reposez !... »
Ils sont dix, en comptant le capitaine, qui ont gardé leur blouse sous
un ceinturon rouge et noir. Leur casque est d’une ampleur exorbitante,
leur plumet hors de sens. Ces proportions ne sont dépassées que par
celles du bonnet à poil des deux sapeurs et du tablier de cuir blanc
qui les empêche de marcher.
Pendant la pause, ayant calé d’aplomb l’unique pompe et détendu leurs
seaux de toile, lentement, trois pompiers se dirigent au bâtis qui,
sans escalier, n’offre à leur montée inquiète que le colombage de son
armature.
- Aux toits ! ordonne le capitaine.
Le pompier paysan n’est pas agile. Il lui faut l’épaule de son
compagnon pour quitter le sol et pour que, tant bien que mal, il
parvienne au chevron.
C’est à ce poste qu’au moyen d’une perche – permanente au bâtis – un du
peloton lui fait tenir la lance reluisante.
- Faites donner les eaux ! commande encore le capitaine.
Et les quatre hommes restés en bas – les sapeurs, le tambour et le
clairon n’interviennent pas au jeu des eaux – s’éloignent à une
distance respectueuse de leur machine, lèvent, baissent les bras, et,
avec ensemble feignent de pomper.
Ils feignent, parce que la pompe est vide, parce qu’ils savent qu’à ce
commandement suprême de « faites donner les eaux », l’incendie est
considéré comme éteint.
Replacée sur ses roues, deux hommes au timon, deux hommes à l’arrière,
précédée par les sapeurs, le tambour et le clairon, la pompe reprend
alors, en grand tapage, le chemin de son dépôt.
Je reconnais péniblement dans les sapeurs le charron et le bourrelier.
A distance, la hache au cou, ils me font l’effet de broussailles
fagotées qui marcheraient sur la neige, la cognée restée au lien.
La foule les conduit, les entoure à l’auberge où ils boivent comme au
jour de vrai incendie. Mais l’accoutrement des sapeurs dépasse le cadre
de la porte. Ils ne peuvent pénétrer, et l’aubergiste arrose les
bonnets du perron.
Cependant, les dévots, les femmes qui présentent leurs enfants, les
goutteux, les paralytiques se pressent à l’autel de saint Just. Toute
l’église est envahie. Il y a profusion de prêtres et de chantres au
lutrin. Et un grand désarroi règne dans les bas-côtés : les petits se
refusent à baiser les reliques.
Leurs cris, le remuement des chaises et des béquilles mêlés aux jeux de
l’harmonium, aux sons des cuivres, à la voix grasse et puissante des «
basses », dominent jusqu’à l’ébranlement du clocher.
Tous les fronts sont en sueur ; la poussière voile le camail et
l’habit, et l’autel de saint Just resplendit des feux de cent petits
cierges qui charbonnent, s’égouttent, et, à demi-fondus, se répandent
comme pâte au pétrin.
En dehors, sur le parvis et dans l’avenue, pour ceux qui n’ont pu
trouver place, des abbés disent l’évangile de bon chemin.
Pour deux sous, ils tiennent le pèlerin agenouillé sous l’étole, lui
font le signe de la croix avec le pouce de la main droite sur le front.
Il est des pèlerins sans souplesse qui ont la jambe raide… L’abbé élève
alors l’étole à hauteur de leur épaule.
Et, jusqu’à midi, le chant des hymnes se propage jusque sur la place du
marché.
Le cidre, brassé en décembre, est en mai à maturité, propre à la
dégustation.
A ce point, il est dit de «
première »… par mon grand oncle Morin,
qualifié «
goulayant », «
nif » par Hélie, proclamé «
droit en
goût » et «
justificatif » par Harel.
Et vêprée chaude garde pèlerin au piot.
Comme, à la vue de buveurs bruyants, je fais remarquer à M. Jamet que
la manière d’approcher saint Just m’apparaît bachique et tout idolâtre :
- Il demeure dans le sein des nations converties, me dit M. Jamet, un
assez grand nombre de petites pratiques et superstitions païennes que
l’avenir abolira.
Le culte à Bacchus, par exemple – nous croisions un chantre aviné, sans
surplis, en soutane rouge, qui ressemblait à un broc de cuivre – le
culte, dis-je, qui le faisait honorer au temps du Paganisme, s’explique
en ce que Bacchus fut considéré comme ayant planté la vigne. Il ne
détournait point du vrai Dieu, inconnu aux Grecs, un hommage qui lui
était dû.
On ne saurait, sans injustice, comparer son culte licencieux à cette
espèce de piété du pèlerin pour le bon cidre ; car celui-ci ne lève son
verre à aucun faux dieu : il se désaltère, rend hommage au Créateur de
toutes choses, et apprécie la saveur et le prix de ce qu’il boit.
Pour ce qui est de saint Just, soyez assuré que s’il reçoit plus que sa
mesure il en reporte au Seigneur.
Le pape Grégoire écrivait aux missionnaires qu’il envoyait en
Grande-Bretagne : « Il faut se garder de détruire les temples des
idoles, il ne faut détruire que les idoles, puis faire de l’eau bénite,
en arroser les temples et y placer les reliques. Si ces temples sont
bâtis, c’est une chose bonne et utile qu’ils passent du culte des
démons au service du vrai Dieu. »
Et pour ceux qui s’enivraient, le Grand Pape ajoutait : « C’est en
réservant aux hommes quelque chose pour la joie extérieure, que vous
les conduirez à goûter les joies intérieures ».
Je reprends : « Ces gens qui vont d’une terrasse à une autre, comment
feront-ils pour s’en retourner dévotement ?... »
- Précisément, me répond M. Jamet, le clergé, depuis peu, a décidé que
le retour des processions s’effectuerait individuellement, les croix
dans leur gaine et les bannières roulées.
Il est arrivé que des objets du culte ont été égarés après avoir été
oubliés à l’auberge, que le vent ait renversé le porte-bannière, que le
joueur de
campunelles réglât mal sa mesure… Et vous n’ignorez pas la
mésaventure arrivée l’an passé au chantre de chez vous, au retour de sa
procession.
Il en était au verset :
Ah ! que l’bèr’ de Fervacques est bon !...
Ora pro
nobis !
quand il se sentit pressé de s’écarter du rang pour gagner le fossé.
Harel était
bu. Il en avait franchi le rebord d’une jambe, lorsque
vint à passer un troupeau de moutons.
Quoi que la procession fît pour s’écarter et livrer passage, le
troupeau prit peur et se répandit du côté du chantre.
Comme Harel faisait obstacle, que les moutons étaient pressés par le
chien, un mouton de tête s’élança entre les jambes du chantre, et, tous
y voulant passer, enlevèrent le malheureux, qui, dans ce torrent
laineux, roulait sans voix et sans secours.
Il fut ainsi porté à dos de mouton, cramponné à la renverse, sur une
longueur de dix toises et ramené dans la procession en un désarroi
indescriptible !
……………………………………………………………………………………………………………………..
Harel !...
ECOLE BUISSONNIERE
Le grand bois domine le bourg.
De mon lit, à l’aurore, je perçois le roucoulement des tourterelles, le
martellement d’un pic, le cri du geai.
Mon imagination vagabonde avec l’oiseau, le suit dans les habitudes que
je lui connais.
Mais la venue des écoliers effarouche jusqu’au merle dans le roncier
voisin, jusqu’au roitelet de la clôture, qui fuit, le trille au bec.
Levons-nous tôt ! Allons au loriot à court de thème !
L’air trépide au ras du sol. Tous les bruits sont proches…
A mes pas, dans le chemin, le « rieur » s’esclaffe dans la haie… le
verdier s’envole des herbes folles…
Je monterai à la lisière du bois où la grive s’époumonne au plus haut
du hêtre ; je reviendrai avec cette fauvette à tête noire qui me suit
toujours inquiète, toujours veuve, qui se plaint aux petites chapelles
des vieux murs.
La clarté rose est partout. Elle inonde le taillis, la fougère,
l’aiguille morte des pins.
Dans le fourré, un rossignol est là… si près qu’il me semble que son
ardeur fait trembler la fine ramure.
J’écarte une branche… Je le vois… Il serre un scion menu… Il a le bec
levé, dans sa gorge déployée une petite noix qu’il roule en fermant les
yeux… Tu tu tui tui tio tio tu…
Et au-dessus de la forêt, l’épervier dessine un cercle, se maintient
immobile… A peine si le frémissement de son aile est sensible… Puis, la
chute aplomb dans le moutonnement des cimes !...
Entrons !...
Quoique décidé, assez grand garçon pour apprécier mes risques en forêt,
je n’entreprends guère de ravin écarté sans une hésitation voisine de
l’inquiétude.
A la vérité, je me sens à l’aise dans la clairière où je botanise. Il
me faut de l’horizon.
D’ordinaire, le sentier est un raccourci qui mène d’un chemin de
roulage à un autre, à la coupe de l’hiver passé, à la hutte d’un
casseur de silex.
C’est au point où il s’efface que l’inquiétude me saisit, tandis que la
curiosité me pousse en avant.
Il n’y a pas de sentier dans le ravin profond : l’égout des pentes, la
filtration des terres y donnent naissance au ruisseau.
Le mucus y fermente, l’arbre décapité y pourrit, lépreux envahi par les
lichens, les champignons vénéneux et la variété des fougères d’ombre.
Le silence n’y est troublé que par le remuement des hautes cimes, le
crissement de deux écorces, le brusque retrait d’une bête puante… Et le
bruit mal défini retient mon pied soulevé, crispe ma main à la branche
basse…
Ce que je sais d’histoire fabuleuse n’est pas pour me rassurer.
Mon père, esprit cultivé, aimait à répéter qu’il y avait des divinités
partout : dans la forêt, au bord des eaux, dans les jardins !...
Il y croyait.
A la ville, les murs de sa bibliothèque se décoraient de gravures
mythologiques.
Je vois, dans leurs détails, Pan poursuivant Syrinx, Diane surprise par
Actéon.
Lui-même avait composé de petites odes ; des « abois à la lune », que
je savais par cœur :
A travers l’arbre au noir feuillage,
Pourquoi souris-tu tristement ?
Traines-tu par le firmament
Quelqu’amour qui te décourage ?...
Et, comme pour m’affermir dans la croyance païenne dont il alimentait
sa veine poétique, à un âge où l’intelligence des Lettres échappe à
l’enfant, à sa mort, ma mère, sans discernement, avait pour moi tiré de
sa bibliothèque les livres illustrés qu’il y avait rangés.
Je me souviens d’une Mythologie comparée à l’histoire, où j’ai
patiemment passé en couleurs Léda, Eole, Jupiter et Vénus, la plupart
des Nymphes, Aegipans et Satyres encornés.
Dans le ravin, ces images accourues au battement de mes tempes, à la
moindre clarté remuante, me tiennent cloué sous l’ombre des pins,
disposé cependant à la réalité redoutable du faune aux pieds de chèvre
et de la nymphe écartant les roseaux…
Au reste, la rencontre d’une vieille femme me met en émoi et je gagne
la clairière.
Ici, la silhouette de l’arbre se découpe dans le bleu.
La clarté filtre à travers le tremble, pénètre le mur de verdure, se
pose au pied du frêne, se niche au creux vétuste.
Le rayon joue au tapis vert des mousses, flambe dans les herbes
rousses, éclate aux nacres de la fleur, se fixe aux contours de la
digitale hautaine.
Sur le sol sain et chaud, la mouche émeraude décrit les angles de son
vol, le bourdon se saoule à la ronce, le lapin gîté s’ensauve, roule
sur sa piste comme un petit manchon…
Apeuré par un volier de ramiers, un écureuil gonfle sa queue, saute du
chêne à la branche du châtaignier…
Et la flore est changeante : l’ajonc d’or alterne avec le lit de sauge
; sur l’argile plus humide, la centaurée étoile son mince bouquet mauve
; là, c’est la famille des véroniques – petites prunelles tendres qui
regardent passer, et, à dix pas, le jardin des oiseaux pillé par le
bouvreuil.
Dans ce peu d’espace lumineux, je perds tout malaise, je respire à
grands coups la sève amère des bourdaines, le parfum des églantines et
des chèvrefeuilles.
La chaleur me pénètre comme elle pénètre les pierres. Je me sens
ardent, heureux de vivre. Mais le souffle du plateau dépasse mes forces
et je me couche face au ciel, l’oreille aux bruits animés du buisson.
Un étourneau passe : il va à sa couvée… L’oiseau qui gagne son nid a
des précautions d’approche ; il s’arrête, hésite, donne le change à qui
l’observe. S’il allait indiquer le lieu de ses amours !... Du nid il
revient d’un trait, s’en éloigne jusqu’au bas du vallon.
Je sais autour de moi des nids de merles. Ils sont faits de mousses et
d’argile, à hauteur d’homme, à la fourche du « sauvageon ».
Sur ses œufs, la fixité de l’oiseau est extrême. On dirait une faïence
noire à bec d’or.
Le roitelet construit aux éboulis des talus : tas de mousse serré,
bloqué entre deux racines.
L’entrée du nid est si étroite qu’on n’y peut présenter qu’un doigt…
J’ai compté dix-huit petits au même nid. Ils prenaient la volée à la
queue leu-leu ainsi que les abeilles sortent de la ruche…
A l’heure lisible au cadran des chênes, quand le soleil descend de
branche en branche, je laisse la forêt silencieuse.
Pas de cime inquiète aux lueurs du couchant. Loin en amont, elle
déploie le rideau somptueux de ses pins et de ses hêtres.
Ces arbres qu’ont épargnés la hache, atteints seulement par la foudre
et le Temps, se haussent, dans le soir tranquille, aux arcs constellés
du Rêve… Hormis le hululement de la chouette, la note flutée du
crapaud, rien ne l’agite. La Nuit calme s’entend avec Elle pour la
passée de l’ombre.
Elle s’endort après avoir recueilli le
volier de la plaine, le
corbeau du plateau, les corneilles du clocher… Celles-ci, aux mêmes
heures, sans bruit, regagnent le même massif : Elle est le refuge d’une
vie ailée innombrable !... Et je pense avec mon père que si le jour les
nymphes se tiennent sous l’écorce des chênes, je pense, dis-je, que la
Forêt est bien ingrate de me cacher Echo !
Un dimanche après vêpres que, musant au bois, je coupais des scions de
coudrier pour les alignements d’un arpentage, je fus surpris d’entendre
à un tournant de mon sentier une petite voix gutturale et brève qui me
parut se lamenter.
Je me tournai du côté où venait le bruit et je vis une fille dont
l’accoutrement indiquait une bohémienne.
Ses cheveux étaient serrés dans un foulard rouge, sa jupe à ramages
voyants, ample et courte, découvrait ses jambes nues.
Je savais que des nomades suivaient régulièrement les fêtes régionales.
Il en était passé au Clos Neuville à l’époque des grandes foires,
quémandant de la paille et du foin pour leurs mules.
Cependant, la notion que j’avais de mon éloignement du bourg, de mon
sentier isolé, me jeta dans la confusion.
Je ne pouvais l’éviter, du moins sans quelque lâcheté contraire à ma
nature, et je l’attendis ferme au milieu du chemin.
Elle ne me vit qu’au moment de me joindre, et, comme si, de son côté,
elle eût à redouter quelque chose de moi, elle fit un saut brusque de
chèvre dépistée sur le talus… « Ay dios !... »
Elle n’était pas suivie, et quand elle m’eut dépassé de plusieurs
enjambées, je me retournai sur elle.
Contrairement à ce que je prévoyais, la petite bohémienne s’arrêta
soudain, s’assit sur le rebord et se reprit à gémir :
« Ay Dios !... Ay Dios mio !... »
Enhardi par le champ qu’elle laissait, pour me convaincre aussi que
j’étais sans frayeur, je fis trois pas dans le sens de sa route.
Que comprit-elle ? Je la vis se relever, secouer sa jupe dont le bas
laineux retenait des brindilles de ronces mortes et s’avancer à ma
rencontre.
De près, je remarquai qu’en dépit de ses plaintes, ses yeux noirs
étaient secs, tachés de petites flammes qu’elle s’exerçait à atténuer
par un ensemble de douceur composée.
Quoique troublé, je la questionnai et j’entendis à son dialecte mélangé
de français, qu’envoyée par les siens, elle était allée au bourg
chercher de l’eau-de-vie et qu’en chemin elle avait cassé sa bouteille
pleine… « Ay Dios !... Ah ! mon Dieu !... »
Elle avait le teint brun jaune, la bouche charnue et rouge, la lèvre
fendue pareillement à une cerise craquelée, et elle découvrait des
dents d’une blancheur éblouissante… deux incisives pointues de jeune
chien.
Son âge devait dépasser le mien et sa maturité visible, sa demi-nudité
influençaient mes yeux… A cet instant je regrettai d’être seul.
« Ay Dios mio !... »
J’eus l’idée de m’en dégager en lui faisant l’aumône. Mais je n’avais
point de sous, seulement une pièce de cinq francs, renouvelée la veille
: ma masse d’écolier.
Lui donner ma pièce m’apparut une libéralité extrême, et le sens commun
me le défendit. En toute autre occurrence, je n’eusse pas manqué de
trouver le moyen de me tirer à meilleur compte. Pourtant j’avais ouvert
mon porte-monnaie et mon élan généreux était esquissé !
- Je vais, lui dis-je, te donner le prix de l’eau-de-vie que tu as
répandue. Combien te faut-il pour la renouveler ?...
Elle leva ses prunelles de jais vers les branches, découvrant un cercle
de ses cils deux globes blancs et bleutés, et, ayant croisé ses pieds
nus :
- O gran senor ! una peseta… un franc !...
Je lui tendis ma pièce.
Elle me l’arracha presque, et, dans le même saut de chèvre qu’elle
avait fait pour m’éviter à son passage : « Gracias ! merci !... » elle
s’enfuit vers le plateau.
Stupide, je la vois détaler, sans souci des racines nouées sous ses
pas, son foulard rouge éclaboussant la grisaille du taillis…
Mais elle s’arrête… se retourne… du même pied me rejoint.
Et, dans une détente joyeuse, le rire aux dents, épanouie, elle
m’explique qu’elle va au bourg, y remplacera sa bouteille cassée et
regagnera sa roulotte avec l’eau-de-vie rachetée.
Elle compte sur ses doigts : uno, dos, tres… avec trois sous une
bouteille neuve !... l’eau-de-vie ?... una peseta !... pour le reste de
ma pièce ?... la buena ventura !...
Sa mimique, ses gestes expressifs devancent le brouillamini de son
langage. Je comprends tout ce qu’elle dit. Je n’ai plus d’émoi… et je
n’ai plus d’argent !...
L’accompagner jusqu’à l’auberge, l’attendre pour en recevoir un argent
maintenant sacrifié ?... A l’inconvenance d’être vu avec cette
bohémienne, je préférai garder l’avantage de ma générosité. Puis, elle
m’avait deviné de maison aisée : ma vanité s’en trouvait bien.
Ay Dios ! Nous dévalons le bois avec entrain.
De place en place, pour me laisser la piste, la petite gitane enjambe
l’ornière, bondit sur le talus, retombe à pieds joints dans le chemin.
A ce jeu, son foulard se dénoue… Je vois que ses cheveux sont du noir
de jais de ses yeux, mais emmêlés à la nuque, qu’elle a mince et
presque olivâtre… Et elle va les mollets nus tachés d’argile sèche,
serrant ma pièce blanche dans sa main…
Nous convînmes, au sortir du bois, de nous revoir le lendemain, à la
même heure et à l’endroit où nous nous étions rencontrés.
- Juramente ?... C’est juré ?...
- Je le jure !...
Le soir, en fin de veillée, dans la salle de la mairie où nous relevons
au cadastre les surfaces de pièces de terre que nous devons arpenter,
le visage à l’abri dans l’ombre circulaire que projette l’abat-jour de
la lampe, j’ai demandé à M. Jamet ce qu’il savait de ces « nomades »
qu’on rencontrait périodiquement par les routes.
D’où venaient-ils ?
Etait-il vrai qu’ils vivaient de rapines ?... qu’ils volaient des
enfants ?...
- Oh ! là ! s’écria M. Jamet, voler des enfants ! les bohémiens en ont
à revendre. Ce sont vos contes de nourrice qui vous reviennent ?...
Par coïncidence, dans la semaine qui précédait le pèlerinage, il avait
reçu la déclaration de séjour d’une famille de bohémiens d’origine
catalane.
- J’en ai là sept ! le père, la mère, une aïeule, trois « pequenos »,
une fille de treize ans… Sept, compta-t-il en soufflant les grains de
fusain de son dessin décalqué, campés là-haut dans une même roulotte,
arrêtés par la crevaison de leur âne.
J’appris que le bohémien avait demandé à la marquise de Montgommery de
cueillir de la bourdaine au bois pour la confection de ses paniers et
qu’il en avait obtenu un plateau de hêtre vert pour son industrie de
pièges à rats, d’auges et de cuillers en bois, à condition que lui et
les siens ne se livreraient à aucun dommage, aucune espèce de mendicité.
Jusqu’à ce jour, remarqua M. Jamet, ils n’ont été pour
personne un objet de plaintes. Et leur séjour sera de courte
durée, car, à la vérité, leurs moyens d’existence ne s’exercent qu’à la
ville, où le père et les enfants, musiciens de sentiment, font danser
la fille.
- La petite gitane est danseuse ? dis-je.
- Danseuse, appuya M. Jamet, sans me prêter plus d’attention.
- D’où viennent les bohémiens ? reprit-il.
Ils se sont donnés, chez nous, pour des descendants de ces Egyptiens
condamnés par le Christ à errer éternellement pour n’avoir pas voulu le
recevoir dans sa fuite devant Hérode… Mais ils sont descendus de la
Mongolie, ont pénétré en Egypte et en Bohême et se sont répandus en
Europe vers le XVe siècle, je crois.
- C’est la légende du Juif Errant, coupai-je…
- Oui, à cela près qu’ils sont sans religion particulière et sans mœurs.
Ils se marient entr’eux, sans s’occuper du degré de parenté,
quelquefois le frère avec la sœur et à un âge extrêmement précoce.
Leur boisson favorite est l’eau-de-vie, et, en Espagne, on leur donne
le nom de gitanos pour désigner leur caractère rusé…
- C’est un danger de les rencontrer ? demandai-je encore.
- Oui, répartit souriant M. Jamet, un danger pour les poules ! non pour
le passant, car ils sont naturellement lâches, et, de tout temps, ils
ont répugné au combat. Je n’ai pas souvenance de la relation d’un vol
par escalade ou par bris de clôture commis par un vrai bohémien.
» Mais pourquoi ces questions et l’intérêt que vous semblez y attacher ?
- De l’espèce et de la quantité, répondis-je aisément, de mendiants
venus aux fêtes du pèlerinage.
Nous allâmes nous coucher.
Danseuse !... Et je n’ai pas soufflé ma chandelle, que mon imagination
se peuple de jambes roses, de génuflexions sur fil d’acier tendu, de
balanciers, de parasols et d’éventails agités par de maigres bras
cerclés de velours noir…
Je vois de petits carrés de tapisserie prestement déroulés aux
devantures des cabarets, aux coins des places, sur lesquels, au son
d’accordéons, des garçonnets à perruques rousses pirouettent et se
désarticulent, le pouce à la poche de leur costume ample et bariolé,
sur lesquels aussi se trémousse, castagnettes en mains, une fille aux
tresses serrées et courtes, une fleur à l’oreille…
Et voilà que se dessine, lumineuse, la première petite danseuse que je
vis…
Elle était du ballet d’un drame célèbre où mon grand-père m’avait
conduit :
le Courrier de Lyon. J’en perdis le boire et le manger. Je
la désirai pour sœur, si fortement que j’en parlai en confidence à ma
mère…
Et ma vision s’efface pour faire place à une autre : j’ai douze ans. Je
m’éprends d’une acrobate dont la souplesse et la beauté causèrent dans
la cité une sorte d’émerveillement…
Avec netteté je revois son visage, je détaille ses contours…
Elle est en maillot couleur chair, en corselet d’écailles
scintillantes. Un diadème au front, elle s’avance à la rampe sur une
boule énorme qu’elle dirige avec les pieds. Elle est inondée de feux,
et, les yeux au-dessus du public, elle sourit dans ses exercices de
jongleuse… D’équilibre instable, elle retient la boule qui s’avance,
recule, s’écarte, la ramène et la garde immobile sous elle, comme fixée
à un pivot !
Voilà de ça plus d’un an… Je n’ai rien oublié de cette gerbe gracieuse
d’où s’émanait aussi, en dépit de son flamboiement, je ne sais quoi de
voilé, d’inapparent de sa pensée et de sa vraie vie que je savais se
passer dans la roulotte d’à côté… Je concevais seulement qu’un monde de
convenances, de préjugés et d’habitudes séculaires la rendaient
impossible à mon élan puéril… Et pourtant, je lui aurais donné ma vie…
et celle des autres !...
Dans cette baraque foraine, où l’on jouait le drame et la pantomime,
mon acrobate tenait le rôle de Colombine. Heureux… pauvre Pierrot !...
Mais quoique j’aie vu Colombine laver son linge à la fontaine, je ne
lui dois aucun désenchantement !
Ha ! mais, je suis voué aux filles de roulottes !
- Bonté divine ! s’exclame de son lit la mère de M. Jamet, vous avez le
délire, mon petiot !...
Je n’ai pas été au rendez-vous.
Je me suis parjuré.
Le ton de M. Jamet, ce qu’il m’a dit de ces nomades m’a influencé au
réveil, arrêté au primesaut. Le contact de mes camarades – ces «
stables » de la terre argileuse – a fait le reste. Chez nous, les
racines de l’arbre ne dépassent guère les rameaux.
Puis, la nuit a laissé de sa cendre d’ombre sur ma journée d’hier. A
présent, quelque chose de fripé et de déteint voile la flamme de la
petite gitane.
Enfin, cette nichée au galetas de vieille diseuse et de pequenos, cet
âne crevé me répugnent à leur penser.
Et rencontrer, m’épiant au passage, l’aïeule jaune en hardes rouges
!... Pouah !...
Cependant, peu après l’heure convenue, je me suis penché sur le chemin
de la Vierge, et j’ai regardé vers le bois.
La petite gitane était là.
Dépitée d’attendre sous le couvert, elle était venue sur le terre-plein
de la chapelle que trois marches élevaient à hauteur de tréteau. Elle y
dansait !
De ma place, je voyais sa frêle silhouette se profiler sur la niche.
Elle hanchait, tournait les bras en l’air, donnait de la jambe à gauche
et à droite, s’arrêtait pour saluer un public imaginaire… Et
l’anachronisme de son jeu dénaturait ce lieu sylvestre : truqué,
l’arbre d’au-dessus devenait pour moi un portant de théâtre, la
chapelle blanche une toile au vent, la touffe verte un zinc découpé…
La Forêt trichait ! Elle gardait ses divinités et me donnait en échange
la mimique sémaphorique d’une petite saltimbanque échappée de la Cour
des Miracles !
PELOUSE ET PRAIRIE
J’ai accompagné mon curé jusqu’au perron du château.
Sous l’avenue d’ombre qui aboutit à l’entrée, la porte massive s’élève
à hauteur des ormes et sa voûte basse, cintrée, ouvre sur la pleine
lumière du parc, découvrant une allée principale et une large corbeille
surmontée d’une anse de rosiers.
Le pont-levis a disparu, mais, dans les longues ouvertures de la porte,
on voit encore l’axe des flèches formant le levier auquel le tablier
était suspendu.
Je préfère au caractère sombre et menaçant des salles basses et des
souterrains où l’on donnait la question le plein air des jardins, et je
cours aux pelouses, aux familles d’arbres exotiques, à la volière où
les oiseaux des îles mélangent leurs cris et leurs couleurs violentes.
J’erre par les allées aux ordonnances symétriques, je m’attarde à la
variété des plantes en bordure, au dessin des massifs et je flâne à la
nappe claire des douves que la Touques détournée remplit de son eau
limpide. Si je me penche pour scruter le fond, le petit banc des carpes
s’éloigne de mon bord en frôlant les algues qui frémissent de la pointe.
Répétée dans l’eau, toute la partie récente du château, en pierre et
briques roses, à hautes fenêtres, à amples toits, dessine à l’envers
l’élégance de son style Louis XIII, qui semble avoir pour assises les
lances de ses girouettes. Un souffle, et tout se brouille… Est-ce un
symbole ? Il reste si peu de chose de la partie gothique que maintient
le lierre !
Cependant, on y montre encore une chambre où dormit Henri IV. Le lit a
ses rideaux, son dessus de brocard, quelques bibelots et son carrelage
en terre dure, émaillée de Pré d’Auge.
M. Jamet m’a raconté qu’au temps des oubliettes, un méchant comte de
Fervacques batailla contre les catholiques et qu’il fut, pour Lisieux,
un dangereux voisin.
D’après la chronique, ce seigneur menaça souventes fois la ville
d’incendie. Un jour il entra à cheval dans l’église Saint-Pierre, en
emporta les vases sacrés et l’or de l’évêché.
Mais est-ce de l’histoire ? de la légende, qu’efface de sa
courbe harmonieuse le postillon Roland amenant au perron sa calèche
attelée de deux postiers à grelots ?
Roland, galonné d’or, a un chapeau ciré en forme de cône, un gilet
cramoisi, une capote verte à larges revers aussi cramoisis, et qui,
repliée aux cuisses, découvre ses bottes vernies et sa culotte de peau.
Et l’attelage armorié roule sur le sable qu’il fait craquer dans un
rayonnement de couleurs vernissées où le ponceau domine, s’éloigne
rutilant sous les ormes, stylisant à son arrière l’ombrelle blanche de
la marquise.
Au delà du parc, vers Courson, la prairie s’étend jusqu’aux limites
bleutées de la colline, partagée par le ruisseau dont le cours sinueux
se devine à ses touffes d’aulnes.
Son agrément varie selon qu’elle est en herbe haute ou coupée.
En pleine herbe, les râles des genêts s’y appellent et s’y répondent
jour et nuit, jusqu’à ce que la faulx ait passé.
Joindre l’oiseau est une tâche difficile, car il se tait au bruit qui
l’approche, ne reprend son cri de crécelle qu’après avoir piété loin
par les avenues qu’il fréquente. Parce qu’il fait silence vous le
croyez à dix pas…, il en est à cent ! Il dépiste le meilleur chien.
Toute ruse est vaine pour le surprendre.
C’est qu’il a pour demeure l’herbe drue, le couvert des marguerites
géantes, des populages d’or et des reines-des-prés, les parasols de
l’ombellifère, toute la flore radiée qui lui est un sûr abri.
S’il s’élève de son immense droguier aux senteurs de ciguë, c’est pour
retomber tout aussitôt, en une chute d’oiseau blessé, car son aile
roussâtre est inhabile au vol.
En montée, dans la partie moins humide et plus éclaircie, une herbe
dure et fine à la graine tremblottante, se mêle au myosotis tendre, aux
boutons d’or, aux trèfles blancs et rosés. Pas de fleurettes que
n’incline le poids lourd d’une abeille ou d’un scarabée qui s’enivre au
calice ; pas de tiges qui n’aient leur coccinelle, leur insecte à
élytres rouges et leur mouche aux yeux d’émeraude : aucunes planent au
sommet des longues herbes, y décrivent un vol saccadé et triangulaire.
Ici, le criquet vibre et défie le râle ; le soleil y distille les sucs,
y répand les arômes ; il y anime toutes les ailes, arde tous les
pollens, y consume les couleurs… et la sauterelle frémissante
s’énamoure dans le sentier !...
Et les hirondelles qui nichent au château – comme de petites ardoises
se détachant du toit – viennent raser la nappe verte et onduleuse, s’y
ébattent et montrent aux crochets brusques de leurs retours le petit
point de leur ventre blanc.
Le foin coupé, la prairie n’offre plus que la trame de son velours vert
et l’ombre traînante des nuages.
A ce moment, la rivière en relief découvre son onde, s’anime de la vie
déplacée des hautes herbes : l’oiseau, le papillon, l’insecte dans plus
d’espace font place à l’étalon, à la poulinière et aux pouliches
pur-sang que l’entraîneur attend.
Ici et là, le radier s’élargit, devient un abreuvoir, et la passerelle,
élégance rustique, fait le saut d’une rive à l’autre.
Là, je poursuis l’artificielle libellule, j’effarouche l’araignée des
algues et la truite rapide ; je vois tomber sur le scion du saule une
goutte d’arc-en-ciel !...
pui… pui… c’est le martin-pêcheur !
Pui
!... il raie de son trait bleu le miroir qui le double !...
Je reviens par l’enclos des pouliches. Curieuses comme le sont les
bêtes oisives, elles s’ébranlent dans un trot mesuré et fier,
s’arrêtent à quelques pas, s’ébrouent et se tournent à demi pour se
protéger… Les poulinières se contentent de lever la tête.
Plus d’une fois, ayant à traverser la troupe magnifique de ces juments
de race à la robe brune et si lisse qu’on dirait la pulpe d’une
châtaigne, j’ai dû donner mon bouquet de myosotis !... Elles le
flairaient, le prenaient du bout des lèvres, le laissaient tomber…
Le reprendre ?... m’indigner ?... Elles ne comprennent que l’anglais !!
AJONCS EPINEUX
Car pour repos j’ai enfoulure…
Alain CHARTIER.
Nous voici dans la montée sinueuse du plateau d’en face.
C’est jeudi, nous allons chez le père Rocques rétablir dans ses limites
un bornage contesté.
C’est la première fois que je franchis la vallée pour m’élever au
sommet de ce versant.
Que verrai-je au-delà du ciel qui touche la colline ?
Je m’imagine une flore nouvelle, des chemins aux issues lointaines, des
hommes dont je ne saurai jamais le nom…
Arrivé au faîte : « Retournez-vous, orientez-vous ! » me dit M. Jamet.
J’ai devant moi un panorama nouveau de la vallée, et, avec peine, je
situe l’endroit où nous habitons. Le recul efface ou met en valeur les
alentours immédiats de l’école, des plis de terrain que je ne
soupçonnais pas, quoique habitué à les fréquenter. La forêt s’est
abaissée, comme écroulée au pied de l’avenue, et le clocher, en
contre-bas, dépasse à peine les ormes du château. Dans les ondulations
répétées qui, une à une, conduisent mon regard vers Prêtreville, je ne
reconnais plus l’emplacement du Clos Neuville. Il est si étroit, si peu
saillant que j’en éprouve une déception.
« Il en est du paysage, observe M. Jamet, comme pour tout autre chose.
Un aspect diffère à mesure qu’on le contourne. Savoir choisir son point
de vue, c’est implicitement connaître les autres : une erreur de
jugement dépend d’une orientation unique, d’une illusion d’optique,
tout au moins de n’avoir pas fait le tour de son objet. »
Cette morale était à l’adresse du père Rocques, bonhomme processif dont
l’instituteur connaissait le caractère obstiné.
Mais, dans mon coup d’œil jeté sur le vaste écran, ma rétine sensible
gardait la nappe soyeuse de l’herbage, le relief du manoir cossu, et,
chemin faisant, d’une borne à l’autre, je saisissais l’opposition de
l’apparente nature du plateau.
Sur le devers de la route, aux talus, une herbe rèche et rare, une
terre friable et marneuse remplacent l’argile et la poussée verte des
fonds humides.
Les haies, sans continuité, sans épaisseur, sont d’illusoires clôtures
que la touffe d’ajoncs pare plutôt qu’elle ne garnit, et, au-delà de la
banque et du fossé, le sillon mince et court, ici inculte, est là
chargé d’avoine maigre. L’ivraie et le coquelicot envahissent le champ
d’orge.
« Il faut aller plus avant dans les terres, m’explique M. Jamet, pour
trouver un sol labourable, l’ampleur et l’harmonieux parallèle du
sillon : nous sommes sur un sol de transition, entre le pâturage
naturel de la vallée et la culture intensive des hauts plateaux. Et,
revenant au père Rocques : le paysan qui l’habite s’en ressent ; à
l’étroit sur une terre aride, il est âpre et sans véritable aisance. »
Nous dépassons des chaumes entourés d’une haie d’épine ou de buis, un
jardin fleuri de quelques tulipes. Mais les entrées en sont misérables
: la barrière est fixée au tétard, râcle de l’angle et du fagotage qui
retient les poules. Et le vent de mer dépenaille le chaume, écorne la
cheminée, où l’hirondelle assoupie fait penser à plus de ruine dans
plus de solitude.
De clos en clos, s’estompe un seuil préservé des bestiaux par une
palissade délabrée, au milieu de pommiers sans ordonnance, morts ou
boîteux, exténués, agenouillés aux portes de méchants pressoirs.
Parfois sur le sillon et la lisière revêche, s’anime un troupeau de
moutons dont le chien limite l’avance, contient le débordement. Et les
corbeaux qui piochent du bec nous regardent passer… Aucuns s’élèvent
lourdement, se posent plus loin, un sur une branche menue qui plie sous
le poids, un autre s’engage vers la vallée, à grande hauteur, gagne le
versant opposé. Je perçois son cri funèbre :
croa, croa !... Le petit
point noir se fond aux flocons d’un nuage épais, ventru comme un pichet
d’étain.
Le père Rocques nous attendait à la route.
Je le connais pour l’avoir vu maintes fois aux offices, rencontré à la
mairie, où il était venu consulter le plan du cadastre.
Il a sa barbe de dimanche passé ; il est en casquette de laine, en
gilet à manches et en sabots. Son pantalon, qu’il met aux jours de
bottelage, est rapiécé aux deux genoux.
Il nous salue d’un œil inquiet, gauchement, découvrant à son front
chauve la barre brune du hâle. Ses tempes et son cou sont creusés de
rides, les muscles et les veines saillent à son avant-bras. Il tient
avec précaution un rouleau d’actes – ses titres de propriété – et, tout
en s’excusant de nous conduire directement à « sa terre », sans passer
par sa maison, il nous fait pénétrer, par une brèche de la haie, dans
le labour dont il conteste la superficie réduite.
Le père Rocques assigne son frère pour avoir abattu, au point de
partage, un chêne centenaire qui témoignait de la séparation des lots.
De son côté, le frère prétend avoir mis bas le chêne parce que, dans sa
lente croissance, l’arbre a déplacé la borne médiane, les autres ayant
disparu peu à peu aux chocs bisannuels de la charrue.
Il ne conteste pas la redevance de la moitié du chêne, sous la réserve
que le père Rocques paiera sa part des frais d’abattage, de la mise en
planches et du fagotage à façon.
Mais le père Rocques n’entend pas de cette oreille : pour lui, l’ancien
bornage est le bon.
Il revendique la moitié du chêne, sans aucun frais d’exploitation, le
chêne étant mitoyen et son frère ayant usé d’un droit régalien contre
le coutumier.
Et le bonhomme a engagé le procès, se refusant chez le notaire à toute
ratification d’actes.
- « Y n’auront pas mon «
sine » ! (1) jure-t-il.
Cependant, M. Jamet déploie son équerre et je pars sur un côté du
rectangle, je jalonne, et reviens prendre la chaîne.
Le père Rocques en observe les mailles afin qu’elles ne se nouent pas,
les compte et recompte, et, dans la notion qu’il se fait d’une courte
étendue, il la contrôle en l’arpentant par de grandes enjambées.
Aux haies qui séparent le champ, le bonhomme ouvre le roncier, met au
jour à coups de sabot une pierre enfouie sous la mousse. –
Est-ce une borne ? Faut-il en faire état ?
Et le frère est venu. Il se tient sur son lot, comme un dieu Terme. Et
par hasard les femmes Rocques apparaissent de chaque côté du champ.
Elles sont en bonnet de coton et tiennent la pointe de leur tablier.
Les deux hommes ont discuté âprement, jusqu’à ce que M. Jamet se soit
rapproché d’eux. A ce moment ils se taisent. M. Jamet pouvant témoigner
d’une injure, mais les deux femmes ont rejoint leurs maris, et, la
bouche amère, se reprochent un trait cupide : le drap qui servit à
l’ensevelissement de leur défunte mère, qu’une seule des parties avait
abandonné par surprise !...
Leurs cris sont si aigus que les mésanges s’enfuirent des pommiers, et
que, dans le courtil voisin, un cheval s’est arrêté de paître !
Mais, impérieux, le père Rocques commande à sa femme de le suivre. – «
On se reverra ! » et, M. Jamet, ayant fermé l’équerre, nous nous
dirigeons vers la maison pour déjeûner.
Nous marchons, pensifs, froissant du pied les herbes dures, butant sur
un sol inégal, lépreux, taché par la gouttelette sanguine de l’œillet
sauvage et l’épineux ajonc.
Au banc de la table calée d’une brique, face au dressoir débordant
d’almanachs empilés à demi-hauteur d’assiettes jamais touchées, se
reliant par des fils d’araignée, face encore à l’armoire sans corniche,
éculée de l’arrière, brunie par la fumée de l’âtre, nous avons, sur un
bout de nappe, totalisé les opérations de la matinée.
Comparé avec la teneur « d’environ » des titres, notre total dépasse de
quelques mètres le même nombre d’hectares et d’ares.
Le père Rocques ne s’en montre point surpris. Il s’y attendait. C’était
son droit d’occasionner les frais d’une contre-expertise.
Mais la disposition du repas a calmé son emportement. Il s’excuse de
recevoir M. Jamet d’une manière si modeste, et il coupe au doloir la
tourte chevillée au huchier, nous offre un morceau dur, moisi : « Le
pain recuit, dit-il, déchausse les dents, mais il tient à l’estomac. »
Hé quoi ! il n’est pas riche, sa terre est ingrate, son ciel acariâtre,
il n’a pas de pommes, et les lapins « trépanent » ses avoines.
- On paie la tourte de seize livres plus d’un écu, Monsieur, reprend sa
femme ; c’était deux liards la livre dans le bon temps !... Et, posant
le plat : Rocques vient de vous dire notre misère, il a oublié que ses
«
bedons » (2) crevaient comme des mouches…
- Peut-être, hasarde M. Jamet, que vos génisses viendraient à bien si
vous leur donniez plus longtemps le lait de la mère et si vous les
teniez sur de la paille fraîche ! Il y avait là une question de
nourriture et d’hygiène.
Mais tous deux se sont élevés contre cette observation. On ne vivait
pas de propreté. Et avec quoi ferait-on le beurre si l’on réservait le
lait aux
élèves ? L’eau de foin leur convenait à huitaine. Il y avait
d’autres causes de mortalité où les soins dispendieux ne pouvaient
rien. Elle en savait de déplorables.
Et la mère Rocques explique, cependant que son homme l’appuie, ahane en
nous passant le plat, que le
bedon qui boit au seau s’y jette
goulument, s’emplit les narines, et se coupe l’haleine.
Pour éviter sa plongée profonde, il fallait placer sa main dans le
lait, tenir à fleur les doigts que le «
bétat » tétait et ainsi lui
maintenir le museau.
Autrement, il s’irritait, butait du front comme il eût fait à la
mamelle de sa mère, et, finalement, renversait la fille et le seau.
Celle-ci, assise, devait donc serrer avec force le seau entre ses
genoux et abandonner sa main jusqu’à la dernière goutte.
Or, il était arrivé à Rocques d’employer une servante amoureuse.
- Calamiteuse ! interrompt le bonhomme. homme.
- La gueuse donnait ses rendez-vous dans l’étable, aux heures de
nourriture. – Qu’arrivait-il ? – Ce n’était pas à l’citer !... Parbleu
! lutinée par le gars, la fille serrait mal son seau, le veau répandait
son lait, et le bètat dinait par cœur !... tout uniment !... »
Rocques en avait perdu huit veaux la même année.
Et la bonne femme secoue la tête, donne la tremblotte à ses pendants
d’oreilles sertis d’humbles émeraudes.
A ce rappel, le père Rocques s’anime, ses petits yeux bleus sont
devenus malicieux. – « Y a un’ chos’ qui m’console, gazouille-t-il, si
rich’ qui soient dans la vallée, y n’en ont pas comm’ cettui-ci !... A
vot’ santé ! »
Bédam ! ses pommiers vont de travers, ils sont caducs, mais les pommes
en sont odorantes et fermes, pareillement aux grains d’une vieille
vigne.
Et devinant en M. Jamet le répartiteur de l’impôt foncier, il évalue
les fonds de la vallée, déprécie par analogie ceux de son plateau.
Est-ce que l’on pouvait s’enrichir là où trois chevaux suffisaient à
peine pour tirer le soc, où toute semence était condamnée par la
sécheresse, où le pommier périssait sous la mousse, dévoré, cuit par le
soleil ?...
Quant au rapport des vaches, mieux valait n’en pas parler. Faute d’eau
claire et d’herbe grasse, le rendement en beurre faisait pitié ! Et
vendre son lait au fromager, c’était proprement porter son engrais chez
autrui, chez plus riche que soi… D’ailleurs à qui se fier dans un pays
où les bornes avaient des jambes !...
Revenu au procès, M. Jamet insinue qu’il voit un arrangement possible :
« Pourquoi, mon père Rocques, le champ étant un rectangle parfait,
divisible par moitié sans atteindre en aucune façon ses servitudes et
son aspect, pourquoi, dis-je, ne vous contenteriez-vous pas du simple
partage et du champ et du chêne ? Entendez-vous avec votre frère pour
une part des frais d’abattage… »
- M’entendre avec mon frère ! répète le père Rocques, le regard droit
sur M. Jamet, le geste arrêté… Merci bien ! » Et, après un silence : «
Chacun, M. Jamet, connaît midi à sa porte !... » Et, frappant du point
la table : « On remplacera les bornes par une double
plante ! Chacun
sa haie : çà coûtera les yeux de la tête, mais c’est de droit !
Nous regagnons la route par les courtils du père Rocques, musant aux
étables et aux granges dont les tuiles tombées font au pied des murs
délabrés un amas rouge et lavé.
Le bonhomme dit vrai, son herbe est roussie, ses mares sont sans eau ;
ce qui en croupit, amené du chemin, est fangeux, nauséabond ; la
chenille ronge ce que le soleil a laissé de feuilles vertes. Pas de
branche squelettique qui n’ait sa toile floconneuse et grouillante, ses
chenilles balancées au bout des fils… Certains pommiers ont une
chevelure si gluante que l’oiseau s’en détourne.
La méfiance égare ce paysan, me dit M. Jamet, il pourrait éviter les
chenilles en charfouissant le pied de ses arbres, en leur faisant à
hauteur d’homme un collier de glu. Mais il a horreur de toute
nouveauté, de toute hygiène préventive.
D’ailleurs, tous confondent la cause avec l’effet : Rocques s’en fie
pour présager le froid à l’apparition dansante des papillons jaunes, à
la floraison hâtive de l’épine noire… Mais non ! ni l’insecte, ni la
fleur n’annoncent le froid, au contraire !
Ils pendent les taupes aux branches basses des pommiers, lapident au
fourré le hérisson sous le prétexte qu’il fait avorter leurs vaches…
Mais non ! Mais non ! la taupe est son auxiliaire et le hérisson ne
vient autour des laiteries qu’attiré par les senteurs du lait. Parce
qu’il est arrivé qu’une vache s’est couchée, et piquée sur un hérisson
à demi enfoui sous elle, aucun avortement ne s’ensuit. »
Et, comme si un paria de l’ombre, victime de l’ignorance humaine,
venait pour en témoigner, devant nous, sur la barrière de la route,
crucifiée, une chouette étend ses ailes tachetées, ayant au bec un
caillot de sang noir !...
__________
(1) Signature.
(2) Veaux.
COURONNES ET LAURIERS
Ça ! que l’on m’apporte une coupe ;
Du vin frais : il en est saison !
SAINT-AMANT.
Aujourd’hui dimanche, cérémonie des prix, retour à la ferme… Est-ce
possible ?...
Je me lève, fébrile.
Pour la première fois, mon coffre à dessus de poils prend un caractère
de compagnonnage intime et joyeux. Son désordre est égal au mien. Il
exprime bien notre hâte de départ.
Pourtant, à l’idée de quitter ma soupente, quelque chose de menu se
rompt en moi. Est-ce pour la grand’mère, pour la lucarne teintée de
rose au matin, pour des habitudes rythmiques d’ennui, de coucher et de
lever ? Je ne sais. Mais, avant de descendre, je tourne sur moi et je
me vois, dans le morceau de glace, faire un geste d’adieu aux murs.
Et je ne pense plus à rien. Un élan tout physique tend les muscles de
mes jambes et me prépare au saut du retour.
Je monte et je descends les escaliers sans raison. Et quand, vers dix
heures, Mme Neuville, ma mère, Hélie et Harel pénètrent dans la salle,
mon émotion ne se traduit par aucune effusion. Je les regarde en
déshabitué d’eux, et je grimpe dans la carriole que je remise moi-même
à l’auberge.
La distribution aura lieu après vêpres, dans le courtil aux caves du
maire.
Un plancher sur tréteaux, drapé d’andrinople rouge, constitue l’estrade
dont les montants sont ornés de laurier d’Apollon.
Sur la toile du fond se détache le buste neuf de la République,
l’écharpe tricolore en sautoir.
La tente est meublée de deux tables chargées de livres et de couronnes,
d’un harmonium-flûte, dit de missionnaire, prêté par le curé, de cinq
fauteuils et de petites chaises raides et maladroites, déhanchées,
marquées au fer des initiales de la paroisse.
Les fauteuils sont de style Louis-Philippe. Le petit harmonium-flûte à
trois octaves (le soufflet sur le clavier s’actionne de la main gauche)
est contenu dans une boîte d’acajou ayant la forme d’un antiphonaire.
Les places de choix sont destinées au sous-préfet, au maire, à
l’inspecteur-primaire, au délégué d’arrondissement et au curé.
Les bancs de l’école et les chaises empruntées aux maisons du bourg,
meublent le parterre que clôture un cordeau à linge.
C’est moi qui, en semaine, ai déballé les prix, encarté le feuillet
nominatif sous la couverture du livre doré, qui ai fait le lot de
chacun, arrondi et noué les couronnes.
- Elles n’ont pas l’éclat du cercle d’or que recevait le soldat romain
victorieux, me dit M. Jamet ; humbles et sans grand mérite, elles sont
pourtant de tradition. Dans tous les temps elles ont été un ornement
dans les réjouissances publiques et jusque dans les sacrifices.
» La couronne de roses blanches est, pour les filles, joie et parure.
Elle sied aux cheveux blonds et aux yeux très bleus. Leur suavité
artificielle n’est pas loin de la fraîcheur des roses naturelles
groupées plusieurs ensemble au sommet des branches…
A côté de gros livres, d’édition récente, reliés de toile carminée,
dorés sur tranche, il en est de petits, édités à Rouen et à Tours, dont
la mode est expirante.
Leur couverture à médaillon encastre une lithographie ou un chromo. La
partie gaufrée – entrelacs, coquilles et perles – est dorée, bien en
relief sur un fond blanc, vert ou rose pâle.
Le livre qui m’est destiné porte aux angles de petits trèfles reliés,
croisillonnés entre eux par des filets d’or et représente en médaillon
une diligence recouverte de sa bâche. Le postillon mène au galop ses
six chevaux, et des visages s’estompent aux carreaux de la voiture,
tandis que, courant sur la route, deux femmes font des signes d’adieu
aux voyageurs.
Ces petits livres ont un attrait indéfinissable. Par analogie, ils
conduisent à l’enchantement des lettres de nouvel an dont les
guirlandes en couleurs et les médaillons perlés sont encore encadrés
par les découpures imitant les plus fines dentelles.
Ils sont tous « revus et approuvés », mentionne l’éditeur, par un
comité nommé à cet effet par Monseigneur l’Archevêque de Rouen.
Les titres m’ont donné de l’aile, plus ou moins jeté dans les fers avec
Sylvio Pellico, le Lépreux de la cité d’Aoste ;
emporté loin dans les sables avec les Conquêtes de l’Algérie, la
Jérusalem délivrée ;
poussé sur les Océans avec les Naufrages célèbres, la Case de l’Oncle
Tom ;
ramené aux pays des neiges avec la Jeune Sibérienne, les Soirées de
Saint-Pétersbourg ;
laissé au soleil ardent avec la Jeune Indienne…
Les doigts englués de vernis, les yeux ravis aux lithographies
coloriées, j’ai pris contact avec Florian et Cervantes, les bêtes
habillées par Granville, le Petit Plutarque et les Enfants célèbres.
Et, maintenant, tout cela est rangé sur l’estrade ; les couronnes de
laurier sur la table de gauche, les couronnes de roses blanches sur la
table de droite ; l’or des livres rutile au soleil, attire sous les
tréteaux les poules de l’enclos, et, sur les prix, doucement tombent et
se mêlent aux lauriers verts, comme pour s’y apparier, les feuilles
mortes, sanguines et jaunes, des pommiers d’août.
Au dernier coup de vêpres, les deux écoles sont à leurs bancs.
Autant dire que les fidèles n’ont quitté l’église que pour le courtil.
Les filles sont en blanc, sans leur voile ; les garçons en petites
blouses bleues et pantalon noir.
M. le Sous-Préfet s’entretient avec le Maire, l’Inspecteur avec
l’Institutrice, le Curé avec les filles et le délégué avec tout le
monde.
La famille Jamet, Mme Neuville et ma mère occupent les premières
chaises du parterre : Hélie et Harel se sont adossés à un arbre.
Il fait très chaud et des paysans accrochent leurs blouses aux branches
; en bras de chemise, hors l’enceinte, ils s’épongent, plaisantent et
font venir le cidre de l’auberge qui donne accès dans le champ.
M. le Sous-Préfet préside. Il est jeune, d’une élégance aisée dans son
uniforme galonné d’argent. Une raie impeccable sépare ses cheveux
châtain clair dont une mèche rebelle s’écarte et de la pointe lui
touche le sourcil. Quand de sa main fine il la ramène à la masse lisse
de son front, cela lui donne l’air de découvrir quelque chose… Il porte
la moustache à l’anglaise, et son sourire, longtemps maintenu, découvre
ses dents qu’il a saines et bien rangées.
Pour le commun, il a le geste retenu et distant tout à la fois, mais il
met familièrement son bras sur le cou du maire et avec lui monte du
même pied les degrés de l’estrade. – « Mon bon ami !... » On le sait de
brillant avenir, son père étant le maire d’une importante ville de
France. Son épée est plaquée de nacre, elle flamboie à son côté.
Sans qu’il le veuille, sous la bâche qui ondule, M. le Sous-Préfet
souriant fait songer à des ornements de haut style, au galbe et à
l’éclat des lustres.
M. le Maire est un homme grand et fort, aux épaules rondes et massives,
portant blouse en semaine. Ses petits yeux d’un bleu lessivé, sous un
sourcil sans dessin, évoluent lentement dans sa face vermillonnée, à
double menton. Il a de courts favoris noirs, la bouche grasse et la
main puissante. Un peu penché, il entend d’une oreille velue les propos
qu’on lui tient et répond à tout invariablement par deux exclamations
exhalées avec peine et douceur : « Ha bien !... Ha bien !... »
Riche terrien, il parque ses bœufs dans la vallée, mène lui-même ses
bêtes grasses au marché de la Villette.
C’est sans attrait qu’il s’intéresse aux choses communales. Mais
noblesse oblige, et il fait de bonne grâce, au jour d’exception, le
sacrifice de ses goûts et de sa tranquillité. Il se soucie peu des
honneurs et d’être mis en avant. Empressé, il cède la place à de plus
intrigants, à ceux qui ont plus de volubilité. Lorsque je vois ses
petits yeux bleu de ciel errer – sans se poser – sur le moutonnement
des visages, je me dis qu’il cherche par delà, là-bas, à l’horizon, un
point d’appui aux nappes de ses herbages.
Le chœur des garçons est un signal. Un papier en main, M. le Maire se
lève et souhaite la bienvenue au membre du Gouvernement.
Et c’est la montée des robes blanches et des blouses bleues. Les prix
s’éparpillent dans l’assistance, se passent de main en main. Sous la
couronne de roses blanches, la joue des filles s’empourpre ; elles vont
dans les rangs, de-ci, de-là, retenues aux chaises par la mousseline de
leur robe, et, pour en tirer coquetterie, ajustent les roses et les
épinglent à leur chevelure.
Les petits gars ont de véritables manchons verts ; ils descendent
l’estrade dans le plus grand embarras. Leurs souliers solides, leur
blouse bouffante, leurs couronnes – ils en reçoivent autant que de
livres – les entravent de partout… ils portent le laurier de travers
!...
A la reprise des chœurs, M. le Sous-Préfet se lève, et, après quelques
souhaits pour de si bons écoliers qui deviendront plus tard
d’excellents citoyens de la République, présente M. le délégué qui
répandra le vin d’éloquence : « Amusez-vous bien ! » conclut-il en
ramenant sa mèche décidément indisciplinée.
M. le délégué est un monsieur ample, à bras courts, à main potelée, mal
enveloppé dans une redingote négligée ; son petit nez en quête,
chevillé entre deux yeux rapprochés et spirituels, est surmonté d’un
front trop large et trop haut, tendu comme une voile, mais l’ensemble
sympathique est modifié par le trait d’une méfiance visible : un
sourire grimaçant et sans franchise.
On sait qu’il a une grande facilité d’élocution, qu’il peut sur
n’importe quel sujet parler d’abondance.
Il ne fera pas de discours, dit-il, il causera simplement, au milieu de
gens qui se connaissent et se comprennent, sans le secours, sans la
pompe inutile des phrases.
Je prévoyais que le délégué dirait quelque chose que je saisirais
aisément, et, précisément, il cite Sully et le paraphrase : « Le
labourage et le pâturage sont les deux mamelles de l’Etat ». En peu de
mots, il démontrera que l’Agriculture est le fondement de l’ordre et du
bonheur publics, la nourrice des races vigoureuses de corps et d’âme et
de mœurs saines !...
A cet énoncé, le maire se tourne vers le délégué et le regarde en homme
à qui l’on révèle un sens nouveau, une puissance inconnue : « Ha bien
!... Ha bien !... »
Soit qu’à cet instant Mme Neuville ait trouvé le morceau indigeste ou
qu’elle se soit levée pour toute autre cause, elle laisse son rang et
gagne ses gens à proximité. Je la rejoins.
A ce moment, l’assistance n’est guère attentive. La chaleur est extrême
et des chaises ont été transportées sous les pommiers. Après leur
blouse, les paysans ont retiré leur gilet et vaquent entre les arbres,
le pouce à la bretelle ; un va-et-vient discret s’est établi entre
l’estrade et l’auberge, d’où, par intermittence, aux points de silence
de l’orateur, la brise apporte le bruit des dominos remués.
Les mots de
sympathie… de
confiance… d’
Agriculture… nous
parviennent par dessus les groupes, et, sur l’estrade, dans sa
redingote ouverte, le délégué s’agite, les bras arrondis, comme
pressant une mappemonde sur son cœur !...
Et M. l’Inspecteur prend la parole :
L’Histoire enseignée sous l’Empire n’était pas la bonne. La Vérité
sortait de son puits sous le régime nouveau. En conséquence, la refonte
de l’enseignement s’imposait et, avec elle, la revision des programmes
scolaires.
De récentes découvertes modifiaient profondément les sciences physiques
et chimiques et jusqu’aux connaissances qu’on avait en biologie. Les
temps étaient proches où les hommes auraient plus d’aisance et partant
plus de « mieux être ».
Notre récente défaite n’avait pas été sans profit :
En métallurgie, par exemple, l’industrie arrivait – après les Allemands
– à couler dans un même creuset, la quantité d’acier suffisante pour
émettre des canons d’une grande portée ; par un même procédé,
l’industrie obtenait des masses énormes de fonte qui permettaient de
franchir, d’une seule arche, les plus larges fleuves de France ; on
augmentait par des alliages la résistance de l’acier et on emprisonnait
la vapeur dans un tel corset de métal qu’on en centuplait la force
propulsive…
L’hélice et le piston ne connaîtraient bientôt plus d’obstacles : on
irait à New-York en 7 jours, en 13 heures de Paris à Marseille.
Aller vite deviendrait une condition de prospérité.
Le plancher du monde s’établissait commode et sûr pour le plus grand
bien du corps…
Encore un peu, et la cité idéale, affranchie de l’erreur et de la
routine, connaîtrait dans plus de liberté, d’égalité et de fraternité,
dans plus de justice aussi, la félicité à laquelle chacun de nous avait
droit.
M. le Curé roule des yeux énormes ; il se tourne vers M. Jamet un peu
pâle, et j’entends qu’il lui dit pendant que le délégué congratule
l’Inspecteur : « Dans la Cité idéale de M. l’Inspecteur, il n’est fait
mention d’aucun devoir envers Dieu !... Et brusquement :
« Mes enfants… je n’ai pas l’expérience de la félicité sur terre et
j’ai bien peur que dans la cité que préconise M. l’Inspecteur, il n’y
ait hélas ! autant de malheureux que dans le passé. Notre Sauveur l’a
dit : Il y aura toujours des pauvres parmi vous. Mais ceux-là
m’appartiennent, et je leur dis : Résignez-vous !... Résignez-vous
parce qu’il n’y a que des apparences de liberté et de richesse et parce
que le véritable bien réside dans la résignation volontaire à son état…
Je vous dis que la joie s’assied au foyer des humbles de cœur… Vous,
les filles, soyez de bonnes ménagères ; honorez vos parents afin d’être
vous-mêmes des mères respectables.
Et vous, garçons, vénérez votre Patrie. Elle est la terre de vos aïeux.
Conservez votre bien pour le transmettre à vos descendants. Vous
héritez des efforts de vos parents, mais ce n’est qu’un dépôt. Enfin,
craignez Dieu et fuyez le cabaret, car en même temps que vous vous y
avilissez, vous y perdez votre temps et votre santé. Par dessus tout,
venez aux offices des dimanches ; l’église est la gardienne de vos
traditions, elle vous rendra meilleurs et vous consolera dans
l’épreuve… ! »
M. le Sous-Préfet, le délégué et l’inspecteur se sont levés aux
premiers mots du curé. Je les vois donner de la main et de la tête,
subitement pressés de regagner leur voiture. Le Maire voudra bien
transmettre leurs compliments au Curé. – « Ha bien… Ha bien…
Et maintenant debout, M. le Maire convie son entourage à le suivre pour
se rafraîchir.
Hélie et Harel emboîtent le pas du Maire et, par petites pauses, nous
nous écartons de l’estrade que démeublent quelques complaisants.
Nous piquons droit vers la bonne face des caves, qui, plâtrée rouge et
blanc, semble se pencher pour voir sous les feuilles.
Une marche de granit et nous passons de la clarté chaude à l’ombre
humide, surpris violemment par l’arôme subtil de l’alcool qui, à la
longue, a pénétré, saturé et noirci la poutre et la muraille.
Nous sommes devant six tonnes de cidre de cinq mille litres chacune,
rangées côte à côte, face à dix tonneaux de mille contenant des
eaux-de-vie de dix à vingt ans.
La cave de M. le Maire, a coutume de dire M. Jamet, représente
l’aisance d’un gentilhomme breton qui a manoir et cent arpents de terre…
L’effet de l’ombre, l’ampleur circulaire des grands foudres rendent les
intronisés silencieux. Mais les robinets de cuivre, les mesures d’étain
posées sur les contreforts qui relient les douves, les petits verres
laissés là sur le baril, se dégagent de la demi-nuit par leurs clartés
de veilleuses et leur image ranime les langues.
Pour démontrer que les fûts sont pleins, le maire en frappe les douves
du revers osseux de sa main ; il donne à goûter dans une écuelle de
bois : A qui la «
gâtée » !... On porte à la santé du maire, on fait
l’éloge du crû.
Le groupe est revenu à la lumière pour y apprécier l’eau-de-vie.
Selon Harel qui tient auprès de lui quelques connaissances, il n’y
avait guère que les eaux-de-vie de Nestor et les cidres de
Saint-Philbert-des-Champs qui pouvaient rivaliser avec les crûs de M.
le Maire. Nestor était « hors concours » et Guéret de Saint-Philbert
avait eu le diplôme d’honneur au dernier concours agricole.
Chacun goûte, y revient, pépie de la lèvre, se souvient d’une
eau-de-vie remarquable : celle de Pelhètre d’Auquinville pesait 60
degrés à 9 ans de fût !..
Hélie qu’une si grande quantité d’alcool en un même lieu pénètre
d’admiration, hasarde au passage un compliment : « Durant qu’jétais
cheux m’sieu d’Colbert, y soignait dans sa cave cinq ou six cents
litres d’eau-de-vie, et manquablement qu’çà commençait à faire pas mal
d’embarras !... » ̶ « Ha bien… Ha bien… » lui
sourit le Maire.
Je ne suis plus là que pour presser Harel. Je devine aux clartés roses
de la rivière, aux plaques étamées de ses tournants, que le soleil
décline. Mais, verre en main, il a pris racine à l’ombre d’un pommier.
Il a son rire mouillé, arqué haut des beaux jours, il claque de la
langue, lève ses cils blonds, déguste avec lenteur et s’en fait donner
d’une autre à laquelle il promet une maturité splendide… Le maire se
réjouit.
Cependant, à voir ces gens si attentifs à la couleur du liquide, à
l’arôme qu’il dégage, j’ai l’impression qu’il s’agit là de choses
capitales ; je sens confusément aussi qu’il y a contradiction,
désaccord entre leurs intérêts et la morale de l’estrade… En
définitive, ces eaux-de-vie s’écoulaient par le cabaret, sous le
couvert du «
fil-en-quatre »… Alors ? Alors le Maire était
répréhensible, quoique primé dans les comices, et Harel, qu’un plaisant
couronnait de roses blanches, son verre irradié par le soleil expirant,
le crâne sillonné par l’ombre des branches, était un suppôt de Bacchus
?...
Ce matin d’août, à l’aube, je reprends pied dans le clos.
A ma vue, un vieux coq, le cou tendu, la tête oblique, demeure une
patte en l’air… ̶ Hé oui ! c’est moi !
Mais le verger est vide. A cause des pommes hâtives on en a retiré les
vaches. Il est vide, muet et d’aspect nouveau. J’avais laissé l’arbre
en fleurs, je le retrouve pliant sous les fruits. Pas de pommier qui ne
soit épaulé… En se rabattant les unes sur les autres, les branches ont
dessiné une épaisse rotonde d’où saillent, menues et nuancées les
pommes de Mousset-Roux et de Binet-Violet. Sous l’ombre de tant de
feuilles jointes, je pousse du pied les petites boules du fruit tombé.
Je vais aux ronciers de la haie. Déjà l’églantier oppose à la mûre le
corail de sa baie ovoïde, et, au-dessus des ronces, les coudriers
étoilent leurs
trocelets roussis.
Le dicton est vrai : année de pommes, abondance de noisettes. Si je
secoue l’arbuste, les petites noix tombent dans la haie avec le bruit
sec des grêlons sur le blé.
Un coup aux mûres, et je dévale au ruisseau. La chienne me suit.
Dans son trajet, à découvert, l’eau ne baigne plus que l’assise des
grosses pierres. Dans le courant anémié, la truite et la loche ont
regagné la fosse voisine, ou, profitant d’une ondée avivante, sont
descendues à la rivière. Cependant, aux cuvettes rocheuses maintenues à
niveau par un filet de source constante, mon image fait regagner le
creux à quelque poisson emprisonné là, et, sous la pierre que je
soulève se dégage à mesure que l’eau se clarifie, le corselet d’une
écrevisse. Eblouie, elle reste immobile, ses antennes appuyées sur ses
pinces… La saisir est un jeu. Elle claque alors de la queue, élève ses
pattes et pince à vide !...
Mais la chienne, en devançant mes pas, trouble les fonds et je franchis
la haie du ravin.
Je ne sais où diriger ma joie. Tout m’est un objet d’élan. Frénétique,
je me vautre au sol, j’étreins l’arbre, je mords le fruit. Je crie,
j’appelle, je défie !... J’ai la notion de la «
terre à soi » ! et je
frémis d’aise au grand air du matin.
Et voilà que ma turbulence et les aboiements de Diane ont jeté
l’inquiétude parmi les vaches qui paissent dans ce lieu retiré.
Mugissante, la troupe s’est ébranlée dans un cliquetis de chaînes. Mais
une ardeur combative me raidit sur place. J’attends le choc !... Les
pesantes bêtes, en éventail, convergent au petit point d’angle où je me
trouve. Je les ai toutes devant moi, essouflées, la tête basse, en demi
cercle arrêtées… Elles me hument, l’œil exorbité, l’oreille tendue aux
aboiements de Diane qui a repassé le ravin. Je n’ai pas bougé… Je
comprends que le danger va naître de mon immobilité, et, brusquement,
je m’élance sur les vaches, les bras tendus… Ha !...
Et les voilà reculant, s’évadant, se désunissant dans un galop gauche
qui soulèvent leurs croupes, fait se nouer leur queue sur leur échine
et ballotter leurs mamelles énormes entre leurs jarrets !...
Le jardin aussi a changé d’aspect.
Sanguine au pêcher, une cape de verdure jaunie habille la quenouille et
l’espalier. Les primevères ont fait place aux dahlias vivaces et aux
coquelourdes renouvelées.
Au bord des allées, Hélie a laissé croître l’oignon dont la houppe
grenue et rayonnante dépasse l’épi défleuri des lavandes, et, aux rames
d’une aire en attente, il a disposé la variété bleue, blanche et mauve
des volubilis.
Ceux-ci ont gagné la palissade, le mur et grimpé sur l’auvent et la
porte.
Des cordons parallèles de reines-marguerites doublent les bordures de
buis, et, dans les encoignures, en élévation, se dégagent de leurs
feuilles velues des citrouilles géantes qui bombent leurs cuirasses
luisantes, pareilles à des bassins de cuivre oubliés là.
Pour que les pêches tardives, les crassannes grises, les Doyenné et les
beurrés ne rompent leurs attaches, le bonhomme a placé sous les poires
de petits paliers de planches maintenus à l’arbre par des scions
d’osier.
Mais ici, comme au verger, la vie est silencieuse. La période de la mue
rend l’oiseau muet. Son chant, les jeux de la pariété, l’éducation
sonore de la couvée sont finis en août. Pas plus que l’oiseau, le
papillon ne s’accouple au temps des lavandes exténuées et des
chrysanthèmes, il franchit seul le mur et l’iris défleuri du toit.
Dans la maison, même silence.
Je comprends que cet assoupissement est dû aux chaudes journées d’août,
à l’arrêt de toute sève, qu’il est provoqué par l’attente des maturités
automnales, qu’il est la veillée des efforts prochains. Il explique les
longues méridiennes de Hélie et de Harel qui n’ont plus à seconder
Catherine, et qui, dans l’intervalle d’une traite à une autre, se
tressent des semelles de paille, vont à la pêche ou bien s’attardent à
la confection de quelque outil. Leur activité renaîtra à la première
gelée, dans le cadre effeuillé du clos, au gaulage et au pressurage des
pommes à cidre.
Quant à moi qui ne subis pas l’influence caniculaire, dès demain je
rafraîchirai ma turbulence dans la rivière, je lancerai l’épervier.
J’accompagnerai Duhamel dans ses prises nocturnes et je monterai le
cheval dans le pré !
A plat ventre, bras ouverts, j’ai collé mon oreille au sol pour
entendre battre le cœur de la Terre… Je n’ai entendu battre que le
mien. Mais au Printemps, j’ai assisté au mariage des bêtes, à leurs
pétulances amoureuses ; j’ai vu naître leurs petits. J’ai compris la
tendresse des mères, au nid, dans le terrier et à l’étable, j’ai vu
l’émerveillement des yeux qui s’ouvrent à la lumière :
Le pigeon donne encore sa béquée d’orge agglutiné ; la poule, sa part
de grain jeté ; le coq râcle le sol, y trouve une larve, jette l’appel
aux poussins, qui, accourus, s’emparent du ver, se le divisent.
J’ai surpris le garenne léchant les yeux de son petit, lustrant sa robe
grise, le menant aux boutons d’or qu’il décapite !
Ah ! le saut du cabri qui veut têter sa mère ! Sur ses pieds d’arrière
il dessine son élan dans la courbe gracieuse de son col, donne du front
au front baissé de la chèvre qui le reçoit et l’encourage, anime ses
coups, jusqu’à ce que, las de son jeu d’approche, le faon se rue à la
mamelle qu’il boute pour de bon afin d’en descendre le lait.
A l’opposé du chevreau ardent, l’ânon se tient sous le col de l’ânesse.
Ils sont immobiles. L’ânesse a l’oreille basse. On dirait de grands
jouets de bois. A la place où le bât meurtrira l’ânon, la mère pose sa
tête lourde. Tous deux forment une croix…
Et c’est la truie qui s’est allongée au bord de son auge. Elle a treize
faons et n’a que douze pis !... Si bien que, malgré l’offre de son
ventre, il y a toujours un faon – le moins vigoureux – qui n’a pas sa
place à table. Sa plainte est rageuse, sa recherche obstinée. Il essaye
la trouée, bûche aux pattes des buveurs, grimpe dessus, en éborgne un
du pied, en mord un autre à l’oreille et n’arrive, au-dessus des
mamelles, qu’à une tétée de poils !... Il contourne alors la ventrée
rose et frissonnante et se place au groin de la laie. Là, assis,
l’oreille écartée, il gueule si fort qu’il sème l’inquiétude jusqu’aux
chenils voisins. Mais le frère est sourd à la voix de son frère, et les
douze petites queues frétillent dans la joie. Ah ! les petits cochons !
En prévision de l’orage qui tue le poussin dans sa coquille, nous avons
hier, Catherine et moi, devancé l’éclosion d’une couvée à terme.
C’étaient des œufs de cane qui, faute d’une couveuse de l’espèce,
avaient été placés au nid d’une poulette, mystifiant en cela sa nature
et sa tendresse.
Au seuil de la grange, à dix pas de la mare, bien au clair, sous la
poule au panier, nous avons pris, un à un, les œufs marrons que la
poule avait becquetés, et pellicule par pellicule préparé l’ouverture
au petit.
L’opération est minutieuse : il arrive que la coquille adhère au
poussin. Un décollement hâtif et le nouveau né saigne et crève. Il faut
avoir soin de se huiler les ongles.
Nous avons ainsi délivré dix petits portant livrée de duvet jaune, à
courts moignons d’ailes, qui se sont tassés au creux d’une poignée de
foin. Là, le soleil les a séchés. Et en moins d’un quart d’heure, la
nichée a pépié hautement et dirigé ses narines vers la mare d’où venait
un relent humide. Un à un, boulant du foin, bûchant sur un fétu,
boitant du pied, cognant du bec en terre, ils vont à l’eau comme
poussés par un grand vent.
En vain leur mère tente de les attirer, de les couvrir de son aile, ils
vont pépiant et flutant à la vase, et les voilà qui donnent de l’avant
à pleine onde, plongent sous la nappe aqueuse, s’ébrouent, se dressent,
agitent leurs moignons et font ruisseler sur leur duvet doré le
chapelet des perles d’eau.
Et la mère a volé sur le bord. La surprise, la crainte, la tendresse
pénètrent tout son être. Informe sous ses plumes hérissées, les ailes
relevées pour l’envol, elle tourne sur elle, glousse, racle les ronces,
va et vient sur le talus, d’un saut franchit l’eau et jette un cri si
désespéré, que les vieux coqs accourent et que les poules mères qui
glanent demeurent la tête en l’air !
Demain dimanche, 1er septembre. – Le soleil entre dans la Balance, dit
Harel. – Dans les jours qui suivront, on gaulera les pommes hâtives du
clos.
Les préparatifs de l’abattage ont été l’occasion pour Hélie, d’un long
recul dans son passé :
« Durant qu’j’étais cheux m’sieu d’Colbert, nous a-t-il conté à table,
j’ai gaulé un
périer qui couvrait, à ly tout seul, oh ! oui… un
arpent d’terre !... »
Diable ! Ce poirier, Hélie, était aussi d’une hauteur prodigieuse ?
« Dam oui ! la maîtresse. Car, en mourant, il a donné quasiment vingt
cordes (1) de gros bois et pus de septante bourrées fagotées !... »
Nous nous récrions : « Hélie, Hélie, nous vous passons les basilics
couvés par des crapauds, les aurores boréales qui prédisent la guerre,
mais un poirier de cette envergure !...
- Que ce verre là m’empoisonne, a juré le bonhomme, si je ne vous dis
pas la vérité, toute pure ! A preuve…
La preuve : M. de Colbert avait désigné Hélie et Cantrel pour monter
dans le poirier. Tous deux y avaient abattu les poires et «
manquablement » que Cantrel et lui, de toute la matinée, ne s’étaient
vus ni entendus dedans !...
Hélie exagère.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Octobre ferme la parenthèse qu’avril avait ouverte. Dans le triomphant
semestre, le cycle du germe, de la fleur et du fruit s’est accompli. Au
point final de l’arc Eté expire ! L’Automne est là, impatient
d’effeuiller les arbres !... Il se hâte aux pommiers, aux murs des
granges, à l’espalier crucifié. Sa main froide transit le rosier, le
dahlia et les hautes herbes ; il démantèle le taillis, dépenaille la
haie, et, faux monnayeur, paie de son or faux la cime qu’il déprède.
Alors, sous le ciel pâle, l’horizon se rapproche, ramène au regard,
dans la perspective éclaircie, la face des clos dépouillés.
Partis des pressoirs lointains, les appels, un aboiement perdu, le
bruit des socques parviennent, à travers les branches nues, aux échos
découverts, aux seuils de solitude, et, près des chaumes, les grands
poiriers se haussent, se regardent anxieux par dessus les haies, se
renvoient les chouettes, les grives et les pics qui piochent leurs
chancres.
Au frisson des écorces, la sève se fige, le talus sablonneux s’écroule
!... Dans le sentiment soudain qu’elles ont de leur durée « les choses
ont des larmes » !…
Au soir, les petites lueurs des lanternes dansent au pourtour des
caves, par les sentiers effacés et les chemins creux. Et, pour peu que
la nuit soit claire, on voit, dans le val, les manoirs accroupis, et,
sur eux, veiller résignée, l’humanité des arbres.
________
(1) Stères.
III
DEUILS
LA MORT DE MME NEUVILLE
Décembre 1889.
Mme Neuville est morte. Elle s’est éteinte dans sa chaise à coquille,
devant sa petite table, dans le décor d’une neige opiniâtre qui bloque
les portes, s’amoncelle à mi-fenêtre.
Le froid avait transi jusqu’au pain. En certains clos, on le taillait à
la hache, et, par endroits, la neige était si haute qu’elle atteignait
le larmier des auvents et les branches basses des pommiers. Partout
elle comblait les trous, effaçait dans son nivellement les touffes de
ronces et les monticules de terre, et, selon que le vent la poussait,
elle s’entassait et s’élevait contre les haies, les emmurant dans son
moutonnement mat qui changeait l’aspect de toute étendue.
A cause des pentes glissantes le trafic s’était arrêté et un grand
silence montait de la vallée, où les bœufs, ne paissant plus, se
tenaient serrés aux bords des étables, survolés par les étourneaux qui
pillaient les graines de leur foin.
Les voliers affamés venaient aux poulaillers disputer le blé et
jusqu’aux miettes de la fenêtre constituant le repas des rouges-gorges
et des mésanges qui n’hivernent point. On devinait leur arrivée dans
les grands arbres à la cendre de neige qu’ils faisaient tomber…
Cependant Mme Neuville ne voulut pas remettre le service anniversaire
de Neuville, et, à ce bout de l’an, elle était allée à l’église une
chaufferette à la main.
Ce fut sa dernière sortie.
Elle avait éprouvé le vertige du silence. Depuis, elle tirait présage
des bruits de la nuit, se disait entourée de petites flammes qui la
suivaient au jardin. Elle dormait à sa table et ne se couchait qu’avec
répugnance.
Chaque matin elle mettait de l’ordre dans sa lingerie et en avait sorti
le drap de son ensevelissement ; elle y avait aussi rassemblé ses
bonnets démodés, enroulé ses rubans portés aux jours exceptionnels de
sa jeunesse.
Quand elle passait d’une pièce à une autre, elle rangeait les chaises,
les objets épars et se regardait au miroir. Nous la surprîmes se
rajustant des papillottes.
Elle avait perdu le goût de la table et de l’économie. Un soir qu’une
malheureuse était venue, Mme Neuville avait dénoué son tablier de
cachemire, l’avait passé aux hanches de la pauvresse. Ce geste
renouvelé du bon saint Martin, nous affligea par son étrangeté ; non
que Mme Neuville ne fût compatissante, mais parce que ses habitudes de
charité n’étaient pas à cette mesure.
Enfin, d’accord avec ma mère, elle prit quelques dispositions
testamentaires : l’une d’elles assurait les derniers jours de Hélie
dans le clos. Et, ayant mandé Duhamel, elle le pria de retirer du
plancher de la grange, sous le foin, deux plateaux de chêne qu’elle y
savait en réserve. Elle entendit que ce bois servît à la confection de
sa bière. Comme s’il se fût agi d’une sortie d’agrément, elle fit
noircir le harnais du cabriolet, reluire les boucles et le cuivre des
lanternes.
Elle n’eut pas de fièvre et ne voulut pas se coucher pour mourir. Elle
demeura à sa petite table, devant son formulaire et ses lunettes
repliées ; seulement de temps à autre, elle buvait un peu de vin et se
mouillait les narines avec de l’eau de lavande.
Elle redemanda son curé le jour de sa mort. Celui-ci revint par le
sentier, à l’approche de l’ombre, l’étole et le surplis saupoudrés de
grésil. La sonnette du petit clerc nous jeta dans le trouble, et ma
mère, ayant en hâte étendu une serviette sur la table et disposé deux
chandeliers d’argent aux angles, Mme Neuville communia, dans la
cuisine, à sa place d’habitude, assise, en caraco, son voile de veuve
sur son bonnet.
Le prêtre s’en alla et ma mère se disposa à replier la serviette et le
voile, mais Mme Neuville s’y opposa, et, tandis qu’elle suivait de ses
yeux son curé et la lanterne dont la petite flamme orange dansait sur
la neige, elle demanda qu’on lui récitât l’Office des Morts.
Mon grand oncle Morin, Duhamel, sont assis devant l’âtre, Hélie et
Harel au banc du mur. Ils sont tête nue : Leurs fronts chauves, leurs
mains lourdes, leurs contours brusques rappellent les personnages des
vitraux de l’église…
Nous n’eûmes pas à feuilleter le formulaire, l’étui à lunettes
s’encartait au psaume 114, et ma mère, d’une voix blanche, commença :
Dilexi quoniam exaudiet Dominus,
- Vocem orationis meae… répondit Harel.
Lis en français, dit ma grand’tante.
- « Le Seigneur garde les simples ; j’étais réduit à un misérable état,
et il m’a sauvée. »
« J’ai dit alors, Rassure-toi mon âme, puisque le Seigneur t’a fait
tant de grâces :
Car vous avez, Seigneur, retiré mon âme de la mort, mes yeux des
larmes, mes pieds de la chute…
-
Requiem aeternam dona eis Domine,
-
Et lux perpetua luceat eis, reprit Harel.
……………………………………………………………………………………………………………………….
L’ombre s’est accrue, les bougies fument et vacillent aux appels d’air
de l’âtre… Mme Neuville se lève, étend les bras… Ma mère la reçoit.
Elle expire au milieu de nous, debout !...
Au repas qui suivit le service à l’église, nous gardâmes les amis venus
de loin et les familiers de la maison. Aucune femme ne parut à table.
Encadré de Morin et de Duhamel, j’occupai la place de Mme Neuville.
M. Jamet, que je n’avais pas revu depuis dix ans, se trouva face à moi,
entre notre notaire et l’ingénieur des Ponts et chaussées qui affermait
la chasse sur le bien. Au reste, chacun se plaça à sa convenance, en
évitant toutefois le brasier ardent, par crainte d’opposition brutale,
de telle sorte que le bout de la table touchant l’âtre resta inoccupé
et que la flamme qui montait jusqu’à l’attache de la crémaillère put,
seule, éclairer la nappe et la pièce sombre, ouatée de neige aux
impostes.
L’usage voulait qu’on servît la soupe, le bouilli, le fromage et les
fruits.
A cette fin Catherine puisa directement dans la marmite et Harel passa,
sans préséance, l’assiette en suivant le rang.
La vapeur du potage, la neige fondue qui fumait aux bottes, mouillaient
le dessous des chaises, embuaient le plafond bas et le cristal des
verres, et la flamme alimentée outre mesure, empourprait les visages.
Aucun ne se plaignit. Discrètement, on parla du temps. Une hésitation
déférente au penser de Mme Neuville caractérisait le geste sobre et le
parler rare des convives.
- Il fallait remonter avant dans le siècle, commença Duhamel, pour
comparer un hiver aussi âpre : des pommiers gelaient ! Il avait surpris
des cygnes sauvages au ravin de la ferme, rencontré des lièvres boiteux
et des oiseaux morts. Les corbeaux avaient quitté le plateau, et le
chemin d’Enfer, qui menait au bourg, était si complètement nivelé que
son tracé était indéfinissable…
Nous nous représentâmes le chemin enseveli : il nous avait fallu deux
jours pour dégager le nôtre, afin que la carriole qui descendrait Mme
Neuville pût gagner la route.
Je revois Harel dans les glissades retenant la jument par la bride, le
flot noir des paysans resserré entre les talus blancs et la haute croix
touchant les branches, occasionnant de minuscules avalanches sur le
velours… Par endroits, le ressaut de la voiture fut si rude, qu’il
déplaça la bière et qu’il éteignit la petite flamme de la lanterne
crêpée !...
- Les morts sont lourds, avait murmuré M. Jamet, qui emportent avec eux
les tables de la tradition.
- Le chemin se refuse au départ ! avait dit Hélie.
Le départ !... Pour Hélie, Duhamel et Morin et pour quelques autres qui
avaient vieilli en compagnie de Mme Neuville, le départ n’impliquait
plus le retour… L’idée qu’ils s’en faisaient leur causait du malaise.
- A qui le tour ? persifla Duhamel.
Hélie n’entendit pas, mais une larme roula sur sa blouse empesée ; il
la secoua comme il eût fait d’une miette de son pain.
Le notaire fit l’éloge de la morte :
Elle n’avait pas augmenté son avoir. Elle laissait intact à ses
descendants le bien qu’elle avait reçu. D’ailleurs une exploitation
paysanne ne pouvait donner que l’aisance ; la richesse rapide avait des
origines différentes, incompatibles avec la stabilité et la simplicité.
Madame Neuville n’avait point commercé au-delà de son horizon.
- Elle représentait l’expérience et la sagesse rurales, interrompit
Jamet.
L’ingénieur parla de son aménité souriante ; de la manière colorée dont
elle recevait ses amis. Et Duhamel la représenta jeune, parée aux
dimanches comme on l’était dans ce temps là. Les modes étaient
régionales. Il n’y avait pas de chemin de fer pour diminuer les hauts
bonnets et rétrécir les crinolines. Il avait vu Neuville et sa femme à
cheval gagner la ville voisine. C’était loin !...
Mon grand-oncle, qui avait assisté à son mariage et aux principaux
événements de sa vie, en retraça les passages émouvants : la mort de
Neuville et celle de mon père. Hélie s’en souvenait : il l’avait vue
pleurer devant l’âtre et se plaindre sous les arbres.
Il dit encore qu’elle n’abandonna jamais son deuil, en aucune
circonstance, mais que sa peine s’atténua au contact de sa fille et aux
initiatives qu’elle prit pour amender sa terre et embellir sa maison.
Elle aimait les roses, les disputait aux courtilières, au gel, sans se
lasser. L’horticulteur nous désigna, dans l’allée qui menait au puits,
des rosiers qu’il lui avait apportés voilà plus de trente ans !... Son
jardin était son livre colorié comme l’Initiation à la Vie dévote de
saint François avait été son livre d’heures. Ses manies ne dépassaient
pas l’ampleur de sa petite table, et son tiroir, rempli de graines et
de quelques friandises, témoignait de la douceur de ses relais à
l’ordinaire de ses jours.
Et Morin, l’œil humide, se versa du cidre. Il se souvenait de gaietés
que sa belle-sœur avait eues à l’époque des semis, aux dîners de
Pâques. Une, entre autres, avait dérouté son entendement. Une année que
le cidre était de «
première » et qu’on avait servi le jus ambré,
orgueil du Clos Neuville : « Jurez-moi, avait-elle dit à Morin, que si
je meurs vous m’en verserez un barillet sur ma tombe !... »
Morin avait juré, et ce serment, maintenant, troublait sa conscience.
Machinalement, nous levâmes nos verres, et tandis que Harel et
Catherine servaient le bouilli, une pensée attendrie aimanta mes yeux
vers la fenêtre où se tenait ma grand’-mère. Je la vis en esprit donner
au clos le sourire de ses yeux apâlis et remarquai qu’elle avait laissé
au mur la patine de sa pose habituelle…
M. Jamet m’interrogea et je lui narrai quelques-unes des impressions
dernières de la défunte. J’en vins à rappeler qu’elle se plaignait que
de petites flammes la suivaient au jardin, qu’elle secouait le bas de
sa jupe pour s’en débarrasser.
- Les petites flammes ont été une réalité, me répondit Jamet : Madame
Neuville, qui pressentait sa fin, en exprimait le symbole sous sa forme
concrète. En définitive, les petites flammes ont brillé dans la maison
et au jardin, doublées aux lanternes de son cabriolet, elles se sont
multipliées sur son seuil et à l’église !... »
-
Tost allumees tost esteinctes !... appuya l’instituteur.
Je rappelai encore la grande confusion où la jeta le déboisement de la
Vallée. Un noble riverain, pour les besoins de son industrie, avait
abattu les peupliers centenaires qui bordaient la rivière et lui
faisaient un rideau somptueux de ses hauts fuseaux. Elle vit tomber, un
à un, les beaux arbres de sa jeunesse, et l’avilissement de son horizon
lui coûta des larmes.
A ce rappel, Duhamel s’anima : il ne regardait plus de ce côté. Au
premier arbre « assassiné », il avait jeté au noble sa démission de
garde.
Mettre à bas des peupliers centenaires, tout au plus propres à faire
des caisses à fromage !... Tous protestèrent. Un indigné ne craignit
pas de jeter l’anathème contre les industries naissantes de la région :
« A quoi prétendait, raccordée au réseau, la scierie de Beuvillers ?...
Est-ce que dorénavant les capitaux se grouperaient pour le déboisement
de la province ?... En pays forestier, soit, mais en Lieuvain, en Auge,
où l’arbre était parure, fonction du sol et de l’égalité des saisons
?... Est-ce qu’on allait démanteler le domaine, éventrer les chemins,
dépeupler la terre de ses chênes au profit du marchand de traverses et
de l’entrepreneur de Paris ?... »
Un peu timidement, l’ingénieur expliqua que le déboisement
des provinces était fatal : on devait répondre aux exigences de
l’industrie naissante. La prospérité de la France en dépendait.
Le progrès n’était pas un vain mot, redoubla le notaire. On avançait à
pas de géant vers le mieux. Au courant des travaux de Pasteur, il
préconisa l’application de ses découvertes à la fermentation du lait.
L’heure était venue pour les fromagers de le traiter scientifiquement.
- De la « physique » !... dit Harel.
Mais une récente invention s’adressait aux fermiers qui barattaient le
beurre. Ceux-ci ne connaîtraient plus l’attente à huitaine pour
recueillir dans leurs poëlons une crème rancie. Ils pouvaient, après
chaque traite, verser leur lait dans une « écrémeuse », en obtenir une
crème immédiate, fraîche et employable.
Catherine regarda le notaire avec des yeux hagards…
- Des expériences de traite à l’étable, continua le notaire, à
l’étonnement de la servante, ont démontré la possibilité de traire dix
vaches dans le même temps qu’on en trait une, au moyen de tétines où
l’on pratique le vide, de telle sorte que la vachère n’a qu’à
surveiller l’écoulement du lait qu’elle reçoit dans un récipient unique.
Le notaire est fou !... pensa Catherine.
- L’avenir est là !... conclut le notaire.
L’ingénieur, qui s’était contenu devant le notaire reprit : « Dans la
fromagerie que vous préconisez, vous installerez l’électricité. Il est
possible de capter la force potentielle d’une chute d’eau et de la
transporter, au moyen d’un câble, à une très longue distance. Cette
force motrice actionnera votre fromagerie, la presse et l’arbre de
votre pressoir. Notez que le même câble animera, dans la vallée, le
rebord de la route pour le transport des voyageurs et des marchandises.
» A la vérité, le trolley et le rail sont hideux, ils déshonorent le
paysage ; ils n’en sont pas moins la démonstration évidente d’une force
agissante à très lointaine portée. Ils deviendront une nécessité…
- Electorale ! chevilla M. Jamet.
- La traction nous réserve l’étonnement, appuya l’ingénieur. Le moteur
à essence, de minuscule dimension, est trouvé. Demain il s’adaptera à
des véhicules de toutes sortes, dont la forme et les organes restent à
harmoniser, mais dont la vitesse ne trouvera d’obstacles que dans
l’étroitesse de la route et la profusion de ces voitures sans chevaux.
» Ne doutez pas, continua l’ingénieur des ponts-et-chaussées, que le
petit moteur modifiera les chemins du monde, voire les routes de l’air,
qu’il y trouvera son appui, indifférent à la « rose des vents »…
Le silence régna. A l’exception du notaire et de M. Jamet, aucun de
ceux qui étaient là n’était préparé à tant de science et de nouveauté.
Ils ne comprenaient pas les termes techniques de l’ingénieur, mais tous
sentaient un danger dans la foi du néophyte et dans son éloquence un
témoignage indéfinissable de rupture au chaînon de leurs habitudes…
Cependant un sourire sceptique plissait la lèvre des hommes mûrs. Les
plus âgés, désorientés, demeuraient sans pensée. Je saisis en des yeux
hostiles le signe d’une révolte bridée, soudaine et sourde.
- Nous sommes au moment, reprit l’ingénieur, où les capitaux doivent se
rassembler pour l’exploitation intensive de toute matière usinable. Ce
que ne pourra le particulier, la société anonyme l’entreprendra.
L’Amérique créait des villes autour de ses mines de fer, l’Angleterre
autour de ses charbonnages ; l’Allemagne obstinée, scientifique et
pratique, tirait parti de tout. Et puisque des études récentes avaient
repéré en Normandie les mines de charbon du Pays de Galles et que chez
nous le minerai de fer était en abondance, il fallait se hâter et
obtenir les concessions de l’Etat qui, seul, disposait du sous-sol.
- Comment ?... dit quelqu’un, le sous-sol appartient à l’Etat ?
- Le sous-sol et le sol, répondit le notaire, si le but est d’intérêt
général.
Ce fut de la stupeur !
- Alors ? La propriété était une fiction ?...
Et ceux qui, sans le savoir, avaient du minerai sous leur «
table »,
pouvaient être dépouillés au bénéfice de concessionnaire ?
- Oui, dans l’intérêt général, répéta le notaire.
- Non ! interrompit Jamet ; dans l’intérêt d’un petit nombre ; pour
quelques-uns, la richesse indécente quand l’entreprise réussit, et,
pour tous, l’inquiétude et la honte, quand l’entreprise échoue !...
Il ne manquait plus que l’exploitation minière pour souiller la face du
ciel et des hommes.
Et, par succession d’images, ces gens de la Vallée adorable,
tremblèrent sur leurs bases, menacés au-dessous de leur argile
végétale. Ils virent la scierie échancrer leur horizon, le mur de la
fromagerie s’édifier dans les fermes, leurs méthodes périmées, et,
jusqu’à la grâce isolée de leurs routes avilies par le rail !...
Et ce fut pour eux une seconde mort qu’ils trouvaient à la table !...
En somme, au nom de progrès scientifiques, on désaxait leur équilibre
économique et l’on souillait de la lèpre usinière le cadre de leurs
mœurs.
Quoi plus ?...
- Quoi plus ? dit Jamet en se levant, la séparation des Eglises et de
l’Etat ! Elle était dans l’air. Elle constituerait un progrès politique
!...
- C’est la fin du bon monde ! s’écria Duhamel.
- Le commencement d’une ère ! répartit l’ingénieur.
- Une course à l’abîme ! conclut Jamet.
- Manquablement, soupira Hélie, qu’la maîtresse a ben fait de mouri… !
Le soir tombait sur la neige. Dehors, nous vîmes une chose étrange :
haut sous nuées, du levant au couchant, un
volier de corbeaux barrait
le ciel de son ruban funèbre… D’où venaient tant de choucas ? Où
allaient-ils ? Où se déviderait ce volier sans fin, augural et muet ?
Et pourquoi vers le crépuscule ?