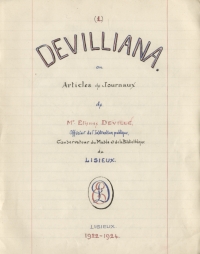Chroniques du « Journal de
Rouen »
___
29 septembre 1922
___
Le Pèlerinage du Mont
A TRAVERS LES SIÈCLES
Les travaux de restauration opérés au Mont
Saint-Michel par les soins de la commission des Monuments historiques,
ont rendu à l’abbatiale archangélique
son antique beauté. Voici que la vie spirituelle, un moment
suspendue dans ce grand corps sans âme, vient d’y
reprendre son cours normal. Le Mont Saint-Michel au péril de
la mer retrouve, dans la splendeur des pompes liturgiques, son
éclat des anciens jours.
La date du 29 septembre 1922 restera à jamais
mémorable dans les annales du célèbre
sanctuaire, et l’affluence nombreuse, accourue de tous les
points de la Normandie, rappelle un instant le souvenir de ces longues
théories de pèlerins qui, religieusement,
s’ébranlaient autrefois à travers la
mélancolique étendue de ses grèves.
L’institution des pèlerinages montois est
contemporaine des premiers miracles qui consacrèrent la
réputation du culte de l’archange sur le mont
Tombe. Les vieux légendaires de la bibliothèque
d’Avranches nous ont conservé de naïfs
récits que les scribes du couvent transcrirent pour
l’édification des fidèles. Des prodiges
se sont accomplis dans cette église ; des malades y
ont recouvré la santé ; des aveugles,
des sourds et des muets, la vue, l’ouïe et la parole.
Dès le XIe siècle, des confréries
s’établirent en Normandie sous le vocable de
l’archange ; elles avaient pour but
l’ensevelissement des morts. Faut-il en voir
l’origine dans le récit que la
Légende
dorée a consacré à un
pèlerin de Lorraine, se rendant à Compostelle,
qui mourut près du Mont Saint-Michel et fut miraculeusement
transporté à Saint-Jacques par
l’apôtre lui-même, scène dont
le souvenir est conservé dans le tympan d’un
vitrail de l’église Saint-Jacques de
Lisieux ?
A l’origine même de la fondation du
monastère, le roi Childebert III y vint en
pèlerinage l’an 710. Ce fut, dit un vieil
historien, la première tête couronnée
qui « humilia son front devant l’autel
élevé sous l’invocation du prince de la
milice céleste. »
Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre,
prédécesseur immédiat du
Conquérant, visita fréquemment le Mont. Harold,
qui disputa à Guillaume la couronne d’Angleterre,
y fut envoyé comme ambassadeur du roi Edouard. Il accompagna
le duc de Normandie à l’abbaye,
venerunt ad
montem Michaelis, dit la Tapisserie de Bayeux.
Au commencement du XIIe siècle, le duc Robert, revenant de
Terre Sainte, y vint rendre grâce à Dieu avec
Sibille sa femme. Ce fut alors l’époque des plus
magnifiques pélerinages et les animosités les
plus grandes se calmèrent au pied de ses autels :
Saint Thomas Becket, Henri II d’Angleterre et le roi de
France en visitant le sanctuaire de l’archange ne pensaient
qu’à la réconciliation,
tanta erat
temporis pietas et concordia, dit Robert du Mont, qui fut un des
témoins de cette royale visite en 1158.
Puis ce furent Saint-Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Charles
VI, Louis XI qui vint plus d’une fois à
l’abbaye et le gratifia d’importantes
largesses ; François Ier en 1518 et 1532 ;
Charles IX et son frère Henri en 1561. Ce fut par ordre de
ce dernier que le célèbre historien de Thou vint
au Mont en 1580 et en fit la description.
En l’année 1210, le roi Philippe-Auguste fonda
à Paris la confrérie de Saint-Michel en une
chapelle dédiée à l’archange
dans la cour du palais de la Cité. Il existait
même certaines hôtelleries qui
hébergeaient les pauvres pèlerins et les enfants,
qui y trouvaient les ressources nécessaires pour continuer
leur pèlerinage. On se fera une idée du nombre de
ces pèlerins quand on songe que du 1er août 1368
au 25 juillet 1369, l’hôpital de la
confrérie de Saint-Jacques, à Paris,
hébergea 16,690 pèlerins qui se rendaient au Mont
ou qui en revenaient.
C’est en 1333 que commencèrent ces fameux
pélerinages d’enfants qui devaient se continuer
pendant plus d’un siècle. Un auteur anonyme,
contemporain des faits qu’il raconte, entre à ce
sujet dans de minutieux détails, que je suis dans la
nécessité de résumer.
Dans ce temps-là, dit-il, notre église vit
arriver, de près et de loin, une innombrable multitude
d’enfants qu’on appelait
pastoureaux. Les uns
venaient en bande, les autres isolément. Beaucoup assuraient
avoir entendu des voix spirituelles qui leur disaient :
Va au
Mont Saint-Michel, et alors l’ardeur du désir les
faisait trembler de tous leurs membres. Ils laissaient dans les champs
leurs habits et leurs troupeaux et se mettaient aussitôt en
marche sans en informer ni maîtres ni parents. Nous avons vu
un prêtre dont les paroissiens furent saisis de cette subite
dévotion : bien que sa maison ne fut pas
éloignée, il n’eut pas le temps
d’y entrer.
Un autre exemple n’est pas moins singulier, c’est
celui d’un forgeron qui laisse son fer chaud sur
l’enclume pour se mettre en route.
Rien ne pouvait retenir les pastoureaux ; dans le
diocèse de Séez, près
d’Ecouché, deux jeunes gens brûlaient de
partir pour le Mont ; leurs parents, pour les en
empêcher, les enfermèrent. Peu après,
le père ayant ouvert le cachot, ne trouva que deux corps
inanimés ; leurs mains se dressaient vers le ciel
comme s’ils étaient morts en invoquant Saint
Michel.
Le zèle des petits pèlerins dut
s’accroître au bruit de certains miracles que Dieu,
disait-on, opérait en leur faveur.
A Mortagne, un homme ayant voulu empêcher le
départ de plusieurs enfants, perdit immédiatement
l’usage de la parole.
A Sourdeval, trois maçons se moquaient des
pastoureaux : à les entendre,
c’étaient des victimes de l’art des
magiciens et des enchanteurs. La punition de ces railleries ne se fit
pas longtemps attendre ; un mal subit les frappa tous les
trois et, pour s’en délivrer, ils durent se vouer
à Saint-Michel.
Pressés par le besoin, quelques-uns de ces enfants
cueillaient des cerises dans le jardin d’un nommé
Féret ; le propriétaire les chasse
brutalement ; mais étant monté dans un
arbre, il tombe à terre et périt de cette chute.
Dans un lieu nommé Dyssie, une bande de treize pastoureaux,
qui venaient de pays éloignés,
achetèrent pour leur repas un pain du prix de deux petits
deniers tournois ; ils s’en nourrirent tous et il en
resta même de nombreux morceaux.
Après avoir longuement raconté ces miracles, le
bon moine termine par cette réflexion :
« Beaucoup de pastoureaux nous ont dit que cette
dévotion les prenait tout à coup, et avec une
telle force qu’aussitôt ils partaient, dans
quelqu’état qu’ils se trouvassent et
quelle que fût la longueur du chemin à parcourir.
D’où provenait ce mouvement ? Pourrait-on
en attribuer la cause à un autre qu’au Seigneur,
qui se cache aux savants et se manifeste aux petits et aux
humbles ? »
Les pèlerinages du XVe siècle offrirent des
circonstances encore plus singulières. Ils furent entrepris
par des enfants des Flandres et des bords du Rhin. (1)
En1457, nous apprend le moine historien Jean Huynes, il vint
d’Allemagne si grande quantité d’hommes,
de femmes et d’enfants si jeunes que plusieurs
n’avaient point encore atteint l’âge de
neuf ans. L’histoire d’un de ces jeunes
pèlerins raconte que, le 2 mars 1457, un enfant de neuf ans,
nommé Nicolas, fils de Pierre le Pellier, du
diocèse de Liège, fut pris du désir de
voir le Mont Saint-Michel. Il demanda à son père
la permission de se joindre à une bande qui partait. Le
père refusa, mais promit de le mener au Mont dans deux ans.
Cette réponse calma l’enfant. Mais peu
d’instants après il vit passer trois
pèlerins de son âge, alors il ne peut
maîtriser son désir et se joint à eux
sans prévenir son père. Celui-ci se lance
à sa poursuite et le rejoint à la porte de la
ville. Dans sa colère, il le prend par les cheveux en
proférant des blasphèmes, mais au même
instant il tombe mortellement frappé par la vengeance
divine. L’enfant continua sa route et, après 24
jours de marche, il arriva au Mont avec une troupe de trente
pèlerins.
Ce religieux entraînement s’était en un
instant communiqué à tout le Brabant,
à la haute et à la basse Allemagne, à
tel point que les pèlerins avaient de la peine à
trouver des vivres sur leur route. Ces migrations alarmèrent
les hommes sages des bords du Rhin, et les docteurs se mirent
à l’oeuvre pour arrêter ce
mouvement. Un des savants les plus réputés de
cette époque, Denis de Rietrel, plus connu sous le nom de
Denis le Chartreux, écrivit à cette occasion un
curieux traité intitulé
Epistola de cursu
puerorum ad sanctum Michaelem. On ignore l’influence de
cette épître sur les masses dont elle voulait
détruire les illusions ; toujours est-il
qu’après 1460, on ne trouve plus trace de ces
pèlerinages.
Les pèlerins avaient l’habitude
d’emporter quelque souvenir du lieu qu’ils avaient
visité. Dès le Xe siècle, les
pèlerins du Mont Tombe arrachaient des pierres aux murs de
la collégiale ou détachaient quelque fragment de
l’autel de saint Aubert, à tel point que les
chanoines durent s’opposer à ces
déprédations. Les pèlerins se
contentèrent alors de petits morceaux de granit du rocher,
du sable de la montagne ou des coquilles des grèves. Ce fut
à ce moment qu’on moula, en plomb et en
étain, ces petites enseignes destinées
à être cousues sur le vêtement des
pèlerins. La coquille devint l’emblème
du sanctuaire de l’archange, et Louis XI en orna le collier
de l’ordre célèbre des chevaliers de
Saint-Michel, qu’il fonda en 1469.
On peut voir au musée de Cluny, dans la belle collection de
plombs historiés trouvés dans la Seine,
formée par Arthur Forgeais, un certain nombre de ces
curieuses enseignes du pèlerinage montois.
Lorsque l’abbaye fut transformée en prison, les
foules pieuses allèrent faire leurs dévotions
dans l’église paroissiale ; mais
lorsqu’en 1865 les bâtiments de l’abbaye
furent loués à
l’évêque de Coutances,
l’ère des pèlerinages
s’ouvrit à nouveau. Ceux de 1865, 1867, 1875 sont
à retenir, ainsi que les solennités du
couronnement de la statue de l’archange, le 4 juillet 1876.
Pour compléter l’oeuvre de restauration,
il faut maintenant détruire la digue insubmersible qui a
fait perdre au Mont, son caractère quasi
mystérieux. Il faut rouvrir la voie aux vagues de la mer, et
leur permettre de revenir se briser sur le roc inébranlable
où se dresse la Merveille.
NOTE :
(1) Voir Etienne DUPONT : Les Pèlerinages
d’Enfants allemands au Mont Saint-Michel, Paris 1907, 1
brochure in-8°.
____
13 octobre 1922
____
L’Art de Terre à Manerbe
et au Pré d’Auge
A PROPOS
de l’Exposition des Arts appliqués de Caen
L’Exposition organisée à Caen par les
soins de la Région économique et le
Comité régional des arts appliqués de
Basse-Normandie, a permis de constater que la céramique
décorative est encore en honneur dans notre province.
Les tuileries normandes de Caen, du Maizeret et de Bavent, les
fabriques de Subles, de Noron et de Bayeux ont exhibé des
pièces très intéressantes et
très artistiques, rappelant les plus belles productions de
l’âge d’or de la céramique
normande.
Emaux polychrômes à grand feu, épis,
frises, métopes, tuiles, poinçons, abouts de
poutre, statuettes, animaux, vases à reflets
métalliques, grès délicatement
ouvrés ont, tour à tour, excité la
curiosité des visiteurs et des gens de goût. Bien
peu se sont doutés que toutes ces pièces aux
couleurs chatoyantes n’étaient qu’une
réminiscence d’un art qui fut jadis
très prospère en notre région, alors
que des fours de Manerbe et du Pré d’Auge
sortaient ces superbes épis, ces jolis pavés et
cette vaisselle de terre qui provoquait l’admiration
d’un vieil historien normand, Gabriel Dumoulin, qui en
parlait ainsi en 1631 : « On fait en
Normandie de la poterie en beaucoup de lieux et à Manerbe,
près de Lisieux, des vaisselles de terre qui ne
cèdent en beauté et en artifices à
celles qu’on nous apporte de Venise ». En
1667, Du Val pouvait encore écrire :
« La plus délicieuse contrée
de la Normandie, où l’on fait de la vaisselle de
terre plus belle qu’ailleurs ».
L’histoire de la céramique de Manerbe et du
Pré-d’Auge est très peu connue. Les
rares auteurs qui lui ont consacré quelques lignes,
l’ont fait avec une brièveté et un
laconisme que beaucoup d’érudits ont
imité.
Après Rever, étudiant en 1826 les
pavés émaillés de Calleville (1),
Raymond Bordeaux (2) est le premier à signaler
l’intérêt de cette fabrication dont on
ne s’occupa guère dans la première
moitié du XIXe siècle. En 1885, M. de
Mély essaya de déterminer l’origine de
la majolique française dans un curieux article de la
Gazette des Beaux-Arts (3). Plus tard, en 1902 et 1904, un
érudit avocat de Pont-Audemer, A. Montier, étudia
les pavés du Pré-d’Auge et de Lisieux
et les épis de faîtage (4). Ces derniers travaux
ne sont surtout que des descriptions d’oeuvres,
suivies d’un essai de classement.
Les origines de la céramique à Manerbe et au
Pré-d’Auge sont très anciennes et
semblent bien devoir être reportées à
l’époque gallo-romaine. Des fouilles
pratiquées à divers endroits de ces deux villages
ont amené la découverte de fragments de vases
d’une antiquité indiscutable ;
malheureusement on ne possède aucun document
écrit pour ces périodes lointaines. Il nous faut
arriver au moyen-âge pour rencontrer quelques textes
importants sur ce sujet.
M. de Mély a écrit que l’industrie de
la poterie se serait implantée à Manerbe vers
1375, après la fermeture des ateliers du Molay. Je ne
partage pas tout à fait l’opinion de mon savant
compatriote et j’estime au contraire que l’art de
terre n’a pas cessé d’être en
honneur à Manerbe et au Pré-d’Auge
depuis l’occupation romaine, certains pavements sembleraient
confirmer cette opinion. Nous savons notamment qu’en 1361,
Robinet Guernin, potier de l’évêque de
Lisieux, vend à Robert Delamare son titre de potier de
l’évêque à cause duquel il
jouissait d’un singulier prestige : celui de vendre
seul de la poterie dans l’étendue de la ville et
banlieue de Lisieux, excepté pendant la foire Saint-Ursin,
qui commençait à la « vigile
de ladite feste à l’heure de None et tout le jour
d’icelle à heure de soleil
coussant ». En 1418, Guillaume Coquerel
était pourvu de cet office. En échange de ce
privilège, ils étaient tenus de fournir la
vaisselle de terre de la salle à manger du prélat
le jour de son entrée dans sa ville épiscopale.
Il est regrettable que le cartulaire de l’abbaye du
Val-Richer ait été détruit en 1793, il
nous eût certainement fourni de précieuses
indications, surtout pour le XIIIe siècle.
Pendant les XIVe et XVe siècles, ce fut principalement la
fabrication du pavé figuré et de la tuile qui
alimenta les fours du Pré-d’Auge
jusqu’au moment où la fabrication savante fit
place à l’industrie de la poterie.
A l’époque de la Renaissance, une influence
étrangère se manifeste dans les productions. Il
est probable qu’à la suite des
expéditions au-delà les Alpes, des artistes
furent ramenés par de grands seigneurs et
s’établirent dans nos contrées. La
technique changea alors, les motifs décoratifs ne sont plus
les mêmes, et, certains rinceaux, que j’ai vus dans
les restes d’anciens vitraux de l’église
de Manerbe, dont le choeur fut reconstruit en style ogival, en
1513-1514, trahissent une influence nettement italienne.
Sans vouloir toucher à la grande place que Bernard Palissy
occupe à si bon droit, sans chercher à lui
enlever aucun mérite, il faut bien reconnaître
qu’au milieu du XVIe siècle, lorsque les
échos des succès du grand artiste parvinrent aux
ateliers de Manerbe et du Pré d’Auge, nos artisans
normands s’inspirèrent résolument du
maître. Leurs productions sont classées par les
historiens de la céramique - qui se sont montrés
bien peu curieux dans la circonstance, - sous
l’étiquette « suite de
Palissy ». Bon nombre de ces pièces ont
même été vendues comme des oeuvres du célèbre potier.
« Ce qui distingue au premier coup
d’oeil les ouvrages du Pré
d’Auge de ceux de Palissy, c’est que les
émaux sont plus froids et rosés avec
sècheresse partout où l’on rencontre du
jaspé, les taches en sont petites,
arrêtées, non parfondues ».
Cette citation, que j’emprunte à Jacquemart, ne
doit pas être prise à la lettre, et plus
d’une pièce du Pré d’Auge,
par le fini de son dessin, la richesse de sa couleur et de son
émail peut être mise en parallèle avec
les « rustiques figulines ».
Avec le XVIIe siècle, la fabrication des épis
disparaissant, nos potiers s’attachent surtout à
la fabrication du pavé, du pavé Pré
d’Auge et du pavé de Lisieux, dont je parlerai
plus loin. Elle se poursuit jusqu’au XVIIIe siècle
et la décadence commença à cette
époque. C’est alors que sortirent ces
amortisements vernis au plomb qui remplaçèrent
les épis émaillés et dont la
composition, moins élégante et moins savante,
n’est cependant pas dépourvue d’art.
C’est de cette époque que datent ces nombreuses
fontaines-lavabos, à la glaçure ou vernis en
plomb, procédé connu des potiers gallo-romains.
Il en est de fort belles avec des ornements en reliefs et
j’en sais une portant la signature de
« Jacques Vatier du Pré d’Auge
1771 ».
Les archives du tabellionnage de Lisieux, mises à ma
disposition par Me Cailliau, notaire, que je tiens à
remercier de son obligeance, m’ont permis de retrouver un
certain nombre de noms de potiers, mais peu de renseignements sur leurs oeuvres. Ce sont des actes de la vie courante où
les potiers interviennent pour opérer des transactions,
faire des achats ou des ventes, des partages ou des traités
de mariage.
Très souvent, le tabellion omet d’indiquer la
profession des intéressés, en sorte que beaucoup
de noms échappent, surtout pour les périodes
anciennes.
Deux noms dominent surtout dans l’histoire de la
céramique de Manerbe et du Pré d’Auge,
les Bocage et les Vattier. Un Colin Bocage apparaît en 1499
dans un partage de biens, ce qui prouve que cette famille
était établie au Pré d’Auge
depuis déjà longtemps. Un autre, du
même nom, fournit, en 1527, de « la brique
et le pavey pour la maison de nouveau édifiée
à la fabrique Saint-Pierre » de Lisieux,
et plus tard, le 27 août 1562, Thomas Bocage vend du
« pavé figuré pour paver
devant le maistre autel » de la
cathédrale, à raison de 65 sols le mille. En
1576, Jacques, fils Thomas, fait une nouvelle
« livreson de six centz de pavé
figuré pour paver à l’église
près la tombe de Mons. de la
Houblonnyère ». Cette famille
s’est perpétuée au Pré
d’Auge jusqu’à nos jours. De
même les Vattier, dont le premier que je connaisse est un
certain Robin Vattier qui vend deux pièces de terre en 1501.
Cette famille prit une telle importance par la suite que leur nom est
demeuré à un des hameaux du Pré
d’Auge.
Je citerai encore Robert Bence « potier de la
paroisse de Manerbe », cité dans des
actes de 1537 et 1564 ; Pierre Castelain,
« du mestier de potier de
terre », du même lieu, 1528 et
1540 ; Pierre Coquerel, 1534 ; Guillaume Huchon et
Robin Moullin, « thuilliers de Manerbe,
1554 ; Charles Vitet, 1556 ; Jehan Logres,
« tuilier de la tuilerye du
Val-Richer », 1571 ; Guillaume Fiquet, 1752
et Antoine Gosset, 1765.
A Manerbe, le nombre des potiers devait être
élevé au milieu du XVIe siècle puisque
dans un acte du 25 mai 1534, se trouve, comme abornement
d’une propriété, la
« rue des Potiers ».
Au commencement du XIXe siècle, il y avait encore au
Pré d’Auge 42 potiers et une trentaine de noms
figurent encore dans le recensement de 1816. A partir de 1880, les
fours s’éteignirent à Manerbe et au
Pré d’Auge et, actuellement, il ne reste plus
trace de ces établissements qui eurent pourtant leur heure
de célébrité.
Les débuts de ces ateliers furent la fabrication exclusive
de la tuile et du pavé. La tuile, de grand moule et de petit
moule, était vernissée par un bout, de couleur
jaune, rouge, verte ou brune, permettant sur les toits
d’élégantes combinaisons
géométriques. Les premiers pavés
furent, non pas émaillés, mais
vernissés, les dessins faits d’une
légère engobe de terre blanche sont
incrustés dans la terre rouge suivant l’ancien
procédé de sigillation employé par les
Babyloniens pour leurs briques, et recouverts d’une couche
vitreuse incolore à laquelle certains oxydes
métalliques ont donné parfois une couleur verte
ou jaune. Cette fabrication se développa
rapidement ; les paysans aisés et les bourgeois ne
se contentant plus de l’aire en terre battue pour leurs
demeures, ils les firent carreler et recherchèrent
dès lors la variété dans la
décoration de ces pavages.
Tantôt, c’est un carreau à fond rouge
avec décor d’engobe blanche ;
tantôt à fond blanc et engobe laissant en
réserve le décor qui apparaît de la
couleur rouge de la terre.
En examinant une série complète de
pavés du Pré d’Auge, on peut suivre la
marche du goût public, chaque siècle ayant pour
ainsi dire, laissé l’empreinte de son passage par
ces modestes carreaux de terre cuite.
Au XVe siècle, l’influence gothique se fait encore
sentir et la fleur de lys règne en souveraine avec les
marguerites et les fleurettes.
Au XVIe siècle apparaissent les palmettes, les combinaisons
variées de rinceaux et de ferronnerie. Vers la fin du
règne de Louis XIV, l’influence de Le Brun et de
Boule s’exerce. On voit alors se produire une foule de
combinaisons de lignes droites ou courbes, de rinceaux, de palmettes,
de feuilles refendues, de volutes, de noeuds,
d’entrelacs et d’enroulements.
Vers le milieu du XVIIe siècle, un potier du Pré
d’Auge qui avait travaillé à Rouen,
Joachim Vattier, imagina de fabriquer des pavés de
faïence à dessins symétriques et
revêtus du plus bel émail blanc, bleu, jaune, vert
ou brun. On les connaissait sous le nom de
« pavés Joachim » ou
« pavés de Lisieux ».
Leur vogue fut telle que non seulement les châteaux et les
manoirs normands, mais encore le Trianon de porcelaine à
Versailles, détruit en 1685, furent revêtus de ces
brillants carrelages.
Quelques-uns de ces pavés portent, au-dessous, une croix
à quatre feuilles estampée dans la
pâte, c’est la marque de Joachim Vattier, qui
semble l’avoir réservée aux
pavés de choix.
En 1770, un sieur Dumont établit à Rouen une
fabrique de pavés de Lisieux qui fonctionna
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Durant les Xve et XVIe siècles, les fours de Manerbe et du
Pré d’Auge approvisionnèrent les
châteaux et les manoirs de ces beaux épis de
faîtage dont la majestueuse élégance
complétait si bien la décoration. Les artisans
qui modelèrent ces pièces superbes
étaient de véritables artistes et nos modernes
tuileries font bien de s’inspirer de ces modèles
que les collectionneurs et les musées recherchent
aujourd’hui avec empressement.
Cette effervescence artistique diminua bientôt ; la
mode des épis passa et, à la fin du XVIe
siècle, ils furent remplacés par des motifs
décoratifs répondant mieux au goût du
jour.
L’activité des potiers ne s’en tenait
pas là, ils modelaient aussi des statues religieuses et
profanes, le Christ de l’église du Pré
d’Auge, le groupe de Sainte Anne et de la Vierge dans
l’église de Saint-Ouen-le-Pin et les superbes
décorations du château des Loges et de ses
jardins, résidence d’été des
anciens évêques de Lisieux. Comment ne pas citer
aussi ces plats et ces soupières à
décors en relief à l’instar des oeuvres de Palissy. Un érudit lexovien,
Arthème Pannier, en a décrit un certain nombre
que l’on rencontrait encore dans les fermes aux environs de
1860. J’ai recueilli, pour le musée de Lisieux,
des fragments de vaisselle de terre dont la faïence actuelle
n’approche pas comme
légèreté et finesse. Ces fragments,
trouvés à Manerbe, au village de la Closetterie,
confirment pleinement l’opinion de Gabriel Dumoulin.
Aujourd’hui, on ne trouve plus rien de cette brillante
époque. Seules des oeuvres de décadence,
des objets usuels : bénitiers, fontaines, plats,
poissonnières, soupières, bassinoires, passoires,
bouteilles, cruches et vases divers, tous de couleur
uniformément verte à reflets
métalliques, se rencontrent encore chez les antiquaires et
les brocanteurs de la région qui leur assignent une valeur
assurément exagérée.
En 1879, MM. Tissot et Loutrel essayèrent vainement de faire
revivre cette fabrication qui occupe une place importante dans
l’histoire de la céramique ornementale. Il y
aurait pourtant quelque chose à faire en ce sens, la
matière première existant toujours à
profusion dans le pays.
Puisque le goût a ramené l’usage des
épis de faîtage, ne pourrait-on pas rallumer de
nouveaux fours à Manerbe et au Pré
d’Auge et y ressusciter cet art de terre qui porta si loin la
renommée de ces petites localités.
NOTES :
(1) Dans Mémoires de la Société des
Antiquaires de Normandie, 1826, p. 183.
(2) Dans Bulletin monumental, t. XIII, 1848, p.629.
(3) Les origines de la majolique française, dans Gazette
des Beaux-Arts, 1885, p. 229-250.
(4) Notice sur les pavés du Pré d’Auge
et les pavés de Lisieux. Paris, 1902, in-8. Etude de
céramique normande. Les épis du Pré
d’Auge et de Manerbe. Paris, 1904, in-8.
____
23 octobre 1922
____
Les Origines
du Collège de Lisieux
L’origine du Collège de Lisieux remonte
à l’année 1571, et fut la
conséquence logique de l’ordonnance royale de 1561
qui décidait que, dans les villes épiscopales de
plus de dix prébendes, les officiers municipaux pourraient
se faire délivrer le revenu d’une
prébende vacante pour l’affecter à
l’entretien d’un précepteur devant
instruire gratuitement les jeunes gens de la ville.
Les conseillers municipaux de Lisieux demandèrent
à l’évêque
l’application de cette ordonnance en réclamant le
revenu de la prébende de La Chapelle-Hareng, vacante depuis
1567.
Formeville,
Histoire de
l’Evêché-Comté de Lisieux,
t. I., p. 325 a résumé l’historique de
cette affaire, et il semble bien avoir en connaissance des actes de
1571, dont j’ai retrouvé les minutes et dont les
archives municipales possèdent des copies du XVIIIe
siècle, mais il n’a pas extrait de ces actes tous
les renseignements qui s’en dégagent.
L’instruction de la jeunesse a fait l’objet de la
sollicitude du clergé du moyen-âge, mais aucun
établissement scolaire proprement dit
n’apparaît à Lisieux avant 1568,
année où le corps municipal, d’accord
avec l’évêque et le Chapitre, avait
acquis une maison pour les études, rue Pont-Mortain. Deux
ans plus tard, une maison appartenant au sieur Rufin, de
Valsemé, sise près de
l’Hôtel-de-Ville, grand’rue, avait
été achetée pour servir de maison
d’école, mais ces fondations ne paraissent pas
avoir été de longue durée.
En exécution de l’ordonnance de 1561, les
conseillers de ville avaient demandé une prébende
à l’évêque, mais ce dernier
avait fait la sourde oreille. L’affaire fit l’objet
d’un procès qui se termina par une sentence du
lieutenant du bailli d’Evreux au siège
d’Orbec, 5 janvier 1569, condamnant
l’évêque à
délivrer la prébende en litige ou une autre
d’égale valeur, et de payer, en attendant
l’exécution, une rente de 250 livres par an.
Ce ne fut que deux ans plus tard que
l’évêque se décida
à traiter avec les conseillers par un accord, et
à s’en « aller hors de
procès », dit le texte de
l’appointement survenu.
Ce fut le jeudi 4 janvier 1571, devant Olivier Carrey et Jacques
Eveillechien, tabellions royaux à Lisieux, que se
réunirent
« Révérend père en
Dieu messire Jehan Le Haynuyer, docteur en théologie,
conseiller et premier omosnier du Roy »,
évêque et Comte de Lisieux, d’une part,
et Robert Lefèvre, Michel Le Bezeur, conseillers de ville,
assistés de Alexis Desboys, procureur, Guillaume Mauduit,
Pierre Ledoulx, Jehan Costait, Jehan Lemyre, Jehan Depagny et Nicole
Thorel, bourgeois de Lisieux.
L’évêque se soumit à la
sentence de 1569 et exposa les raisons qui l’amenaient
à cette conclusion :
« Désirant la création
d’un collège en lad-ville pour le bien
d’icelle et du pays et que les précepteurs et
régens puissent avoir moien de vivre et entretenir pour
l’instruction et éducation de la
jeunesse. »
C’est la première fois que le mot
« collège » est
prononcé.
L’acte est passé au palais épiscopal,
en présence de Me Robert Bourdon, Pierre Marest, charpentier
et Me Joseph Lemyre, requis en qualité de témoins.
Cette convention ne tarda pas à être mise en
exécution puisque, quatre mois plus tard, le vendredi 4 mai
1571, devant les mêmes tabellions, Jacques de Boucquetot,
seigneur de Coquainvilliers et noble demoiselle Perrette de Recusson,
sa mère, rendent « aux habitans en
général, corps et hostel commun de la ville de
Lisieux », représentés par
Guillaume Mauduit, Guillaume Deraines, Robert Lefèvre,
conseillers, Alexis Desboys, procureur de la ville, et Guillaume
Beaufils, receveur des deniers communs, commis et
députés pour traiter cet achat, par le conseil de
ville dans sa séance du 22 avril
précédent.
L’immeuble vendu est ainsi désigné dans
l’acte : « Ung manoir, maisons,
mazure, de fondz à comble, court, jardin,
héritaige, droictures, préémynences et
libertés à ce appartenant, comprins le boys,
thuille, et aultres choses d’une maison par cy devant faict
abatre par led. sieur de Coquainviler, partie dud. manoir, ainsy que le
tout se contient et pourporte, nommé le manoir de
Coquainviler, assis en la paroisse sainct Germain de Lisieux, en la rue
au Boutillier jouste, d’un côté, la rue
au Boutillier ; d’autre côté,
Robert Lambert, sieur d’Herbigny et plusieurs
autres ; d’un bout, le jardin et héritage
de lad. ville de Lisieux et d’autre bout maistre Jehan
Duprey, licencié en médecine. »
La destination de l’immeuble est nettement
déterminée : «
pour
faire ung collège dellibéré estre
faict en lad. ville ». Le manoir de Coquainvilliers
fut acquis moyennant le prix de 1.500 livres, dont le receveur de la
ville paya la moitié comptant.
L’évêque avait fourni 500 livres et les
750 livres restant dues, devaient être soldées par
la ville, au jour de Noël prochain venant. En cas de
non-paiement, la ville s’était engagée
à constituer une rente de 75 livres pour garantir le solde
de l’acquisition.
Le lieu où l’acte a été
passé n’est pas indiqué. Les
témoins présents furent Robert Leboullenger,
avocat à Lisieux, et Michel Legouil, d’Avernes.
Moins d’un siècle après, en 1683, ce
collège, en pleine décadence, fut repris par les
Eudistes.
Quant aux bâtiments, ils subsistèrent,
à peu près dans le même
état, jusqu’en 1850, date à laquelle la
partie bordant la rue fut remplacée par les constructions
actuelles de la Providence.
____
30 octobre 1922
____
UN GRAVEUR NORMAND
Emile Vaucanu
1864-1894
Il y a quelques mois, dans ce journal, Georges Dubosc attirait
l’attention sur un artiste de grand talent, fauché
en pleine activité dans des circonstances tragiques qui
ajoutent un dramatique intérêt à sa
carrière si courte, cependant si laborieuse et si
féconde.
Il s’agissait de fournir, à des amis
fidèles que Vaucanu a laissés en Auvergne, les
éléments d’une biographie
destinée à paraître dans
l’
Annuaire de Brioude.
Répondant à l’appel de mon savant
confrère, j’ai adressé à
Brioude quelques notes et documents pouvant servir de commentaire
à la publication de certaines oeuvres de
l’artiste. La place restreinte dont disposent les
éditeurs de l’
Almanach de Brioude ne leur
permettant pas d’entreprendre une biographie de Vaucanu,
l’occasion m’a paru propice de rappeler la vie de
ce graveur qui fût devenu célèbre si la
mort n’était venue, à
l’aurore de sa carrière, anéantir les
légitimes espoirs que son oeuvre faisait
déjà pressentir.
Vaucanu Emile-Joseph-Isidore, naquit à Bernay, le 8 novembre
1864. Sa jeunesse s’écoula, paisible et sereine,
dans sa ville natale, en un milieu qui semblait peu propice
à l’éclosion d’une
carrière artistique. Son père tenait alors une
étude d’avoué, mais sa petite maison,
Grande-Rue, conservait encore, malgré ses modifications, un
certain cachet d’antiquité. Qui sait si le vieux
logis n’exerça pas sur l’intelligence
d’Emile Vaucanu une influence décisive ?
Il ne manque pas, à Bernay, de vestiges du
passé : d’antiques maisons à
pans de bois et à pignons sur rue, ni
d’édifices intéressants, mais la ville
est encore plus riche en souvenirs, que les historiens locaux ont
scrupuleusement recueillis. La rue qu’habitait les Vaucanu
s’appela d’abord rue aux Juifs, puis Grande-Rue et
rue du Commerce avant de recevoir le nom de M. Thiers. Elle
était autrefois bordée de porches sous lesquels
circulait une foule nombreuse et bariolée, surtout au moment
de la célèbre foire fleurie. Les
façades des maisons, en encorbellement sur les sombres
galeries des porches, étaient édifiées
en colombages mortaisés dans les larges poutres des
entablements, décorés de guivres ou de rageurs.
Les pignons étaient variés de formes, car les
charpentiers, alors très habiles, y déployaient
tout leur savoir et tout leur goût.
C’est dans ce cadre médiéval, dont il
devait plus tard fixer les aspects, que Vaucanu passa ses primes
années. Il avait instinctivement le goût de la
curiosité et du bibelot. En compagnie de son
frère Gustave, il parcourait les campagnes de la
région bernayenne à la recherche
d’objets rares et précieux, de livres
armoriés ou de pièces de céramique que
ne recherchaient pas encore les rabatteurs et les marchands.
C’était pour lui une joie sans égale
que de rapporter au logis familial un livre blasonné, un
plat ou une assiette de fabrication rouennaise ou quelque
pavé figuré provenant des ateliers de Manerbe ou
du Pré-d’Auge, en attendant le jour où
il devait trouver sur sa route, sous le ciel d’Orient, ces
briques émaillées, ces carrelages
éclatants aux dessins compliqués et savants qui
enchantent et émerveillent les regards.
Venu à Paris vers 1884, il fréquenta pendant
quelques années l’Ecole des Beaux-Arts,
près de laquelle il habitait ; son nom figure pour
la première fois parmi les élèves
récompensés, en 1885, année
où il obtint une mention d’anatomie.
De petites expositions provinciales, auxquelles il prit part,
attirèrent bien vite l’attention des connaisseurs
sur son talent précoce de graveur. Un diplôme
d’honneur à Boulogne en 1887, un à
Châteauroux en 1888 et une médaille de vermeil
à Evreux en 1892, récompensèrent ses
laborieux débuts.
Elève de Henriquel-Dupont, de Bouguereau, de Tony
Robert-Fleury, il fut admis à concourir pour le prix de
Rome, section de gravure, en 1890. Il n’obtint pas le
succès qu’il méritait et se remit
aussitôt au travail.
On le trouve pour la première fois exposant au Salon des
artistes français en 1887, avec huit gravures, parmi
lesquelles le vieux
Manoir de la Salamandre à Lisieux, un
Reliquaire de l’abbaye de Saint-Evroul et un
Portrait de
Chevreul. La physionomie de l’illustre savant lui inspira
quelques bonnes études pour un portrait dont je connais
plusieurs états successifs, traités avec beaucoup
de science et de vérité.
L’année suivante, il envoie neuf gravures dont une
délicieuse petite
Vue sur l’Eure à
Chartres, l’intérieur de l’
Eglise de
Saint-Martin d’Etampes, et un
Coin d’atelier, le
sien, tiré en bistre, d’une facture originale avec
ses traits vigoureux profondément incisés dans le
cuivre. Il prend part également à
l’Exposition « Blanc et
Noir » où il envoie deux gravures, dont
l’une est précisément un
Portrait de
Chevreul.
En 1889, on le trouve à l’Exposition universelle
où il figure avec onze gravures ; au Salon, six
gravures, presque tous sujets archéologiques ; une
vingtaine de pièces aux Amis des Arts de l’Eure,
à Evreux, où il obtint une médaille de
bronze, bien que « ses vues de petites
églises du pays d’Ouche, jolies et fort
adroites », au dire du rapporteur, eussent pu lui
valoir « une des plus hautes
récompenses ». J’ai vu ces
charmants dessins : la tour de l’ancienne abbaye du
Bec, les églises de Bosc-Robert, Bosc-Roger,
Saint-Ouen-de-Mancelles, Saint-Laurent-des-Grés, Le
Tilleul-Fol-Enfant ; les ruines du château de
Groslay, la maison natale de dom Massuet à Gisay-la-Coudre,
le vieux manoir de Cernières, et je regrette que tout cet
ensemble n’ait pas été
conservé dans les portefeuilles d’une Commission
des Antiquités.
Aux Artistes français, en 1890, il expose un buste en
plâtre de Jacques Daviel, le savant oculiste originaire de La
Barre, dont la statue, oeuvre de l’excellent
sculpteur rouennais Alphonse Guilloux, décore la place de
l’Hôtel-de-Ville de Bernay. Un bas-relief en
plâtre stéariné,
Femme normande
morte, complétait cet envoi, le premier où
Vaucanu se révéla comme sculpteur. On le trouve
cette même année, pour la première
fois, à la Société nationale des
Beaux-Arts, avec un autre
Portrait de Chevreul.
En 1891, il fit un important envoi à la
Société des Amis des Arts de l’Eure, 77
eaux-fortes qui lui valurent une médaille de vermeil.
Aux Salons de 1891, 1892 et 1893, il figura à la
Société nationale, vers laquelle il semble devoir
s’être orienté de
préférence, avec quelques bas-reliefs en bronze
et des gravures, parmi lesquelles le fameux
Manoir de Canapville que
les habitués de la ligne de Trouville connaissent bien.
En 1892, il prend part au concours d’aquarelles
organisé par la Société des Amis des
Arts de l’Eure ; sur 371 aquarelles que comprenait
l’exposition de cette année, Vaucanu en avait
envoyé 90. Cette preuve de labeur acharné fut
méconnue, car l’artiste n’obtint aucune
récompense.
Entre temps, il participa aux Expositions universelles de Madrid, 1892,
et de Chicago, 1893, s’y faisant remarquer par le nombre, la
variété et
l’intérêt de ses envois.
Vaucanu, qui s’était tout d’abord
fixé rue Mazarine, puis rue du Cherche-Midi, abandonna
« le quartier » après
sa sortie de l’Ecole, et vint s’installer dans le
XVIe arrondissement, avenue Kléber, vers 1890. Dans ce
quartier aristocratique, il ne tarda pas à créer
d’intéressantes relations qui
l’amenèrent à faire partie de la
Société d’Auteuil et de Passy
où se rencontraient les beaux esprits et les gens de
goût. Il y fut présenté le 12 mai 1892,
en qualité de statuaire, sans doute à cause
d’une circulaire dont j’ai retrouvé un
exemplaire par laquelle il annonce qu’il exécute
des médaillons et des bustes suivant des prix
déterminés. Il fallait vivre à Paris,
et Vaucanu n’aimait pas faire appel à la bourse
paternelle. Il avait une fierté d’artiste et un
esprit d’indépendance qui se
manifestèrent jusqu’au dernier jour.
Notre artiste voyagea en Belgique, en Allemagne, en Algérie
et en Turquie. Il rapporta de ce pays de nombreux croquis dont un
nombre fut utilisé dans ses albums de
Vues anciennes et
modernes en eaux-fortes, taille-douce et gravures sur bois. Il avait
aussi l’intention d’entreprendre un vaste ensemble
iconographique,
La France par provinces, dont une partie seulement,
l’Auvergne et la Normandie, vit le jour.
C’est également en cette année 1893
qu’il entreprit la gravure du tableau de Roll,
La
Fête du Centenaire de 1789 à Versailles, gravure
dont le cuivre mesure près d’un mètre
de largeur et dont il ne fut tiré que quelques exemplaires
devenus aujourd’hui introuvables.
Au mois de décembre, il présentait à
la Société d’Auteuil la planche du
diplôme qu’il avait gravé pour elle. Il
fut alors chaudement félicité par les membres
présents et il fut décidé que la
première épreuve serait offerte au
président, Eugène Manuel. Je possède
une épreuve de ce diplôme très
artistique sur lequel Vaucanu a su harmonieusement grouper les
physionomies de Boileau, Racine, La Fontaine, patrons illustres de
cette société parisienne.
N’avions-nous pas raison de dire que ses premières
excursions dans la campagne normande avaient
préparé Emile Vaucanu, peut-être
à son insu, à trouver sa véritable
voie ? En étudiant son oeuvre, en
feuilletant les charmants croquis où il a fixé,
en quelques traits vigoureux, les modestes églises de nos
villages, j’ai bien souvent pensé à
Hyacinthe Langlois, du Pont-de-l’Arche, ce maître
de l’eau-forte qui, lui aussi, aima passionnément
son pays.
A l’exemple de Langlois, Vaucanu se fût volontiers
improvisé antiquaire, s’il en avait eu le temps.
Comme lui, il se laissait séduire et retenir par tout ce qui
pouvait intéresser son esprit. Cet impérieux
besoin d’apprendre l’attirait dans les
bibliothèques, particulièrement à
l’Arsenal, ce séjour
d’élection des amis des livres,
véritable asile de calme et de fraîcheur.
Ce fut dans ce salon littéraire qu’il rencontra un
érudit avec lequel il se lia bien vite, Henri
d’Allemagne, dont le nom demeure inséparable de
ses superbes publications sur le luminaire et les jouets.
Vaucanu fut avant tout un homme du document, un amateur de la
sévérité et non un illustrateur
fantaisiste, crayonnant et burinant au gré d’une
imagination plus ou moins capricieuse, sans souci de
l’anachronisme. Voilà pourquoi, aux yeux de
quelques critiques, l’oeuvre de notre compatriote
paraît manquer d’originalité. Jugement
trop sommaire si l’art ne consiste pas dans la
singularité.
Comme illustrateur, Vaucanu possédait toutes les
qualités requises par ce genre si exigeant et si complexe.
Il savait faire abstraction de soi-même pour
s’asservir à la pensée de son auteur.
On trouve quelques-uns de ses dessins dans l’
Histoire de
l’Art en France, de François Bournand,
publiée en 1891 ; dans une substantielle notice de
Ch. Duplomb sur
la Rue du Bac, dont Vaucanu s’inspira pour
reproduire quelques vieux hôtels de cette vivante
artère de Paris. Enfin, dans le remarquable ouvrage de Henri
d’Allemagne,
Le Luminaire, notre artiste exerça
sa maîtrise en reproduisant tous les menus objets
figurés dans cette belle publication.
A partir de 1894, Vaucanu disparaît de la scène
artistique. C’est à ce moment qu’il
partit pour l’Orient, devançant son ami Henri
d’Allemagne, qui devait plus tard retrouver sa trace
après les dramatiques événements
qu’on va lire. Je laisse la parole à M.
d’Allemagne qui s’exprimait ainsi, en
tête d’un grand ouvrage publié en
1911 :
« En 1893, mon intention était de passer
mes vacances au Caucase et dans la Transcaspienne, et je devais partir
avec un jeune graveur de talent, M. Emile Vaucanu, que ce projet avait
particulièrement séduit. Diverses raisons
m’empêchèrent de mettre mon projet
à exécution, et mon compagnon, impatient de
connaître ce pays étrange, partit seul dans
d’assez mauvaises conditions. Son budget d’artiste
ne lui permit, en effet,d’autre luxe que
d’être passager du pont sur un des bateaux qui
assurent le service entre Marseille et Batoum en faisant escale
à Constantinople et aux différents ports de la
Mer Noire. Arrivé à Batoum, M. Vaucanu travailla
de son métier de dessinateur chez quelques riches
particuliers et parvint à gagner l’argent
nécessaire pour se rendre à Tiflis. Dans cette
ville, le sort lui fut moins favorable et il put à peine
trouver de quoi pourvoir à sa propre subsistance.
Néanmoins, hanté du désir de continuer
sa route, il entreprit bravement de faire à pied le chemin
qui sépare Tiflis de Bakou.
Tous ceux qui ont voyagé dans cette région savent
qu’il n’existe pas de grandes routes analogues
à celles qu’on rencontre dans le reste de
l’Europe ; les chemins sont mauvais et surtout fort
mal fréquentés. Vaucanu en fit la triste
expérience, car ayant eu l’imprudence
d’accepter l’hospitalité du conducteur
d’un
arabeh, sorte de chariot grossier, il fut, pendant son
sommeil, assommé aux trois quarts, à coups de
matraque et jeté pour mort sur le côté
de la route. Un heureux hasard conduisit près de
là une âme charitable qui le releva, lui donna des
soins empressés et, après l’avoir
ramené à la santé, lui fournit les
subsides nécessaires pour lui permettre de gagner Bakou, de
traverser la mer Caspienne et même d’atteindre
Ashhabad. Dans cette ville, notre artiste fit connaissance
d’un ingénieur français
attaché à la construction du chemin de fer
Transcaspien et il passa près de six mois dans sa maison,
reproduisant, soit à l’aide du crayon ou de la
glaise, les traits des membres de la famille de son hôte si
hospitalier.
Ce temps écoulé, Vaucanu jugea le moment venu
d’aller plus avant ; aussi, après avoir
pris congé de ses bienfaiteurs, se dirigea-t-il vers la
gare, non sans avoir été préalablement
lesté de ces beaux billets multicolores de cent roubles que
l’on désigne en Russie sous le nom
d’arc-en-ciel. Par suite d’un sentiment difficile
à expliquer, il ne voulut pas conserver l’argent
qui lui avait cependant été si
libéralement offert, et, arrivé à
Samarkand, il mit sous enveloppe les billets de banque et le retourna
à l’ingénieur d’Askhabad.
Démuni de ressources et n’ayant pas
trouvé à utiliser ses talents, il
vécut misérablement pendant quelques jours
à Samarkand, dans le voisinage du chemin de fer, couchant
sur un tas de rails, et il s’abstint de toute visite aux
autorités russes ; puis sans argent, sans armes et
même sans aucunes provisions, il quitta Samarkand pour se
diriger vers le sud-est, dans la direction des Pamirs, qu’il
voulait atteindre à toute force.
C’était peu de temps après
l’époque des travaux de la délimitation
des Pamirs, et les journaux européens étaient
pleins de récits des divers voyageurs qui avaient fait
partie de cette commission. Vaucanu avait voulu faire une exploration
à lui seul, et rapporter de ces montagnes des croquis qui
lui permettraient de constituer ensuite un album
d’eaux-fortes des plus précieux. Seul, sans guide
et sans aucun renseignement précis, il parvint ainsi
jusqu’à une distance d’environ 275
kilomètres de Samarkand, en un endroit qui sortait
complètement de la zone d’influence de la Russie.
Là, il fit la rencontre de Turcomans qui,
étonnés de voir un étranger
s’aventurer ainsi chez eux, pensèrent
qu’il devait être cousu d’or pour pouvoir
faire une pareille entreprise et résolurent de le mettre
à mort.
D’après les renseignements que j’ai pu
recueillir postérieurement, ce fut le chef du village qui
commit ce crime abominable ; il ne lui fut du reste que
d’un maigre profit, car, quand il retourna les poches de mon
malheureux ami, il ne trouva que quelques objets sans valeur, des
plantes desséchées et les feuillets de ce fameux
album pour lequel Vaucanu avait sacrifié sa
vie. » (1)
J’ai vu quelques-uns de ces feuillets que
l’infortuné avait envoyés à
ses parents et qui restent le suprême témoignage
de sa prodigieuse activité. Ce sont des dessins à
la plume et au crayon rehaussés de gouache, des croquis
rapides avec des notations qui devaient lui permettre, plus tard, une
exécution définitive. Ces dessins ne portent, en
général, que de rares légendes,
l’indication du lieu. Un seul est daté :
Caucase, lundi 7 mai 1894 »
Beaucoup de ces feuillets portent ce titre :
«
Vieux Merv ». C’est
une oasis de l’Asie centrale, au sud du Turkestan,
dépendant de la province russe Transcaspienne. Merv est
l’ancienne capitale de la Margiane citée dans les
inscriptions des Achéménides,
colonisée par Alexandre-le-Grand. Les ruines de tours, de
palais, de bains, de tombeaux qui couvrent les environs, attestent la
splendeur passée de la ville.
Vaucanu y séjourna quelque temps, menant une existence tout
à fait précaire, soutenu par la pensée
que, le premier, il doterait l’art de précieuses
restitutions des ruines grandioses qu’il avait
esquissées. Nous venons de voir qu’il en fut
autrement.
L’oeuvre d’Emile Vaucanu, par ses
multiples aspects, par les procédés divers
auxquels il eut recours pour traduire et fixer sa vision des personnes
et des choses, est d’un artiste très
éclectique, épris de la beauté,
soucieux de la perfection et du fini, aimant le pittoresque, jamais
insensible devant ce qui peut tenter le crayon, le burin le pinceau.
Pour lui rendre complète justice, il faut la
connaître dans le détail, s’en
pénétrer, en suivre la genèse et le
développement dans les états successifs des
planches gravées.
Par malheur, cette oeuvre est très
dispersée, et un concours de circonstances
fâcheuses semble s’être
acharné contre elle. Les rares épreuves de ses
eaux-fortes, qu’il offrait assez facilement à ses
amis, sont aujourd’hui disséminées. Son
frère Gustave en avait recueilli un assez grand nombre,
malheureusement un incendie, survenu il y a quelques années,
en détruisit la plus grande partie et le reste fut tellement
endommagé que c’est avec peine qu’il
m’a été possible d’en dresser
un essai de catalogue.
Pourtant, en classant et en décrivant les peintures,
sculptures, aquarelles, dessins et estampes qu’il
m’a été donné de rencontrer,
j’ai pu atteindre le chiffre de cinq cents pièces,
ensemble aussi imposant par la variété que par la
valeur artistique.
Et dire que le nom de Vaucanu ne figure pas au catalogue du Cabinet des
Estampes de notre Bibliothèque nationale ! Un tel
artiste devrait au moins y être
représenté, ne fût-ce que par
quelques-unes de ses grandes pièces dont il serait
peut-être possible de retrouver des épreuves.
C’est une oeuvre de réparation que
j’espère mener à bien quelque jour. Ce
tardif hommage sera un acte de justice qui donnera à Emile
Vaucanu la place qu’il mérite parmi les
maîtres graveurs dont s’honore, à juste
titre, le siècle dernier.
NOTE :
(1) H. d’Allemagne. Du Khorassan au pays des Bactuaris.
Trois mois de voyage en Perse. Paris, 1911, 4 vol. in-4, t. I. p. 1 et
2.
____
20 décembre 1922
____
NOËL
Folklore et Littérature
De toutes les fêtes du Christianisme, Noël est
assurément la plus touchante, la plus intime, la plus
poétique. C’est elle qui a
créé les plus gracieuses légendes,
suscité les plus pittoresques traditions, inspiré
les plus charmantes oeuvres d’art.
Peintres, sculpteurs, graveurs, musiciens, poètes, ont
immortalisé le mystère de la crèche
par des oeuvres très différentes, mais
toutes empreintes d’un même sentiment de joie et
d’espérance. Les plus grands génies se
sont inclinés devant le berceau de l’Enfant, pour
saluer sa venue en ce monde qu’il devait
conquérir, au prix de tant de sacrifices.
Puisque la fête de Noël est la fête des
petits, il m’a paru opportun de rechercher, dans les
traditions populaires, les croyances, les usages, qui disparaissent de
plus en plus devant une civilisation sans âme. Le bon vieux
temps avait tout de même son charme, oyez plutôt.
La fête de Noël offrait des
particularités fort curieuses qui se manifestaient la
veille, dès le crépuscule. Dans les villes
surtout, une certaine animation régnait dans les rues
où les gens se pressaient pour les emplettes à
faire en vue du réveillon et des cadeaux à offrir
aux enfants. A Caen, en particulier, les enfants se promenaient avec
des lanternes, lesquelles, jointes aux bougies enveloppées
de papier rouge des marchands de marrons et d’oranges,
donnaient une grande animation à la ville.
En Champagne, les enfants parcouraient les rues, un lampion
à la main, en chantant ce refrain populaire :
Allons
à la Crèche
Vers
l’Enfant Jésus ;
Sur la
paille fraîche
Il est
étendu.
Les chandelles des lampions, ordinairement fournies par les
épiciers, étaient demandées par les
bambins qui criaient à tue-tête à la
porte des commerçants :
Ma
p’tite chandelle.
Noël ! Noël !
En Béarn, l’aubade était
donnée devant les maisons des personnes qui avaient eu un
enfant pendant l’année. Les chants ne
s’arrêtaient qu’après une
ample distribution de châtaignes.
Une des traditions les plus poétiques est certainement celle
qui se rapporte à cette heureuse veillée,
à cette nuit merveilleuse que l’imagination se
plaisait à remplir de prodiges extraordinaires.
C’est véritablement
l’« enchantement de
Noël » surtout au moment de
l’heure sainte, c’est-à-dire entre
minuit et une heure. A ce moment, la terre s’arrête
dans sa rotation pour laisser régner
l’éternité. Pendant l’heure
sainte, les vieux châteaux, les villes et les
églises effondrées se relèvent et se
repeuplent de gens qui, autrefois les habitaient ; les pierres
des dolmens se déplacent et laissent voir des
trésors dont un homme vif et hardi peut se saisir
s’il met à profit l’occasion rare.
L’eau des sources reçoit une vertu merveilleuse
pourvu qu’elle soit puisée durant les douze coups
de minuit. A l’heure sainte, toute la nature est en
fête : Les prés sont
émaillés de fleurs, les arbres couverts de
feuilles. Une jeune servante rentrant dans la nuit cueillit un de ces
rameaux verts qui, à la maison, se changea en feuilles
d’or. Dans le Tyrol, on raconte qu’un petit
garçon cueillit une branche fleurie d’un cerisier
dont les pétales blanches se changèrent en
florins dans sa main. En Thuringe, assure-t-on, une petite fille trouva
des grosses mûres sous la neige ; une autre rapporta
des roses et des framboises.
Pendant cette nuit, nous apprend une autre tradition, les habitants des
villages qui avoisinent Sainte-Reine, s’ils ont la foi et
exempts de tout péché, peuvent voir la Sainte
Vierge, accompagnée de Sainte Reine et d’une
nuée d’anges, partir, au milieu d’une
traînée lumineuse comme l’arc-en-ciel,
de sa chapelle d’Alise pour se rendre au château de
Grignon où Sainte Reine fut martyrisée.
A cette même heure, dans toutes les étables, les
bêtes parlent entre elles ! Malheur à
celui qui surprend leur conversation, car il est assuré
d’une mort prochaine.
En Bretagne, on prétend que pour comprendre leur langage, il
faut tenir entre ses bras un enfant nouveau-né et qui vient
justement de recevoir le baptême : on apprend alors
où se trouve un trésor capable
d’enrichir tous les habitants de la terre.
Dans le pays de Bade, les bêtes se prosternent à
genoux pour adorer le Christ ; en Belgique, elles se
relèvent toutes pour ne se recoucher
qu’après une heure. Sur les bords de la Lahn,
elles se racontent les secrets de leurs maîtres ;
dans le Tyrol, les vaches annoncent à leurs gardiennes si
elles vont se marier dans l’année.
C’était en cette nuit que l’on mettait
au feu la traditionnelle bûche de Noël,
appelée
seuche en Auxois,
tronche en
Franche-Comté et
chouquet de Noué en Normandie.
C’était d’un usage
général de faire brûler quelque chose
la nuit de Noël. Dans certaines maisons, la bûche
atteignait des proportions démesurées et il
était quelquefois bien difficile de la placer dans
l’âtre où elle devait brûler
jusqu’aux Rois, sans s’éteindre et sans
qu’on y touche. Les charbons en étaient
soigneusement recueillis et considérés comme un
talisman contre le feu du ciel. Pendant la veillée, en
Normandie, on vidait force pichets autour du chouquet : le
petit Jésus donne des pommes à qui bon lui
semble, et un moyen certain de se le rendre favorable était
de faire honneur, cette nuit-là, au
bère de
choix que l’on tient déjà de lui.
En Bretagne, la bûche de Noël était
destinée à chauffer les anges qui descendent
alors sur la terre. Les hommes ne les voient pas ; mais ils
sont visibles pour tous les animaux, surtout pour les agneaux, les
boeufs et les ânes. Les
ménagères de l’Auxois croyaient que la
Sainte Vierge vient se chauffer auprès de la bûche
de Noël ; elle se plaît surtout dans les
maisons où le foyer est bien propre. Aussi avait-on soin de
le balayer avant d’aller à la messe de minuit.
La messe de minuit est en effet le grand acte de veille de
Noël ; tout se résume dans cette
solennité qui est la commémoration même
de l’événement dont la fête
du lendemain n’est que la continuation. Aussi avec quel
éclat est-elle célébrée,
avec quel empressement les fidèles s’y rendent. Je
ne parle pas, bien entendu, de ces cérémonies
toutes mondaines où la tradition et
piété sont également
sacrifiées. Je parle de la messe de minuit comme on la
célèbre dans nos églises de campagne,
où la simplicité et le recueillement font tous
les frais. L’église illuminée,
l’autel paré de verdure, la liturgie est assez
riche pour se charger du reste. Joignez à cela certaines
coutumes locales, par exemple : des bergers amenant un agneau
blanc orné de rubans, une crèche
naïvement exécutée, le chant de vieux
cantiques familiers, n’est-ce pas tout cela qu’il
faut pour parler au coeur de celui qui sait méditer
ou prie ? Combien éloquentes, dans leur majestueuse
simplicité, étaient ces messes
d’autrefois, dépourvues de cette pompe froide et
vaine qui est presque de rigueur aujourd’hui ! A
minuit, le chant des cantiques s’élevait, alors
que dehors s’accomplissaient les merveilles dont je viens de
parler. Il y avait à cette heure solennelle quelque chose de
grand et de mystérieux, que la naïve imagination de
nos pères traduisait par des actes surnaturels qui
poétisaient si bien le charme de cette nuit
enchantée.
Combien pittoresques ces cortèges munis de lanternes qui se
déroulaient, en de longues théories, à
travers la campagne obscure et couverte de neige, vers la petite
église dont les vitraux historiés flambaient
à l’horizon. Toutes les mères pouvaient
y assister sans rien craindre pour les poupons qu’elles
laissaient à la maison car, si nous en croyons la
légende, pendant leur absence, la Vierge venait les garder
et les soigner.
Le pain bénit donné à la messe de
minuit, généralement offert par les meuniers,
devait être conservé toute
l’année.
Une curieuse tradition, en usage dans certaines campagnes,
était d’aller, au retour de la messe de minuit,
visiter le bétail dans les étables ; si
les bêtes tournent le dos à la porte
d’entrée, c’est signe que
l’hiver sera long ; dans le cas contraire, il fera
chaud de bonne heure.
Une autre coutume, d’un usage général,
était d’offrir des gâteaux, surtout aux
enfants. Ces gâteaux, fabriqués
spécialement pour la circonstance, étaient
très divers de nom et de nature. Dans le Berri,
c’étaient des
cornaboeufs, des
hôlais, que l’on distribuait aux pauvres le matin
de Noël. En Dauphiné, les
poignes de
Noël ; dans le Mentonnais, les
fraichoué ou beignets de pommes ; à
Caen, des petits pâtés remplis de confiture et le
traditionnel
craquelin normand. Dans le Nord de la France,
à Lille notamment, on donnait des
coquilles,
gâteau fabriqué avec plus ou moins de finesse,
avec ou sans raisin, sur lequel on incrustait un petit Jésus
en sucre. Les coquilles étaient données aux
enfants qui, le matin, croyaient les tenir de l’enfant
Jésus lui-même. Desrousseaux a dit, dans une de
ses chansons :
J’vas dir’ une prière à
p’tit Jésus
Pour qui
t’apporte eun coquille.
A Arras, ce gâteau se nommait
queugnot ; en
Lorraine,
cogné,
coquelin ; dans le pays de
Charleroi,
cougnoux et
cougnoiles à Mons. A
Liège, tout le monde, même les plus pauvres
ménages, se régalaient de
bouquettes,
pâtisserie faite de sarrazin, de viande de porc ou de lapin.
En Allemagne, le gâteau principal de la Noël,
c’était le pain d’épice sous
toutes ses formes ; il y a aussi le
bretzel de
Noël, grand et riche, fait de farine,
d’oeufs et de sucre. En Espagne, les bergers venant
à la messe de minuit, recevaient des tourtes de Marie,
tortas de Maria.
A Cannes, c’était un gâteau
d’un autre genre, qui devait se vendre un peu partout, en
ayant vu moi-même à Bernay pendant mon enfance.
Beaucoup se souviendront sans doute de ces marchands qui colportaient
sur une tablette des animaux en pâte sculptée
qu’ils vendaient pour servir à
l’amusement des enfants. Ceux-ci mangeaient volontiers le
gâteau indigeste, quand le jouet avait cessé de
plaire. Les pâtissiers animaliers qui modelaient ainsi la
pâte, semblaient avoir adopté trois types
principaux : le cerf, le bêlier et le
cheval dont la tête était quelquefois
surmontée d’un coq. Tous ces
quadrupèdes en pâte de farine avaient des jambes
de bois, quatre allumettes.
L’usage du
petit soulier dans la cheminée est si
généralement connu que je ne puis omettre de
l’indiquer. Bientôt, ce ne sera plus
qu’un souvenir qui prendra sa place à
côté des autres coutumes
désuètes. Peu d’enfants
aujourd’hui croient encore à
l’équipe merveilleuse et charmante du petit
Jésus, laissant tomber dans toutes les cheminées
les joujoux et les cadeaux qui font la joie des enfants à
leur réveil. Cette naïve croyance avait quelque
chose d’ingénu et de candide qui convenait si bien
aux tout petits !
L’arbre de Noël, sapin illuminé,
chargé de jouets et de friandises, est
d’importation plus récente chez nous et nous est
venu d’Allemagne par l’Alsace. Il est encore
d’un usage très fréquent, non seulement
dans certaines familles, mais surtout dans les oeuvres et les
collectivités, mais là encore, il a perdu une
grande partie de sa poésie originale.
La fête de Noël est en Angleterre la fête
par excellence, la grande fête domestique où
l’on déguste le traditionnel
plum
pudding ; dans les familles aisées on mange bien
souvent une dinde ou plutôt un dindon, dont la
réputation est bien rachetée par ce principe du
Noël des oiseaux où l’on dit que le
dindon,
Par un
noble abandon
S’offre à la cuisine
De la
sainte maison.
C’était une coutume druidique de conclure la paix
par un baiser donné sous le gui sacré ;
aujourd’hui on pend le gui au-dessus de la porte, et si un
garçon trouve une fille sous le gui, il peut
l’embrasser.
Les chansons de Noël en mémoire du
Gloria in
excelsis sont universelles en Angleterre ; dans beaucoup
d’églises anglicanes a lieu un
carol service en
musique. Les anciennes félicitations sont devenues
l’objet d’un grand commerce, les
Christmas cards
sont très répandus et tout le monde en envoie
à ses amis.
Les traditions et croyances de Noël sont très
nombreuses et très variées dans les
provinces ; ainsi à Toulon, on ne coulait pas le
linge à la rivière pendant les neuf jours qui
précèdent Noël, parce que la bonne
Vierge lave, pendant ce temps, les langes pour le petit
Jésus. En Dauphiné, on ne devait pas manger de
pommes le jour de Noël afin d’éviter les
furoncles durant l’année. En Bretagne, on croit
que, si à minuit on peut mettre dans la crèche
à côté de l’enfant
Jésus, un enfant malade, il guérit, fut-il
à l’article de la mort. On dit,
à Liège, que lorsque les eaux de
rivières grossissent à Noël, il y aura
une bonne récolte. A Soest, en Westphalie, le soir de
Noël, les enfants se réunissaient sur la galerie
extérieure de l’église et
là, sous la direction d’un maître de
chapelle chantaient pour endormir le petit Jésus, suivant
l’expression populaire, des cantiques entrecoupés
de sonneries de trompettes. Les enfants, en chantant leur cantique, se
tournaient successivement vers les quatre points cardinaux en agitant
des petits drapeaux.
Ceux qui sont nés le jour de Noël n’ont,
paraît-il, rien à craindre à la guerre,
ils n’y seront pas tués ni blessés. Ils
jouissent en outre d’un singulier privilège, ils
savent faire tourner la baguette qui découvre les
trésors.
Anciennement c’était l’usage en Flandre
de donner le nom d’Adam et d’Eve aux enfants,
filles ou garçons nés la veille de
Noël ; les calendriers belges indiquent le 24
décembre comme fête de nos premiers parents.
La littérature populaire suivit de bien près la
tradition, la précéda même.
L’origine des Noëls est certainement aussi ancienne
que le Christianisme. Le premier en date, n’est-ce pas ce
cantique que les bergers ravis entendirent la nuit même de
Noël ? Dès le IVe siècle, saint
Ambroise avait composé plusieurs hymnes se rapportant
à cette fête et saint Augustin, dans un de ses
sermons, y fait non seulement allusion, mais en cite même une
strophe.
Pendant tout le moyen-âge, on s’en tint
à peu près aux
tropes,
c’est-à-dire à des additions au texte
même de la liturgie, à tel point que ce texte fut
pour ainsi dire noyé dans le commentaire
exagéré dont il était farci pour le
rendre plus solennel. Un savant, qui a consacré à
ce sujet un ouvrage très important (1), fait remonter
l’origine de ces pieuses additions au IXe siècle.
Ce fut dans l’abbaye de Saint-Gall, sur les indications
d’un moine de Jumièges, que les tropes firent leur
apparition. Leur diffusion fut rapide, surtout dans les
monastères. A partir du XIIIe siècle, une
transformation s’opéra, et ces pièces
devinrent de véritables drames liturgiques qui se jouaient
dans les églises, tels furent les
Offices des
prophéties du Christ, le
Drame des Pasteurs et
l’
Office de l’Etoile. Ces solennités
eurent un grand succès et de longue durée,
puisqu’en 1484, Innocent VIII engageait les prêtres
à les maintenir dans les églises (2).
L’usage de représenter dans les
églises, le jour de Noël, l’adoration des
bergers et celle des Rois, a survécu en France
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. On
pourrait même dire qu’il s’est
perpétué jusqu’à nos jours,
par les crèches, plus ou moins ornées,
qu’on a coutume d’ériger, pendant tout
le temps de Noël jusqu’à la Purification.
Quand le drame sortit de l’église pour gagner le
parvis et la place publique, il changea de proportions comme de
caractère. Ce furent ces interminables mystères,
de plusieurs milliers de vers, rude épreuve de
mémoire pour les interprètes, qui se jouaient
dehors malgré l’inclémence de la
saison. Et pourtant, le peuple s’intéressait
vivement à la représentation de ces
pièces dont bien peu supportent aujourd’hui la
simple lecture.
On connaît la célèbre
représentation du
Mystère de
l’incarnation et de la Nativité donnée
à Rouen aux fêtes de Noël 1474, en plein
vent, sur le théâtre dressé au milieu
du Vieux-Marché. La naissance du Christ faisait partie du
cycle dramatique qui finit par embrasser la totalité de la
vie de Jésus. Cette oeuvre fameuse passant tour
à tour par les mains de Jean Mercadé,
d’Arnoul Gréban et de Jean Michel, fut une de
celles qui enthousiasma le plus nos aïeux.
C’était un véritable
événement que la représentation de ces
mystères qui exigeaient une mise en scène et de
nombreux acteurs. Avec le temps, et surtout pour obvier à
leur prolixité, surgirent des drames moins
développés, qui furent en quelque sorte
l’abrégé des mystères, je
veux parler des moralités. Les collèges, les
écoles, les psalettes, le bas-choeur des
églises, les clergeons, formaient une troupe nombreuse
pouvant rivaliser avec les Confrères de la Passion et
appelés naturellement à
l’interprétation de ces oeuvres qui
cadraient mieux avec la vie de chaque jour.
Ceci donna lieu à toute une production locale, parfois
très originale, mais dont nous ne connaissons que de rares
spécimens, insuffisants toutefois pour nous permettre de
l’apprécier. De tout cela, il reste quelque chose,
les
Noëls proprement dit : courts
poèmes, virelais ou pastourelles formant un tout complet,
pouvant se détacher du reste. De la longue
période qui précéda le XVIe
siècle, on ne peut guère citer que Adam de la
Halle, né à Arras en 1240, encore est-il beaucoup
plus connu par le
Jeu de la Feuillie et
Robin et Marion que par les
quelques Noëls qu’il a laissés.
De curieux manuscrits des XVe et XVIe siècles nous ont
conservé bon nombre de Noëls encore populaires
aujourd’hui, beaucoup plus anciens qu’on ne croit.
Ils y sont transcrits tout au long, bien avant que
l’imprimerie et surtout les érudits
n’eussent songé à les reproduire. La
Bibliothèque nationale en possède un du
commencement du XVIe siècle (Ms. frans. 2368) qui porte
cette inscription sur un de ses
feuillets :
Cest
livre de Noelz est au Roy Loys XIIe
A partir du XVIe siècle, deux courants
d’idées nettement définies se font jour
dans les Noëls ; le maintien de la tradition
gauloise, réaliste, gaie, et, d’autre part, le
goût de l’idéalisme, de la
précision dans la forme et de la délicatesse dans
l’expression. Ces deux impulsions si différentes
sont en quelque sorte incarnées dans Lucas le Moigne et Jean
Daniel, dit maître Milou.
On ne saurait trouver plus de bonhomie et de franchise naïve
que dans les
Chansons de Noëls nouvaulx, publiés
à Paris, en 1520, par maistre Lucas le Moigne,
curé de Saint-Georges du Puy-la-Garde, au diocèse
de Poitiers. Plusieurs de ses Noëls sont encore connus
aujourd’hui ; ils devinrent rapidement
célèbres, on les chantait partout en France, et
Rabelais a fait d’ailleurs allusion au cantique
de la venue
de Nouel qui, dit-il, « se danse en Lanternois aux
divers sons des Couzines ».
Henri Chardon a publié les
Noëls nouveaulx de
François Briand,
maistre des escolles de Saint-Benoist en
la cité du Mans (3). Ce recueil comprend vingt
Noëls, dont quatre sont notés à deux
parties, ce qui est rare pour l’époque, ce sont
des Noëls savants, distillant quelque peu l’ennui.
Pourtant, on y trouve quelques strophes, relatives à la
Vierge, gracieuses et empreintes d’une certaine
gaieté qui a contribué à leur
popularité. Briand est aussi l’auteur
d’une moralité, mélange de
Noëls, de Mystère et d’une Farce, que le
même éditeur a eu raison de faire revivre (4).
Bien que les deux ouvrages de Briand aient été
imprimés de son vivant, un seul exemplaire a
survécu jusqu’ici dans une bibliothèque
monastique d’où H. Chardon l’a
exhumé.
Le courant idéaliste se manifesta au moment où la
Pleïade inaugura dans la poésie les souvenirs de la
mythologie, aussi est-ce vainement qu’on chercherait dans
Remy Belleau une pastorale consacrée à la
Nativité. Le représentant de ce second mouvement
est Jean Daniel, organiste d’Angers et de Nantes, dont les
Noëls sont complètement oubliés
aujourd’hui aussi bien que ceux de son compatriote du Mans,
Nicolas Denisot, qui a pourtant laissé quelques chants
gracieux.
On peut citer encore les noms de Crestot, Laurent Roux, Jean Fauveau,
Jean le Frère, Jean de Masle, Barthélemy, Aneau,
Samson Bédonyn, Denis Gaignot, Jérôme
Olines et Marguerite de Navarre, auteur d’une
Comédie de la Nativité de
Jésus-Christ, encore est-il bien difficile de discerner la
part revenant à chacun. Il y a d’ailleurs de si
jolis Noëls anonymes.
Les XVIIe et XVIIIe siècles n’ont
laissé que des cantiques prétentieux, envisageant
beaucoup plus la naissance de l’Eternel que
l’humilité de Jésus. Parmi les auteurs
de cette époque, il convient de citer François
Colletet, les pères Surin, Binard et Christian Prost,
l’imprimeur Gauthier et l’abbé
Pellegrin. La littérature du grand siècle a
écrasé de sa puissante majesté la
simplicité du sujet. Quelques Noëls du XVIIIe
siècle ont conservé cette empreinte de la
pastorale classique, avec ses allégories pompeuses, froides
et dépourvues d’à-propos. La
littérature noélique était parvenue
à son déclin lorsque survint la
Révolution.
Le XIXe siècle manifesta un mouvement d’opinion en
faveur des vieux Noëls, pour leur rendre leur
vitalité et leur grâce d’antan. Mais il
n’en composa pas. A part le célèbre
Noël d’Adam, dont l’histoire est bien
connue, à part quelques poèmes
délicats et charmants, par exemple le
Sommeil de
l’Enfant Jésus, oeuvre de jeunesse
d’Alphonse Daudet, et le délicieux petit drame de
Maurice Bouchor,
Noël, musique de Vidal, on ne trouve
à peu près rien à citer,
pourquoi ? Serions-nous trop vieux ?
De nos jours, des compositeurs ont fait d’heureuses
adaptations musicales sur les airs de Noëls anciens, mais ce
furent surtout les messes qui obtinrent le plus de succès.
Je citerai en particulier la
Messe pastorale de Samuel Rousseau, qui
contient des pages d’une poésie naïve et
charmante, pittoresque et grandiose tout à la fois.
Les vieux Noëls français, d’inspiration
et de factures si diverses, épopées rustiques,
églogues et idylles conservant la beauté un peu
rude des fleurs sauvages, n’ont rien perdu de leur saveur,
même jusque dans le Nouveau-Monde.
En effet, nous les retrouvons là-bas dans cette nouvelle
France du Canada où ils sont religieusement
conservés et chantés haut et ferme devant de
nouveaux maîtres qui n’osent lui imposer silence.
Le Canada français chante pour ses enfants et les enfants de
ses enfants, afin qu’ils n’oublient pas ces
cantiques sacrés au rythme desquels la première
patrie endormait leurs berceaux, éveillait leurs jeunes
âmes, et que, de la sorte, ce répertoire de
mélodies nationales se transmette comme un inestimable
héritage, un legs sacré, de mémoire en
mémoire et de génération en
génération.
Un lettré de là-bas (5) les a réunis
dans un recueil, ces Noëls anciens de la nouvelle France qui
sont aussi ceux de l’ancienne. Parmi les airs que M. Myrand a
pieusement recueillis, il s’en trouve que tout petits nous
avons entendus, nous avons chantés, ce sont pour ainsi dire
des souvenirs de famille.
NOTES :
(1) Léon Gautier : Histoire de la
poésie liturgique au moyen-âge. Les Tropes.
Paris, 1886.
(2) Voir A. Gasté : Les drames liturgiques de la
Cathédrale de Rouen, dans Revue catholique de Normandie,
t. II, 1892, p. 349 et suiv.
(3) Nouelz nouveaulx de ce présent an 1512... Paris, 1904.
(4) Quatre histoires par personnages sur les quatre
évangiles de l’Advent à jouer par les
petits enfans les quatre dimenches dudit advent... Paris, 1906.
(5) E. Myrand, Noëls anciens de la nouvelle France
Québec, 1907.
____
8 janvier 1923
____
Un Vieux Logis de Lisieux
Le Manoir Lambert, rue du Bouteiller
Notre concitoyen, M. Dubois, juge de paix honoraire, vient de rendre
à l’antique manoir où il habite,
l’aspect qu’il pouvait avoir à la fin du
XVIe siècle. Les colombages ont été
soigneusement repeints et les intervalles recouverts de couleur brune
filetée simulant des briquettes disposées en
chevrons héraldiques.
Qu’on se représente tous les manoirs de la rue aux
Fèvres traités de la sorte, la vieille rue
retrouverait bien vite cet air de jeunesse et de coquetterie
qu’elle eut jadis, aux heures brillantes de sa splendeur
aujourd’hui bien déchue.
De tous les manoirs de la rue du Bouteiller, le manoir Lambert est
assurément le plus intéressant. Construit
à la fin du XVe siècle, son
rez-de-chaussée en brique et pierre est très
caractéristique par les moulures et les torsades qui
entourent les fenêtres. L’étage, plus
récent, est bâti en colombages et les curieuses
lucarnes avec les têtes découpées qui
composent leur dentelure, rappellent bien l’imagination
capricieuse des artistes de la Renaissance.
Il est bien difficile de retracer l’histoire de ce manoir
dont je trouve trace, en l’année 1506, dans un
acte de vente passé entre Robin Buchart et Robert Aragon,
écuyer, de la paroisse du Coudray.
En 1540, il appartenait à Pierre Delaporte,
licencié en lois, avocat, qui le céda
à la veuve d’un certain Pierre Lambert. Le nom du
manoir ne vient pas de ce premier propriétaire, mais bien
d’un autre Pierre Lambert, conseiller du roi au
siège présidial d’Evreux, dont
j’ai rencontré le nom pour la première
fois en 1569 dans un acte de vente d’une maison bornant sa
propriété. Ce conseiller se distingua surtout par
son humeur ligueuse durant les guerres du XVIe siècle.
Nous ne savons depuis quelle époque Pierre Lambert
possédait cet immeuble ; de Caumont (
Statistique
du Calvados, t. V., p. 286), dit que le manoir fut construit pour lui.
Il ne partage pas cet avis, la partie basse est de beaucoup
antérieure à ce personnage qui se contenta
d’agrandir et de modifier un manoir plus ancien.
Quoi qu’il en soit, le 30 avril 1570, ledit Pierre Lambert le
bailla en échange à son frère Robert
Lambert, seigneur d’Herbigny, contre plusieurs
pièces de terre sises à Manerbe, et
nommées le lieu de la Viparderie. Robert Lambert habita
longtemps ce manoir, au moins jusqu’à la fin du
XVIe siècle, puisque lorsque Henri IV préleva une
contribution de guerre sur la ville, après sa soumission en
1590, Robert Lambert fut taxé à la plus grosse
somme, 750 livres.
Le propriétaire actuel, M. Dubois, ne possède
aucun titre antérieur à 1772, de sorte
qu’il est impossible, quant à présent,
de savoir quand et comment ce manoir est sorti des mains de la famille
Lambert.
Toujours est-il qu’en cette année 1772, il
appartenait à Jacques-François Becquet, bourgeois
de Pont-l’Evêque, qui le céda, le 29
mars, moyennant 5,500 livres, à Nicolas-Louis
Perrée des Isles, ancien officier de la maison royale. Ce
manoir est alors ainsi désigné :
« Une maison de fond en comble consistant en
plusieurs appartements à divers usages,
située en cette ville, rue du Bouteiller, paroisse
St-Germain, bornée d’un côté
la demoiselle Davy, d’autre côté lad.
rue du Bouteiller, d’un bout lad. demoiselle et
d’autre bout le sieur Christophe Paris et une
allée commune. »
Le manoir servait alors de caserne à des soldats du
bataillon du régiment de Limousin, qui se trouvaient en
garnison à Lisieux.
Pour agrandir son jardin, le sieur Perrée des Isles acquit,
l’année suivante, le 5 juillet, de
maître Antoine-Charles Le Bret, avocat au Parlement,
conseiller du Roi, rapporteur du Point d’honneur au
département de Lisieux et patron de
Saint-Martin-de-la-Lieue, un emplacement de terrain sur lequel se
trouvaient les restes d’une maison inhabitable, se
prolongeant jusqu’aux remparts près la tour
Lambert, dans laquelle l’acquéreur avait la
jouissance d’une cave basse dont la porte ouvrait sur son
jardin, moyennant une rente annuelle de dix livres, payable
à l’Hôtel de Ville de Lisieux.
La tour Lambert ayant été vendue comme bien
national et acquise, le 29 Ventôse an V (20 octobre 1796) par
Jacques-Guillaume Périer, gendre de Nicolas-Louis
Perrée des Isles, auquel il la céda le 14
Nivôse an V (3 janvier 1797), moyennant une somme de cinq
cents livres en numéraire et l’extinction
d’un certain droit de passage, la
propriété fut alors définitivement
constituée telle que nous la connaissons
aujourd’hui.
A la mort du sieur Perrée des Isles, sa succession fut
partagée entre ses trois filles. Sa veuve, dame Julie
Jacquet, désirant conserver pour elle le manoir Lambert,
donna en échange à la succession de son mari, le
7 Pluviôse an XI (27 janvier 1803), une terre et ferme
à elle appartenant, sise à Thiberville et
Fontaine-la-Louvet, au village de la Bulletière.
Le nom de manoir Lambert a toujours été
conservé à cet immeuble qui passe pour avoir
été la demeure du gouverneur de Lisieux, sans
doute en souvenir du séjour de la garnison, dont
j’ai parlé plus haut.
Puisse l’exemple, si bien donné par M. Dubois,
être suivi par tous les propriétaires de nos vieux
logis lexoviens !
____
16 juillet 1923
____
LES SECRETS DES VIEILLES RELURES
En ce temps là, au XVIe siècle, le carton
était rare et les relieurs, pour habiller les productions
toujours croissantes de l’imprimerie à son
apogée, ne se firent pas scrupule d’employer, pour
renforcer les plats de leurs volumes, tout le papier ou le parchemin
dont ils disposaient. Feuillets d’épreuves et de
volumes, manuscrits, gravures, minutes d’actes, tout fut mis
en usage, juxtaposé et encollé de
façon à fournir une matière
résistante pour recevoir la peau de veau si bien polie, sur
laquelle les relieurs poussaient, avec un art infini, ces fleurons et
ces fers azurés qui font aujourd’hui la joie des
bibliophiles.
Beaucoup de ces vieux livres nous sont parvenus dans un état
de délabrement lamentable et, à travers leurs
airs entrebaillés, il n’est pas rare
d’apercevoir des restes d’écriture ou
d’impression, que le curieux distingue et apprécie
tout de suite.
D’intéressantes trouvailles ont
été faites dans ces conditions, des ouvrages
inconnus, des gravures insoupçonnées ont ainsi
revu le jour, jetant une lumière nouvelle sur les origines,
encore obscures, de la xylographie.
Il y aurait un curieux chapitre à écrire sur ce
sujet s’il était possible de connaître
les résultats de toutes ces trouvailles. Il m’est
arrivé bien souvent de procéder ainsi
à l’équarrissage de très
vieilles reliures, et je conserve, dans mes cartons, bon nombre de
reliques ainsi découvertes.
Tout récemment, mon attention était
attirée par la couverture en velin fleuronné
d’un vieil in-folio, dont les plats
décollés laissaient apercevoir des indices qui ne
trompent jamais. Avec précaution je me mis à
l’oeuvre, et le résultat de mon
opération me mit en présence d’une
trentaine de fragments, manuscrits et imprimés dont la
valeur littéraire, n’offre pas un grand
intérêt, il est vrai, mais que compense la valeur
artistique, ainsi qu’on va le voir.
C’est dans un traité de Galien,
intitulé
Methodus medenti, imprimé en 1530 par
Simon de Colines, que cette trouvaille vient d’être
faite.
Ce sont d’abord quatorze fragments de manuscrits sur papier,
des XVe et XVIe siècles, presque tous des cahiers de
philosophie et de théorie, des vers latins et un fragment
d’un plumitif d’une juridiction portant la date du
« XIIIe jour de janvier. »
Sur l’un de ces fragments se trouve un reçu
mutilé, d’une certaine somme en or,
versée à « frère
Girard Bruntau, le 2 janvier 1518. »
Cinq fragments de parchemin, des mêmes
époques : acte de tutelle, donation ou constitution
de rentes dont une, notamment, devait servir au
bénéficiaire pour « le tems de
l’escolle et avoir ses nécessités quant
tems et besoing sera ». On y lit les noms de Velyot,
le costumier, Jehan Thomas dit Mignot et Christophe Paillard. Sur deux
autres lambeaux, les dates seules subsistent :
« l’an de grâce mil cccc quatre
vingts unze » et
« 1502 ». Le dernier, de plus
grande dimension, teinté régulièrement
de rectangles rouges, par dessus une écriture du XVe
siècle, est perforé à
l’instar de ces rouleaux de musique en usage pour divers
instruments mécaniques ; le mot
« deffaux » y figure plusieurs
fois, ainsi que le nom d’un certain Jehan Douche.
Les imprimés sont moins nombreux : quatre fragments
d’un livre d’Heures imprimé en gothique
avec bordures historiées, rappelant les immortelles
productions de Simon Vostre, et conservant une partie des litanies des
saints, ne permettant aucune attribution spéciale. Cinq
petits fragments d’un ouvrage de théologie
imprimé en caractères gothiques très
fins, avec initiales à fond criblé. Enfin, une
feuille contenant les sept dernières pages d’un
opuscule de saint Basile,
De legendis ethnicis opusculum
imprimé en lettres rondes.
Les deux pièces les plus curieuses sont deux fragments de
xylographes, imprimés d’un seul
côté et coloriés : le bleu, le
rouge et l’ocre sont seuls employés.
L’aspect des figures de ces deux gravures rappelle
l’
Ars moriendi, la
Bible des pauvres et le
Speculum
humanae salvationis.
Ces deux fragments appartiennent vraisemblablement à une
suite de gravures, avec légendes dans le bas,
disposées deux par deux sur la même feuille et
encadrées par un simple filet.
Le premier, qui mesure 225 millimètres de haut, y compris la
légende, est incomplet dans le sens de la largeur, qui ne
mesure que 100 millimètres. Il représentait, dans
son ensemble, la scène de l’agonie au Jardin des
Oliviers, Le morceau retrouvé ne montre que deux disciples
endormis et une partie de paysage avec tours et une flèche
d’église au dernier plan. La légende,
sur trois lignes, est empruntée au chapitre XXVI de saint
Mathieu ou au XIVe de saint Marc.
Le second fragment mesure 200 millim. de hauteur, non compris la
légende ; également incomplet dans le
sens de la largeur, il mesure 150 millim. et montre un
fragment d’une autre planche, sur la gauche. Le sujet
représenté est la Cène. Le Christ est
assis à table entouré de ses apôtres.
Il tient le pain de sa main droite et sa gauche s’appuie au
calice posé sur la table. Il est vêtu
d’une robe rouge et porte le nimbe crucifère,
c’est d’ailleurs le seul personnage qui soit
nimbé. Les apôtres sont assis sur des escabeaux de
bois et la scène se détache sur un fond de
vitraux à résilles de plomb. Judas est assis
devant le Christ, tenant à la main la bourse aux trente
deniers. Il ne subsiste qu’un lambeau de la
légende.
Je ne saurais, quant à présent, identifier ces
deux gravures. Appartiennent-elles à une suite formant un
ouvrage de même nature que ceux cités plus
haut ? ou sont-ce des produits de l’imagerie
populaire du XVe siècle ? Je pose la question aux
amateurs et aux érudits qui
s’intéressent à
l’étude des incunables de la gravure.
____
7 août 1923
____
L’HOTEL DE VILLE DE LISIEUX
L’hôtel de ville de Lisieux vient
d’être l’objet de modifications
intérieures, qui font complètement oublier
l’aspect qu’il offrait à la fin du
XVIIIe et même durant les premières
années du XXe siècle.
Le premier étage surtout a été
très remanié, permettant un groupement plus
rationnel des services, maintenant très à
l’aise dans des bureaux confortables et clairs.
A propos de rajeunissement, il ne sera peut pas sans
intérêt de faire connaître comment la
ville fut dotée de ce charmant hôtel, demeure
seigneuriale, maintenant maison commune de la cité de
Lisieux.
La constitution du Conseil de ville, par
l’évêque Thomas Basin, le 30 mars 1448,
est le premier document qui jette quelque lumière sur
l’histoire de l’administration municipale de
Lisieux.
Antérieurement à cette date, nous ne savons que
peu de chose, sauf que la population de la cité concourait,
dans une certaine mesure, avec le pouvoir épiscopal,
à l’administration des affaires de la ville.
Le regretté Jean Lesquier a réussi à
reconstituer le fonctionnement de cette administration et certains
traits importants de la vie municipale à Lisieux pendant le
second quart du XVe siècle. (1)
Antérieurement à 1445, il est impossible de
préciser l’endroit des réunions de la
Chambre de ville, nous n’avons aucun témoignage
sur ce point.
Le premier hôtel de ville connu ne fut qu’une
simple chambre, louée dans la maison de Colin Vagnel, le cas
échéant. Les comptes municipaux mentionnent cette
location à plusieurs reprises, mais sous forme temporaire.
La réforme municipale de Thomas Basin, en 1448,
eût pour conséquence la location
définitive de cette chambre qui servit, pendant dix ans, de
lieu de réunion et de chambre commune aux conseillers de
Lisieux.
Le 22 juin 1458, les bourgeois prirent à fieffe de
l’évêque un manoir, dont il subsiste
encore aujourd’hui quelques restes dans la
communauté de la Providence, et y installèrent
l’hôtel de ville. Enclavé entre la
Grande-Rue et la rue du Bouteiller, avec lesquelles il communiquait par
deux allées, cet hôtel fait un ensemble assez
compliqué de constructions, dont la plupart avaient
été réédifiées
au XVIe siècle, c’est du moins ce que permet de
supposer le bâtiment encore existant dans la cour de la
Providence.
Un plan de cet hôtel, conservé aux archives
municipales, montre quelle en était la composition
et la distribution, comportant une grande cour intérieure et
plusieurs logements que la ville louait à des particuliers,
ce qui augmentait ses ressources.
Le corps municipal y tint ses séances jusqu’en
1770, date à laquelle il se trouvait dans un tel
état de délabrement qu’il fallut songer
à pourvoir à sa restauration et même
à sa reconstruction. Nous en trouvons un écho
dans une information, faite le 5 septembre de cette année,
laquelle nous apprend que l’édifice
« est défectueux et
irrégulier ; qu’il est construit en bois,
en très mauvais état ;
entièrement caduque et de la plus mauvaise construction,
prêt à croûler, les pierres en
étant entièrement calcinées au point
qu’il s’en suivrait une
réédification à
neuf. »
Le maire de Lisieux, Noël Le Rat, lieutenant
général du bailliage vicomtal, avait
demandé à un architecte lexovien, Gabriel
Fontaine, de lui évaluer le montant de la dépense
à faire pour remettre en état les anciens
bâtiments de l’hôtel de ville. Un
état avait été dressé et il
se trouvait que le montant des travaux à effectuer
s’élevait à près de 40.000
livres, somme énorme pour la ville, dont les finances
étaient passablement obérées.
Les conseillers et notables furent donc convoqués pour en
délibérer et, le 7 mars 1770, en
l’hôtel commun, devant le maire, en
présence de MM. Dorville, Regnoult et Grainville,
échevins, et en l’absence de M. Bourdon, bailli
vicomtal de la ville et Jean Le Roux, sieur du Chesné,
procureur fiscal au bailliage, les conseillers Desbordeaux, Desperrois
l’aîné, Bullet et Caboulet, auxquels
s’étaient joints quelques notables, tel que Mes
Ledorey, chanoine ; Sébire, curé de
Saint-Jacques ; Le Cavelier, avocat, et de Neuville-Descours,
s’assemblèrent « en
état de commun » suivant la vieille
formule toujours en usage.
Le maire donna connaissance du devis de l’architecte Fontaine
et, sans en contester la sincérité,
déclara que la ville ne pouvait engager une pareille
dépense sans recourir à un emprunt,
« ce qui mettrait le comble à la
misère vu les charges cumullées que les besoins
présents de l’Etat ont forcé
d’impozer et encore en égard au prix excessif des
denrées, surtout du bled, cet objet de première
nécessité. Ces considérations si
naturelles dans une compagnie composée de citoyens qui ne
désirent que de contribuer au bien estre de la ville, nous
ont déterminé à différer
ceste entreprize, quoy que urgente, dans
l’espérance de tems plus heureux. Mais quand on
arriverait à ces tems tant désirés
pour le bien public, on rencontrera toujours un obstacle insurmontable
résultant de la situation et emplacement de cet
hôtel dont le terrain est étroitement
resserré par deux communautés qui le borne (sic)
de chaque côté et dans une position fort
désagréable et imcommode à
à accéder par rapport aux allées
estroites qui y conduisent, en sorte qu’après une
dépense considérable la ville ne trouvera pas un
sol d’augmentation dans ses revenus patrimoniaux et sera au
contraire assujettie à une dépense
journalière d’entretien à
d’anciens bâtiments qui diminuera le prix des
loyers actuels. »
Au lieu d’entreprendre la restauration du vieil
hôtel, une autre solution s’offrait, beaucoup plus
intéressante au point de vue pratique et au point de vue
financier : un hôtel confortable et bien construit,
situé dans le centre de la ville, sur la voie principale,
était à vendre, pourquoi ne pas
l’acheter ?
L’affaire était assez engageante ;
d’autant plus que le devis de Fontaine ne comportait que les
réparations les plus urgentes et les plus
économiques, et qu’un autre expert, Hubert,
ingénieur des Ponts et Chaussées au
département de Lisieux, avait déclaré
que pour remettre convenablement l’Hôtel-de-Ville,
il fallait compter au moins 60.000 livres, « un
hôtel de ville ne se rebâtit pas comme la maison
d’un petit bourgeois », disait-il dans son
rapport.
L’hôtel à vendre appartenait
à Pierre René de La Roque, seigneur de Serquigny,
lequel n’en demandait que 30.000 livres.
Le Conseil, après mûre réflexion, fut
d’avis qu’il y avait lieu
d’acquérir cet hôtel et qu’il
ne fallait pas laisser passer une occasion aussi avantageuse,
qu’un emprunt, avec ou sans intérêt,
serait fait et qu’il serait remboursé par
l’aliénation de l’ancien hôtel
commun.
Le 6 juin suivant, cette délibération
était approuvée par un arrêt du Conseil
d’Etat du Roi, dont voici les
conclusions : « Le Roy estant en
son Conseil a approuvé et homologué la
délibération prise par les officiers municipaux
et notables de la ville de Lisieux, le 7 mars 1770, pour être
exécutée selon sa forme et teneur. Permet, en
conséquence, ausdits officiers municipaux
d’acquérir, pour et au nom de la
communauté, la maison, cour, jardin et
dépendances appartenants au sieur de La Roque, tels que les
dits lieux qui se trouvent plus particulièrement
désignés sur la
délibération dudit jour aux fins, clauses et
conditions les plus avantageuses que faire se pourra, pour, ladite
maison, servir à l’avenir
d’hôtel commun ; leur permet en outre de
vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, par une ou
plusieurs adjudications, l’Hôtel de Ville actuel,
ensemble les bâtiments qui en dépendent, comme
aussi la portion de terrain faisant partie de ladite nouvelle
acquisition qui pourra être regardée comme
inutile, lors de l’établissement de
l’Hôtel de Ville. »
Le Parlement de Rouen, la grande Chambre assemblée ordonna
le 3 août, que les lettres patentes, datées du 16
juillet, homologuant cet arrêt, seraient lues,
publiées et affichées, aux messes paroissiales,
aux carrefours et marchés publics et qu’une
information « de commodo et
incommodo » serait faite, le sieur Louis Joseph Le
Chevalier d’Ecaquelon, conseiller du roi en sa cour de
Parlement de Normandie, fut délégué
à cet effet.
Ce conseiller se transporta donc à Lisieux, le 5 septembre,
pour l’exécution de cet arrêt et en vue
de procéder à l’enquête. Il
entendit successivement Daniel Varin, 38 ans, vicaire de
Saint-Jacques ; J.-B. Mignot, prêtre
habitué en l’église
Saint-Germain ; J.-B. Hébert, 42 ans, chanoine
promoteur ; Nicolas Louis de Giverville, écuyer,
sieur de Saint Aubin, 65 ans, demeurant près la porte de
Paris ; Louis François Douesy, chevalier, seigneur
de Montfort, 26 ans, conseiller au Parlement de Normandie, demeurant
ordinairement à Rouen, rue d’Ecosse, paroisse
Saint-Godard, actuellement dans son hôtel à
Lisieux ; Jean Armand, Antoine de Voine de Fermanel, 60 ans,
demeurant à Lisieux, rue des Trois Marches ; Hugues
Yon, 65 ans, conseiller du roi, grenetier au grenier à sel
de Lisieux, demeurant rue du Bouteiller ; Guillaume Poret, 68
ans marchand, demeurant Grande Rue et Pierre Louis Regnault, 54 ans,
demeurant rue Pont Mortain.
Aucune note discordante n’est relevée dans cette
information, tous sont unanimes à reconnaître le
bien fondé de cette opération, qui ne peut,
disent-ils, qu’être très fructueuse et
très utile à la ville.
En conséquence, le Parlement de Rouen, par un nouvel
arrêt du 14 septembre, ordonna que les lettres-patentes
seraient enregistrées et exécutées
selon leur forme et teneur.
Restait donc à procéder à
l’acquisition du nouvel Hôtel-de-Ville, ce qui eut
lieu le vendredi 1er février 1771, en la maison du maire, en
présence de Pierre Coudrey, commis au greffe des
Insinuations ecclésiastiques du diocèse de
Lisieux et Pierre Moisy, praticien, demeurant en la même
ville.
Par devant Jacques-Louis Daufresne, notaire royal à Lisieux,
fut présent messire Pierre-René de La Roque,
chevalier, seigneur et patron du bourg et paroisse de Serquigny,
demeurant en son château de Serquigny, de présent
à Lisieux, lequel vend à la ville et
communauté de Lisieux, représentée par
MM. Noel Le Rat, lieutenant général du baillage
vicomtal de ladite ville, maire ; Christophe Grainville,
avocat au Parlement de Normandie ; Pierre Loir,
négociant et Louis-Nicolas Bullet des Londes, marchand,
échevin de Lisieux, « une maison avec la
cour, remise, bûcher, écurie, pavillon de devant
ladite maison et enclos comme le tout est, le droit de fontaine y
attaché, le jardin étant derrière
ladite maison et une place de terre vide étant à
costé ledit jardin du costé de la rue
Haute-Boucherie ; le tout situé en cette dite
ville, Grande-Rue de la Porte-de-Paris et rue au Char, paroisse
Saint-Jacques... »
Etaient compris dans cette vente, la tapisserie à
personnages, « placée et tendue dans la
grande salle et les sonnettes de métal attachées
et scellées dans les différents
appartements. »
Le vendeur se réservait les meubles meublants :
lits, secrétaires, tables de marbre avec leurs consoles,
trumeaux contre les cheminées et tous meubles portables
ainsi que les armoires en lambris placées au second
étage, le tout devant être enlevé dans
un délai de quatre mois.
La vente était consentie moyennant 28.000 livres en
principal et 1.200 livres « pour le pot de
vin » du marché.
Sur cette somme furent versées 12.000 livres et les 1.200
livres de vin, sur les deniers appartenant à la
ville ; le reste devait être payé au
vendeur, en son château de Serquigny, dedens dix-huit mois,
avec l’intérêt. Cette
dernière somme fut soldée le 28 août
1772.
Cet acte fut contrôlé et insinué le
même jour et, le dimanche suivant, le notaire en donna
lecture à l’issue de la grande messe de
l’église Saint-Jacques, en présence de
François Duclos, Thomas Le Bourlier, Jean Gallot, Jacques Le
Conte, Louis Lelasseur et Louis Graindorge, tous bourgeois de Lisieux.
La remise des anciens titres qui fut faite au maire lors de la
passation de l’acte, nous permet de retrouver les origines de
propriété de cet hôtel.
En 1712, il était en la possession de Raoul Demoy,
écuyer, seigneur d’Ectot, conseiller au parlement,
épouxe de noble dame Barbe Le Bas,
héritière en partie de noble dame Antoinette de
Vimont, sa mère, par contrat passé devant Me
Coignard et son confrère, notaire à Rouen, le 7
février 1712.
En 1740, le 10 mai, dame Marie-Barbe Regnauld de la
Girardière, veuve de maître Charles Le Bas,
seigneur et patron de Saint-Sébastien de Préaux,
conseiller du roi, ancien receveur des Tailles en l’Election
de Lisieux, et Charles Louis le Bas, son fils, le vendent, moyennant
25.300 livres, à messire François-Claude
Duval-Lenormand, écuyer, seigneur et patron de Victot,
conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne de France,
demeurant à Lisieux, rue du Bouteiller.
Ce dernier la cède à son tour, le 29 mars 1753,
moyennant 23.000 livres, à messire Pierre-René de
La Roque, de Canon, seigneur de Serquigny, demeurant à
Lisieux, Grande-Rue de la Porte-de-Paris, dernier possesseur avant la
ville.
Un plan ancien et une façade en
élévation de cette demeure font bien voir les
transformations que la ville ne tarda pas à faire
à son hôtel.
En effet, la cour intérieure n’était
pas ce qu’elle est aujourd’hui ;
l’aile droite n’était pas construite,
son emplacement était occupé par des maisons
vétustes qui disparurent bientôt pour faire place
à une construction en rapport avec l’aile bordant
la rue du Char, qui fut elle-même exhaussée
d’un étage.
Aussitôt que la commune fut en possession de son nouvel
Hôtel de Ville, elle chargea le sieur de Cessart,
ingénieur en chef des ponts et chaussées de la
Généralité
d’Alençon, de dresser un rapport concernant les
changements proposés par les officiers municipaux.
« La maison de M. La Roque, disait-il le 3
août, dont l’Hôtel de Ville de Lisieux
vient de faire l’acquisition est beaucoup trop
étendue pour y faire simplement une maison de ville. Il y a
lieu d’y établir, outre les appartements
nécessaires à la ville, les casernes de la
maréchaussée, un corps de garde pour les troupes
passantes ou en garnison, avec un magasin pour le
dépôt des équipages et
différentes autres dispositions pour louer le jardin et une
partie des appartements à des particuliers, au profit de la
ville. »
Le détail estimatif comportait l’exhaussement
d’un étage de l’aile gauche existant, la
construction de l’aile droite et autres changements et
réparations dont le montant était
prévu à 22.614 livres 14 sols.
Pour parvenir à ce résultat, il fallait encore
recourir à l’autorité royale afin
d’obtenir l’assentiment nécessaire.
C’est ce qui motiva l’arrêt suivant du
Conseil d’Etat, donné à Versailles, le
7 janvier 1772 :
« Le Roy en son Conseil, a permis et permet aux
officiers municipaux de la ville de Lisieux de faire, à la
maison qu’ils ont acquise du sieur de La Roque, et qui leur
sert maintenant d’Hôtel de Ville, les changements
et constructions portés au rapport du sieur Cessart,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, que sa
Majesté a homologué et homologue, et qui
consistent :
1° Dans l’exhaussement d’un
étage sur l’aile gauche de la cour dudit
hôtel pour servir de corps de garde et de chambre de
discipline pour les troupes et de logement pour les pompes et autres
ustensiles pour les incendies et au concierge dudit Hôtel de
Ville.
2° Dans la construction neuve d’une aile droite dudit
hôtel, avec pavillon pour servir de logement à la
brigade de maréchaussée.
3° Dans une écurie pour les chevaux de ladite
brigade.
4° Dans différents changements dans le grand
bâtiment pour parvenir à sa location. Veut, sa
Majesté, que les ouvrages dont il s’agit ne
puissent être entrepris que d’après
l’adjudication au rabais qui en sera faite par devant
l’Intendant et commissaire départy en la
Généralité
d’Alençon ou son
délégué qui sera chargé de
veiller et d’en ordonner le paiement. »
Aux termes de cet arrêt, le sieur de Cessart dressa un
détail des changements et des nouveaux ouvrages à
faire ; ce document avec les plans et devis, furent
adressés aux maires et échevins, le 8 mai, par
les soins de l’Intendant de la
Généralité
d’Alençon.
Ces travaux furent mis en adjudication, qui fut publiée
à trois reprises, par Charles Morel, huissieur audiencier.
Elle eut lieu, le 22 juin 1772, en l’Hôtel de
Ville, devant le bailli de Lisieux, Bourdon de Beaufy,
délégué de l’Intendant.
L’ensemble du travail fut adjugé, moyennant 23.380
livres à un nommé Louis Pimbert.
Les récents travaux de transformation que vient de subir
l’Hôtel de Ville, les modifications
apportées dans sa distribution intérieure, nous
interdisent toute comparaison avec le texte du devis de 1772, qui
semble néanmoins avoir été
exécuté dans son entier.
NOTE :
(1) L’Administration et les Finances de Lisieux de 1423
à 1448, dans Etudes lexoviennes, t. II, pages 37 et
suivantes.
____
8 septembre 1923.
____
A PROPOS
du « Champ Saint-Ursin »
DE LISIEUX
Nous n’irons plus au bois
Les... arbres sont coupés....
Nous pouvons, en effet, chanter avec une certaine pointe de tristesse
la ronde célèbre ; les arbres de la
côte Saint-Ursin sont tombés.
Sans pitié pour leur robuste et verte vieillesse,
méconnaissant l’ombre et la fraîcheur
qu’ils répandaient sur la côte
aujourd’hui dénudée, on les a fait
disparaître, sans se douter qu’on
déshonorait, de ce fait, un des plus anciens sites de
Lisieux.
Puisqu’il n’a pas été
possible d’empêcher cet acte de vandalisme, il me
sera bien permis d’évoquer les souvenirs du
passé de ce coin célèbre :
interrogeons pour cela les vieux parchemins.
Sortant de Lisieux par l’ancienne porte de Paris, longeant
les mornes bâtiments de l’hospice
jusqu’à la rue Roger-Aini, à droite, le
promeneur s’engageant dans cette voie raboteuse et montante,
accède bientôt à un plateau connu sous
le nom de « Côte
Saint-Ursin ».
C’est là que verdoyait jadis cette fameuse
forêt Rathouin, si souvent mise à contribution par
les charpentiers pour la construction des vieilles demeures qui sont
aujourd’hui la parure de Lisieux.
La tradition nous apprend que ce fut à cet endroit que se
produisit, au XIe siècle, le miracle de la châsse
de « Monsieur Sainct Ursin » dont
le souvenir nous a été conservé par le
tableau bien connu qui se voit toujours dans l’ancienne
chapelle de la Charité, en l’église
Saint-Jacques.
Cet emplacement était demeuré dans le domaine non
fieffé de l’évêque. La
piété populaire en avait fait un lieu de
pèlerinage très fréquenté
et une croix avait été plantée
à l’endroit ou saint Ursin avait, si
manifestement, fait connaître son intention de demeurer
à Lisieux.
La nature de ce terrain, sans cesse foulé aux pieds par des
foules pieuses, par les processions qui s’y rendaient
à des dates déterminées,
l’avait fait considérer, de temps
immémorial, comme une non-valeur pour le comté de
Lisieux. En effet, jamais le champ Saint-Ursin ne figure dans les rares
comptes épiscopaux qui nous sont parvenus.
Le 20 août 1770, par devant Jacques Louis Daufresne, notaire
royal, illustrissime et révérendissime seigneur
Jacques Marie de Caritat de Condorcet, conseiller du roi en tous ses
conseils, évêque et comte de Lisieux,
étant en son palais épiscopal,
désirant tirer utilité pour le comté
de Lisieux d’un terrain en friche nommé le champ
Saint-Ursin, faisant partie du domaine non fieffé de cet
évêché et comté de Lisieux,
situé en la campagne de Saint-Jacques, contenant trois acres
vingt-trois perches, borné au nord par le grand chemin de
Paris ; au midi, par les héritages d’un
nommé Thorel ; à l’est, par
les héritages du nommé Jean Nasse ;
à l’ouest, par les héritages de M. Le
Bas de Préaux ; ce terrain était
demeuré inutile de temps immémorial et de nulle
valeur et ne pouvait, dit l’acte, « dans
l’état actuel être d’aucun
produit audit comté de Lisieux, ledit seigneur
évêque a cédé et
abandonné, à titre de fieffe
perpétuelle, à Charles Louis Le Bas, seigneur et
patron de Préaux et des fiefs de la Nollard et de Friardel,
conseiller du roi, receveur ancien et alternatif des tailles de
l’Election de Lisieux, y demeurant, paroisse Saint-Jacques,
deux acres et demie, vingt-six perches et demie de terre ou environ,
à prendre sur le terrain ci-dessus borné, le
surplus devant être réservé pour
l’entrée et la sortie des processions qui ont
coutume d’aller en dévotion à la croix
qui est sur ce lieu et cela, par la partie qui fait angle, au levant,
avec le chemin de Paris et les héritages du sieur Jean
Nasse. »
L’acquéreur pouvait clore son terrain, mais il
devait faire en sorte qu’il y ait autour de la croix, tant du
côté du sud que du côté du
nord, cinquante pieds de terrain libre pour l’usage des
processions qui voudront y aller faire leurs prières. Cette
partie réservée ne pouvait être
enfermée par aucune clôture et
l’entrée ordinaire demeurait à
l’encoignure de la pièce du sieur Jean Nasse.
Le preneur pouvait tirer de la marne dans le terrain fieffé,
mais sans porter préjudice à
l’accès des processions et
l’évêque avait la faculté de
prendre, sur le terrain réservé, du gazon et
terre pour son usage.
Cette fieffe était consentie moyennant quatre cents livres
de rente foncière, perpétuelle et non rachetable,
laquelle rente devait commencer à courir à
Noël de la présente année 1770.
L’acte fut passé au palais épiscopal,
le vendredi avant midi, 20 avril 1770, en présence des
sieurs Charles Morel, huissier, et Pierre Moisy, praticien, demeurant
en cette ville, contrôlé et insinué le
lendemain.
Aussitôt en possession du terrain, le sieur Le bas
commença par faire délimiter la partie
réservée autour de la croix. Le mardi 12 juin,
Michel-Hubert Chiron, arpenteur juré et reçu au
bailliage d’Orbec, demeurant à Drucourt, certifie
qu’il s’est transporté sur une
pièce de terre en herbe, nommée la
« Place de la Croix
Saint-Ursin », à l’effet de
déterminer les cinquante pieds prévus par le
contrat de fieffe. Le tout fut fait à la mesure royale
d’Orbec, vingt-deux pieds à la perche.
En homme prudent et avisé, le sieur Le Bas, envisageant que
par la suite il pourrait s’élever des
difficultés au sujet de cette fieffe, désirant
sauvegarder ses intérêts, adressait, le 4 avril
1772, au lieutenant général civil et criminel au
bailliage d’Orbec, une supplique dans laquelle il
s’exprimait ainsi : « Il est
constant et reconnu, par le contrat, que ce terrain était
demeuré inculte de temps immémorial et par ce
moyen ne produisait aucun revenu au comté de
Lisieux ; la fieffe qui en est faite aujourd’hui est
donc un avantage pour le seigneur évêque et ses
successeurs. »
Le suppliant avoue que s’il l’a portée
à un si haut prix, « ce n’a
été qu’en considération de
la proximité de ce fonds qui se trouve voisin du sien et
parce qu’au moyen des améliorations et
augmentations qu’il compte y faire, il en ressortira, dans la
suite, un avantage pour lui et ses successeurs. »
Dès l’hiver de 1771, le sieur Le Bas avait
commencé par faire entourer le terrain de plantes vives en
orme et épine, puis avait fait porter dessus des terres et
du fumier en grande quantité pour y former un sol qui puisse
le disposer à produire quelque chose le plus tôt
possible, et de plus, y avait planté beaucoup de jeunes
arbres.
Mais, comme toutes les choses nécessaires pour vaincre
l’ingratitude du sol et forcer la nature,
n’étaient pas faites à beaucoup
près, le sieur Le Bas n’avait pas cru devoir
continuer ses travaux qu’auparavant il
n’eût fait constater la nature et cause de la
clause du contrat de fieffe qui portait qu’en cas
d’éviction dudit fonds par ceux qui pourraient se
présenter avec titres valables pour le réclamer
comme ayant été réuni au domaine non
fieffé dudit comté de Lisieux faute
d’aveu, le suppliant et ses successeurs
« seront remboursés de toutes leurs
dépenses, frais de culture, plantations,
améliorations, etc. »
C’était pour parvenir à ce
résultat que le sieur Le Bas adressait cette
requête, demandant que le seigneur
évêque soit appelé devant le juge pour
s’entendre dire que cette estimation sera faite par experts
choisis par les parties.
Cette requête fut signifiée à
l’évêque, le 2 mai, par le
ministère de François Lemire, huissier audiencier.
Trois jours plus tard, devant Jean-Baptiste-Antoine Desperriers,
chevalier, seigneur haut justicier de Saint Mards de Fresne, seigneur
et patron du Besneray, chevalier de l’ordre royal et
militaire de Saint-Louis, conseiller du roi, lieutenant
général civil et criminel au bailliage
d’Orbec : « Vu les conclusions
portées sur le plumitif par Me Guérouet,
procureur du sieur Le Bas, et Me Milcent, procureur de
l’évêque, il est
décidé que l’expertise sera
faite » et le sieur Le Bas de Préaux
choisit pour cette opération Marc Tabarie, laboureur
à Saint-Martin-de-Mailloc et Guillaume Champagne, aussi
laboureur à Saint-Denis-de-Mailloc et que
procès-verbal en sera dressé par les experts. Le
demandeur n’oublie pas de faire remarquer que jamais le champ
Saint Ursin n’aurait pu produire semblable rente sans
amélioration.
Le 12 mai, cette sentence était signifiée
à l’évêque de Lisieux par le
même François Lemire, lui enjoignant de se trouver
le lendemain à l’audience du bailliage
d’Orbec, en même temps que les experts
désignés par le sieur de Préaux. Le 13
mai, les procureurs des deux parties se
présentèrent devant le lieutenant du bailliage
ainsi que les experts désignés et il leur fut
enjoint, en leur âme et conscience, de dresser le
procès-verbal en question, ce qu’ils promirent et
se soumirent faire.
Sept jours plus tard, devant le lieutenant du bailliage, les deux
experts déclarent avoir parcouru et visité le
champ Saint Ursin et que de leur examen il
résulte : « que le terrain
fieffé est, de sa nature, de nulle valeur,
n’étant en son intégrité que
terre glaise en une partie et tuf dans l’autre partie, le
tout couvert de mousse et de bruyère, lequel terrain
n’aurait jamais été d’aucun
produit audit seigneur évêque étant
inculte de temps immémorial. Mais en
considération de ce que ledit terrain est à
proximité des héritages dudit sieur de
Préaux, nous l’avons estimé
à cinq livres de rente
foncière. » Ils constatent ensuite les
améliorations et les travaux faits par le sieur de
Préaux et estiment, dans leur état actuel, les
travaux exécutés à la somme de huit
cents livres. Lecture leur est alors donnée de leur
procès-verbal qu’ils reconnaissent
sincère et véritable.
Le 2 juin suivant, le contrat de fieffe du terrain était
déclaré homologué et le sieur de
Préaux maintenu et gardé en la possession et
jouissance de la portion de terrain faisant partie du champ Saint
Ursin, le tout aux charges et conditions du contrat du 20 avril 1770,
faisant défenses à toutes personnes de troubler
le possesseur dans la jouissance de ce bien.
Cette paisible jouissance dura à peine dix ans, au bout
desquels elle fut troublée par un
événement tout à fait inattendu.
Le 15 juillet 1782, les officiers municipaux de la ville de Lisieux
prenaient une délibération tendant à
faire transporter hors la ville les cimetières de
Saint-Germain et de Saint-Jacques, au nom de certaines
considérations d’hygiène, longuement
développées dans la
délibération et se référant
surtout à un arrêt du Parlement de 1781, relatif
aux cimetières des campagnes. Les officiers municipaux
avaient choisi comme lieu de transfert le terrain autrefois
dédié à Saint Ursin, au haut de la
montagne de ce nom. Ce terrain, de l’avis de tous, et des
médecins en particulier, la nature d’un lieu
déjà béni, indiquaient suffisamment
que le choix devait être agréé.
Un arrêt du Parlement de Rouen, du 15 mars, approuvait cette
mesure qui était notifiée aux officiers
municipaux, le 19 avril, en la personne de Me Aubert,
secrétaire et greffier de la chambre et maire de Lisieux et,
le lendemain, à M. Le Bas de Préaux,
propriétaire de la partie du Mont-Saint-Ursin, ainsi choisi.
Naturellement, ce dernier fit opposition et déclara avoir
remis à la Cour une requête en ce sens. Dans cette
requête, il exposait que les députés de
la municipalité s’étaient
arrangés avec un sieur Sanson, marchand, de la paroisse
d’Ouilly-le-Vicomte, qui s’était
proposé de leur céder un terrain convenable pour
le transfert des cimetières.
En effet, le 10 juillet 1782, le sieur Sanson attestait à M.
Le Bas de Préaux que dans le cas où la
translation des cimetières serait jugée
nécessaire, conformément aux dispositions de la
déclaration du Roi de 1776, il était
prêt à céder et abandonner à
la première réquisition, en toute
propriété, à des conditions justes et
raisonnables, aux fabriques de Saint-Jacques et de Saint-Germain et au
Chapitre de la ville de Lisieux, deux pièces de terre sises
en la paroisse et campagne de Saint-Jacques, qu’un certificat
de François Hubert, locataire du sieur Sanson, en date du 7
septembre 1782, dit être bornées, au nord, par le
chemin allant à la chapelle du Bois ; au sud, le
nommé La Mare ; à l’est, le
sieur Sanson et à l’ouest, la grande route de
Lisieux à Honfleur.
Mais le sieur Le Bas avait des ennemis qui avaient,
paraît-il, fait changer subitement d’avis les
députés et les avaient
déterminés à choisir son terrain du
Mont Saint-Ursin. Le malheureux propriétaire en fait
aussitôt ressortir tous les désavantages au point
de vue de la nature du sol, de la superficie et surtout il laisse
entrevoir le préjudice énorme que cela va lui
causer, étant donné les travaux et les
dépenses qu’il a faits pour mettre ce terrain en
état de produire.
Le Parlement de Rouen rendit un arrêt le 22 avril, disant que
cette opposition serait transmise au procureur
général et l’opposant était
autorisé à assigner les maire et
échevins de Lisieux aux fins de se désister sur
ladite opposition, ainsi qu’il appartiendra, et à
procéder en conséquence de
l’arrêt du 15 mars.
Dans un nouvel arrêt, du 5 juillet 1782, le Parlement de
Normandie ne se prononce pas définitivement, il ordonne
qu’une enquête
de commodo et incommodo sera
ouverte et qu’un procès-verbal en sera
dressé, quand la visite des divers terrains
proposés aura été faite.
Un nouvel arrêt, du 12 juillet, décide que le
sieur de Saint-Germain, conseiller au Parlement, se transportera
à Lisieux pour surveiller l’enquête et
assister à la rédaction du
procès-verbal.
Le 12 septembre, Jean Piperey de Saint-Germain, conseiller du Roi en sa
cour de Parlement, mande de son hôtel à Rouen, au
sieur Le Bas et aux maire et échevins de Lisieux, de se
trouver, le jeudi 3 octobre, à huit heures du matin, sur le
terrain du mont Saint-Ursin désigné dans la
délibération du 15 février et dans
l’arrêt du 15 mars, pour se rendre ensuite aux
autres endroits que le sieur de Préaux désignera.
En conséquence, le jeudi 3 octobre, Noël-Jean
Piperey de Saint-Germain, en présence de
Jean-Gaspard-Benoît Charles, conseiller substitut du
procureur général, assisté de
Pierre-Auguste Mustel, conseiller du roi, notaire en la cour de
Parlement, pour exécution des arrêts rendus les 5
et 22 juillet, auxquels s’étaient joints les
sieurs François-Auguste Yon, avocat au Parlement, et
Guillaume-François Ricquier, négociant,
l’un et l’autre échevins de la ville de
Lisieux et Nicolas Boissey, avocat au Parlement,
député par la ville, et dame Antoinette-Catherine
Levasseur, épouse du sieur Le Bas de Préaux,
dûment autorisée par ce dernier, se
réunissaient à l’endroit convenu.
Les députés de la ville commencèrent
par faire ressortir tous les avantages du terrain choisi,
situé sur une montagne à l’est de la
ville, où les vents y circulent librement ; que
cette montagne excède la plus haute tour de la
ville ; qu’il n’y a point de terrains aux
environs plus élevés ; que le sol
paraît très propice pour la consommation des
corps, bref toutes sortes de bonnes raisons qui semblaient devoir
militer en faveur de leur projet.
La dame de Préaux répondit que les officiers
municipaux donnaient la preuve la plus évidente de leur
acharnement en persistant dans le choix qu’ils avaient fait.
Elle expose à son tour tous les désavantages du
projet ; difficulté d’accès
à cause de l’encombrement que le transfert du
corps allait causer dans la rue Etroite ; la mauvaise
qualité du sol et bien d’autres
considérations longuement exposées et
développées dans le procès-verbal, qui
ne comprend pas moins de 26 pages in-folio d’une
écriture très serrée.
Elle proposa ensuite d’autres terrains qui avaient
été offerts par des particuliers,
situés, l’un à peu de distance de la
ville, entre la nouvelle et l’ancienne route de
Pont-l’Evêque, et l’autre,
près le chemin de la Chapelle du Bois.
Une longue discussion s’établit ensuite entre les
députés de la ville et la dame de
Préaux ; on ordonna même de pratiquer des
fouilles à divers endroits.
Enfin, le procès-verbal est clos, le 8 octobre et, en ce qui
concerne le champ Saint-Ursin, il est finalement reconnu que ce
terrain, s’il est le plus voisin de la ville, est
d’un accès et d’un travail difficile et
que la plus grande partie mise en valeur par les travaux du sieur de
Préaux, serait d’un prix onéreux.
Le dossier de cette affaire est incomplet, car il ne contient pas le
texte des lettres-patentes accordées par le roi, au mois de
mai 1783, au sieur Le Bas de Préaux, lettres qui closent en
réalité le débat. Il ne les
connaît que par un arrêt du Parlement de Rouen, du
28 novembre 1783, y faisant allusion, déclarant que le roi,
par ces lettres, a confirmé le contrat de fieffe du 20 avril
1770, lequel demeure en force et vertu et doit être
exécuté selon sa forme et teneur.
Cet arrêt du 28 novembre met fin à cette longue
procédure. Le sieur Le Bas eut gain de cause et demeura
paisible possesseur de son champ. Bien plus, la Grande Chambre
assemblée, ordonna que les lettres-patentes seraient
registrées ès registres d’icelle pour
recevoir pleine et entière exécution,
n’oubliant pas de rappeler le libre accès
à l’emplacement réservé pour
l’usage des processions et autres
cérémonies de dévotion
pratiquées à la croix plantée sur le
champ Saint-Ursin.
L’année suivante, les cimetières
préoccupèrent encore la municipalité,
jusqu’au jour où le Champ-Remouleux devint la
nécropole de la ville de Lisieux.
Pour faire sans doute oublier le souvenir de leur impardonnable faute,
une avenue de jeunes arbres a été
plantée en face de la vieille croix, qui demeure
l’objet de vénération de la
piété populaire.
Il nous faudra attendre bien des années encore, avant que
leurs rameaux soient assez vigoureux pour remplacer les
épaisses frondaisons des arbres séculaires que
nous regretterons toujours.