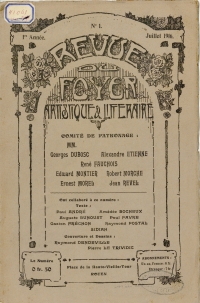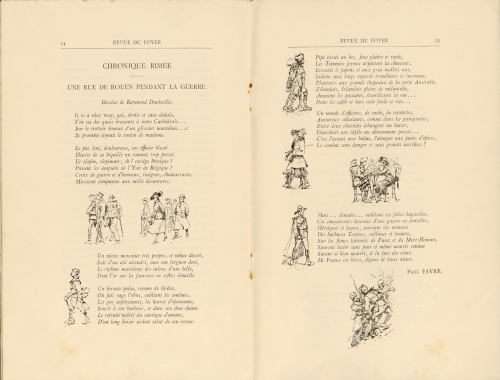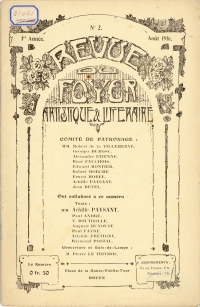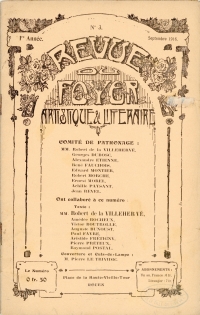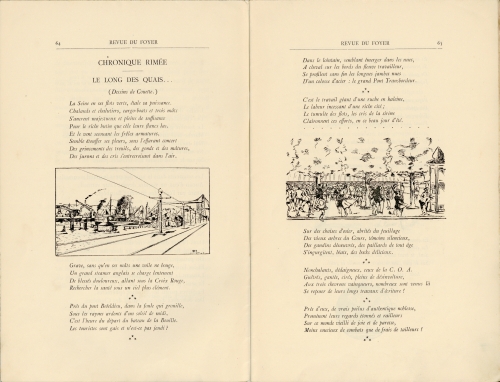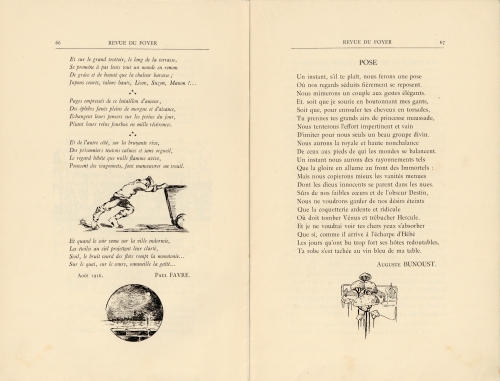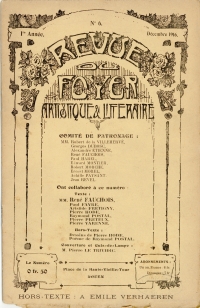|
Revue du
Foyer, Organe Mensuel du Foyer Artistique et
Littéraire / RAYMOND POSTAL,
secrétaire de rédaction.PAUL FAVRE,
rédacteur en chef.- Rouen : Imprimerie Lecerf, 1916.- N°1-6,
juillet-décembre.- 136 p. : ill. ; 25 cm.
Saisie du
texte : O. Bogros pour la
collection
électronique de la Médiathèque
André Malraux de Lisieux (01.VII.2016)
[Ce texte n'ayant
pas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement des
fautes non corrigées].
Adresse : Médiathèque André Malraux,
B.P. 27216,
14107 Lisieux cedex
-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01
Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]
obogros@lintercom.fr
http://www.bmlisieux.com/
Diffusion
libre et gratuite (freeware)
Orthographe (même fautive)
et graphie conservées.
Texte
établi sur les exemplaires de la Médiathèque (Bm Lx : 41061), n°1 à
n°6, 1re année, juillet-décembre 1916
REVUE
DU
FOYER
ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
ROUEN
Place de la Haute-Vieille-Tour
[SÉLECTION D'ARTICLES]
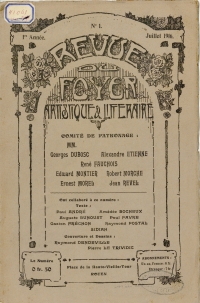
~ * ~
1re Année. - 1er Juillet 1916. - N°1.
NOTRE BUT
Ne vous effrayez pas, ne criez pas à l'impudence ! au scandale ! « Oh !
quoi, direz-vous, vous écrivez encore à cette heure ! » Eh ! oui, mieux
que ça, nous avons fondé une société nouvelle, nous éditons une
nouvelle revue ! Il faut, avouons-le, un parfait courage pour tenter,
en ces temps de tristesse et de deuil, une pareille
entreprise.
Des canons ! des munitions ! voilà le vrai cri de rappel, voilà le
ralliement des âmes. Des sonnets, fussent-ils sans défauts, des
articles, des vers, la France n'en a cure ! Il lui faut non des poètes
pâlissant sous le joug d'une Muse rébarbative, mais des hommes
d'action. Très modestement, sans citations, sans croix de guerre, nous
réclamons l'honneur d'être, nous aussi, de ces hommes-là.
L'action a toute la France comme domaine. Sur les rives de la Meuse et
de l'Oise, de l’Yser et de l'Aisne, le canon tonne, sans trêve, sans
arrêt. Des légions héroïques s'immortalisent de la gloire la plus pure
à défendre notre sol souillé par le barbare, à s'efforcer de bouter
l'ennemi. A l'arrière, jour et nuit, sans répit encore, des milliers
d'ouvriers, vulcains modernes, forgent dans le rouge brasier l'airain
qui brisera l'ennemi et tonnera la victoire. Plus à l'arrière, tout un
peuple vit dans une sainte communion avec ses défenseurs, tait sa
douleur, tait ses souffrances, vit de fiévreuses attentes, d'infinis
espoirs en un lendemain toujours reculé, et travaille de toute son âme
à conserver intacte et belle la France que le teuton ne ravira pas.
La fermière pousse la charrue dans les sillons des plaines, la ménagère
tourne les obus à l'usine, l'industriel, le commerçant ouvrent à
nouveau leurs ateliers, rallument les feux depuis longtemps éteints.
C'est le réveil d'une nation qui a voulu vaincre et qui veut vivre. A
ce renouveau du monde, l'artiste resterait-il insensible et sourd ?
Etouffant ses sanglots, oubliant ses douleurs, voilant sa misère, le
peintre a repris son pinceau, le graveur son burin, le musicien son
archet, le poète sa lyre.
Nos poilus immortels font à la frontière un rempart de leurs poitrines,
leurs sang coule à flots pour nous conserver la France, la belle France
de nos aïeux.
Nous, les « gens de plume », voulons, à l'heure du retour, dire aux «
gens d'épée » :
« Vous n'avez pas voulu que la France devînt province d'Allemagne, vous
vous êtes immolés pour lui épargner ce suprême déshonneur ; nous, à
notre tour, nous vous rendons une France vierge de toute pollution de
kultur germanique ». Pour être dignes de nos frères de là-bas, pour
parachever leur œuvre, pour maintenir la gloire littéraire de notre
Patrie, au travail !
Au travail, c'est bien, mais, nous direz-vous, quel est votre programme ?
Très simple, nullement prétentieux. Nous lutterons le bon combat pour
le Beau, pour le Vrai dans le Beau. Sans nous embarrasser de vaines
formules d'écoles, chacun de nous conservera son caractère, son
tempérament propre. Notre Foyer doit justifier son nom : l'humble logis
familial où nous viendrons nous retremper dans une saine émulation
d'idées nobles et généreuses.
AMIS LECTEURS,
En répondant, généreux, à notre appel, vous avez compris le but de
notre Œuvre ; c'est pour nous le meilleur des réconforts et le plus
grand des stimulants.
Des Normands qui, dans le domaine de la pensée humaine, ont illustré
notre petite Patrie, nous ont, d'ailleurs, dans notre Comité de
Patronage, apporté le précieux appui de leurs noms :
M. RENÉ FAUCHOIS , l'auteur applaudi de Beethoven , de la Forêt-Sacrée ,
de l'Augusta , a bien voulu couvrir de sa jeune gloire nos modestes
débuts.
Un illustre vétéran des lettres, le puissant romancier d'Un Cérébral et
de Rustres , M. JEAN REVEL , nous accordait son concours par ces mots
d'une foi sincère : « Je suis à vous de corps et d'âme », tandis que M.
EDW. MONTIER , le noble poète de Marie-Antoinette et l'auteur de tant
d'ouvrages d'éducation, encourageait aimablement nos efforts. MM.
GEORGES DUBOSC et ERNEST MOREL , critiques autorisés, ont accepté avec'
la plus parfaite bonne grâce d'être nos parrains auprès de la Presse
rouennaise.
M. MORCHE , Directeur de la Revue des Indépendants ; M. ETIENNE ,
Directeur de l'ancien Donjon , honorent profondément notre Revue, en lui
apportant le patronage de leurs noms consacrés par un passé littéraire.
A tous merci ! A la Municipalité rouennaise, qui nous a gracieusement
accordé un local ; à nos amis souscripteurs qui ont laissé tomber
l'obole de leur générosité dans nos escarcelles, à nos amis abonnés, à
nos futurs lecteurs, nous redisons merci, merci encore.
Fiers de leur concours, nous nous efforcerons , par une sage
administration de notre Revue, par une sévère épuration des manuscrits,
par un choix varié de pages littéraires, de mériter leur approbation et
de justifier la confiante sympathie dont ils ont bien voulu entourer le
berceau de
La Revue du Foyer artistique et littéraire.
*
* *
LETTRES D'UN VIEUX JEUNE HOMME
I
LITTÉRATURE D'APRÈS-GUERRE
MADEMOISELLE,
Je vous dois une des plus heureuses minutes de ma vie. C'est tout
simplement une bonne fortune que de trouver dans son courrier une
lettre de vraie jeune fille, fleurant la délicatesse et la bonne
humeur, sérieuse à la fois et primesautière, marquée au coin de ce
vieil esprit français, honnête et robuste, qui est immortel...
Vous me proposez d'échanger régulièrement quelques idées sur divers
sujets qui vous intéressent. Je suis confus de cet excès d'honneur que
je ne crois pas mériter. Et puis, vous le dirai-je ? j'ai un peu peur
de ces joutes épistolaires où vous paraissez devoir être une redoutable
adversaire. Il y a de la confiance et une douce ironie dans votre
missive. Je vous remercie pour la confiance ; je tâcherai à m'en rendre
digne. L'ironie m'amuse ; je vous la retournerai peut-être.
Vous voulez bien m'apprendre que vous avez vingt ans et que vous savez
déjà beaucoup de choses .. . J'ai souvent pensé que l'éducation moderne
de la jeune fille constitue un parfait modèle d'incohérence. Je vous en
reparlerai quelque jour. Mais il me plaît que vous ne soyez pas tout à
fait ce que les gens irrévérencieux appellent une « oie blanche ». Nous
pourrons mieux causer en amis. Et ce sera très agréable et un tantet
romanesque cette correspondance à laquelle le mystère ajoute un piment
que j'apprécie fort.
... Car je ne vous connais pas, ou, si je vous connais, je veux croire
le contraire... Vous êtes l'Inconnue d'un attrayant problème et je vous
imagine (avec raison, j'en suis sûr) jolie, fine et nerveuse — comme
votre écriture.
Avec précaution, — le sujet l'exige — vous me demandez ce que je pense
des Lettres d'après-guerre. Si j'étais de ceux que l'on appelle des «
chers maîtres » je croirais volontiers avoir affaire à quelque
journaliste en quête de copie. La supercherie ne serait du reste pas
neuve, mais la modestie m'oblige à écarter semblable hypothèse ...
Gentiment vous prenez soin de me dire que vous n'êtes pas un bas-bleu.
J'en suis fort aise. Je n'aime pas les bas-bleus. Fades effeuilleuses
de marguerites ou machines à penser compliquées et inesthétiques, ces
femmes m'écœurent. Elles n'ont plus de sexe et plus de grâce ou elles
en ont trop. Ce sont proprement des monstres.
Les bas-bleus fixés sur l'opinion que je professe à leur égard, je puis
vous avouer humblement que je n'augure rien de précis de l'avenir de
nos Lettres. La guerre peut très bien être le roboratif dont elles
avaient besoin. Mais il faut vouloir qu'elle le soit. Pour être sauvé,
il faut désirer l'être. Vous croyez à la spontanéité d'un élan
régénérateur ; parce que votre âme est neuve et généreuse. Je ne crois
pas aux miracles de cet ordre et j'admets difficilement la probabilité
d'une transformation profonde de notre littérature. Certes, le
spectacle de la Patrie en danger nous a valu de sublimes réveils
individuels. Le dernier de nos soldats comprend la portée vitale de la
lutte entreprise. Mais une foule de gens simples accablent aujourd'hui
du plus entier mépris tout ce qui est idée pure, sans se rendre compte
que les idées régissent les actes, qu'on le veuille ou non.
A cette heure, les Français se battent. Demain, il faudra refaire leur
éducation : ce sont pour la plupart de grands enfants. On l'a dit cent
fois et ce n'est ni un reproche ni une insulte :
est-il rien de plus beau que l'enfance ? si ce n'est, je pense, votre
jeunesse... Leur courage est admirable et atteint souvent à l'héroïsme.
Que tous ces hommes à leur retour, s'attachent de toutes leurs forces à
une oeuvre de relèvement intellectuel et moral, et nos Lettres
retrouveront la droite vigueur, la délicatesse, l'idéalisme générateur
de Beauté et de Bonté qui firent leur gloire et celle de la France ...
Reconnaissons que nous sommes encore loin du nécessaire ensemble
d'efforts loyaux. Une collection d'exploiteurs de la naïveté publique,
— journalistes, pseudo-écrivain, marchands de films, remarquablement
dépourvus du « sens de l'idoine » — offrait récemment à la foule
d'effarants mystères d'Outre-Atlantique. Dans nos salles de concerts,
des demoiselles très décolletées viennent vous chanter les poings sur
les hanches qu' « on les aura quand on voudra ». Ces choses sont
pénibles à entendre.
Je n'en parlerais pas si elles ne rencontraient que l'accueil qu'elles
méritent. Mais elles plaisent trop souvent. .. Mais le brave peuple
mord ... Renan disait qu' « il n'y a que la bêtise humaine qui puisse
nous donner une idée de l'infini ». Proposition hardie sans doute, mais
à laquelle les exemples ne manqueraient point !
Cependant, la masse est bien excusable de n'être pas acquise à l'art
vrai. Sa culture est rudimentaire et les rudiments en sont fréquemment
viciés. Cette corruption du sentiment artistique n'existe-t-elle pas
d'ailleurs dans d'autres milieux ? dans le vôtre peut-être, qui eût pu
lui opposer une heureuse résistance ? L'a-t-il fait ? non ... L'a-t-il
voulu faire ? non. C'était la mode, n'est-ce pas, d'applaudir aux
œuvres faisandées qui constituaient la part la plus importante de nos
programmes d'hier.
La mode est un démon dont rien ne nous délivre...
Rien, pas même la guerre, qui se contente de la changer. Aujourd'hui,
la mode est de faire son devoir, bravement, simplement, pour la France.
Demain, si vous le voulez, Mademoiselle, avec les autres jeunes
françaises vos soeurs, elle sera de retourner aux belles traditions de
nos Lettres nationales. A l'heure présente, nous sommes tous
nationalistes. Soyons-le sans restriction. Ayez cette pudeur de ne rien
accepter de nos écrivains qui soit indigne d'être lu ou entendu par une
Française. Les artistes probes feront leur devoir. Les autres, ceux qui
traînaient à la scène des personnages en décomposition (au moral comme
au physique), se tairont ou suivront les premiers. Le génie, français
fera le reste. Nous serons délivrés de la scurrilité et de la
scatologie. Qu'importe alors l'orientation que prendra le mouvement des
idées au lendemain de la paix, s'il est soumis à un patriotisme éclairé
et intelligent ?
Voilà les grandes lignes d'une question vaste et complexe.
Quel sera le poète de cette guerre ? Il est prématuré et inutile de
vouloir le dire. Déjà, de belles strophes ont jailli de la plume de
maîtres parmi lesquels nous aimons à reconnaître une de nos gloires
normandes... Ce poète de la guerre, il est peut-être aux tranchées ; il
n'est peut-être pas encore de ce monde. Mais il viendra, et sa lyre
fera entendre des accents inouïs, parce qu'elle exaltera la plus pure,
de nos gloires, la plus belle de ces gestes de Dieu que les Francs ont
ici-bas la mission d'accomplir.
Avec la volonté de vaincre l'ennemi, ayons celle de nous vaincre, et
l'avenir de nos Lettres sera tel que vous le désirez, et que nous le
désirons tous.
RAYMOND POSTAL.
*
* *
CHRONIQUE RIMÉE
UNE RUE DE ROUEN PENDANT LA GUERRE
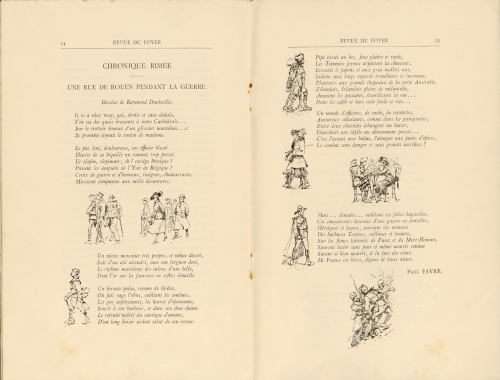
~ * ~
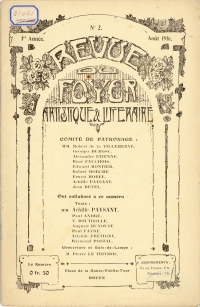
~ * ~
1re Année. - Août 1916. - N°2.
MERCI !...
A l'heure où nous mettons notre
deuxième numéro sous presse, notre premier mot sera pour exprimer notre
gratitude à tous les amis, connus ou inconnus, qui ont encouragé notre
œuvre.
Nous devons un tribut
particulier de reconnaissance à nos confrères de la Presse qui ont
annoncé et commenté favorablement notre apparition, au Journal de
Rouen, â la Dépêche de Rouen, à Paris-Journal, où de bonnes plumes font
honneur à la province normande.
A tous, bien sincèrement, nous disons : Merci !...
Nous voudrions pourtant que ce
merci fût plus large encore et qu'il s'adressât à des centaines
d'abonnés, à des centaines de souscripteurs.
Notre œuvre est nouvelle,
hardie, audacieuse. Dans le fracas des canons de la Somme et de Verdun,
elle semble être une note discordante de quiétude et d'ironie. On nous
l'a dit, parce qu'on nous a mal compris. Il n'est pas un esprit
réfléchi qui ne redoute, à l'heure actuelle, une recrudescence de bas
matérialisme. Nous voulons être, dans notre modeste sphère, des
combattants. Mais si nous luttons pour la pensée, nous luttons surtout
pour la pensée française. Puissent à notre effort répondre, près de
nous, d’autres efforts ! De l'activité intellectuelle des jeunes
générations dépend l'avenir d'une Patrie qui doit rester le foyer de la
civilisation humaine.
Notre idéal est inspiré de
patriotisme et d'art. Pour le combat que nous voulons mener, il nous
faut aussi des armes, des munitions.
AMIS LECTEURS,
Vous nous avez donné vos
cotisations, vos abonnements. Mais les prix du papier augmentent chaque
jour dans des proportions incroyables, et nous avons besoin d'argent,
de beaucoup d'argent. Recrutez-nous d'autres membres, d'autres abonnés.
Forts de votre appui moral et financier, nous ferons œuvre utile et
grande. Nous avons confiance en votre générosité ; nous savons que
l'élite à laquelle s'adresse La Revue du Foyer ne
restera pas indifférente au mouvement que nous sommes fiers de créer.
Nous l'assurons à l'avance de notre gratitude et si notre voix était
qualifiée pour parler au nom des Morts de la guerre, nous lui dirions
que nous aider, c'est continuer leur tâche, c'est bien mériter de la
France.
Nous avons la bonne fortune d'annoncer à nos amis l'adhésion au Foyer de deux nouveaux membres d'honneur : MM. Robert de la Villehervé et Achille Paysant.
M. de la Villehervé, qui dirige La Province
et fut l'ami de Banville et de Coppée, n'a plus à être présenté en
Normandie où tout lettré apprécie hautement le talent délicat et rare
qu'il a mis dans Les Armes fleuries et dans Petite Ville .
M. Achille Paysant, que
couronna l'Académie française et qui obtint le grand prix de
Littérature spiritualiste, est un de ces maîtres dont la sympathie
honore grandement de jeunes écrivains. L'auteur de Vers Dieu ! a bien voulu nous donner la primeur d'un remarquable sonnet que nos lecteurs liront plus loin.
Ces deux adhésions nous sont
précieuses. Elles qualifient notre initiative. A l'heure difficile des
débuts, elles nous réconfortent et nous encouragent.
LA REVUE DU FOYER.
*
* *
LETTRES D'UN VIEUX JEUNE HOMME
II
LES VACANCES
MADEMOISELLE,
Le temps est revenu des villégiatures balnéaires. Fortune oblige : vous
partez. Le soleil d'août darde ses rayons sur une nature indifférente
aux douleurs humaines... Vous souvient-il de l'été de 1914 ? Comme
celui-ci, plus que celui-ci même, il s'annonçait magnifique, vivifiant,
prodigue de bienfaisante vitalité. Jamais vivre n'avait semblé meilleur
; et, soudain, il fallut apprendre à mourir.
Depuis, combien des nôtres sont tombés ! Et cependant, en dépit de nos
deuils, nous avons repris notre vie normale, nos affaires, nos
occupations et, avouons-le, nos plaisirs.
Nous montrerions là l'égoïsme le plus laid si, au fond, cette
insensibilité apparente, cette sérénité hautaine n'étaient de belles
formes du courage civique. Sourire est un des moyens de tenir. En
réalité, la France n'a qu'une âme comme elle n'a qu'une volonté.
Bouclez donc vos malles sans remords et chassez bien vite le si
délicieux scrupule dont vous me faites confidence. Votre frère aîné se
bat à Verdun ; mais penserez-vous moins à lui parce que vous reposerez
au bord de la mer votre jeunesse surmenée par vingt mois de volontariat
d'infirmière ? Non, n'est-ce pas ? Et vous retrouverez à votre retour
les chers blessés qui vous appellent mademoiselle Printemps...
D'ailleurs, ce scrupule, qui montre une jolie délicatesse de
conscience, je l'aime, comme aussi cette joie discrète à laquelle vous
vous abandonnez, aussitôt après, la pensée des randonnées en
automobile, des parties de tennis — et des flirts. Soyez jeune et gaie,
vous avez raison. Prudente aussi.
Pourtant, dussé-je me vouer aux foudres de votre respectable mère, je
persiste à considérer la flirtation comme une des inéluctables
nécessités de la vie, non sans risques certes, mais riche
d'enseignements précieux. Si l'on veut, c'est un sport ; il y faut de
la technique et de l'entraînement. On peut alors s'en tirer fort bien,
et, ma foi, le marivaudage est préférable à l'élégie. Mais prenez
garde, et surveillez votre partenaire.
Surtout, conservez à chacun des plaisirs sa vraie valeur. Ne faites pas
passer avant la promenade en automobile la conversation du beau jeune
homme qui la conduit. J'aime l'automobile ; elle m'a valu assez de
rares émotions pour m'être chère. Les chauffeurs mondains me plaisent
moins ; très peu comprennent leur voiture.
Ces messieurs qui cherchent à toucher en Bourse les plus grosses différences
mettent leur point d'honneur à réaliser sur route les plus fortes
moyennes. (Avez-vous remarqué l'allure mathématique que prend souvent
le langage de la nouvelle génération masculine ?... C'est un signe des
temps.)
Il peut y avoir une volupté supérieure à se sentir maître d’un
organisme mécanique qui entraîne son conducteur à une vitesse
vertigineuse. Victoire sur la matière, sur l'espace et sur le temps,
victoire qui déchire — mais si peu ! — le voile de notre ignorance,
c'est là jouissance d'intellectuel. Les intellectuels sont peu nombreux
dans la bourgeoisie commerçante, et surtout les fervents de la
spéculation métaphysique. Ces négociants brassent les chiffres, mais ne
sentiront jamais cette poésie des nombres
dont parle Vigny. Faire du cent à l'heure, ce n'est pour eux ni
augmenter les possibilités humaines, ni prendre conscience d'atteindre
une parcelle d’infini ; c'est, à peine, goûter le coup de fouet du vent
et sa griserie; c'est satisfaire un amour-propre mesquin — et, s'il se
peut, battre des records. La portée philosophique de leur geste leur
échappe, comme la pensée qu'ils en pourraient extraire et dont le
développement mériterait de tenter la plume d'un Maeterlinck ou
d'un Revel.
Mais je m'égare et je vous ennuie ... Et vous me trouvez sans doute
injuste, parce que ces jeunes sportsmen frivoles d'hier sont
aujourd'hui nos plus vaillants aviateurs. Preuve nouvelle qu'ici-bas
l'absolu est difficile à établir. Le bien et le mal se touchent et se
pénètrent, et il convient de mûrir ses jugements et de garder, devant
les gens et les choses, l'olympienne équanimité qui sied aux sages.
...Trève de philosophie ! et que ma propre faute ne transforme pas en
laborieux discours ces lettres qui ne doivent être qu'un agréable
bavardage !...
Vous prévoyez les jours de pluie, et vous voulez bien me demander ce
qu'il faudra lire. Les livres que l'on emporte aux bains de mer ont le
plus souvent l'humble sort de rester au fond des malles. Vous le savez
comme moi, mais — telle est la femme ! — vous m'en voudriez de ne pas
vous répondre ; j'obéis donc.
Encore qu'il n'existe pas à proprement parler de « littérature de
vacances », quelques gendelettres se sont consacrés à un genre de
romans où ils appliquent avec un sérieux incontestable la loi du
moindre effort — à la fois pour eux et pour leurs lecteurs. La formule
en est simple : prenez une, deux, trois grandes gamines, mal élevées,
mais jolies ; un, deux, trois jeunes gens élégants et riches, dont un
lieutenant à particule; mélangez les blonds et les brunes, les bruns et
les blondes ; agitez le tout dans quelques récipients variés mais
immuables (palaces, tea-rooms, clubs de tennis)... On pleure un peu,
avec coquetterie, et l'histoire se termine par des mariages...
Méfiez-vous de ces romans : ce sont les pires, parce que les plus
artificiels. Lisez des œuvres fortes et solides qui vous montreront la
vie telle qu'elle est, avec ses, luttes et ses peines, et ses larmes.
Apprenez à la regarder en face ; c'est une route périlleuse où l'on ne
peut avancer si un bandeau voile les yeux.
S'il est vrai que l'amour soit le plus puissant des mobiles humains,
sachez que le mariage ne résout rien, ne couronne rien. C'est la fin du
prologue ; la « grande scène » vient après. Elle peut être très belle
et durer la vie. De toute la sympathie que m'inspirent vos vingt ans,
je vous souhaite pareil bonheur.
Mais croyez qu'au fond, la manière la plus sûre de rencontrer le Prince
Charmant, c'est de l'attendre. Truisme, direz-vous. Non, conseil utile.
Le proverbe a raison, et Cupidon est de ces dieux qu'il ne faut pas
tenter. Ne le cherchez pas et vous ferez peut-être bientôt sa
connaissance, au bord des flots smaragdins, parmi vos compagnons de
promenade. Ce seraient alors de bonnes vacances, et passées plus
agréablement qu'à lire des berquinades. à couverture rose.
RAYMOND POSTAL.
*
* *
POÈMES EN PROSE
LA REINE DES NYMPHES
Si vous voulez, Léda, seuls, tous deux, nous irons dans la forêt sombre et inexplorée, où nul être humain n'a jamais pénétré.
Vous vous appuierez sur moi, abandonnée et confiante et je sentirai votre taille souple ployer sur mon bras.
Nous entendrons sous nos pas crier les feuilles roussies et
recroquevillées du dernier automne, comme pour nous avertir de notre
témérité.
Mais nous avancerons bravement dans ce lieu que l'on dit redoutable, car la Jeunesse et l'Amour ne craignent rien.
Même je voudrais qu'il surgît des monstres menaçants, car je me
battrais contre eux pour vous défendre et, fort de mon amour pour vous,
si terribles qu'ils soient, je les vaincrais.
Nous marcherons longtemps ainsi, à pas lents, nous frayant un chemin parmi les buissons sauvages.
A chaque bruissement insolite, vous vous serrerez plus fort contre moi
comme une enfant délicieusement apeurée et, chaque fois, je vous
rassurerai d'un baiser.
Enfin, nous arriverons au carrefour où les Nymphes aux cheveux
flottants sur leurs épaules nues dansent au son des notes qu'égrènent
les flûtes de Pan des Sylvains.
Elles dansent, en chantant de douces mélopées célébrant l'Amour éternel et divin.
Elles dansent, formant une guirlande de corps jeunes aux formes pures,
et blancs, si blancs qu'on les croirait taillés dans le marbre.
Elles dansent, bondissant et retombant légères, puis bondissant encore
comme des gazelles énamourées, faisant voltiger les feuilles mortes qui
se choquent en crépitant.
Elles dansent et leurs seins se soulèvent oppressés et haletants,
cependant que leurs bras nus décrivent des courbes gracieuses au-dessus
de leur tête et le long de leurs flancs.
Elles dansent. Et leurs joues se colorent d'une roseur délicate,
cependant que de leurs lèvres sort une musique mélodieuse comme une
source.
Elles dansent...
Et vous, dépouillant soudain vos voiles, vous êtes entrée dans la
farandole et vous avez mêlé vos chants aux chants des Nymphes, ajoutant
un joyau à la couronne mouvante de corps nus.
Mais voilà que les chants et les danses s'arrêtent et que les flûtes de
Pan des Sylvains elles-mêmes cessent la cascade de leurs notes
cristallines.
Vous seule, ô la plus belle, dansez et chantez toujours.
Vous seule, maintenant, bondissez légère et svelte, traçant dans l'air des orbes capricieux comme une fumée.
Et vos longs cheveux flottent sur vos épaules nues, et vos joues se
colorent, et votre sein se soulève, et les rayons lunaires viennent
plus amoureusement caresser vos flancs aux formes plus pures et plus
blanches que celles des Nymphes.
Car plus que celle des Nymphes votre voix est une musique qui charme la
forêt tout entière, et ce sont les Nymphes qui viennent de vous
reconnaître pour leur Reine et qui se sont prosternées devant votre
resplendissante beauté.
PAUL ANDRÉ.
~ * ~
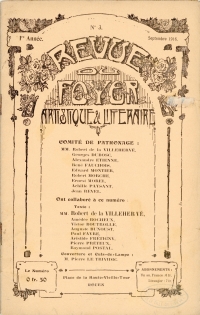
~ * ~
1re Année. - Septembre 1916. - N°3 LETTRES D'UN VIEUX JEUNE HOMME
III
LA GUERRE ET LES POÈTES
MADEMOISELLE,
Jamais le " res, non verba" des
Anciens ne fut plus actuel qu'aujourd'hui. Il y a quelque impudence à
organiser la victoire du haut d'une tribune, et ce n'est pas y aider
que de célébrer, même sur une lyre sonore, le courage de nos frères et
la gloire de leurs armes. Tout est vain qui n'enfante pas des actes
utiles : les déclamations qui exaltent le Droit et le Progrès en un
pathos romantique, comme les discours qui prétendent constituer, à
l'usage de nos combattants, un ravitaillement moral. Les phraseurs
énervent les guerriers.
La saine politique — et la guerre est un phénomène politique — doit
être réaliste, et il serait désirable qu'une foule de Français
substituassent sans retard aux nuées confuses d'un Droit non défini,
les fortes réalités d'une terre à défendre, d'un affront à venger,
d'une langue à conserver, d'un génie national à perpétuer et à enrichir.
Cela dit, et étant posé que le Verbe est peu de chose (quoi qu'en pense
Hugo), que vous répondrai-je lorsque vous sollicitez mon avis sur
l'avenir de notre poésie ? D'abord, que les poètes, qui sont d'éternels
incompris et qui s'étonneraient fort de ne plus l'être ! — vous sauront
gré d'une telle sollicitude ; ensuite, que je ne sais, et que personne
ne sait dans quelle mesure la guerre influera sur leur production
future.
C'est que, voyez-vous, les rêveurs impénitents et charmants que sont
les poètes, vivent en marge des autres hommes. Il en fut ainsi de tout
temps. On verse sur eux le mépris à pleines mains, écrivait déjà Usbek.
Satisfaction facile que ne négligent jamais ceux pour qui leur
existence même est un reproche et un défi.
Peu leur importe. Fous de génie — le don poétique est-il autre chose
qu'un déséquilibre au profit de l'imagination ou, le plus souvent, de
la sensibilité ? — ils savent la grandeur de leur vie et
l'immarcescible beauté de leur passion. L'indifférence ou le dédain de
la foule leur est une jouissance, et des plus chères. Et puis, ne
savent-ils pas, pour les redire aux heures noires, ces vers d'un des
leurs :
Mais l'Esprit me console et dit : Garde ton songe,
Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous...
Il est donc difficile de déterminer selon quel angle d'incidence les
événements actuels agiront sur eux. C'est, uniquement, une affaire de
personnalités. L'œuvre d'un poète, qui traduit ses sentiments les plus
intimes comme ses sensations les plus propres, exige, avant tout, un
développement très large de son individualité. Etre soi,
ce devrait être, pour tous, la grande règle de la vie ; c'est la leur.
Cependant, si le jeu des conjectures est risqué, il est permis
d'espérer, parce que les poètes constituent une élite, qu'ils sauront
tous, au lendemain de la paix, s'alimenter aux sources éternelles de
l'Idéal. Nous souhaitons, nous désirons un relèvement civique et moral
; à eux de le vouloir ; à eux de faire leur cette tâche nationale —
qu'ils réussiraient, si on lisait encore des vers...
Vous vous récriez, parbleu ; j'ai tort d'être pessimiste, et ma
mauvaise humeur est impardonnable, puisque, des vers, vous en avez lu
toutes ces vacances. Vous faites plus : vous vous intéressez à ceux qui
en font. J'aime cela ; c'est d'une vraie fille de France ; c'est
aimable, gracieux, juvénile ; c'est un de ces riens qui classent une
âme.
Nous vivons dans un temps où la sensibilité devient rare. ( Mais où sont les neiges d'antan ?.. .) Et la vôtre, qui est joliment nuancée, s'embellit encore de ce qu'elle est exceptionnelle. Trop de vos amies — les sportives et les flirteuses
— ont sacrifié de gaieté de cœur tout ce qui fait la noblesse et le
prix de la vie. D'autres, plus exaspérantes peut-être, jouent aux cérébrales.
Elles sont l'ornement habituel de certains salons — dits bien-pensants,
parce qu'on y pense fort peu... et fort mal. Elles y étalent avec
suffisance une âme sèche et un jugement superficiel et pédant. Leur
type le plus fréquent dans notre monde s'appelle « la demoiselle qui a
lu Bourget ». Pourquoi Bourget ? parce que je ne sais quel snobisme,
bête comme tous les snobismes, l'a mis à la mode dans ce milieu
frivole, auquel il ne s'adressait guère. J'admire et j'aime Bourget,
c'est l'un de nos meilleurs écrivains, et le plus puissant peut-être;
mais rien de pire ne pouvait lui advenir que cette sympathie
d'écervelées qui le lisent, l'analysent, et le jugent gravement, — sans
le comprendre.
Tout cela, penserez-vous, est assez éloigné de notre sujet. Mais moins
qu'il ne semble, puisque nous sommes d'accord pour admettre que la
sensibilité est la qualité essentielle et maîtresse des poètes. Voyez
la guerre ; elle les a inspirés et les inspirera encore bien davantage,
mais elle les émeut plus par ce qu'elle contient de douleurs et de
sacrifices que par le brillant spectacle des armées qu'elle oppose les
unes aux autres.
Certes, ils ont dit et la gloire des morts et celle des vivants, et
l'espérance de vaincre et la grandeur de notre cause. Encore qu'il ne
faille pas s'exagérer leurs mérites, ils ont contribué à maintenir la
confiance en l'avenir. Et demain verra sans doute naître un sonneur de
clairon, qui immortalisera son nom en écrivant, pour l'éternité,
l'épopée dont nous sommes les témoins.
Chanter le sol national, exalter les vertus françaises, c'est là un
rôle qui n'est pas sans beauté. Le patriotisme est un devoir vital,
certes, proposé par les contingences, mais que les hommes se sont donné
à eux-mêmes ; il n'est pas en nous. Or, l'instinctif besoin du poète,
c'est de donner une forme aux infinies aspirations humaines, à celles
que chacun de nous trouve en lui, mais plus ou moins exigeantes, aux
heures où il regarde son âme.
La soif de tendresse et le désir de se survivre, c'est tout l' Amour ; l'impérieuse nécessité de donner un sens à la vie, c'est toute la Foi ; à celle-ci, la Nature offre
des raisons, à celui-là un cadre. Thèmes vieillis, diront les
modernistes. Qu'importe ? Thèmes éternels et les seuls dignes
d'enthousiasmer l'homme ; voilà ce qu'il faut répondre. Voilà ce que
les vrais poètes chanteront toujours et la guerre n'y changera rien.
Si elle change quelque chose, que ce soit en rendant à tous ceux qui
tiennent une plume, une conscience plus haute du rôle qu'ils peuvent
jouer. Que la tempête, après avoir secoué jusqu'à la souffrance toutes
leurs fibres sensibles, leur laisse au cœur un peu plus de ce que les
uns nomment altruisme, les autres philanthropie, l'Evangile charité.
Qu'au lieu de s'isoler dans leur tour d'ivoire, ils se rappellent qu'il
y a autour d'eux maintes blessures à panser, et plus d'une âme à
réconforter. Qu'ils apprennent, eux, les maîtres de, la pensée, à
maintenir une union sacrée qui sera plus nécessaire que jamais ; qu'ils
sachent, ces dépositaires de la langue des dieux, qu'il leur appartient
de verser les divines consolations de l'amour et de l'espérance; qu'ils
soient vraiment humains.
Alors, mais alors seulement, on pourra parler des bienfaits de la guerre.
RAYMOND POSTAL.
*
* *
HONFLEUR
Honfleur met donc toujours sur son plateau de Grâce
Des pommes de pommiers et des pommes de pins,
Comme au temps que j'allais m'y rouler, galopin,
Petite pomme rouge au fond de l'herbe grasse !
La Miss à bandeaux gris que ses mots embarrassent,
Est-elle là toujours en jersey blanc, qui peint ?
Et la femme en grand deuil qui vend des massepains ?
Et le glauque Océan plein de fourbe et de grâce ?
Surtout, dans la ruelle aboutissant au port,
As-tu vu, babouine et feutre à larges bords,
La terreur des marmots, ce long Père Laflûte ?
Un nègre inoffensif qui riait laidement,
Grâce à qui sur mes pleurs combien de fois vous plûtes,
Beaux effilés du châle épais de ma Maman.
AUGUSTE BUNOUST.
~ * ~

~ * ~
1re Année. - Octobre 1916. - N°4
A NOS LECTEURS
Fondée au milieu de la tourmente, à une heure où les préoccupations littéraires pouvaient sembler inopportunes, la Revue du Foyer vit
et prospère. Elle a rencontré les concours les plus précieux, reçu les
encouragements les plus flatteurs, recueilli les adhésions les plus
propres à faire d'elle une des plus intéressantes revues de province.
Un de nos nouveaux amis nous
adressait dernièrement du front une lettre admirable dont nous croyons
pouvoir offrir à nos lecteurs les lignes suivantes :
« ... Tous ceux de nous
qui ont vu le poilu de 1914-16 — ce héros ! — accepter tous les
sacrifices, endurer toutes les souffrances sans jamais perdre le
sourire, fleur délicate de l'âme française, ne pourront que trouver
naturelle et même opportune, votre généreuse tentative. Notre chère
Normandie se devait — elle qui a tant et si magnifiquement versé son
sang ! — à cette œuvre de renaissance et de sainte tradition... »
A ce témoignage d'un combattant
de la France, que nous sommes fiers d'avoir reçu, nous n'ajouterons que
quelques mots. Cette mission de renaissance, la Normandie ne l'oubliera
pas. Et la Revue du Foyer
fera sa part de l'œuvre de décentralisation qui
s'impose. Déjà nos amis et nos lecteurs ont pu apprécier l'effort que
nous faisons pour leur présenter, sous une forme élégante, un choix
varié de pages littéraires d'une tenue belle et saine. Ils
reconnaîtront, nous n'en doutons pas, le sacrifice que représente le
présent numéro spécial. Nous leur demandons de nous aider à supporter
l'accroissement énorme de frais qu'entraîne pour nous l'augmentation
constante du prix du papier.
Bien des revues ont suspendu leur publication. D'autres ont réduit leur format. Nous voulons vivre .
Plus même, nous voulons donner à notre Revue le développement qu'exige
le souci d'un réveil intellectuel. A nos amis de nous prêter
assistance, de nous faire d'autres abonnés, de recruter de nouveaux
adhérents au Foyer .
M. Paul HAREL , le célèbre poète
d'Echauflour, a eu la bonté de nous accorder et son patronage et le
concours de son beau et robuste talent. Nous l'en remercions ici en
notre nom et au nom de nos lecteurs.
Nous aurons la bonne fortune d'offrir à ceux—ci dans un de nos prochains numéros, un fragment inédit de la nouvelle version de Rivoli , de M. René FAUCHOIS ,
qui sera jouée cet hiver au Théâtre Sarah-Bernhardt. Tous les
admirateurs du grand écrivain normand voudront lire et conserver cette
belle page.
La Revue du Foyer.
*
* *
CHRONIQUE RIMÉE
LE LONG DES QUAIS...
*
* *
LETTRES D'UN VIEUX JEUNE HOMME
IV
ON RENTRE . . . ET ON ROUVRE
M ADEMOISELLE,
Vous voici donc revenue. Les vacances sont terminées et
vous avez fini, me dites-vous, de lire les quelques livres que vous
aviez pris chez votre libraire, à la veille de votre départ. Il vous a
plu de donner un démenti à ma seconde lettre. Tant mieux, parbleu !
puisque vous avez su mêler — pour votre plaisir et votre profit — à la
douce musicalité des vers du pur Albert Samain, les graves
enseignements du romancier de l' Étape, qui vous a rappelé avec le Sens de la Mort, celui de la Vie et celui de l'Amour...
... Maintenant, suivant l'expression consacrée, on rentre
; vous venez de quitter votre retraite d'Houlgate ; pour tous ceux à
qui l'été avait permis de partir, la vie courante reprend ; écoles et
théâtres rouvrent, et déjà les chandails éclatants, les robes blanches,
les bonnets de laine, tout l'équipement habituel des bains de mer n'est
plus qu'un souvenir clair et joyeux ... Joyeux, sans doute, et c'est
juste, mais moins qu'autrefois, n'est-ce pas, puisqu'ils ne rentrent
pas encore ceux qui luttent pour nous à la Somme et à Verdun, et que
tous ne rentreront pas. Mais qui contestera que cette joie soit
conscience d'être et de s'affirmer, orgueil de montrer la vitalité de
la race et sa précellence, et sa pérennité ? Et puis, vous savez qu'à
l'heure sainte du retour, — comme M. René Fauchois l'a dit, en un vers
sublime qui affirme la communion des vivants et des morts -
Ceux qui n'y seront pas y seront davantage...
Continuez à peindre, mademoiselle, c'est une innocente distraction.
Mais n'attendez de moi ni conseils, ni avis. . J'espère bien faire un
jour votre connaissance, mon amie mystérieuse. Quel qu'eût pu être pour
moi le plaisir de vous rencontrer dès maintenant, je ne vous guiderai
pas à travers les expositions de peinture que nos diverses Sociétés
ouvriront cette saison. J'en suis confus, désolé, navré, mais je n'y
puis rien faire. Je suis incompétent en la matière, d'abord ... La
nature m'a ainsi fait ; elle a ses arcanes, et je n'ai ni l'ambition de
vouloir les pénétrer, ni la mauvaise humeur de lui en garder rancune.
Seulement, je constate ... J'aime à croire que vous ne m'en voudrez pas.
Une certaine manière de se coiffer jointe à une certaine manière de se
vêtir, confère, sinon le talent créateur, du moins une autorité qui
peut couramment en tenir lieu. Une tournure d'esprit assez spéciale,
due à de sérieuses études mathématiques, me fait volontiers mettre les
idées et les sentiments en formules. Puis-je vous dire que dans les
arts en général et la peinture en particulier, cette autorité est en
raison directe de la longueur de la chevelure et de la cravate, et de
la largeur du feutre souple ? Ces trois parties de l'habillement ou de
son propriétaire doivent autant que possible être noires ; la tradition
le recommande fortement. Une pipe en bois complète un esthète de la
façon la plus heureuse.
Ainsi revêtu de l'uniforme de la confrérie, si j'ose dire, un homme a
qualité pour rendre au nom de l'Art des jugements qui seront toujours
sans appel. Si je ne craignais d'en faire une application un peu
légère, je dirais que là aussi, le fameux « credo ut intelligam » est de mise.
Je ne vous le cacherai pas, je ne remplis aucune de ces conditions. Je
suis de ces simples qui jugent une œuvre d'après la conception qu'ils
ont du Beau et du Vrai. Mais nos modernes barbouilleurs se soucient
bien de ces vénérables idoles !... Le Beau, le Vrai, qu'est-ce que cela
? Une toile représente un paysage, un coin de bois, une rivière. Vous
ne lui demandez que des sensations ; ils y verront des idées.
Parlez-leur esthétique ; ils vous répondront sociologie. Dites-leur la
beauté d'un crépuscule automnal ; ils vous prédiront le grand soir...
Je dois à la vérité de le dire, cette douce manie sévit surtout chez
les jeunes, ceux qui suivent encore les cours d'une Ecole des
Beaux-Arts. Ils sont écoliers le soir, mais à l'heure de l'apéritif, en
petit comité, loin des oreilles profanes, ils exécutent les Maîtres.
Quiconque, en Lettres ou en Arts, se rapproche des formes
traditionnelles, est étiqueté classique.
C'en est fait de son honneur, ils ne savent pas de plus sanglant
outrage. Rien que de penser à l'infini mépris avec lequel ils
prononcent ce mot, un petit frisson m'agite...
Au demeurant, ils palabrent plus qu'ils ne travaillent et leur paresse
légendaire n'est pas un mythe. Vous avez lu dernièrement dans les
journaux l'histoire de ce petit rentier qui s'est suicidé pour que l'on
parle de lui. Ils lui ressemblent. Incapables de faire parler de leur
talent, ils demandent à leurs baroques productions de leur assurer une
tapageuse réclame. Peut-être feraient-ils mieux de se suicider eux
aussi. L'art n'y perdrait rien.
Mais parlerait-on d'eux ? Car le peintre est un loup pour le peintre,
trop souvent. Ces chevaliers de la palette manient supérieurement
l'éloge condescendant et conditionnel, — qui tue.
— Machin ? Oui, ce n'est pas mal, ce qu'il fait. .. Mais attendez dix ans, il sera intéressant ...
Il y a des exceptions sans doute, et mon ami, l'excellent maître belge
Segers, vous le dirait. Mais elles sont rares. Et j'aime à me rappeler
ce qui advint à un de mes bons camarades. Traité d' épicier
par un bohème famélique et râpé au cours d'un jeune Salon, pour avoir
douté de la vérité de ses ciels trop verts, de ses visages trop bleus,
de ses rivières trop jaunes ; traité de philistin
par un authentique ruban rouge qui exposait dans un autre salon,
officiel celui-là, des plagiats de Poussin qu'il se permettait de
trouver sans originalité, il s'abstient maintenant de tout commentaire
quand il visite les galeries de tableaux. Il est sage et je l'imite.
Faites comme moi, vous vous éviterez des froissements inutiles ; mais
n'allez pas me répondre, parodiant le vers de Marot :
... Ce Monsieur-là, c'était vous-même. ..
RAYMOND POSTAL.
*
* *
COMMENT JE SUIS RENTRÉ D'ALLEMAGNE A LA MOBILISATION
Le lundi 27 juillet 1914, gare de l'Est, à Paris, je prenais le train à
destination de Francfort-sur-le-Mein. J'étais venu passer le mois de
juillet en France. Mais, si dans les établissements d'enseignement
secondaire de Prusse les grandes vacances commencent plus tôt que dans
nos lycées, en revanche, elles ne durent guère plus de six semaines. Le
10 août je devais être de retour à Berlin.
Je voulais cependant, avant ma rentrée, faire un tour en Allemagne et
visiter la ville natale de Goethe dont, écolier rêveur, sur les bancs
du collège, je m'étais imaginé, en traduisant péniblement les premiers
chapitres de « Fiction et Réalité » ( Dichtung und Wahrheit),
les vieilles rues aux maisons à pignons et claire-voie et ce fameux «
Römer » d'où le 3 avril 1764, Goethe enfant assista aux fêtes du
couronnement de l'archiduc Joseph, plus tard Joseph II, comme roi de
Rome. L'occasion était d'autant plus tentante que j'étais invité par
une famille berlinoise qui faisait alors un séjour aux eaux dans le
Taunus, à quelques kilomètres de Francfort.
C'était bien imprudent, s'exclamera-t-on, de s'en aller ainsi en
Allemagne à la veille de la guerre. Il fallait vraiment vouloir se
fourrer dans la gueule du loup. Car la guerre était imminente.
L'Autriche se déclarait insatisfaite des concessions de la Serbie à son
ultimatum. La situation était très tendue, l'instant critique. Mais
nous autres Français, nous avions déjà, à différentes reprises, été si
près de la guerre que nous ne voulions plus y croire. Ne répétons-nous
pas à qui veut nous entendre que tout finit toujours par s'arranger ?
Et puis, vis-à-vis de ces Allemands qui m'avaient invité, qui
m'attendaient pour le lendemain, je ne voulais pas paraître avoir peur.
Ne fallait-il pas leur prouver que nous ne désirions pas la guerre et
que, s'ils la rendaient inévitable, nous ne la redoutions point ? A
ceux qui espéraient me retenir en m'objectant : « Et s'il y a la guerre
? » — « Je reviendrai », répondis-je gaiement en montant dans le train.
Le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, je passais sous les
forts de Metz qui écrasent de leur masse pesante les gracieuses
collines lorraines. Le train suivait la vallée de la Moselle. C'était
un radieux matin d'été. Des brumes dansaient légères sur les prés.
Aucune manifestation d'activité extraordinaire, aucun signe apparent de
guerre. Cependant, depuis quinze jours au moins déjà, et par appels
individuels, l'Allemagne appelait ses réservistes. A partir de Metz
jusqu'à Francfort je remarquai que ponts, tunnels, viaducs et autres
points stratégiques importants étaient déjà gardés militairement. Les
journaux du matin n'apportaient aucun espoir de conciliation, au
contraire. La guerre, pour les Allemands, n'était plus qu'une question
d'heures.
Je puis avouer que j'eus un moment d'hésitation. Mais il était bien
tard pour rebrousser chemin. J'arrivai vers dix heures à Francfort où
m'attendaient mes Berlinois. En dépit de la gravité de l'instant gros
de menaces, la réception, je dois le dire, fut très cordiale et
l'accueil, je le crois, sincère. On ne désirait pas la guerre. Que
deviendraient, en effet, le commerce et l'industrie de l'Allemagne dans
un pareil cataclysme ? Personnellement, mes amis redoutaient une
éventualité qui, si elle ne les ruinait pas complètement, compromettait
sérieusement leur situation en interrompant les affaires importantes
qu'ils faisaient et les relations commerciales suivies qu'ils
entretenaient surtout avec la France et la Russie.
Je fus cependant frappé de l'animation qui régnait dans les rues de
Francfort. C'est devenu un lieu commun de dire que les Allemands sont
lourds et pesants, et l'on sait qu'ils ont l'air de dormir en marchant.
Or, ce jour-là, ils me semblaient bien éveillés, voire singulièrement
excités. Il y avait foule dans les rues principales. Les gens se
pressaient aux devantures des journaux pour lire les dernières
dépêches, et surtout devant les bureaux de cette sale Gazette de Francfort
qui, d'heure en heure, faisait paraître des éditions spéciales et
affichait de sensationnelles nouvelles pour mieux entretenir la
surexcitation dans le peuple.
La nuit, à différentes reprises, je fus réveillé par les manifestations
qui se déroulaient au pied de la statue de Bismark, sur la place, juste
devant mon hôtel. Les Allemands en voulaient alors surtout à la Russie.
Ils ne lui pardonnaient pas sa mobilisation partielle pour répondre à
la menace autrichienne d'attaque contre la Serbie. On ignorait encore
Outre-Rhin et l'on se demandait si la France marcherait aux côtés de
son alliée.
Je passai à Francfort même ou aux environs immédiats, aux abords du
Taunus, les mercredi, jeudi et vendredi dans des alternatives d'espoir
et d'angoisse. Enfin, le vendredi après-midi, voyant que l'horizon
politique ne se dégageait pas, qu'il n'avait plus guère de chances
d'éclaircie, et que bien au contraire il s'assombrissait toujours
davantage, je me décidai à aller voir notre représentant officiel, et
je me fis conduire au consulat de France. Là se trouvaient également
bien des compatriotes venus pour la même cause que moi. A ma question
sur la situation, ce qu'il en pensait et me conseillait de faire, notre
agent consulaire commença par me demander ce que je faisais moi-même
dans cette galère, si j'avais des intérêts commerciaux dans la place ou
si seulement j'étais là pour mon bon plaisir. Je dus lui dire que
c'était, en effet, pour ce dernier motif. La réponse fut nette et
catégorique : « Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Prenez le
premier train et rentrez en France ». Je ne voulais pas encore me
rendre à l'évidence.
— « Mais enfin, objectai-je, sur quoi vous basez-vous
pour me donner ce conseil ? Avez-vous des instructions de notre
gouvernement ?
— « Je n'ai absolument rien, me dit-il. Mais il se
peut très bien que mes dépêches aient été interceptées. Moi, je vous
dis ce que je ferais à votre place. Je suis forcé de rester à mon poste
jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on me mette à la porte. Vous,
ce n'est pas la même chose. Votre devoir est de rentrer. »
Il n'y avait de train que dans la nuit, à 1 heure du matin. Je restai à coucher à Francfort.
Le lendemain, samedi 1er août, vers neuf heures, je sautai dans un taxi, et je retournai au Consulat :
« Comment ! s'écria le Consul, dès qu'il m'aperçut : Vous êtes encore
là ! Vous savez pourtant ce que je vous ai dit hier. Si vous ne partez
pas immédiatement, vous allez vous trouver pris dans un guêpier et vous
aurez beaucoup de mal à vous en tirer ».
L'hésitation n'était plus permise. Je rentrai précipitamment à l'hôtel,
bouclai mes bagages en hâte et me fis conduire à la gare. Il y avait un
train à dix heures pour Cologne et la Hollande, un autre un peu plus
tard pour Schaffhouse. Lequel prendre ? Car il ne fallait plus songer à
rentrer par la Lorraine, la route la plus rapide. Les communications
directes avec la France étaient déjà interrompues. Les Allemands
avaient fait sauter les voies à Pagny-sur-Moselle. Je m'informai au
guichet. Par Schaffhouse la voie était certainement libre, par Cologne
on ne me garantissait pas la correspondance. Cependant comme le train
pour Cologne était le premier à partir et que j'avais hâte maintenant,
après avoir tant tardé, d'être sorti de là, je me décidai pour Cologne.
Je pris pour Paris un billet direct, qui me fut délivré sans la moindre
objection, et je fis enregistrer mes bagages. Hélas ! ils ne devaient
pas suivre. La gare de Francfort était remplie. De tous côtés, où que
l'on tournât la tête et que les yeux se portassent, ce n'étaient que
piles de malles et de caisses de toutes sortes, de toutes dimensions,
de toutes provenances, entassées les unes sur les autres, et qui
attendaient le départ. L'encombrement, d'ailleurs, était voulu. Le
trafic des voyageurs et des marchandises n'avait-il pas été entièrement
suspendu deux jours durant, au milieu de la semaine, pour transporter
des troupes et des munitions ?
(A suivre.)
ARISTIDE FRÉTIGNY.
~ * ~

~ * ~
1re Année. - Novembre 1916. - N°5
AURORE
Lorsque des esprits élevés, épris du noble vouloir de convier les âmes
au culte du Beau, ont conçu l'idée de fonder une Revue artistique et
littéraire, les premiers numéros sont un sourire d'aurore. — Les brumes
matinales l'enveloppent encore de leurs tonalités flottantes, et ses
pas tremblés semblent attendre, impatients et inquiets, la force et la
clarté de la grande lumière.
Peu à peu le soleil s'élève ; la crête de la colline s'irise et vibre ;
un rayon darde tout à coup, perce les brumes qu'il illumine et nous
promet un beau jour.
Ce doux rayon vient de fleurir sur le frais matin de la Revue du Foyer.
Les esprits délicats avaient certainement compris les
hautes aspirations de cette audacieuse publication littéraire qui, en
pleine guerre, est entrée dans le temple pour y entretenir, par son
zèle, l'amour de l'art, ce feu plus sacré encore que le feu des
vestales.
Mais, si dès son premier numéro, notre revue normande exposait son
programme : « le bon combat pour le Beau, pour le Vrai dans le Beau »,
il lui restait à préciser son but, concentrer ses tendances, acquérir
une personnalité.
Sans doute, une revue artistique et littéraire n'est pas un organe de
polémique visant une fin nettement délimitée. L'Art est immense ; une
revue artistique doit accueillir tous les efforts. Cela ne saurait
empêcher d'avoir un plan d'action.
Quel est donc ce rayon qui vient de filtrer dans les pages de la Revue du Foyer ?
Déjà, l'orientation, encore que très floue, se laissait deviner à la
simple lecture des noms de quelques collaborateurs connus pour leurs
principes de décentralisation. Voilà que cette tendance s'affirme à
l'occasion d'une manifestation d'art où Rouen espère entendre notre
célèbre auteur normand René Fauchois, développer ses théories pour le
soutien et l'encouragement de toutes les valeurs régionales dont les
élans vigoureux grandiront au dehors le radieux et chaud prestige de la
France. Aujourd'hui, notre distingué confrère Raymond Postal, en
quelques pages solides et confiantes, expose le plan dans toute sa
netteté.
Comme la clarté se précise à cet heureux rayon matinal !
De toutes les provinces, la Normandie est de celles qui possèdent les
éléments les plus riches et les plus divers pour glorifier à l'étranger
le renom de notre généreuse patrie. Et la Seine qui serpente jusqu'au
Havre semble à dessein retenir les navires qui sont venus jusqu'au pied
de la cathédrale rouennaise pour leur permettre de mieux recueillir
dans leurs fortes voiles la grande voix des cloches normandes — qui est
un peu de l'âme française — pour la répéter, comme un écho magique, aux
terres lointaines.
La Normandie est le grand pays de l'élevage, de la culture et de
l'industrie. Son commerce l'entraîne sur tous les marchés du monde où
elle entre en concurrence avec les producteurs les plus entreprenants.
Lorsqu'un pays a eu l'habileté d'envoyer en avant ses idées à
l'étranger, comme un soc pour y défricher et remuer le sol, il y trouve
ensuite des débouchés plus faciles et plus sûrs pour les produits de
ses campagnes et de ses ateliers. Aussi, qui n'accueillerait avec
reconnaissance l'effort de ceux qui prennent à tâche de rassembler les
idées qui iront, ainsi que le barde des temps anciens, chanter sur le
sol de la France et de l'étranger la noble province de Rollon que
l'industrie normande a toujours maintenue grande et prospère, digne de
son bienfaiteur. Ces idées feront entendre partout la voix du terroir,
solide héritière des Corneille, des Pradon, des de Bois Guillebert, des
Malherbe, des Fontenelle, des Dupont de l'Eure, des Louis Bouilhet, des
Flaubert, etc.
La Revue du Foyer qui s'est
faite l'apôtre du Beau, le missionnaire de la plus pure
intellectualité, sera demain — si Dieu lui prête vie — l'alcyon qui
emportera sur ses larges ailes la Pensée Normande comme un des plus
lumineux joyaux de la Pensée Française.
PIERRE PRÉTEUX.
*
* *
CE QU'IL FAUT FAIRE A ROUEN
Encore qu'imprécise et informulée à l'heure de notre fondation, l'idée
de décentralisation présida cependant à la création de la Revue du Foyer.
Nos circulaires et nos articles de présentation en portent la marque.
Nous savions quel magnifique centre intellectuel Rouen pourrait
devenir, si quelques hommes résolus et enthousiastes voulaient s'en
donner la peine. Nous n'ignorions pas de quelle légitime renommée notre
vieille cité jouissait à l'étranger ; mais lorsque, hors de France,
nous avions à répondre à la sympathique interrogation de nos amis, nous
devions avouer que rien n'était fait chez nous pour mettre en valeur
les richesses intellectuelles normandes. Nous vivions sur le Passé ;
nous mangions notre capital de gloire.
Aujourd'hui que la Normandie, cruellement atteinte dans sa chair
et dans son cœur, prépare vaillamment l'après-guerre économique,
l'heure est venue de réaliser l'œuvre de décentralisation
intellectuelle qui s'impose, parallèlement à cet essor commercial et
industriel. Un homme, dont le nom célèbre est un symbole d'activité et
de probité littéraire, s'est trouvé qui a tracé avec une merveilleuse
clarté le programme à suivre. M. RENÉ FAUCHOIS, l'auteur applaudi de Beethoven et de la Veillée des Armes,
qui est normand et rouennais, et qui a su établir, avec un sens très
aigu des réalités et des possibilités, un remarquable plan d'action, a
bien voulu nous associer à son projet.
Nous voulons faire de Rouen un foyer d'intellectualité et, sans
méconnaître la valeur de son prodigieux développement économique — bien
au contraire ! — rendre à ce corps merveilleux de richesse et de santé
qu'est notre province, une âme et une tête.
NOUS DEMANDONS POUR ROUEN UNE UNIVERSITÉ, OFFICIELLE OU LIBRE. Nous
avons ici, certes, des professeurs qui sont des savants et à qui il ne
manque guère que des élèves dignes d'eux, parce que là, comme partout,
il y a un défaut d'organisation. Mais, que l'on offre aux jeunes gens
désireux de poursuivre leurs études et d'embrasser une carrière
libérale, les cours réguliers dont ils ont besoin et, non seulement les
Normands resteront ici et résisteront mieux au décevant attrait de
Paris, mais encore Rouen recevra une foule d'étudiants étrangers. Les
jeunes Anglais dont un frère aîné ou un ami leur aura vanté nos trésors
d'architecture, nos musées, nos environs pittoresques, y viendront
nombreux ; à eux se joindront les Russes, fils d'une race neuve encore
qui se jette sur la science avec un enthousiasme avide ; les Belges,
qui retrouveront avec plaisir à Rouen quelque chose de Liège et
d'Anvers ; et d'autres, les Italiens, les Suisses, etc...
A ces hôtes, Rouen devra offrir les meilleures CONDITIONS MATÉRIELLES ET INTELLECTUELLES DE CONFORT.
L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE, bien en retard dans notre région, doit se
préoccuper dès maintenant de l'avenir. Elle a à réaliser des progrès
nombreux, notamment sous le rapport de l'hygiène, mais elle ne doit pas
oublier qu'elle n'aura pas à recevoir que des jeunes seigneurs. La
clientèle des étudiants ira surtout aux pensions de famille qui
pourront lui offrir, à des conditions modérées, une nourriture saine et
abondante en même temps qu'un logement clair, simple, propre et coquet.
La conception romantique de l'étudiant logeant sous les toits, dans une
misérable mansarde et menant joyeuse vie, n'a plus cours. Dans ce
domaine, comme dans beaucoup d'autres, la chambre touring-club compte
une victoire de plus à son actif.
**
A cette jeunesse studieuse, avide d'apprendre et de connaître, il
faudra des plaisirs nobles et qui élèvent l'esprit. Avons-nous à Rouen
des CERCLES DE LECTURE ? Non ; des SOCIÉTÉS D'ART, DE SCIENCES, DE
LITTÉRATURE bien vivantes ? Non plus.
Que la généreuse ambition de faire œuvre utile et de réparer dans la
mesure du possible les ravages de la guerre anime l'élite de la
population rouennaise, et nous aurons tout cela. Nous demanderons alors
un THÉATRE NORMAND où l'on donnera les œuvres des écrivains et des
musiciens de notre province, maîtres et jeunes, gloires et espoirs. A
quels succès ne pourrait pas prétendre une scène sur laquelle seraient
joués Corneille et Rotrou, Fauchois et Harel, de la Villehervé et
Pierre Nebout, et Edward Montier, Pierre Varenne et Amédée Bocheux,
Boïeldieu et Dupré, Paray et Haelling, et Vallier, et d'autres que nous
oublions et dont le talent fait honneur à la province des Flaubert et
des Maupassant ?
Et surtout quel admirable spectacle que la découverte des valeurs
normandes par la Normandie, l'affranchissement — oh ! très amical — des
modes de Paris et le large développement qu'un tel mouvement ne
tarderait pas à prendre !
Des REVUES, les unes purement littéraires ou artistiques, les autres
portant des idées, provoqueraient entre les jeunes une utile émulation
et répandraient la pensée normande à travers la France, au-delà de ses
frontières, partout où il serait utile de FAIRE CONNAITRE ROUEN.
Ainsi, un incessant contact intellectuel avec les centres
universitaires étrangers et les capitales étrangères, nous
renseignerait sur la marche des idées hors de France et resserrerait
les liens qui nous unissent déjà à tant de nations, de génies
différents sans doute, mais toutes généreuses et belles.
Mais — et ici nous touchons l'originalité du plan conçu par M.
Fauchois, poète admirable, mais penseur respectueux des contingences —
l'université que nous demandons ne sera pas seule à attirer des élèves
du dehors. L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE, qui devra donner une allure
plus régionale à ses cours de technique industrielle et de commerce et
multiplier ses visites aux établissements industriels, recevra les fils
des commissionnaires de Liverpool et d'Anvers, de Londres et de Gênes,
et ceux des industriels de Birmingham et de Verviers... Et L'ÉCOLE DES
SCIENCES ET DES LETTRES, L'ÉCOLE DES BEAUX -ARTS, notre vieux LYCÉE
lui-même, bénéficiant de la propagande faite directement ou
indirectement à l'étranger, connaîtront un regain inespéré de fortune.
Enfin, chaque année, en été, à l'époque où touristes .de toutes
provinces et de tous pays partent en villégiature, aurait lieu une
SEMAINE NORMANDE, consacrée à des festivités de tout ordre
(représentations de gala, expositions artistiques, concerts, tournois
littéraires, réunions sportives), qui attireraient la foule des fêtes
de 1911.
* *
Voilà l'économie d'un programme sur lequel il y aura lieu de revenir.
De sa réalisation dépend l'avenir intellectuel d'une des plus belles
provinces françaises, de la plus fertile peut-être en talents robustes
et sains. Même économiquement, il ne comporte que des avantages. Une
forte cohésion, liant hommes d'affaires et intellectuels, doit assurer
à notre province une vie régionale prospère et bien personnelle.
Parce que l'œuvre projetée est à longue échéance, nous nous adressons à
la jeunesse. Mais la création est nécessaire d'un organisme qui
étudiera les moyens pratiques d'exécution et interviendra, si besoin
est, auprès des Pouvoirs publics. De même, l'action énergique d'une
municipalité affranchie de tous soucis politiques. Rouennais et
Normands doivent tous travailler à cette œuvre de décentralisation que
ce sera l'honneur de M. René Fauchois d'avoir voulue. Tous, négociants
comme universitaires, en bénéficieront : une fois encore la pensée est
l'auxiliaire de l'action.
AYONS LE COURAGE DE FAIRE CE QUE D'AUTRES GRANDES VILLES ONT FAIT.
ORGANISONS COMMERCIALEMENT L'AVENIR INTELLECTUEL DE NOTRE PROVINCE.
Sachons préparer les jours qui suivront la guerre et assurons à Rouen
les moyens d'accroître encore alors son admirable développement.
Nos intérêts et nos sentiments nous le commandent. L'attachement à la petite patrie est la garantie la plus sûre du patriotisme.
Souscrire à ce programme de décentralisation normande, c'est faire œuvre française.
RAYMOND POSTAL.
*
* *
COMMENT JE SUIS RENTRÉ D'ALLEMAGNE A LA MOBILISATION
(suite et fin).
Mes bagages, eux non plus, ne devaient pas partir. Ils le devaient
d'autant moins que j'étais Français et que l'adresse mentionnait mon
nom et leur destination : Paris.
Je ne suis pas encore consolé d'avoir dû payer 10 marks 55 de parcours
pour une malle qui ne devait rien parcourir du tout puisqu'elle est
restée sur place.
Je descendis donc le Rhin jusqu'à Cologne. Dans toutes les gares il y
avait affluence de voyageurs. Les baigneurs des villes d'eaux voisines
— et elles sont nombreuses dans cette région — interrompaient
brusquement leur cure pour rentrer précipitamment. La seconde édition
des journaux du jour annonçait l'assassinat de Jaurès, et, chose
curieuse, sans commentaires.
Au wagon-restaurant je déjeunai en tête à tête avec deux Allemands qui
mangèrent, ma foi, de fort bon appétit et qui burent d'abord à ce qu'il
n'y eût pas la guerre et, ensuite, à ce que s'il y avait la guerre,
naturellement l'Allemagne en sortît victorieuse. Je serais heureux de
les revoir. Nous longeâmes les places fortes du Rhin, Mayence, Coblentz
et la fameuse citadelle de Ehrenbreitstein. Nulle part on ne remarquait
de mouvements extraordinaires de troupes. La mobilisation allemande
était déjà virtuellement terminée. A Cologne, le pont du chemin de fer
sur le Rhin était gardé par un poste avec une mitrailleuse. Il était 15
heures quand, après bien des arrêts et des lenteurs, nous pénétrions
sous le vaste hall de la gare.
Heureusement, il y avait encore la correspondance. Quelques instants
plus tard, je prenais un train venant de Berlin et qui se dirigeait sur
la Belgique. Ouf ! je me sentais déjà un peu plus à mon aise. La
plupart des voyageurs étaient des Français qui rentraient, mais il y
avait aussi des Allemands qui rejoignaient leur garnison ou qui,
simplement, revenaient chez eux. Les femmes qui accompagnaient leur
mari se souciaient fort peu de la victoire de la plus grande Allemagne
; elles pleuraient et sanglotaient en songeant à l'horrible fléau qui
allait se déchaîner.
En cours de route monta dans mon compartiment un jeune ingénieur de la
succursale, à Aix-la-Chapelle, de la manufacture de Saint-Gobain. Il
avait eu juste le temps de s'échapper et de sauter dans un tramway pour
venir prendre le train à une petite station intermédiaire quand les
gendarmes s'étaient présentés et avaient arrêté l'ingénieur chef,
français également, au moment où il s'apprêtait à partir. Combien de
Français ont été ainsi faits prisonniers sur place avant toute
déclaration de guerre, donc au mépris du droit des gens et des
conventions de La Haye, uniquement pour avoir eu une excessive
confiance en l'hospitalité germanique et pour avoir attendu trop
longtemps, alors que chez nous, dès la mi-juillet, prévenus et rappelés
par leur gouvernement, tous les Allemands commençaient à filer ! Car,
n'est-il pas typique et suffisamment éloquent l'exemple de cet hôtel de
Trouville où, le 14 juillet, des automobilistes en excursion obtinrent
à grand peine de quoi déjeuner parce que, le matin même, comme un seul
homme, tout le personnel avait pris le train pour une destination
inconnue pour les autres et de lui seul connue ?
Le train allemand n'allait pas plus loin qu'Herbesthal. Il fallut donc
descendre et passer un à un par un étroit portillon de sortie en
présentant son billet qui fut soigneusement contrôlé et examiné sur
toutes les faces par un haut employé de la gare assisté de gendarmes.
Enfin, nous étions sur le territoire belge. Quel soupir de soulagement
! Déjà, naturellement, la frontière était barrée.
Sur la route, de chaque côté de la barricade, un soldat belge et un
fantassin allemand se regardaient comme chien et chat. Nous dûmes faire
à pied vingt minutes de chemin pour aller à Verviers chercher le train.
En cet instant, ignorant encore du sort de mes bagages, je ne
regrettais pas trop d'avoir, aux dépens de ma malle, soulagé ma valise
à main. Hélas ! si j'avais su ! je l'aurais, au contraire, bourrée
jusqu'à la serrure.
La mobilisation belge battait son plein. A Liège, la gare était envahie
par les réservistes qui rejoignaient en hâte leur corps. C'était un
fourmillement intense, un grouillement continuel qui donnaient même un
peu l'impression d'une cohue. Quelle différence avec le pays d'où je
sortais !
Huit heures du soir. Jeumont, la frontière française ! Les voyageurs
sautent du train à peine arrêté, avides de nouvelles. Des têtes
passent, curieuses, aux portières. On interroge anxieusement, et c'est
avec une vive satisfaction que tous apprennent que le décret de
mobilisation générale est affiché depuis quatre heures. Alors, de
toutes les poitrines, un cri unanime s'échappe spontanément : Vive la
France ! et la Marseillaise
fait tressaillir la nuit de ses accents vibrants. Inutile d'ajouter
que, ce jour-là, la visite de la douane fut assez promptement expédiée.
Les douaniers avaient d'autres soucis en tête. Contrairement à leur
habitude, ils se montrèrent même aimables avec les voyageurs.
De la frontière, le train ne devait plus s'arrêter jusqu'à Paris où nous arrivions à minuit et demi.
Deux à trois semaines plus tard, vers la même heure, c'est à-dire en
pleine nuit, je traversais, mais à pied cette fois, la ville de
Charleroi, qu'une quinzaine de jours auparavant je ne pensais vraiment
pas revoir de sitôt ni en de pareilles circonstances.
ARISTIDE FRÉTIGNY.
*
* *
LETTRES D'UN VIEUX JEUNE HOMME
V
THÉATRE ET MORALITÉ
MADEMOISELLE,
Vous avez raison, les entrepreneurs de spectacles se moquent de nous.
Au seuil du troisième hiver de guerre, à l'heure où toutes les forces
nationales devraient être consacrées à des œuvres belles et élevées, on
offre au public les plus plates inepties. Il faut bien le reconnaître,
une trop grande partie du public les accepte.
Une invraisemblable littérature cinématographique sévit. Cercles rouges
ou dents blanches, d'impossibles histoires de brigands troublent dans
la quiétude de leurs nuits une foule de gens qui n'en peuvent mais.
Rocambole est passé de mode. Aujourd'hui, nous avons Elaine. C'est le
progrès. La bombe asphyxiante a remplacé le pistolet et le tromblon ...
Je préférais encore Mandrin.
Vous aimez à me confier vos réflexions sur la littérature de demain. Ce
sujet brûlant vous semble être un des plus dignes d'intéresser votre
esprit et votre cœur. Il l'est en vérité. Une honnête jeune fille, une
bonne française, ne saurait demeurer indifférente devant lui. Et, cette
fois, vous me parlez du théâtre. Vraiment, vous vous souciez plus de
nos dramaturges qu'ils ne se souciaient de vous et de leurs spectateurs
en général. Vous flétrissez ingénuement leur immoralité ; c'est leur
amoralité qu'il faudrait dire. Mais peu importe. Et gravement, vous
dressez le bilan de leur responsabilité. Certes leur cause est trop
mauvaise pour que je l'ose défendre, surtout contre un adversaire dont
la jeunesse ignore cet art de ménager la chèvre et le chou qu'est au
fond toute la psychologie... Ils nous ont assez intoxiqués avec leurs
sophismes anarchiques, renouvelés d'Ibsen. Vivre sa vie et la vivre en beauté,
c'est peut-être humainement un idéal qui ne manque pas, sinon de
grandeur, de force et de vigueur. Mais, socialement, c'est idiot.
L'individualisme qui est, je ne le conteste pas, une marque d'énergie,
peut donner les fruits les plus riches, s'il soumet l'individu, de par
sa propre volonté, aux lois qui régissent l'existence de la société et
lui assurent de durer et de prospérer. Mais abandonné à lui-même, il
n'est plus que destruction. Un monde où il se donnerait libre cours
serait voué à une désagrégation rapide.
Tout cela, nos auteurs dramatiques l'avaient oublié, ceux du moins qui
obtenaient les succès les plus certains, tandis que nous laissions nos
vraies lumières sous le boisseau. Et sous le charme attirant d'un
théâtre qui ne manque ni d'art, ni d'esprit, mais qui étalait dans tout
son cynisme la décadence de la partie la moins profonde et la moins
française de la France, on reniait bien des vérités qui allaient à
nouveau s'imposer aux premières clartés de la guerre. On admettait de
transiger avec l'absolu des devoirs moraux. Et, n'est-ce-pas,
Mademoiselle, l'adultère lui-même prenait aux yeux des vierges que l'on
menait écouter ces hontes, un je ne sais quoi de perversement
séduisant, qui troublait et tentait leurs âmes
d'ingénues.
Mais pourquoi les conduisait-on dans cette galère ? Pourquoi à ces
jeunes filles dont on exigeait une rectitude irréprochable de conduite,
proposait-on le misérable exemple de la Phalène
? Mademoiselle, avant de condamner les écrivains qui souillaient leur
plume, condamnons ensemble les parents et les mères qui leur
abandonnaient l'âme de leurs filles...
Cela changera-t-il ? Peut-être, mais rien n'est changé encore, puisque
M. Bataille continue, avec son Amazone. Attendons le retour de ceux qui
font la guerre et souhaitons qu'après avoir accepté la discipline des
événements et de la hiérarchie, ils sachent vouloir la discipline des
idées et des obligations morales.
J'entends bien qu'il ne faut pas que nos écrivains transforment leurs
pièces en insupportables cours de morale. Ils pourront toujours laisser
au public le soin de conclure. A ce compte-là, je le sais bien, rien
n'est immoral, parce que de toute action on peut tirer uneleçon utile.
Mais il est à craindre que des esprits chez
lesquels le sens du bien est pour le moins obscurci ne sachent ni
ne veuillent extraire cette leçon. Et puis le spectacle de la passion
au théâtre est dangereux, et bien plus que dans le livre. Le lecteur
doit faire effort d'imagination pour créer le milieu où s'agitent ces
personnages, et il doit s'incarner dans chacun d'eux s'il veut saisir
dans leur intégralité leurs sentiments et leurs sensations.
Au théâtre, l'effort d'imagination est fait par les acteurs. La
détresse de la chair, les élans de la passion, les accents poignants de
l'amour et de la haine y ont l'aspect de la vérité. De là à croire que c'est arrivé, à accepter l'exemple des héros de la scène, à s'identifier à eux, il n'y a guère de distance.
Trop longtemps, on a mis à la scène des êtres sans noblesse et, surtout, sans self-control,
esclaves de leurs instincts et de leurs passions. Trop longtemps on a
fait parler les hommes comme des bêtes ; puis, pour changer, on a fait
parler les bêtes comme des hommes ; il est temps, peut-être, de rendre
à ces hommes le langage des hommes.
..... L'esprit philosophique,
ma jeune amie, est, je le crains, une maladie dont on ne guérit pas. Je
la connais trop pour ne pas en distinguer de nombreux symptômes au long
des pages que vous m'écrivez. Elle consiste, sous sa forme la plus
courante, à poser une foule de questions, le plus souvent ardues, mais
toujours parfaitement inutiles. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment
ceci, comment cela ? On conclut bien vite que la vie est peu de chose,
qu'elle tient à peu de chose et qu'elle ne sert à. rien, du seul point
de vue humain. C'est le plus clair résultat des observations,
subjectives ou objectives, qu'elle exige...
Souffrez que je m'inquiète pour vous de vous voir soulever l'insoluble
problème qui est au fond de cette question de la moralité au théâtre.
Et pourtant, vous dites vrai : la guerre n'a rien changé au rythme du
monde. On meurt plus, on meurt plus jeune, sans doute. Mais le fait
brutal, cette moisson d'existences robustes, déchire-t-il
l'Inconnaissable qui nous entoure ? Non. Il n'a fait que mettre
tragiquement en lumière cet incessant conflit de l'Idéalité et de
l'Instinct qui est le pivot de la vie, — et c'est tout. Mais voyez
comme tout s'éclaire à la sinistre lueur de la mort, puisque aussi
bien, un des fruits de la guerre, le plus sûr peut-être, aura été de
nous accoutumer à sa pensée. Vous regardez autour de vous et vous me
dites assister à une recrudescence simultanée de l'idéalisme et du
matérialisme. Vous constatez un renouveau du sentiment religieux et,
parallèlement, un féroce développement des instincts brutaux, goûts de
lucre ou besoins de plaisir. Vous en voulez savoir la raison : l’idée de la mort a posé, pour chacun de nous, la question du but de la vie.
Voyez nos soldats, nos permissionnaires. Braves tous devant le danger,
parce que le regard humain s'arrête d'abord à l'immédiat et que le
présent impose la lutte pour la Patrie, ils ont, les uns, maîtrisé les
désirs de leurs sens, les autres, donné libre cours à ces mêmes ennemis
intérieurs. Ceux-là croient à l'existence d'une loi morale supérieure
et à une vie future, ou, renouvelant le pari de Pascal, en admettent
l'hypothèse, et déjà désincarnés,
nous donnent l'exemple des plus ascétiques vertus; ceux-ci, comme des
bêtes traquées, s'affolent devant l'imminence de leur anéantissement ou
de ce qu'ils considèrent comme tel, et veulent jouir de leurs dernières
possibilités de plaisir.
Et chez nous, les gens de l'arrière, ce même problème de l'utilisation
de la vie se trouve posé, par la permanence, non du danger, mais de la
mort qui rôde autour de chacun et lui arrache ses plus chères
affections. Les mêmes solutions le résolvent où tentent de le résoudre.
Ce conflit, vous le retrouverez dans chacune des circonstances de nos
jours, les plus humbles même. A sa douloureuse lumière, vous
comprendrez pourquoi, alors que des millions d'hommes meurent ou
souffrent, d'autres rient et d'autres chantent - et pourquoi des
directeurs de théâtres ou de cinémas proposent à des spectateurs qui
les applaudissent des insanités qui nous semblent démodées...
Sollicité par l'azur et par la boue, l'homme trébuche souvent sur son
chemin, et tombe s'il n'est pas de ceux qui font les héros et les
saints... Jeune fille, ne condamnez pas les vaincus de l'existence et
les faibles... Vous n'avez pas trop pour les plaindre et les encourager
de toute votre pitié et de tout votre amour.
Comme dirait M. Camille Cé, cette lutte de l'Esprit et de la Matière, c'est la vie. C'est simple.
C'est effroyablement simple.
RAYMOND POSTAL.
Deux mots pour l’Inconnu.
— Le problème de psychologie que vous me soumettez est intéressant, et
j'en parlerai quelque jour. Je crois pouvoir répondre, dès maintenant,
négativement à la question que vous posez — heureusement pour l'amour,
qui se soucie fort peu des poètes ..
~ * ~
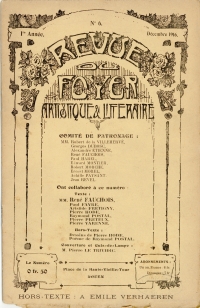
~ * ~
1re Année. - Décembre 1916. - N°6
LA MORT D'ÉMILE VERHAEREN
L'illustre écrivain belge, dont
nous avions eu l'honneur de publier dans notre dernier numéro un
admirable sonnet inédit, est mort tragiquement, le 27 novembre dernier,
au moment où il reprenait à la gare de Rouen le train de Paris. La
veille même, au Musée de Peinture, où il avait pris la parole en
compagnie du grand poète rouennais René Fauchois, et de Madame Lucie
Brille, il avait lu de ses vers et parlé, en artiste vrai, de la
Belgique artistique. Tous ceux qui l'avaient entendu, tous ses
admirateurs se sont inclinés avec un respect ému devant sa dépouille
mortelle, et ont apporté à Madame Verhaeren l'hommage de leur sympathie
attristée.
La Revue du Foyer , à laquelle le
Maître disparu avait eu la bonté de s'intéresser, offre à ses lecteurs
un hors-texte consacré à sa mémoire ; tous ceux qu'aura atteints la
mort de Verhaeren, les amis, Belges ou Français, de l'œuvre et de
l'homme, voudront conserver ce souvenir.
Nous renouvelons ici à la
compagne de sa vie, douloureusement atteinte dans sa plus chère
affection, les condoléances sincères de
LA REVUE DU FOYER.
*
* *
LETTRES D'UN VIEUX JEUNE HOMME
VI
SUR UNE TOMBE
MADEMOISELLE,
Verhaeren n'est plus. Vous me l'avez écrit au lendemain du drame, dans
l'émotion où il nous avait tous jetés : la Ville l'a tué, cette ville
dont il avait dit, mieux que personne, les âpres luttes, les appétits
brutaux, le dynamisme exaspéré, les séductions puissantes, mais
décevantes aussi.
Je ne sais pas de mort qui m'ait plus douloureusement surpris. La fin
d'Emile Verhaeren, plus stupide encore qu'atroce, nous restitue dans
toute sa tragique horreur ce sentiment du fatum
dont les Anciens avaient noté la mystérieuse puissance. On vit, on aime
la vie, on voudrait s'attarder sur chacune de ses heures ; on croit à
quelque chose, à un lumineux idéal de fraternité humaine, ou de Beauté
pure et claire, ou peut-être encore à l'Amour ; on goûte la tiède et
simple douceur d'un foyer que garde une femme aimée, où rient de jeunes
lèvres ; peut-être connaît-on la gloire d'ici-bas et l'admiration des
foules, ou sait-on l'art subtil d'asservir les rythmes et les sons et
de chanter, sur une lyre frémissante, toutes ces joies qui sont le
bonheur : « néant superbe », dit Bossuet. Une balle qui siffle, un
grain de sable, un faux-pas, et tout cela n'est plus qu'un souvenir,
qui passe lui aussi, et meurt.
Et je songe à l'aveugle destin qui vient de faucher, dans la splendeur
de la virilité, le beau et lumineux génie d'Emile Verhaeren ! Et je
songe aussi à ce pressentiment qui marque son œuvre, à tant de poèmes
où il avait mis, en vrai Flamand, mystique à la fois et sensuel, cette
sinistre peur de la mort, qui illumine aussi, de sa funèbre clarté,
tant de pages des autres maîtres flamands, ses amis Rodenbach et
Maeterlinck... Connaissez-vous Intérieur,
de celui-ci, cet acte minuscule qui est un chef-d’œuvre ? On n'a rien
mis à la scène qui fût plus simple et plus tragique ; on n'écrira rien
de plus poignant. De bonnes gens vivent en paix, dont les jours se
passent à l'ombre d'un toit séculaire, dont la vie est pour toujours
faite des mêmes gestes, des mêmes labeurs, des mêmes rêvés. Un soir,
comme les autres soirs, cette famille fait la veillée sous la lampe ;
une enfant est absente. Mais il pèse- sur eux- quelque chose qui est
comme une angoisse confuse d'on ne sait quel drame. Et la mort vient,
dont la main pesait sur leurs têtes, et qu'ils n'osaient pas attendre,
mais- qui vient toujours et brise les bonheurs, et fait pleurer les
yeux et fait saigner les cœurs. O quotidienne douleur des moissons
funèbres !
Pauvre Poète, elle est venue te surprendre, toi aussi, lâchement, au
lendemain d'une visite qui avait été pour nous tous une fête ! Tu
venais de faire ton métier de flambeau,
tu avais exalté l'art immortel de ta petite mais si grande patrie, tu
avais chanté Rubens et Van Eyck ! Nous t'avions applaudi, approché. Tu
avais été cordial, avec cette simplicité dont se paraît ta gloire.
... Elle est venue, toute rouge. Oh ! ces trains qui te faisaient peur,
à toi, de qui la vie meurtrissait le grand rêve de concorde et de
simple labeur, ces trains que tu as maudits, parce qu'ils emportaient
vers les « villes tentaculaires » les déserteurs de la glèbe, dans
leurs wagons
Disparaissant, tels des cercueils, vers les ténèbres...
Ils t'ont tué. C'est la vengeance de la Ville.
Et je t'ai vu sur le petit lit où on avait déposé ton corps. Tu dormais
— pour toujours ! La mort avait éteint cette flamme chaude de tes
grands yeux, comme elle avait scellé tes lèvres harmonieuses. Mais
quelle majesté avait ton visage dans l'immobilité du grand sommeil ! Un
bouquet de roses rouges que la main pieuse d'une admiratrice anonyme
venait de déposer devant toi, jetait une tache de sang sur la nette
blancheur de la petite chambre. Puis d'autres fleurs ensuite sont
venues t'apporter l'hommage d'un peu de cette nature que tu avais tant
aimée, aimée en poète.
Et, comme nous nous retirions, on m'a montré — ô ironie ! — ces sucres
de pomme que tu avais achetés pour celle qui te pleure aujourd'hui, —
pauvres choses broyées et sanglantes, comme ton corps !
...Nous avons suivi son cortège. Les élites de deux peuples qu'a atteints profondément la disparition de celui qui fut l'âme vivante de la Belgique,
ont communié dans la douleur. De grandes voix, belges et françaises,
ont dit quelle perte faisaient en lui nos Lettres et l'esprit humain.
Cela pour le grand public qui l'ignorait, ou presque. Et la
respectueuse admiration d'un Roi a voulu qu'il reposât en terre belge,
dans ce petit lambeau de patrie qu'il avait chanté avec tant d'émotion.
Mais il était salutaire, peut-être, de considérer cette mort et d'en
tirer l'implacable leçon qu'elle contient. Tout passe, la gloire,
l'amour, la vie elle-même et bien vite. Ce qui reste, ce n'est pas le
souvenir des sonorités creuses et vaines, non plus que celui des
plaisirs et des honneurs. Un baiser d'amants, l'harmonie d'un accord,
une vision d'art, sont choses d'un moment. L'instant les voit mourir
qui les vit naître.
Ce qui reste, c'est l'œuvre utile, l'acte de foi qui enfante l'activité
humaine, l'acte d'espérance qui aide à sa durée, l'acte d'amour qui
réunit les énergies ; c'est la Bonté. Parce que Verhaeren fut bon, de
toutes les forces de son cœur tumultueux, parce qu'il sut comme tous
les Sages, la beauté d'une immense pitié pour les infortunes d'ici-bas,
il a pu s'endormir ainsi que Georges Rodenbach, et plus que lui encore,
avec
l'espoir de
revivre
Dans la mélancolique éternité du livre...
RAYMOND POSTAL.
|