[REVER, François
(1752-1828)] Voyage des
Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie
occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit
avec des Observations, des Notes et plusieurs Gravures relatives à
l'Histoire Naturelle, l'Agriculture, les Arts, etc.- Evreux : J.J.L.
Ancelle, An X [1802].- 179 p-7 f. de pl. depl. ; 21,5 cm.
Saisie du texte : O. Bogros pour la collection
électronique
de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (07.IV.2015)
Relecture : A. Guézou.
Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,
B.P. 27216,
14107 Lisieux cedex
-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01
Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]
obogros@lintercom.fr
http://www.bmlisieux.com/
Diffusion
libre et gratuite (freeware)
Orthographe et
graphie conservées.
Texte établi sur l'exemplaire de la
Médiathèque (Bm Lx : Norm 1678)
![[Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](../images/frever01_t.jpg) VOYAGE
VOYAGE
Des
Elèves du Pensionnat de l’Ecole
Centrale de
l’Eure, dans la partie
Occidentale du
Département,
Pendant les vacances de l’an huit.
Avec des Observations, des Notes et plusieurs Gravures
Relatives à l’Histoire Naturelle, l’Agriculture, lesArts, etc.
__________________________________________
» Qu’on lui mette en fantaisie une honneste curiosité
» de s’enquérir de toutes choses : tout ce qu’il y aura de
» de singulier il le verra : un bâtiment, une fontaine,
» un homme, le lieu d’une bataille ancienne, le passage
» de César ou de Charlemaigne….. La solitude, la
» compagnie, le matin et le vespre, toutes heures
» lui seront unes, toutes places lui seront d’étude.
Essais de
Montaigne,
liv. 1. Chap.
25 de
l’institution des enfants. Edit. de Paris an VI.
__________________________________________
![[Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](../images/frever02_t.jpg)
Rapport des Membres
du Conseil d’instruction
de l’Ecole Centrale de
l’Eure, qui ont dirigé le voyage et les
observations des Elèves pendant les
vacances de l’an 8, au Conseil assemblé.
_____
CITOYENS,
nous mettons sous vos yeux le recueil des observations que les Elèves
du Pensionnat de l’Ecole centrale de l’Eure ont faites avec nous
pendant les vacances de l’an 8. Vous y trouverez le tableau de tout ce
qui a fixé notre attention : les sites qu’on a vus ; les manufactures
qu’on a visitées ; les objets d’histoire naturelle ou d’antiquité qu’on
a décrits ; les traits historiques qu’on a pu recueillir : vous y
trouverez de même l’exposé fidèle des difficultés qu’on a rencontrées ;
des doutes qu’elles ont fait naître, ou des conjectures qu’elles ont
suggérées : enfin toutes les recherches auxquelles on s’est livré….
Nous n’ajoutons pas les découvertes qui en ont été le fruit !
Pouvait-on espérer d’en faire de bien importantes en visitant un pays
généralement connu, dans le peu de tems qu’on a pu mettre à le
parcourir ?
Ce
tableau eût peut-être été plus intéressant, si les matériaux qu’il
contient eussent été classés dans un ordre méthodique et régulier :
mais on ne s’était pas proposé de faire un ouvrage
; on
n’avait d’autre intention que de former un seul recueil des notes de
tous les voyageurs, et l’on s’est contenté de les réunir dans l’ordre
même des courses journalières où les observations ont été faites.
Néanmoins
nous pensons que la publicité de ce recueil pourra devenir avantageuse,
non-seulement à nos jeunes observateurs, mais encore à tous les Elèves
de l’Ecole centrale ; ce sera le moyen de les faire participer aux
mêmes recherches et de leur offrir des indications et des exemples
propres à leur inspirer le goût de l’observation.
Il
est dans doute inutile de vous prévenir que parmi les citations et les
développemens qui pourront être inscrits au bas des pages, ou renvoyés
à la fin du journal, plusieurs articles n’ont pu être terminés tandis
que nous étions en course. Vous savez que la petite bibliothèque
ambulante de l’expédition était principalement formée de livres
élémentaires : ainsi nous n’avons pu consulter, qu’à notre retour, des
ouvrages plus étendus, ou ceux dont les rapports avec nos observations
étaient moins directs.
_______
LE
Conseil d’instruction publique, vû le rapport qui lui a été fait sur le
voyage et les observations des Elèves du Pensionnat de l’Ecole centrale
de l’Eure, pendant les vacances de l’an 8, convaincu que la publicité
de ces observations peut être utile à tous les Elèves de l’Ecole,
approuve, conformément au Règlement du Pensionnat, que les détails du
voyage des vacances de l’an 8 soient rendus publics par la voie de
l’impression.
Les Membres du
Conseil
d’Instruction publique,
Signé, &c.
==============================================
LES ÉLÈVES
A LEURS PARENS.
__________
O
vous qui avez prodigué les plus tendres soins à notre première enfance
: vous dont les sacrifices continuels sont la preuve d’une affection
sans bornes : vous enfin qui faites dépendre votre bonheur de nos
progrès dans les sciences et dans la vertu : Recevez les premiers
fruits de nos études et de notre application !
A qui pourrions nous les offrir qui méritât plus notre reconnaissance
et nos respects ?
De qui pourrions nous espérer qu’ils fussent reçus avec plus
d’indulgence et de bonté. ?
______________________________________________
Extrait du
Règlement du Pensionnat, pour
le temps des
vacances.
________
P ENDANT
les vacances les élèves du pensionnat de l’Ecole centrale, qui ont
remporté des prix, parcourent les endroits du Département, les plus
intéressans par leur situation, par l’antiquité des monuments qu’ils
renferment, par les manufactures qui s’y trouvent et par le genre de
culture dont on s’occupe en ces endroits. Ils dessinent ce dont il leur
parait important de conserver les traits ; ils décrivent ce qu’il est
utile de faire connaître. Ils recherchent les productions naturelles du
sol, ils recueillent les plantes utiles ou rares, ils consignent avec
soin tous les détails de leur voyage dans un journal, et ils en
arrêtent en commun la rédaction. Au retour de leur expédition, ils
déposent dans le Musæum de l’Ecole les fruits de leurs recherches avec
leur journal, et le Conseil d’instruction arrête l’impression de ce qui
lui paraît digne d’être rendu public.
Chaque année les instrumens propres aux observations qui devront être
faites, seront portés avec les bagages de l’expédition.
Les élèves désigneront les officiers
du voyage, selon le dégré d’instruction qu’ils leur reconnaîtront pour
le genre de travail dont ils seront chargés.
Il
y aura deux dessinateurs… deux naturalistes… deux historiographes….
deux phisiciens… deux mécaniciens, etc., etc. Les Professeurs qui
pourront prendre part aux observations et au voyage, seront invités,
etc….. Les Directeurs du pensionnat accompagneront toujours les élèves,
etc.
*
* *
VOYAGE
ET
OBSERVATIONS
Des Élèves du
Pensionnat de l’École
centrale de l’Eure,
Pendant les
Vacances de l’an 8. (1)
~ * ~
LE DÉPART.
N OUS partîmes d’Evreux le 15 fructidor an 8,
au lever de
l’aurore ; jamais elle n’avait annoncé un plus beau jour ; c’était le
premier voyage
des vacances
; il était projeté depuis long-temps, nous l’avions attendu avec
impatience, les endroits que nous devions visiter nous inspiraient le
plus grand intérêt ; et le jour du départ nous parut le plus brillant
de l’année.
Déjà nous étions loin de la cité, les bagages et les
instrumens d’observation suivaient les voyageurs, bientôt nous fûmes à
la hauteur de Navarre, et dans un instant nous eûmes dépassé tous les
bosquets dont la route est bordée (2).
Nous ne pouvions nous
livrer encore à des observations suivies, ni à de longues recherches ;
nous étions forcés de nous rendre au lieu désigné pour notre réunion,
parce que plusieurs de nos camarades étaient partis pour s’y trouver en
même-temps que nous, et que d’autres nous attendaient sur la route.
Il
s’agissait d’ailleurs d’aller voir une des grandes marées de
l’équinoxe, à l’embouchure de la Seine, et ce spectacle, qui ne pouvait
être différé, nous forçait de remettre à notre retour les recherches
qui nous auraient retenus trop long-temps ; ainsi pendant plusieurs
lieues nos naturalistes n’observèrent, dans la campagne, qu’un petit
nombre de plantes échappées au feu de l’été, le plus sec et le plus
ardent qu’on eût vû.
LE
DÉJEUNER.
La faim
nous prit. Bientôt, sur le chemin,
S’offre
à nos yeux enseigne, un peu menteuse,
D’un
qui vantait son logis et son vin.
Au
prime abord de la bande joyeuse
L’hôtesse
parut radieuse :
Sur le
profit la dame calculait.
C’était
Perrette au pot-au-lait.
Bribes
de pain, verres d’eau claire,
Notre
déjeûner d’ordinaire,
Lui
rapportèrent peu d’argent.
Comme
elle en faisoit grise-mine,
Certain
du petit régiment
Lui
souhaita quelque berline,
De ceux
qui ne savent marcher,
Sur lit
mollet veulent coucher ;
Et,
s’ils n’ont morceaux à leur guise,
Ne
peuvent desserrer les dents ;
Ceux-là,
dit-il, seraient de bonne prise.
Que je
les plains, les pauvres gens !
Clos et
serrés on les transporte
Dans
une roulante prison :
L’ennui
près d’eux se place et les escorte ;
Tandis
qu’à pied, sur le tendre gazon,
Les
ris, les jeux, nous prenant pour leurs frères ;
Voyagent
avec nous, sous les mêmes bannières,
Sans
effaroucher la raison (3)
LA FIN
DU JOUR : LE COUCHER.
Ainsi
lestés, nous partons, et nous marchons jusqu’à la fin du jour. Nous
cueillîmes le mirtyle, l’aspérule et le lin multiflore que nous
offraient des bois situés sur la route ; et la nuit approchant, il
fallut songer à faire halte. Ce n’était pas le plus grand embarras du
voyage : une tente assez bien close, mais qu’on dresse en plein air, et
de la paille fraîche, au lieu de duvet, sont les préparatifs les plus
importans qui nous occupent quand il fait beau (4).
Que sait-on
? Les sciences doivent peut être un jour pousser leurs conquêtes
jusques chez les Tartares : on sera bien aise alors de pouvoir répandre
nos itinéraires parmi eux, afin de les amener graduellement à l’étude
sérieuse des lettres, par l’attrait des excursions et des caravanes.
Au
surplus, nous nous reposâmes avec plaisir, nous soupâmes de grand
appétit, et nous passâmes une des meilleures nuits dont le sommeil ait
jamais récompensé les fatigues ou le travail de la veille.
LE
LEVER DU SOLEIL : LA VALLÉE DE
RISLE :
LA VILLE DE BRIÔNE : LE
MOULIN
A FOULON.
Dès le point du jour, nous nous levâmes en célébrant le réveil de la
nature, et bientôt après nous fûmes en chemin.
Les
habitans de la campagne, encore plus vigilans que nous, s’arrêtaient
sur la route pour nous voir défiler. On dormait alors dans les villes :
la nuit, réfugiée dans les alcoves, y prolongeait son empire, tandis
que le soleil sortant à moitié de l’horizon, faisait étinceler
l’émeraude et le rubis dans la rosée.
Nous savions déjà qu’il
fallait rapporter à la terre les grands mouvemens dont il n’a, dans le
ciel, que l’apparence : son élévation progressive sur l’horizon nous
excita naturellement à nous entretenir de cette belle théorie, qu’il
étoit réservé à Copernic
de dévoiler. Nous étions encore occupés des
révolutions annuelles de la terre, de celle des autres planètes, des
mouvemens plus étonnans des comètes, lorsque nous découvrîmes Briône,
dans la riante vallée de la Risle. L’histoire de l’ancienne province de
Normandie, fait mention du château qui dominait la ville. Guy de
Bourgogne s’y réfugia vers le milieu du onzième siècle, après la
victoire que Guillaume-le-Conquérant obtint sur les ennemis qu’il eût à
combattre dans les commencemens de son règne (5).
Elle nous a de
même transmis que cette ville fut prise, en 1123, par Henry fils de
Guillaume, sur le comte Galeran, et qu’elle fut brûlée, excepté la tour
dont il ne put se rendre maître. On voit encore sur la colline, à
l’orient de Briône, des restes du château, dont les murs ont dix pieds
d’épaisseur (3 mètres 348 millimètres) : ils sont bâtis en silex, et
revêtus de pierres blanches, régulièrement taillées en parallelipipedes
d’un pied de longueur. On pourrait s’étonner de la petite quantité de
chaux qu’on a fait entrer dans cette construction : le mortier, composé
en grande partie d’un sable très-fin, est sec et friable, et
l’épaisseur des murs a servi à leur conservation beaucoup plus que le
soin qu’on mit à les construire.
Le commerce qui se fait à
Briône n’est pas étendu ; il n’y a point d’usines dans son voisinage,
malgré les avantages de sa position, et nous n’avons vu de remarquable,
qu’une foulerie qu’on trouve à quelque distance au-dessous de la ville.
L’emplacement
en est extrêmement agréable : le travail de clayonage et de maçonnerie,
qui forme les prises d’eau et le courant des moulins, est habilement
masqué par la culture de deux isles plantées de peupliers, et la vue
qui s’étend au loin dans ce riche vallon, trouve par-tout l’image la
plus riante de l’aisance et de la fertilité.
Les procédés du
foulon n’étant inconnus de personne, nous ne les décrirons pas ; mais
ils étaient nouveaux pour nous, et nous ne vîmes point sans admiration,
l’étonnant effet du pilon, dont les coups suffisent pour serrer le
tissu des étoffes, et pour les rendre plus fortes et plus épaisses aux
dépens de la longueur et du lé qu’elles avaient sur le métier du
tisserand.
Cet effet de la pression nous fut développé avec
autant de complaisance que de clarté, par un citoyen de Briône, qui
voulut bien nous accompagner à la foulerie. Il joignit aux explications
qu’il nous donna, des détails étendus sur les matières premières
employées dans la fabrication des étoffes, sur les différentes espèces
de laine, sur la filature, sur la tissure, sur les manipulations et les
apprêts que reçoivent les draps en sortant des mains du foulon. Quelles
furent les indications qui firent trouver les procédés de la foulerie,
ou les heureux hazards qui en donnèrent les premières idées ? ce
furent-là les réflexions qui nous occupèrent en reprenant notre route
le long de la vallée. Mais bientôt nos regards furent attirés par les
charmes du paysage ; ce n’était plus cet aspect triste et monotone que
nous avait présenté, la veille, une plaine aride et jonchée des débris
des végétaux ; c’était la nature vivante et parée des plus belles
couleurs. On eût dit que toutes les plantes, ayant quitté le sol brûlé
des campagnes, se fussent rassemblées sur les bords de la Risle pour
recouvrer la fraîcheur et la vie. Nous contemplâmes avec plaisir les
aigrettes longues et soyeuses de l’épilobe, les couleurs purpurines de
la salicaire, les têtes verticales des cardiaires, les feuilles
anguleuses des tussilages, les épics penchés des persicaires, les
corymbes de l’eupatoire, les joncs épars et articulés, les
potamogetons, les lys et la lentille d’eau. Les buissons eux-mêmes
contribuoient à la beauté du spectacle : ils soutenaient en longues
guirlandes les fleurs argentines de la clématite, dont la couleur
blanche et luisante contrastait agréablement avec les fruits rouges du
tamus et de la couleuvrée.
Tandis que les uns faisaient, en
courant, leurs recherches de botanique, les autres, dans leur marche
plus réglée, mais non moins attentive, contemplaient tout ce qui
flattait la vue et pouvait exciter la curiosité.
Ce n’étaient
pas seulement les beautés particulières de la vallée, ses sinuosités,
son étendue et la longue chaîne de ses collines, c’étaient encore la
forme variée de ses prairies, la division de ses champs, la richesse de
ses plantations.
C’était l’industrie de l’habitant dans la
formation de ses enclos, dans l’ordre de ses vergers, dans la structure
de ses habitations, dans la belle tenue de ses haies, dans le choix et
la culture de ses arbres.
L’ANCIENNE
ABBAYE : LE CHATEAU
EN
RUINES : LES PIGEONS.
Le
temps s’écoulait ainsi sans ennui, la route même se faisait sans
fatigue, lorsque le chemin qui tournait en montant, nous éloigna des
bords de la Risle. Ce changement de direction, qui nous fit craindre un
instant de perdre de vue une vallée délicieuse, produisit un effet
contraire ; du point d’où nous la revîmes bientôt, ses contours ne
parurent que plus agréables.
Nous laissâmes sur la droite, un
établissement fameux, dont les toits élevés, et les constructions
brillantes fixèrent un moment nos yeux : c’était l’ancienne abbaye du
Bec, lieu célèbre, où des hommes recommandables par des vertus réelles,
se retirèrent, il y a mille ans, pour se livrer, dans la retraite, à
l’étude des connaissances de leur siècle !
Plusieurs d’entr’eux
obtinrent l’estime et la vénération de leurs contemporains : pendant
long-tems l’Angleterre et la France se disputèrent l’avantage de les
posséder ; et parmi eux il en est encore dont la mémoire n’a point
cessé d’être honorée. Mais les humbles cabanes qu’ils se firent au
milieu des forêts, ont duré dix siècles, et les constructions superbes
que leurs successeurs élevaient n’étaient pas même terminées, quand des
orages politiques foudroyèrent un orgueil déplacé, en dispersant ces
immenses richesses que le faste et l’ostentation détournaient de
l’emploi qu’on eût toujours dû en faire (note I).
D’autres
objets se découvrirent bientôt à nous sur la pointe de la colline ;
nous apperçûmes les ruines de l’ancien château de Montfort, et le desir
d’aller les reconnaître nous fit redoubler le pas. Nous apprîmes qu’on
voyait encore, il y a quarante ans, au pied de cette colline, un
couvent d’Annonciades ; dont l’église, quoique gothique, était
admirable par l’élégance du dessin et par la hardiesse de sa
construction (note
II).
Rien ne pouvant nous en rappeler les
formes, l’escalade du vieux château fut résolue, et dans un instant
nous fûmes tous au pied de ses antiques murailles. Nous savions déjà
qu’il n’y a point de château démoli, dans toute l’ancienne province, à
qui la renommée ne fasse les honneurs de longs souterrains et de
précipices dangereux. L’opinion du pays n’est point en défaut, de ce
côté-là, sur la longueur du souterrain, qu’on dit avoir été creusé du
haut de la montagne jusqu’au fond de la vallée, continué sous la
rivière de Risle et prolongé fort loin en plusieurs branches. Cependant
il est très-vrai qu’on n’en découvre aucun vestige, et que les
décombres ont obstrué jusqu’à l’ouverture des puits qu’on creusait
autrefois, dans ces châteaux, pour le service de la garnison.
Nous
fûmes donc bientôt rassurés contre le danger des mauvais pas, et nous
tournâmes les fossés qui sont encore très profonds, pour trouver
l’accès de cette ancienne forteresse. Un épais taillis en occupe
aujourd’hui l’emplacement tout entier, avec une grande partie de ses
alentours ; il n’est pas aisé de pénétrer dans les buissons qui en
défendent l’entrée, et nous eussions en vain tenté d’en lever un plan
exact (6). On y a trouvé plusieurs fois des boulets et des armes ; mais
tout ce que l’histoire nous a conservé sur cette place, c’est qu’une
partie de ses fortifications fut détruite en 1203, par Jean Sans-Terre,
frère de Richard Cœur-de-Lion.
C’est une chose remarquable que
l’aspect de ces anciens monumens de la haîne ou de l’ambition des
hommes ! A peine y reconnoissez-vous les vestiges des fortifications ;
les tours s’écroulent successivement, tout se comble à la longue ; la
nature qui reprend ses droits peu à peu, fait croître les arbustes dont
elle couronne les cavaliers et les bastions ! L’herbe tapisse les
parapets et les murs en ruine, et sur les glacis et la place d’armes
que les fureurs de la guerre inondaient de sang autrefois, vous voyez
le pâtre conduire aujourd’hui ses troupeaux, et s’asseoir en paix sur
des appuis de créneaux renversés et couverts de mousse !
Telles
étaient nos pensées au milieu des débris et des ruines, lorsque d’un
pan de mur plus élevé que les autres, nous vîmes tout à-coup cinq ou
six pigeons que notre présence mettait en fuite. Ces oiseaux timides
échappés au ravage des colombiers, et réfugiés parmi les hiboux, dans
de vieilles murailles, nous inspirèrent cette espèce d’intérêt auquel
on se livre machinalement à notre âge : nous eûmes de l’affection pour
eux parce qu’ils avaient couru de grands dangers, et nous voulûmes voir
s’ils prospéraient dans leur nouvel établissement. Les plus alertes,
traversant les buissons, gravirent sur les premières assises de la
muraille : ils s’attendaient à voir les familles naissantes de la
colonie….. et au lieu de nids et de petits éclos, ils trouvèrent des
lacs et des rêts qu’on leur avait tendus ! La manie de la chasse et la
barbarie de l’oiseleur étaient venues les poursuivre jusques sur des
précipices, et ces oiseaux échappés au feu de mille fusils, devaient
enfin périr dans des pièges et dans des filets.
Mettre en pièces
tous ces rêts odieux, fut un arrêt unanime, prêt à s’exécuter !.....
mais l’oiseleur qui les avait placés, en eût ressenti de la peine ; il
eût regardé l’enlèvement de ses rêts comme un vol, ou comme l’effet de
la méchanceté : d’autres que nous, auraient pu devenir l’objet de ses
soupçons ou de sa haîne : nous laissâmes donc les filets sans y
toucher, nous quittâmes ce lieu de destruction, où rien ne pouvait
servir à nous instruire, et nous reprîmes notre route dans la vallée.
L’ÉGLISE
ET LE CHATEAU D’ANNEBAULT :
LES
FOURMI-LIONS.
A
peine étions-nous au pied de la montagne, que nous trouvâmes encore des
ruines : l’ancien château d’Annebault, bâti sur pilotis, auprès de la
rivière, par l’amiral de France Claude d’Annebault.
On pourrait
qualifier cette maison, de superbe extravagance, si plus de vingt
anneaux de fer scellés dans le mur de la terrasse, ne concouraient avec
la tradition du pays, à persuader que l’amiral avait eu l’utile projet
de rendre la rivière de Risle navigable jusqu’au pied de son habitation
; mais cette maison n’a jamais été finie, les ancres qui devaient être
sculptées sur sa façade, sont encore en bloc dans quelques endroits, et
l’on fait maintenant servir à divers usages, les pierres que l’amiral
avait fait venir à grands frais, de plus de quatre lieues, pour les
entasser dans l’épaisseur de ses murailles.
L’église d’Annebault
est du même tems et de la même construction que le château : on y voit
des vitres bien peintes, où l’on remarque divers costumes de ce tems-là
(7).
Il y a sous le grand autel un caveau d’environ trois mètres
en carré, qui servait de sépulture aux anciens Seigneurs, et l’on voit,
dans le cimetière, des tombes en pierre fort épaisses, dont la surface
supérieure est taillée en croix. Nous n’avons acquis sur ces tombeaux
aucuns renseignemens, non plus que sur le nom de cimetière des
Huguenots, qu’on donne à un terrain quadrangulaire, éloigné de l’église
d’environ 300 pas vers le nord-est.
Ce cimetière des Huguenots,
nous rappela seulement les dénominations haîneuses, ou perfides sous
lesquelles les hommes se poursuivent et s’égorgent de temps en temps ;
et nous fîmes des vœux pour n’être jamais témoins des scènes d’horreur
dont elles sont ou l’occasion, ou le prétexte (note III).
Nous
apprîmes en quittant Annebault, qu’on avait autrefois tenté d’y établir
une manufacture de bleu de Prusse. On ignore aujourd’hui jusqu’au nom
de l’étranger qui avait formé ce projet.
A une demi-lieue ou
trois kilomètres d’Annebault, nous vîmes au bord du chemin, dans un
ravin de la forêt, les cônes renversés de quelques fourmi-lions :
c’étaient les premiers que nous eûssions vus ; nous les recueillîmes
donc avec le plus grand soin, et nous marchâmes vers Pont-Audemer, où
nous devions passer la nuit.
PONT-AUDEMER.
Rien n’est plus
avantageux que la position de cette commune pour toute espèce
d’établissement ; et le paysage qu’on peut découvrir du haut des
collines entre lesquelles est située la ville, doit être fort agréable.
Nous
ne pûmes jouir de toute la beauté du spectacle : la pluie qui ne nous
avait pas empêché de monter sur la côte, étendit un voile autour de
nous quand nous y fûmes, et nous déroba les points de vue que nous
cherchions.
Mais nous contemplâmes les différentes branches de
la Risle, distribuées avec le plus grand succès, pour l’arrosement des
prairies et le service de la ville où l’on trouve autant de canaux
qu’il y a de rues.
C’est à cette heureuse distribution de l’eau,
jointe aux qualités particulières qu’on lui reconnaît, que cette ville
doit le grand nombre de tanneries qui en font le principal commerce, et
qui conservent, non seulement en France, mais chez l’étranger, la juste
réputation qu’elles se sont acquise.
LES
MANUFACTURES : LA CORROYERIE
FAÇON
ANGLAISE
L’espoir
que nous avions de voir quelques-unes des fabriques de cette ville,
nous ramena dans ses murs (8) ; nous allâmes visiter la corroyerie,
façon dite Anglaise, des citoyens Donnet, Plumer et compagnie. Cette
fabrique n’est pas la seule dans laquelle on prépare les cuirs de cette
manière, à Pont-Audemer ; il y en a d’autres qui s’occupent comme elle
de ce genre de travail avec succès : mais elle avait concouru à
l’exposition des objets d’industrie au Champ de Mars, en l’an six, elle
avait même obtenu le prix ; voilà pourquoi nous désirâmes de visiter
ses ateliers.
Nous ne décrirons pas tous les procédés des
différentes préparations à l’anglaise,
nous nous bornerons à ceux
qu’on suit pour les tiges
de botte, parce qu’ils sont les seuls que
nous ayons eu le temps d’observer.
Les cuirs préparés à la
manière anglaise, pour faire des tiges de botte, ont 1.° un dégré
très-sensible d’élasticité qu’ils conservent plus ou moins long-temps,
et qu’ils acquièrent dans le travail de la corroyerie, par la réduction
que fait l’ouvrier d’une plus grande dimension de la peau dans une plus
petite ; 2.° une très-grande souplesse qui ne se perd jamais, et qui
leur permet de se prêter à tous les mouvemens, sans contracter aucuns
de ces plis habituels qui se durcissent peu à peu, et se coupent à la
longue ; 3.° ils peuvent devenir par le travail du corroyeur,
très-légers en poids, sans rien perdre de leur qualité pour la durée ;
4.° ils ont un œil plus fin, plus lustré et plus brillant que les cuirs
préparés d’une autre manière ; ils acqu[i]èrent même par le travail
des étires
ou des empreintes,
un grain
qui, tantôt imite les sillons
réguliers du cannelé, tantôt le piqué de loup marin,
etc.
Toutes
les peaux indistinctement ne sont pas propres à recevoir cet apprêt
aussi parfaitement les unes que les autres : il y a du choix à faire
entre les peaux de la même espèce d’animal, il faut en mettre entre les
différentes parties de la même peau.
La peau de cheval est la
plus recherchée pour cette préparation, et quoique celle du veau
réussisse quelquefois assez bien, elle acquiert rarement les qualités
de la première.
Le succès de ces préparations dépend en partie
de la manière de tanner, et en partie de celle de corroyer. Dans la
tannerie, on apporte la plus grande attention à bien vider le cuir, à
bien nettoyer la partie fibreuse de la peau, et l’on retire de l’écorce
du chêne, par le moyen des lavages multipliés, tout l’acide gallique ou
la substance tannante qu’elle peut contenir.
Dans la corroyerie,
on a soin de donner à chaque cuir la destination qui paraît la plus
propre, l’apprêt qui convient à l’usage pour lequel on le réserve, et
les façons, les manipulations longues et combinées qui le portent à sa
perfection : on emploie différens dégras, qui sont
des huiles
préparées.
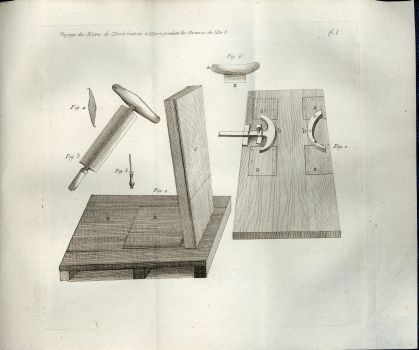 Un
des principaux instrumens qui servent au
corroyeur, pour la préparation des cuirs à l’anglaise, est un chevalet,
(fig. 2, planche première.) composé d’une table, (B) portée sur trois
ais, et sur laquelle l’ouvrier met quelquefois une hausse (A), selon
qu’il a besoin d’être élevé au-dessus d’un montant fixé debout à l’une
des extrémités de la table. Ce montant n’est pas assemblé
perpendiculairement sur la table, et son inclinaison est accommodée à
l’usage de l’ouvrier, aussi bien que sa hauteur. Il est revêtu, dans la
partie antérieure, d’une planche de bois dur, ordinairement de gayac
(C), pour qu’elle résiste davantage et qu’elle ne s’enfonce point sous
les pressions qu’elle éprouve. Un
des principaux instrumens qui servent au
corroyeur, pour la préparation des cuirs à l’anglaise, est un chevalet,
(fig. 2, planche première.) composé d’une table, (B) portée sur trois
ais, et sur laquelle l’ouvrier met quelquefois une hausse (A), selon
qu’il a besoin d’être élevé au-dessus d’un montant fixé debout à l’une
des extrémités de la table. Ce montant n’est pas assemblé
perpendiculairement sur la table, et son inclinaison est accommodée à
l’usage de l’ouvrier, aussi bien que sa hauteur. Il est revêtu, dans la
partie antérieure, d’une planche de bois dur, ordinairement de gayac
(C), pour qu’elle résiste davantage et qu’elle ne s’enfonce point sous
les pressions qu’elle éprouve.
Lorsque le cuir est suffisamment
tanné, le corroyeur le place sur le chevalet pour l’écharner, et il
procède à cette opération avec le couteau (fig. 3.), dont la forme et
l’usage doivent être décrits. Le fil n’en est pas droit comme celui des
couteaux ordinaires, des faulx à raser ou des lunettes
: mais quand
il a été aminci
sur la pierre, on le renverse sur une des surfaces,
et la fig. 4, qui indique le plan de la coupe perpendiculaire à l’axe
du couteau, fait voir le retour du fil des deux tranchans, ce qui donne
plutôt l’idée d’un racloir que d’un couteau.
C’est avec une
broche d’acier, appelée fusil, (fig. 5.) que l’ouvrier retourne le fil
du couteau, et il importe beaucoup que la ligne du fil après sa
courbure soit bien droite et bien égale.
L’ouvrier placé sur la
tablette et penché sur le montant (C) tient le couteau des deux mains,
le fil tourné vers lui, et en rasant le cuir, du côté de la chair, il
en enlève des espèces de feuilles très-larges, et il le réduit à
l’épaisseur qu’il veut lui donner, en la rendant parfaitement égale
dans toute l’étendue de la peau.
Il faut pour ce travail
beaucoup d’adresse, et tous les ouvriers n’acquièrent pas aisément
l’habitude qui est nécessaire pour le faire avec succès.
Lorsque
le cuir est écharné comme il doit l’être, on le lave de nouveau, on le
nettoye avec des brosses et des pierres de grès, on l’imbibe d’autant
de dégras que son épaisseur le requiert, et quand il est seché d’eau,
l’ouvrier le roule sous une pommelle, qui est une espèce de rabot sans
fer, long d’environ dix pouces, courbé dans sa longueur et cannelé dans
sa largeur. C’est en roulant le cuir sur lui même, à plusieurs
reprises, en le froissant avec la pommelle, que l’ouvrier l’assouplit
et qu’il le prépare à conserver long-temps sa souplesse.
Il est
alors en état d’être façonné en tige de botte, et pour cela l’ouvrier
le mouille et l’étend sur une table de marbre, sur laquelle il ébauche
le rétrécissement et les extensions convenables. Cette opération,
commencée sur le marbre, s’achève sur une table revêtue de lames de
cuivre, en quelques endroits, garnie de deux pièces de fer (bb) en arc
de cercle, représentée fig. I.ere, appelée forme.
Les lames de
cuivre indiquées par les lettres (aaaa) servent à conserver la surface
de la forme qui, sans cela, se creuserait sous le fer de l’étire
(fig. 6.)
L’une des pièces de fer en arc est invariablement
fixée à la gauche de l’ouvrier ; l’autre pièce est jointe à une tige
qui est maintenue par deux brides coudées sous lesquelles elle
coule
librement. Une vis de pression peut également la fixer à la distance où
l’on veut qu’elle soit de la première.
La tige de botte,
ébauchée sur la table de marbre, est étendue sur la forme,
entre les
arcs de fer, et elle s’y colle au moyen du dégras dont on
l’abreuve.
L’ouvrier
repasse plusieurs fois l’étire
(AB, fig. 6) sur le cuir, il étend les
extrémités, qu’il aggrandit, tandis que le milieu se resserre sur
lui-même entre les arcs.
Cette manipulation se répète pendant
long-temps, et la pièce de cuir, dont la figure était un carré ou
parrallelograme, est, à la sortie de la forme, plus large dans le haut
que dans le bas, et si rétrécie dans son milieu, qu’on la croirait
échancrée des deux côtés. Cependant on n’en a rien enlevé, et quand on
tire sur les deux côtés, le cuir s’étend et reprend ses premières
dimensions, qu’on lui fait perdre de nouveau en le replaçant sur la
forme.
Enfin, la tige de botte est de nouveau mouillée, passée
en huile, et mise au séchoir, puis rapportée sur le
chevalet,
lorsqu’il le faut, pour recevoir la dernière et la plus difficile des
manipulations. Ce travail n’est cependant nécessaire que
lorsque la
fleur est un peu éraflée : il consiste à refendre la fleur,
ou
plutôt à la parer,
et il s’opère en enlevant, avec le couteau, une
très-légère partie de la fleur, pour rendre à la peau entière le même
grain et le même œil, et faire à ce moyen disparaître l’éraflure.
Tels
sont les procédés particuliers de cette préparation. Les principaux
instrumens dont on se sert, n’étant point décrits dans l’ouvrage sur
l’art du tanneur et du corroyeur, par le Citoyen Lalande, ils furent
dessinés pour que leur figure se trouvât jointe aux détails que nous
comptions donner.
Le couteau sur-tout fut dessiné avec soin,
parce que les fabricans nous assurèrent que les qualités qu’il doit
avoir, sont une chose très-difficile à saisir ; qu’ils ne pouvaient pas
s’en procurer en France, et qu’il n’y avait même en Angleterre qu’une
seule famille d’ouvriers qui sçût donner à ce couteau le plus grand
dégré de perfection (9).
Nous fumes très-sensibles à cette
déclaration des fabricans, nous fîmes des vœux pour que les ouvriers
dont la France peut s’honorer, donnent tous leurs soins à la
fabrication de ces couteaux ; pour qu’on ne soit pas obligé de les
tirer de l’étranger, et que l’imitation d’un procédé utile ne soit plus
subordonnée à l’espèce de tribut que le défaut d’instrumens nous impose.
Les
renseignemens que nous avons acquis sur l’usage des tiges préparées à
la manière anglaise, nous ont convaincus qu’elles étaient les
meilleures qu’on pût employer pour marcher avec des bottes, sans être
beaucoup plus fatigué que si l’on n’en avait pas.
Il y a même
beaucoup de tiges assez bien préparées pour que l’eau ne les pénétre
point, et pour qu’elles soient d’une très-longue durée.
Nous ne
demandâmes point à voir les autres tanneries de la commune, parce que
nous n’avions pas de nouvelles instructions à recevoir, et parce que,
si nous avions voulu voir toutes celles qui méritent, par leur travail
et par leurs succès, d’être visitées, il eût fallu les parcourir toutes.
LA
FILATURE MÉCANIQUE : LA MACHINE A
ROUSSIR.
Nous
fûmes reçus dans une autre manufacture établie et dirigée, à
Pont-Audemer, par les citoyens Callon ; elle renferme des ateliers de
filature mécanique, et des tisseranderies à navette volante, pour la
fabrication de toutes les étoffes de coton, pour les velours, les
basins, etc.
Tous ces travaux avaient déjà obtenu des succès
marqués à Rouen, où les citoyens Callon s’étaient établis avant la
révolution ; mais leur établissement fut détruit dans un soulèvement
coupable, dont ils n’ont pas recherché les auteurs, malgré les pertes
immenses qu’ils ont souffertes.
On prit pour prétexte de cette
violation du droit de propriété et de la destruction d’une des branches
de la prospérité publique, dans une nation commerçante et industrieuse,
le tort que les filatures mécaniques causaient à tous les ouvriers
filant à la main, et la crainte exagérée de voir ceux-ci périr de faim,
en manquant d’ouvrage, si on laissait prévaloir des moyens expéditifs,
dont le produit coutait beaucoup moins que le travail ordinaire des
fileuses.
Ces violences et ces prétextes nous rappelèrent des
oppositions du même genre, que les imprimeries éprouvèrent lorsqu’elles
s’établirent, dans le quinzième siècle ; et les tracasseries qu’on leur
suscita pour les faire prohiber, comme une invention nuisible à tous
les copistes, et propre à les faire périr de misère, la plume à la
main, si les livres se multipliaient à l’infini par la rapidité magique
de l’imprimerie.
On conçoit très-bien que tous les moyens
mécaniques doivent froisser, quand ils s’établissent, les intérêts des
ouvriers dont on employait les bras auparavant : mais cet inconvénient
particulier ne peut être mis en parallele avec les avantages
incalculables qui en résultent pour la société toute entière, 1.° parce
que les prix de la main-d’œuvre fait non-seulement donner les produits
à meilleur compte, mais qu’il met à portée d’assurer la concurrence
avec l’étranger, et qu’il rétablit la balance commerciale ; 2.° parce
que l’état recouvre, pour d’autres travaux, les bras que les mécaniques
remplacent ; 3.° fréquemment encore, parce qu’il y a dans la
fabrication plus d’uniformité et que les machines, quand elles sont
arrivées au dégré de perfection qu’elles peuvent acquérir, mettent le
fabricant et le consommateur à l’abri des torts que leur causent
quelquefois l’inattention, la négligence ou la mauvaise foi de
l’ouvrier.
Telles étaient les observations que nous faisaient
les directeurs de la manufacture de coton et qu’ils appuyaient de la
faveur générale que les filatures mécaniques obtiennent actuellement en
France.
Cette manufacture est située au nord-ouest de la
commune, dans l’ancien emplacement occupé, avant la révolution, par un
couvent de cordeliers, fondé
et aumôné par Louis XI en 1473.
Les
propriétaires actuels de cet établissement y ont réuni une portion de
prairie qui l’avoisinait, pour former une blanchisserie ordinaire ; et
dans les bâtimens de l’ancien couvent ils ont établi leurs ateliers de
tisseranderie et ceux de filature. Cette dernière partie est
alternativement mise en action par un manége et par un courant ; mais
si les bienfaits que les directeurs espèrent de la paix prochaine
remplissent leurs vœux, ils pourront établir une pompe à feu qui
remplacera avantageusement ces deux moyens.
Il nous serait
impossible de rendre compte de toutes les pièces qui sont mises en jeu
dans une filature mécanique ; de toutes les roues, de toutes les
bobines, de tous les fuseaux qui se meuvent à la fois, par le moyen des
engrenages, des cordes sans fin et des renvois de toute espèce.
On
ne voit point sans étonnement, dans la carderie, qu’un enfant puisse
convenablement attacher le coton sur les pointes recourbées d’une carde
circulaire, et que plusieurs tambours, garnis de la même manière, se le
distribuent, dans un ordre admirable, en roulant les uns sur les autres
en divers sens.
Un peigne d’acier poli s’abaisse et se relève
alternativement sur le dernier des tambours ; il détache le coton qui
s’est roulé sur les cardes circulaires et le fait tomber en ouate
dans un cilindre, pour être disposé en boudins dont les
dimensions
diminuent, peu à peu, jusqu’à ce qu’ils soient enfin formés en fils
plus ou moins déliés.
La navette volante tire son nom de sa
course rapide dans la chaîne du tisserand. La même mécanique la pousse
et la rappèle : l’ouvrier n’a que deux mouvemens à faire de la même
main, tandis que de l’autre il frappe, avec le rot, le fil que la
navette vient d’interposer. C’est dans les ateliers qu’il faut aller
prendre connaissance du mécanisme qu’on y met en jeu ; les explications
sommaires ne le feraient pas entendre, et les détails seraient infinis,
s’il fallait en donner une entière description.
Au surplus les
mécaniques sont aujourd’hui très multipliées dans le département, elles
sont connues de beaucoup de citoyens, et ce serait une chose inutile
pour les uns et superflue pour les autres d’essayer de les décrire.
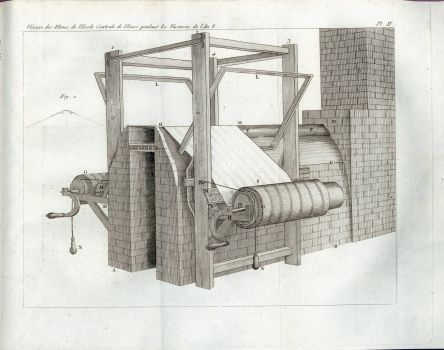 Cependant
il en est une qui est très-curieuse et dont il est en même temps assez
facile de faire connaître les résultats. C’est celle qu’on emploie pour
roussir les étoffes de coton, et qui est représentée dans la planche
2e Cependant
il en est une qui est très-curieuse et dont il est en même temps assez
facile de faire connaître les résultats. C’est celle qu’on emploie pour
roussir les étoffes de coton, et qui est représentée dans la planche
2e
Lorsque les étoffes de coton sortent du métier, elles sont
couvertes d’une espèce de duvet que le fil porte avec lui, et que
l’ouvrier ne peut enfermer dans le tissu. Ce duvet enveloppe, en
quelque sorte, le dessin de l’étoffe : les rayes du basin s’y trouvent
cachées, les points du piqué en sont recouverts, le cannelé des velours
se voit à peine, et l’on sent que, pour faire valoir le dessin et lui
donner de la netteté, il est indispensable d’enlever ce duvet et de
raser en quelque manière le tissu, pour le rendre lisse et faire
ressortir les parties élevées.
Cette opération, qu’on tenterait
inutilement avec des tranchans de quelque espèce qu’ils fussent, se
fait avec beaucoup de succès par le moyen du feu, en brûlant toute
cette surface lanugineuse, pour mettre à découvert le tissu, sans que
le feu l’endommage.
Il y a déjà long-temps que ce travail et
cette méthode se trouvent indiqués dans l’ouvrage du citoyen Pajot,
mais on ne se servait alors que de grandes plaques de fer qu’on faisait
rougir et qu’on passait sur l’étoffe tendue jusqu’à ce que tout le
duvet fut brûlé.
Cette manipulation était toujours difficile,
quelquefois même elle causait des accidens graves et jamais elle ne
brûlait parfaitement le duvet.
Celle qu’on a depuis employée est
infiniment préférable et quoiqu’elle ne soit point particulière à la
manufacture des citoyens Callon, quoiqu’elle soit employée à Rouen et
ailleurs, et qu’elle soit maintenant connue de plusieurs fabricans,
néanmoins comme elle n’est expliquée ni dans l’ouvrage du citoyen
Pajot, ni dans aucune autre, on sera peut-être bien aise d’en voir la
description, et voici en quoi elle consiste.
La construction (A.
B. C.) est un fourneau de brique avec sa cheminée (D. D.). Une grille
de fer (E.) est placée dans ce fourneau et se continue dans toute sa
longueur jusqu’à la cheminée. C’est sur cette grille que se place le
charbon, et le tout est recouvert d’un demi cilindre de fer fondu (F.
F.) qui termine le fourneau.
Les quatre montans de bois (1. 2.
3. 4.) maintenus par des traverses forment un chassis solide sur lequel
sont ajustés deux cilindres ou tambours (G. G.) soutenus par les bras
et les liens (H. H.). L’étoffe qu’il s’agit de raser, ou roussir, est
roulée sur l’un des tambours, de manière que l’envers (I.) soit en
dehors et que l’endroit s’applique sur le demi cilindre de fer (F. F.)
pour reparaître ensuite sur l’autre tambour.
Lors qu’on fait
tourner le premier tambour, l’étoffe se dévide pour se rouler sur le
second en passant sur le demi cilindre. Deux cadres (L. L.) mobiles sur
deux pôles fixés dans leur milieu, sont placés entre les montans :
l’étoffe est passée dans ces cadres et quand leur côté intérieur est
abaissé, elle porte immédiatement sur le demi cilindre ; mais si, en
appuyant la main sur les côtés extérieurs des cadres, on élève les
côtés opposés, ceux-ci enlèvent avec eux la toile qu’ils renferment ;
ils l’empêchent de toucher le fer, et préviennent les accidens.
Tout
étant ainsi disposé, on allume le charbon placé sur la grille ; un
courant d’air l’anime violemment par-dessous et ne tarde pas à
échauffer le demi cilindre ; on parvient même à le faire rougir, et
c’est quand il est très-ardent qu’on abaisse les cadres, pour que
l’étoffe s’applique sur le fer rouge ; on fait alors tourner les
tambours et l’on dévide la pièce entière pour brûler le duvet.
Ce
duvet, réduit en charbon sur le cilindre, est enlevé par une longue
brosse, garnie de soies rudes, qu’on voit en (M. M.) et qui est placée
sur des appuis mobiles, dans une inclinaison semblable à celle de
l’étoffe. L’effet de l’ustion, par le fer, et du frottement sur la
brosse, se montre à découvert sur le tambour, par la manière dont
l’étoffe s’y roule ; l’ouvrier, qui se trouve à portée de conduire et
diriger convenablement la vîtesse des tambours, peut juger en même
temps si l’opération s’est bien faite.
Il semble, quand on voit
la pièce de coton s’abaisser avec les cadres et tomber sur le fer
enflammé, qu’elle va se réduire en cendres, et quand c’est une pièce de
basin qu’on voit ainsi frotter sur un fer rouge, les craintes
deviennent encore plus fortes.
On est du moins porté à croire,
quand on entend le recit de ce travail, que les tambours tournent avec
une grande vitesse et que l’étoffe passe sur le fer avec une extrême
rapidité.
C’est néanmoins le contraire ; les tambours ne vont
pas très vîte, les yeux suivent avec facilité le mouvement de l’étoffe,
et de peur qu’elle ne s’applique pas avec assez de force sur le fer, on
emploie des poids (N. N.) dont la corde s’appuye sur les tambours, au
moyen d’une gorge qu’on y a pratiquée : ces poids augmentent le
frottement des tambours, ils en ralentissent le mouvement ; et la
toile, devenant plus tendue, s’applique avec plus de force sur le fer.
Elle
se roule même dessus à raison de l’inclinaison qu’on lui donne, et l’on
peut voir dans le profil géométrique (fig. 2) l’angle sous lequel cette
inclinaison est déterminée pour roussir le basin.
Cet angle
n’est pas le même pour toutes les étoffes, il est plus ou moins ouvert,
et une barre qui s’élève ou s’abaisse à volonté, au moyen des chevilles
qui l’assujettissent, sert à fixer l’inclinaison qu’on veut donner aux
étoffes.
Malgré la supériorité de cette manipulation sur celle
des plaques rougies qu’on passait autrefois sur la pièce de coton, le
citoyen Callon sait qu’il existe encore de nouveaux procédés par
lesquels les creux des étoffes, dans le piqué et dans les cannelés, se
nétoyent mieux, se rasent plus exactement et deviennent lisses comme
les points les plus élevés.
Il sçait qu’on ajoute de l’esprit de
vin dans le travail, soit en faisant passer l’étoffe par une étuve où
elle s’imbibe du fluide réduit en vapeurs pour qu’il s’enflamme
subitement lorsqu’il touche le fer rouge, soit en employant d’autres
moyens dont il ne fait pas mystère, mais qu’il est juste de lui laisser
publier lorsque, par les essais qu’il compte faire, il aura justifié la
théorie qu’il sait si bien développer.
LES
MÉMOIRES HISTORIQUES.
Nous
nous faisons un devoir d’offrir à tous les citoyens, qui ont eu la
bonté de nous instruire des détails dont nous venons de rendre compte,
l’expression bien sincère de notre reconnaissance. Nous desirons
sur-tout que ce témoignage de nos sentimens, soit agréé des magistrats
de cette commune qui nous accueillirent avec indulgence et qui
voulurent bien, pour notre instruction, communiquer des mémoires
extrêmement curieux dans lesquels sont consignées des notes
intéressantes pour l’histoire.
En effet, c’est dans ces mémoires
qu’on trouve l’explication de deux passages du Catholicon d’Espagne
ou satire menippée, avec la confirmation de quelques détails que
l’histoire a conservés. (note
IV)
Indépendamment de
l’explication de ces deux passages, nous avons encore trouvé, dans ces
mémoires, d’autres détails relatifs aux localités, qui confirment ou
qui développent ce que les chroniques et les histoires de la province
ont transmis, et qui peignent d’ailleurs les mœurs et le caractère du
temps. (note
V)
C’est aussi dans ces mémoires que nous avons
appris que Pont-Audemer, par sa situation sur la Risle et sa
communication avec la Seine, fut pendant long-temps, une des places
importantes de la province. Les Anglais regardaient comme un grand
avantage de s’en rendre les maîtres, et dans les troubles des siècles
précédens, les factieux formèrent contre elle diverses tentatives qui
en firent souvent le théâtre de guerres sanglantes et ruineuses.
Charles
le Mauvais en était en possession, lorsque le Connétable
Bertrand-Duguesclin la prit en 1378 après plusieurs attaques, et rasa
ses fortifications ainsi que le château (10).
Les Anglais s’en étant ensuite emparés, elle fut reprise d’assaut par
les comtes de Dunois et de St.-Pol (note
VI).
Il
nous a paru naturel d’inscrire de suite tout ce qui pouvait avoir
rapport à la ville dans laquelle nous avions passé : mais tous ces
détails ne nous furent pas connus au moment même de notre passage, ce
ne fut que pendant le séjour, que nous fîmes dans le lieu des
observations, que ces connaissances furent acquises par la lecture des
mémoires historiques. C’est aussi par cette lecture que nous apprîmes
que cette ville avait donné naissance à Pierre Lelorain, sieur de
Valmont, auteur des élémens de l’histoire, de la Phisique occulte ou de
la Baguette divinatoire, de quelques dissertations sur les médailles,
etc. et à Pierre David, cordelier, qui fit imprimer des sermons en
latin.
DÉPART
DE PONT-AUDEMER : L’ERREUR
D’OPTIQUE
: LE VIEUX IF.
Tandis
que nous étions à Pont-Audemer, deux de nos camarades de voyage se
joignirent à nous, et lorsque nous eûmes visité les manufactures, nous
partîmes pour nous rendre dans la commune de Conteville où nous devions
établir le centre de nos observations ; au confluent de la Risle et de
la Seine.
La première chose qui soit digne d’être remarquée sur
la route, est un ancien château nommé le Bois d’Aubigny, à
deux
portées de fusil de la grande route et six cents pas du chemin de
traverse.
Il est bâti sur un terrain très-incliné, et quand on
le regarde du côté de l’orient, il semble incliné lui-même vers la côte
au pied de laquelle il est construit ; les arrêtes de ses pignons
paraissent sortir de leur à-plomb, l’on croirait qu’un des bouts de
cette maison s’est affaissé sur ses fondemens et qu’il est entré
profondément en terre.
Cependant il n’en est rien, la
construction n’a nullement souffert et l’apparence n’est que l’effet
d’une illusion d’optique ; mais elle est très-forte, il n’est pas
possible de la corriger, on a beau raisonner, d’après la connaissance
qu’on a du local, contre le faux semblant de la perspective, ce n’est
qu’en approchant de la maison, que l’illusion se dissipe.
L’inclinaison
du terrain est donc la seule cause de l’erreur ; les murs ont moins de
hauteur sur le terrain élevé qu’au bas de la pente, et comme on n’en
voit pas de loin les premières assises, on se persuade que la
différence des hauteurs, dans les extrémités de la maison, vient de
l’enfoncement qui paraît s’être fait dans le sol.
Nous trouvâmes
ensuite un arbre remarquable par sa grosseur et par les irrégularités
de son contour ; c’était un If extrêmement vieux, entièrement pourri
dans toute la partie ligneuse du tronc, ne vivant plus que par son
écorce et ses racines ; mais ferme encore sur ses débris et résistant à
la violence des tempêtes comme aux attaques ruineuses du temps.
Nous
n’en prîmes pas la mesure, parce qu’on nous dit que nous en trouverions
de plus gros et de plus étonnans dans le pays, et nous continuâmes
notre route vers Conteville, où nous arrivâmes après une marche de
trois heures, que la pluie nous força souvent d’interrompre.
L’ETABLISSEMENT
: LES BAGAGES : LES
INSTRUMENS
: LE PREMIER DINER
SOUS LA
TENTE : LES TOASTS.
La
voiture qui portait nos bagages et la tente nous avait précédés ; et
les élèves qui devaient se joindre à nous ne tardèrent pas à arriver.
En très-peu de temps la tente fut dressée ; nous nous établîmes dans un
enclos fermé de murs, dont il nous fut permis de disposer.
Chacun
reconnut le bagage qui lui appartenait : on visita les machines et les
instrumens, tous se trouvèrent sains et saufs à l’exception d’un
thermomètre, et quand ces préparatifs furent terminés, nous songeâmes à
dîner. Nous nous rangeâmes sous la tente, autour d’une table frugale,
et pleins d’espoir dans les courses que nous allions faire, un cri
général se fit entendre, vive la République, vivent les Naturalistes
des deux mondes !
Que leurs occupations, pleines de charmes,
répandent, sur leur vie entière, le calme et la sérénité, qu’ils soient
récompensés de leurs veilles et de leurs travaux par le bonheur de
devenir utiles à leurs semblables ! Que leurs découvertes excitent
toujours notre émulation, que leurs savans écrits soient les guides de
notre inexpérience ; puissions-nous par notre conduite et notre
application, nous montrer dignes de la carrière qu’ils ont ouverte
devant nous !
Ce repas, un des plus intéressans que nous ayons
jamais fait, ne fut cependant pas de longue durée, nous l’eûmes bientôt
achevé et nous songeâmes à met[t]re de l’ordre dans le travail que nous
allions entreprendre.
Les uns se chargèrent de dessiner les sites, les objets de minéralogie,
d’insectologie, de botanique, etc.
D’autres furent chargés de rechercher dans la campagne, les plantes,
les insectes, les minéraux et les fossiles.
Les plus avancés en géométrie eurent la partie des mesures et des
calculs.
Les plus adroits furent nommés pour disposer les plantes dans les
herbiers et les insectes dans les boëtes.
Tous
se promirent de regarder tout, de visiter tout, de ne rien négliger, de
s’avertir réciproquement et de faire tous leurs efforts pour ne pas
laisser dégénérer en une promenade stérile, un voyage dont ils
pouvaient retirer tant d’utilité.
Nous étions alors dix-sept, et nous eussions été plus nombreux s’il eut
été possible de préparer plutôt l’expédition.
Nous
possédions au milieu de nous les Directeurs du Pensionnat, un des
Professeurs, et un des Membres du Jury d’instruction, qui avaient bien
voulu se joindre à nous pour diriger nos observations. Quand nous fûmes
en quelque sorte organisés comme nous venons de le dire, nous nous
présentâmes devant le Maire de la commune, à qui nous rendîmes compte
du sujet de notre voyage, en lui donnant l’assurance que pendant notre
séjour, nous ferions nos efforts pour nous rendre dignes de l’affection
que déjà plusieurs habitans se plaisaient à nous témoigner.
LA VUE
DE LA MER.
Ce
premier devoir étant rempli, nous nous portâmes avec toute l’ardeur
qu’inspire la nouveauté sur le rivage que nous avions plusieurs fois
entrevu de loin. A mesure que nous avancions, la perspective s’étendait
devant nous, et ce spectacle imprimait dans notre ame un sentiment de
grandeur et d’élévation que nous n’avions jamais éprouvé.
Cependant
la surprise se mêlait à notre admiration : nous avions quelquefois
entendu parler de la mer ; nous croyions voir des vagues agitées et des
flots écumans ! Cette fois-là c’était un vaste bassin, calme et
tranquille comme un lac, pur et limpide comme le cristal.
Des
pêcheurs qui furent témoins de notre étonnement, nous expliquèrent la
cause de cette espèce d’immobilité, en nous faisant connaître qu’elle
était l’effet du moment précis de la pleine mer, c’est-à-dire, du
moment où les eaux parvenues à leur plus grande élévation sur le
rivage, étaient prêtes à s’abaisser en refluant vers l’océan. Une autre
cause contribuait encore au calme de la mer, c’était celui de
l’atmosphère et le silence absolu des vents.
Mais ils
observèrent que nous n’étions pas précisément au bord de la mer ; que
nous ne voyions encore que l’embouchure de la Seine ; que malgré la
largeur du bassin, l’eau de la mer qui le remplissait se trouvait à
l’abri des courans atmosphériques qui se font toujours sentir plus ou
moins au large,
et qu’en pleine mer l’eau n’était pas aussi
tranquille. Alors nos yeux se tournèrent vers le Hâvre que nous
découvrions au pied de la côte du pays de Caux et qui se dessinait à
l’horizon comme une langue de terre avancée dans la mer. Vis-à-vis on
voyoit Honfleur situé sur la rive où nous étions nous-mêmes, et dans
l’intervalle de ces deux villes on ne découvrait rien !... Le ton du
ciel se confondait avec les reflèts de la mer, et l’imagination que
rien n’arrête, nous aurait peint l’étendue comme infinie, si les
principes de géométrie ne nous eussent rappelé que l’horizon visible ne
pouvait avoir qu’une lieue de rayon, du point où nous étions placés
(11).
Ces tableaux que nous admirions de plus en plus, se
composaient des côtes élevées qui bordent au nord l’embouchure de la
Seine ; de la pente des vallons qui contraste avec elles au midi ; du
vide imposant que la mer offre à l’ouest ; et vers l’orient de la coupe
perpendiculaire d’une des collines de la Risle, posée d’aplomb sur une
vaste plaine, où paissent cent troupeaux, et couvrant un autre pays que
des lointains vaporeux indiquaient au-dessus d’elle, dans les derniers
plans de la perspective.
Il y avait près d’une heure que nous
étions sur le rivage sans que nous eussions, pour ainsi dire, changé de
place ; personne n’avait éprouvé de fatigue dans la durée du spectacle,
personne ne s’était assis, tout le monde admirait ; et ceux-là même à
qui la vue du rivage était familière, convenaient encore avec émotion,
qu’elle était admirable. Cependant le reflux acquérait de la vîtesse,
le sable était découvert en quelques endroits ; et sur toute la rive on
voyait un banc immense de galet que la mer roule devant elle dans les
gros temps.
Le vent s’était élevé à l’occident, il contrariait
le reflux, il soulevait des lames et poussait des vagues ; nous ne
désirions pas une tempête, mais une plus grande agitation eût satisfait
nos vœux.
PROJET
DE VOYAGE : DÉNOMBREMENT DES
INSTRUMENS
D’OBSERVATION.
Non
contens du spectacle dont nous venions de jouir, nous voulûmes voir la
mer plus en grand, et il fut arrêté que dès le lendemain matin nous
irions à Honfleur pour passer au Hâvre. Un motif d’un plus grand
intérêt que celui de la curiosité nous détermina ; c’était le lendemain
que la plus grande marée de la lunaison devait avoir lieu, et cette
circonstance fit décider le voyage du Hâvre (note VII).
Nous
quittâmes le bord de la mer pour aller faire nos préparatifs, et pour
mettre en ordre les instrumens que nous n’avions fait que visiter dans
les caisses : mais ce ne fut point sans tourner mille fois les yeux
vers le rivage ; et malgré les sites agréables d’une très-belle
campagne que nous traversions, c’était toujours du côté de la mer qu’on
se tournait, quand il se présentait une hauteur d’où l’on pût encore la
voir, ou quand une percée la faisait découvrir entre les arbres.
Nous
nous entretînmes pendant notre retour des productions innombrables
qu’elle renferme : nous nous rappelâmes cette lumière qui brille la
nuit à sa surface, et nous convînmes de revenir le même jour, à la
marée du soir, pour être témoins de ce phénomène.
Au retour du
rivage, chacun s’occupa des attributions qui lui étaient échues : les
instrumens furent de nouveau visités et mis en place, le thermomètre
qu’on avait trouvé le matin un peu endommagé, était la seule pièce qui
eut souffert. Nous avions alors, en état de servir, un baromètre à
cuvette, un hygromètre avec thermomètre (12), un microscope, un
télescope, une chambre obscure d’un très-bon effet, des lunettes
d’approche, plusieurs loupes de différens foyers, des équerres et un
graphomètre (13), un niveau d’eau et un autre à bulle d’air, un
odomètre ou compte-pas (14), deux décamètres, une petite boussole
portative : outre cela nous pouvions disposer d’un atelier voisin dans
lequel il y avait une petite forge et beaucoup d’outils.
Nous
avions aussi les N.os des cartes de Cassini, répondant au territoire
que nous devions visiter, quelques livres d’histoire sur l’ancienne
province, des chroniques et des mémoires, quelques livres de botanique
et d’histoire naturelle, des livres de voyage et Robinson Crusoé. Enfin
nous avions des crayons pour les déssinateurs, du papier, de l’encre de
la Chine, des plumes de corbeau, etc. etc.
Tous les fourmi-lions
que nous avions trouvés près d’Annebault, furent soigneusement mis dans
un poudrier, avec une espèce de sable très-fin, d’une couleur ocreuse
qui nous le fit regarder comme un oxide de fer. Il y en eut trois qui
ne tardèrent point à s’enfoncer, mais les autres étaient languissans,
ils avaient souffert dans le voyage, et ce ne fut qu’au bout de
quelques jours qu’ils se creusèrent des cônes. Depuis ce temps ils ne
dûrent pas regretter leur premier pays, jamais fourmi-lions n’ont été
mieux approvisionnés ; tous les jours il pleuvait des mouches et des
fourmis dans leurs repaires ; leurs mouvemens brusques et rapides
attestèrent le bien-être qu’ils éprouvaient : mais nous ne devions
point voire éclore cette année les demoiselles dont
ils filaient le
trousseau, et ce n’était que l’année suivante qu’ils
devaient parvenir
à leur état parfait.
En attendant le souper, un des voyageurs
lut des notes qu’il avait déjà faites sur les premiers jours de
l’expédition. Mais comme en racontant les observations, il avait
fidèlement employé, dans son récit, les noms de leurs auteurs, ceux-ci
réclamèrent aussi-tôt : c’est au hasard que nous les devons,
s’écrièrent-ils ; il n’y a pas de mérite à être plus heureux qu’autrui
; chaque découverte appartient en commun à tous les voyageurs, sans
qu’il faille de prime pour aucun d’eux. Tous se rangèrent à cet avis,
parce que tous espéraient de contribuer au succès du voyage : on se
rappela le proverbe des anciens qui voulait que Mercure fût commun, et
l’on se mit à table en se donnant l’assurance d’une émulation généreuse
et d’une amitié inaltérable.
VOYAGE
DU SOIR AU BORD DE LA MER :
INSECTES
PHOSPHORESCENS.
La
lune était déjà sur l’horizon, quand nous eûmes soupé, et quoique le
temps fût couvert, la demi teinte qu’elle répandait sur les objets,
nous faisait craindre de ne pas voir la lumière de la mer.
Nous
allâmes néanmoins au rivage : nous prîmes des vases pour puiser de
l’eau, des sacs de toile, en cône, pour la tamiser, des loupes, des
Capsules, etc.
La mer montait quand nous arrivâmes, le flot
était même assez rapide : mais la mer n’était pas lumineuse et le clair
de lune nous parut être l’obstacle qui s’y opposait ; Alors nous
battîmes l’eau, nous l’agitâmes de diverses manières, et nous vîmes
enfin des points brillans, sur le bord des vagues, dont la lumière
devenait plus vive entre les cailloux ; mais ni l’œil ne pût en
apercevoir la cause, ni les loupes ne purent la faire reconnaître, ni
le tact ne pût l’indiquer.
L’eau, qu’on puise à la mer, brille
dans le vase qui la contient comme sur le rivage d’où on la tire ; elle
conserve cette phosphorescence pendant plus de vingt-quatre heures : ou
plutôt les animalcules, qui brillent dans l’eau de la mer, donnent de
la lumière tant qu’ils sont vivans, et ils conservent la vie dans cette
eau, pendant plus de vingt-quatre heures.
Lorsque, pendant le
jour, on agite l’eau de mer, on ne découvre pas ces animalcules qui
sont forts petits et presque entièrement diaphanes :……. mais ce que
nous dirions, sur ce phénomène, ne pourrait être qu’une répétition de
ce qu’a dit un ingénieur de la marine, qui l’observait en 1763 et 1764.
Tout
ce que nous pouvons ajouter à l’extrait que le dictionnaire de
l’industrie a donné des observations de M. Rigault, c’est que 1.° ces
animalcules paraissent absolument privés de la faculté de changer de
place ; 2.° ils sont composés d’une partie à peu-près sphérique, d’une
autre partie tubiforme attachée à la sphère ; et cette attache forme
une espèce de sinus qu’on découvre dans le profil ; 3.° du point
enfoncé où la partie tubi-forme s’attache à la partie globuleuse, on
voit cinq ou six radicules, étendues dans la sphère, imitant,
à-peu-près, une griffe d’asperge et ne paraissant point avoir de
mouvement ; 4.° la partie tubi-forme paraît composée d’anneaux
superposés, et sa longueur moyenne est de deux fois le diamètre de la
sphère ; 5.° la sphère ne paraît avoir aucuns mouvemens, la seule
partie tubi-forme en laisse apercevoir, mais ils ne sont ni rapides ni
variés, et cette partie n’en a point d’autre que de se tordre lentement
sur elle-même en divers sens, comme si elle s’efforçait de se détacher
de la sphère et de se débarrasser des liens qui la retienne ; 6.°
jamais on ne voit ces insectes ni saisir des proies, ni se mettre au
guet pour en surprendre ; au contraire, ils sont quelquefois dévorés
par des animalcules trente fois plus petits, qui s’élancent avec
violence contre la partie sphérique, qui paraissent la saisir et qui la
font se rétrécir et se crisper, présage aussi prompt qu’infaillible de
la mort de l’animal (15).
D’après toutes ces données comment
faut-il regarder ces animalcules ? quelle est leur origine ? où
prennent-ils naissance ? quels sont leurs développemens, comment se
nourrissent-ils ? faut-il les ranger parmi les zoophytes, subissent-ils
des métamorphoses ? sont-ils au dernier période de leurs mutations ?
qu’elle est la source de la lumière qu’ils produisent ? quelles sont
les conditions pour qu’elle paraisse ? est-ce la sphère qui la donne ?
est-ce la partie tubi-forme, est-ce l’animal tout entier ?
Dans
l’inspiration de l’eau, par les poissons, ces animalcules périssent-ils
au passage des branchies, ou sortent-ils sains et saufs de ce filtre
animal ? dans le premier cas donnent-ils à l’eau, qui les contient, une
propriété nutritive pour le poisson qui l’aspire ?......
Voilà
les questions que nous nous faisions et les embarras que nous n’avions
pas l’espoir de lever, à cause du peu de temps que nous pouvions donner
à des observations, qui ne doivent peut être offrir de résultats
certains, qu’après avoir été plusieurs fois répétées avec la plus
grande attention.
LE BOIS
MORT : LES POISSONS PUTRÉFIÉS :
LES
VERS LUISANS.
La
nuit qui s’avançait, nous rappela vers la tente ; mais la
phosphorescence nous occupant toujours, tout ce qui brille la nuit dans
la nature fut mis en parallele avec les animalcules de la mer.
Le
bois qui devient également lumineux quand il pourrit, par d’autres
causes que celle de l’humidité, fut un des phénomènes qui fixèrent
notre attention.
Nous observâmes que ce dépérissement du bois,
cette transformation de la partie ligneuse et dure en une espèce de
parenchime friable quand il est sec, n’étoit qu’une décomposition du
bois, c’est-à-dire, une séparation de tous ses principes, une
restitution, lente et graduée, de ces mêmes principes à leur
première forme…. et dès-lors nous nous demandâmes si la blancheur qui
luisait sur le bois pourri, n’était pas un dégagement de la lumière,
une émanation de ce principe délivré des liens où l’aggrégation l’avait
enchaîné, pendant l’accroissement du végétal.
Pourquoi,
disions-nous, ne serait ce pas de la lumière qui s’évapore, dans
la
décomposition des fibres (16) ? Elles en absorbent, en croissant, une
si grande quantité, elles en sont si avides pendant la germination,
elles sont si faibles, si languissantes, quand elles en sont privées !
Certes le principe lumineux doit entrer abondamment dans la formation
du bois ; et dans la déflagration il éclate avec violence. S’il se
répand alors par torrens, pourquoi le dégagement chronique du même
principe, dans la putréfaction, ne se décélerait-il pas, dans certaines
circonstances, sous la forme des auréoles phosphorescentes que nous
admirons ?
Mais quelles seraient les circonstances où ce
principe serait visible en se dégageant ? Pourquoi ne parait-il pas
toujours dans les décompositions de tous les bois ? Quelles seraient
les recherches à faire, pour constater ces différens états, pour les
reproduire au besoin, pour phosphoriser à volonté un bois qu’on
mettrait pourrir, ou pour le faire se décomposer sans lumière ?
Si
l’on pouvait admettre cette explication pour les phosphores ligneux,
serait-ce la même cause qui ferait également briller les poissons qui
se putrefient ? Si la lumière des décompositions pouvait s’expliquer
ainsi, quelle serait ensuite la cause de ces aigrettes bien plus vives
qui dardent leurs rayons au travers du feuillage des arbustes ? Quelle
est la cause de la lumière que la femelle du lampyris répand
dans les
époques de la fécondation ? Toutes ces questions, que nous venions
d’élever, en revenant du rivage, ouvrirent devant nous une carrière si
vaste d’étude, de recherches et d’observations, que nous désespérions,
à juste titre, de la remplir dans le court espace de notre voyage. Nous
nous promîmes seulement d’en conserver le souvenir pour le temps où
nous pourrions avoir le loisir et l’occasion de nous y livrer ; nous
fîmes des vœux pour que les sçavans qui se plaisent dans l’étude de la
nature, découvrissent les causes des phénomènes que nous ne pouvions
encore qu’admirer, et nous rentrâmes dans l’enclos où la tente était
dressée.
Un des voyageurs qui nous avait quittés vers le
milieu du chemin, pour prendre un sentier différent, revint quelques
minutes après, portant sur son chapeau quatre ou cinq vers-luisans
qu’il étoit allé prendre, dans un bois voisin où il les avait apperçus,
lorsque nous nous entretenions de leur lumière. Il les mit sur de la
terre fraîchement humectée, dont on remplit un pot-à-fleur, en ajoutant
des portions de gazon, et le tout fut enfermé sous une de ces grandes
cloches de verre qu’on employe dans le pays pour la culture des melons
(17).
LE
VOYAGE AU HAVRE : LE TOMBEAU
DE
HARLETTE MÈRE DE GUILLAU-
ME LE
CONQUÉRANT : LE VILLAGE
ENGLOUTI.
Le
lendemain matin nous fûmes levés dès le point du jour : il s’agissait
du voyage du Hâvre, il fallait être à Honfleur pour l’heure du
paquebot, et la marée ne souffrant point de délais, nous nous équipâmes
promptement et nous partîmes.
Nous ne crûmes point devoir porter
tous nos instrumens avec nous : nous prîmes seulement des lunettes
d’approche et de fortes loupes, des tenettes, des
boëtes, des cartons
et quelques feuilles de papier pour le dessin.
Du milieu de la
plaine que nous traversions, nous revîmes les sites de la veille, la
mer qui revenait dans la seine, et le Hâvre où nous allions.
Nous
traversâmes une campagne voisine, dont les habitations groupées sur le
rivage, offraient avec les arbres entremêlés des vergers, un point de
vue charmant.
Nous apprîmes que presque tous les habitans de
cette commune étaient pêcheurs ; on nous montra même de loin, sur des
bancs élevés, dont l’embouchure de la seine est parsemée, les filets
qu’ils tendent, à
mer montante, et qu’ils soutiennent avec de longs
pieux enfoncés dans le sable : nous remîmes à voir ces filets et la
pêche usitée dans cet endroit, après notre retour du Hâvre.
Bientôt nous fûmes vis-à-vis d’une ancienne abbaye de bénédictins,
supprimés depuis plus de trente ans.
Cette
abbaye, nommée Grestain, avait été bâtie et fondée, en 1040, par un
seigneur voisin, nommé Herluin, comte de Conteville (note VIII.)
C’était dans cette abbaye qu’était le tombeau de la mère du fameux
Guillaume le conquérant, Harlot ou Harlette, qui, depuis la mort de
Robert père de Guillaume, avait épousé ce même Herluin, comte de
Conteville. L’abbaye de Grestain était autrefois considérable, et
Charles VII y coucha avec toute sa cour, au mois de janvier 1450, quand
il vint de Jumièges, pour reprendre Honfleur, occupé par les anglais
(note IX).
Dans les grandes marées on voit, à mer basse, les
vestiges d’un ancien village qui existait vis-à-vis de l’abbaye, et que
le sable recouvre aujourd’hui. On croit communément dans le pays, qu’il
fut détruit ou englouti par la mer ; c’est au contraire dans l’incendie
du 20 mai 1139 que ce village périt, et il n’a point été rebâti depuis
(18).
A deux kilomètres (petite demi-lieue) de l’abbaye de
Grestain, on trouve une cascade qui tombe, avec bruit, dans une grotte
profonde : la crainte de n’être pas rendus, pour l’heure du passager,
nous fit remettre à notre retour, la visite que nous comptions en faire.
LA
VILLE DE HONFLEUR : LE PASSAGER DU
HAVRE :
LE VENT CONTRAIRE : LE MAL DE
MER, LE
MOYEN DE LE PRÉVENIR.
Nous
arrivâmes à Honfleur, et l’ardeur de notre marche nous ayant donné plus
d’un quart d’heure d’avance, nous traversâmes la ville pour en
connaître la position ; nous vîmes les deux jettées qui forment le
port, et nous admirâmes l’immense quantité de poissons, de toute
espèce, qu’apportaient les barques des pêcheurs. Nous connaissions
très-peu de ces poissons ; la variété de leurs formes excitait autant
la curiosité, que leur nombre nous paraissait surprenant ; nous
eussions désiré savoir leurs noms, leurs mœurs et leurs propriétés ;
mais le cornet du passager se fit entendre, le flot ne montait
plus,
le paquebot appareillait ; nous courûmes nous embarquer ; nous
saisimes, en arrivant, les
haubans, les écoutes etc, et dans un
instant nous fûmes tous à bord.
La mer n’était pas houleuse,
le temps était assez beau, mais le vent nous était contraire, le
capitaine annonçait plusieurs bordées, et les voyageurs présageaient
une marée longue et fatiguante.
Cependant nous commençions à
dépasser les jettées, nous voyions les édifices reculer derrière nous
et l’horizon s’étendre à l’infini.
Les murs d’Honfleur et les
restes antiques d’un bastion très-fort, nous rappelèrent l’ancienne
domination des anglais sur cette ville, et le courage des français qui
les força de l’abandonner.
Nous vîmes successivement s’éloigner
tous les objets de la côte, et quand nous fûmes au large, nous
éprouvâmes des balancemens que produisaient les vagues. Plusieurs
d’entre nous furent atteints du mal de mer, comme bien d’autres
voyageurs, et c’était en soupirant qu’ils récitaient les imprécations
d’Horace, tandis que ceux qui se croyaient à l’abri, discouraient
tranquillement sur la douleur qu’on ressent à la mer, sur le
soulagement subit qu’on éprouve en débarquant, sur la cause et
l’origine de cette affection, sur les précautions qui peuvent en
diminuer la violence, sur les moyens qui peuvent en garantir. Il
importerait sans doute fort peu de savoir que le siége du mal paraît
être dans la rétine, et que les convulsions de l’estomac, dans les
balancemens d’un vaisseau, ressemblent à celles qui accompagnent le
vertige, ou qu’on éprouve dans les mouvemens rapides d’une voiture,
dans les oscillations de l’escarpolette, dans l’impression que produit
le tournoyement d’un courant, lorsqu’on regarde fixement l’eau qui
s’enfuit.
Mais quand on sait que ces observations, oiseuses en
apparence, conduisent à trouver des spécifiques, et qu’en suggérant
l’usage de l’éther, elles ont fait connaître qu’il ne fallait souvent,
pour empêcher les spasmes de l’estomac, que deux ou trois gouttes de
cette liqueur, prises avec un peu de sucre ; on sait bon gré aux
observateurs de leurs recherches et de la découverte heureuse que
l’analogie leur a fait faire (note
X).
L’ANCIEN
LAZARET : LE PORT
COMBLÉ.
Il
y avait environ deux heures que nous étions partis d’Honfleur, et qu’en
parcourant alternativement deux
côtés d’un rectangle, nous avancions
dans la direction de la diagonale, lorsque nous
découvrîmes un
attérissement, nommé le hoc, qui servait autrefois de lazaret aux
vaisseaux assujettis à la quarantaine. Nous vîmes distinctement, au
moyen de nos lunettes, quelques restes des fortifications du port
d’Harfleur, jadis fameux, occupé tour à tour par la France et par
l’Angleterre et appelé par Monstrelet, le souverain port de toute la
duché de Normandie (note
XI).
Ce même port, où les plus
grands armemens qu’on faisait, dans le 15.e siècle, étaient
reçus
avec avantage, est aujourd’hui totalement comblé ; des atterrissemens
successifs l’ont, en quelque sorte, reculé dans les terres, et
le Hâvre-de-grace
a remplacé sur la Seine le port d’Harfleur abandonné
par la mer en moins de trois cents ans. Le déplacement progressif de la
mer, est constaté, par des monumens sans nombre, sur tous les points du
globe ; mais ses effets, qui sont aussi récens près d’Harfleur qu’ils
sont nuisibles à cette ville, exciteront sans doute l’attention des
naturalistes, des navigateurs et des commerçans. L’affermissement du
Hâvre dont la mer inondait le terrain, lorsqu’Harfleur était un port ;
les dépôts de vase et de sable qui semblent de temps en temps menacer
le port d’Honfleur, à la rive opposée ; les alluvions intermittentes
qui transposent souvent le confluent de la Risle, et qui rendent
aujourd’hui si difficile l’accès de cette rivière, autrefois navigable
; sont des circonstances qui doivent être mûrement pésées, si jamais on
s’occupe des projets d’aggrandissement et d’amélioration que des hommes
amis de leur pays, ont cru pouvoir devenir utiles.
La ville du
Hâvre elle-même ne peut être indifférente, sur ce que présagent de
pareilles variations. Quand le port d’Harfleur recevait les flottes des
puissances maritimes, on ne prévoyait pas que trois cents ans après, ce
ne serait plus qu’une vaste prairie, au milieu de laquelle il ne
resterait qu’une rivière étroite, capable seulement de donner l’entrée
dans la ville à quelques petits bateaux !
LE
DÉBARQUEMENT : LE PORT DE MER :
LE
BATEAU PLONGLEUR.
Nous
nous trouvâmes fort près du Hâvre, à la suite des réflexions que nous
venions de faire, et les constructions de cette ville attirèrent nos
regards et toutes nos pensées.
Bientôt nous doublâmes la jettée
du sud et nous passâmes devant la grosse tour de François I.er. Nous
descendîmes sur le quai, au bout de la grande rue, à l’endroit où les
magnifiques terrasses d’Ingoville offrent à l’œil enchanté, le
spectacle d’un amphitêâtre immense, dont les galeries sont
alternativement chargées de maisons élégantes et de bosquets charmans.
La
porte d’Ingoville, construite par la cardinal Richelieu (19), terminait
autrefois la grande rue et masquait la côte : c’est à la démolition de
cet ancien ouvrage et de ses tours, qu’on doit la beauté de la
perspective.
La ville est très agréable, et si la guerre qui
détruit tout, n’eût pas mis, depuis quelques années, la
désolation dans le commerce, nous n’eussions pas eu la
douleur de
voir le bassin tout entier, rempli de vaisseaux désarmés, offrant
l’image du dépérissement et de la destruction ; les chantiers
abandonnés ; les bras du commerce paralisés, ses sources taries ; et la
moitié des habitans épuisant, dans la détresse et l’inaction, les
restes d’une ancienne abondance, dont leurs vœux ne peuvent hâter le
retour.
Nous eûmes bientôt parcouru la ville, et pris
connaissance de ce qu’il y avait d’intéressant : nous vîmes l’ancien
bassin, les vannes et le pont tournant, le bassin neuf, les détails de
l’intérieur des vaisseaux, l’arsenal, les vestiges de l’ancien ouvrage
à corne, construit par les ordres du cardinal de Richelieu et à ses
frais (note
XII).
Quelques-uns d’entre nous virent aussi ce
bateau fermé, construit en cuivre et en bois, qui nageait, pendant
quelque temps, entre deux eaux, après avoir plongé, et qui remontait
sur l’eau à une grande distance du point de l’immersion. Il était alors
un objet de curiosité et le secret de sa construction n’était pas
connu. Ceux qui le virent, observèrent qu’il était ponté en cuivre
jusqu’auprès du bord ; ils pensèrent que ce bateau-coffre
pouvait
aisément contenir deux hommes, pour le faire plonger en introduisant de
l’eau ; pour le faire mouvoir et le diriger au moyen d’un moulinet ;
enfin pour le faire remonter, en expulsant l’eau formant l’excès du
lest.
LE
RIVAGE : LES ANÉMONES ET LES ORTIES
DE MER
: LES PÉTRIFICATIONS.
La
mer qui s’était retirée pendant que nous parcourions la ville, avait
découvert le rivage à l’ouest du Havre, et nous nous portâmes avec
empressement sur ce terrain que Diquemarre a rendu célèbre par ses
découvertes sur les anémones de mer (20).
Les premiers pas que
nous fîmes, sur le rivage, ne nous offrirent rien d’intéressant ; il
était entièrement stérile ; nous marchâmes pendant une demi-heure, sans
trouver autre chose que des orties de mer, échouées sur le sable, et
dont la putréfaction était plus ou moins avancée (21).
Le nom
d’orties qu’on donne communément à ces zoophytes, ne doit pas faire
croire qu’ils puissent causer de la douleur, comme la plante qui porte
le même nom, à moins que cette propriété ne tienne à la vie de l’animal
; en effet nous en touchâmes plusieurs, à différentes reprises, et
personne n’eut à regretter d’en avoir fait l’essai.
Nous
observâmes seulement que l’odorat, et sur-tout les yeux, étaient
affectés à leur approche, de la même manière qu’ils le sont par les
émanations alkalines de l’urine putréfiée, de l’ail, du phosphore :
mais cette affection était peut-être l’effet d’un commencement de
putréfaction.
Parmi ces zoophytes, celui qui nous parut le plus
remarquable fut une grande ortie nouvellement échouée, dont le pourtour
était agréablement terminé par une découpure très-régulière dans sa
forme, et d’une très-belle couleur purpurine (22). Les caractères
particuliers de cette espèce de zoophyte, sa consistance spongieuse,
cellulaire et gelatineuse, sa transparence, etc., sont des singularités
si différentes de ce que présente par-tout ailleurs l’animalisation,
que nous ne pûmes nous défendre de les admirer.
Nous eumes lieu
de nous convaincre qu’en histoire naturelle sur-tout, la mer, est un
monde inconnu, rempli de richesses infinies, mais difficile à
conquérir, à cause des obstacles qu’il oppose aux recherches et aux
observations.
Aux orties de mer ou méduses succédèrent bientôt
les Goëmons
et les Varecs de toute espèce ; le Varec en forme de
plume, à tige filiforme et rameuse (23) ; le Varec capillacé en forme
de buisson, aux ramifications déliées (24) ; le Varec en
palme,
aux expansions plânes et multipliées, divisées comme les doigts de la
main (25) ; le Varec vesiculeux, aux feuilles ondulées et longues (26).
Nous
étions alors loin du Havre ; le rivage était hérissé de cailloux et de
grosses pierres. Celles que les pêcheurs avaient amoncelées pour former
la bâse de leurs parcs en clayonnage, nous offrirent, dans des creux et
des interstices, une immense quantité d’étoiles qui rampaient, de
crabes qui les mutilaient, de vis, de cornets, de rouleaux et d’autres
coquillages, dont un grand nombre nous était inconnu. Il en était ainsi
des plantes marines et des mousses qui tapissaient les roches, des
madrepores, des raisins polypiers, etc. : et comme chacun de nous
ramassait tout ce qui lui paraissait nouveau, nous fûmes bientôt
chargés de cailloux, de plantes et de coquilles, au point qu’il fallut
se rassembler et comparer ce qu’on avait recueilli, afin de ne garder
que ce qui était important. Nous conservâmes les plus grandes étoiles
vivantes que nous pûmes trouver, et deux éponges branchues que le flot
avait déposées sur le sable.
Nous conservâmes sur-tout un bloc d’argile qui nous parut présenter le
plus grand intérêt.
Il
en existe un très-grand banc sur ce rivage : les briquetiers du Havre
viennent en enlever quand la mer est basse ; ils en font de la tuile et
des pavés fort durs, dont la couleur est blanchâtre au lieu d’être
rouge.
Mais le morceau que nous trouvâmes avait cela de
particulier, qu’il était dur comme une pierre par un de ses côtés,
tandis que par l’autre il n’était que durci comme l’argile battue.
Nous
retournâmes à l’endroit où ce morceau d’argile avait été pris : nous
vous convainquîmes que sur un banc d’argile enfoncé d’un pied sous le
niveau du rivage, il y avait un autre banc absolument pétrifié, et
offrant dans ses câssures les mêmes cavités et les mêmes veines que le
banc d’argile ; la seule différence qu’il y eût, c’est que le banc de
pierre contenait plus de coquilles que le banc d’argile, et que
plusieurs de ces coquilles, qu’on nous dit être exotiques, ne
ressemblaient nullement à celles qu’on trouvait éparses dans le banc
d’argile.
Nous ignorons si cette croûte de pierre fait partie du
banc considérable qui a été particulièrement décrit par M. Dubocage, et
qui contient beaucoup de coquillages, dont les analogues ne se trouvent
que dans la mer des Indes : il faut aller fort avant dans la mer pour
voir ce banc pétrifié qui se découvre très-rarement : on ne lui connaît
que neuf pouces d’épaisseur, et il est porté, comme celui que nous
avons vu, sur un très-grand lit d’argile.
RETOUR
A LA VILLE : ESPOIR DEÇU :
PHÉNOMÈNE
INEXPLICABLE.
Nous
serions restés plus long-temps sur le rivage, si la mer qui le
recouvrait en montant, et si la nuit, dont le terme approchait, ne nous
eussent forcés de la quitter.
Nous chargeâmes donc dans nos
corbeilles tous nos cailloux, nos blocs d’argile, nos goëmons, nos
varecs, nos étoiles et nos coquillages ; nous puisâmes de l’eau de mer
pour avoir des insectes phosphorescens, et nous gravîmes sur les
rochers de la
hève, afin de visiter les phares renommés qui sont
placés sur la côte. Leur lumière s’apperçoit de fort loin dans les
temps calmes et sereins, et elle sert à diriger, pendant la nuit, les
vaisseaux qui viennent en rade.
Le gardien recueille, sur le
rivage et dans les débris des bancs pétrifiés, des fossiles de
différentes espèces ; nous vîmes ce qu’il possédait de curieux en ce
genre, et nous retournâmes vers le Havre, dont nous fûmes prévenus que
les portes une fois fermées ne s’ouvraient plus qu’au jour.
Quand
nous eûmes déposé le butin de notre expédition, nous vîmes sur tous nos
varecs de nombreuses étincelles qui nous rappelèrent nos insectes
phosphorescens, et nous vidâmes l’eau de mer, que nous avions puisée,
pour les y reconnaître.
Mais nous fûmes trompés dans notre attente, et nous n’en découvrîmes
pas un seul.
La
première idée qui se présenta, fût qu’ils avaient péri dans le
transport, ou qu’un peu de liqueur fermentée, qui était peut-être
restée au fond de la phiole, les avait tués, ou que l’eau prise à mer
basse n’était pas féconde en insectes comme la mer haute. Aussi-tôt un
de nous alla chercher de l’eau de mer au port ; mais quand il fût de
retour, l’examen que nous fîmes ne nous offrit rien de plus que la
première eau.
C’est dans de pareilles circonstances, lorsque la
confiance inspirée par le passé se trouve déçue tout-à-coup, que
l’imagination va quêter au loin toutes les causes et toutes les
explications que sa fécondité suggère. Nous ne rendrons point compte de
toutes les idées qui nous vinrent, nous dirons seulement que les essais
du lendemain ne furent pas plus heureux, et que suivant d’anciennes
observations, dont nous vîmes un journal quelques jours après, et dont
on nous parla dès-lors, il paraît que la lumière de la mer n’est pas
aussi régulièrement périodique que son mouvement.
Il y a eu des
années où la mer a été lumineuse de très-bonne heure ; il y en a eu
d’autres où sa lumière n’a paru que fort tard, d’autres où cette
lumière a cessé d’être visible tout-à-coup, en sorte que le lendemain
du jour où elle avait paru très-brillante, on ne voyait pas une seule
étincelle.
Ces observations, dont nous ne pouvions révoquer
l’exactitude en doute, nous jettèrent dans de nouvelles incertitudes ;
nous cherchions les causes qui pouvaient anéantir, dans un instant,
cette prodigieuse quantité d’animalcules dont la mer était peuplée ;
nous eussions d’autant plus desiré connaître ces causes, que nous
étions précisément dans un des cas que les observations avaient
constatés.
Ce qu’il y avait même de plus piquant, c’est qu’il
fallait que les insectes eussent disparu dans l’intervalle des deux
dernières marées, puisque les varecs, que la dernière mer avait
baignés, en étaient couverts, et que le retour de la seconde marée n’en
offrait aucun.
TRAVERSÉE
RAPIDE : LES GROS POISSONS :
LE
CHIEN DE MER.
Cependant
nous avions d’autres recherches à faire sur la rive opposée : nous nous
disposâmes à retourner vers notre tente, et nous descendîmes au
passager que la mer venait de mettre à flot. Le tems n’était pas alors
aussi paisible que la veille, les vagues écumaient sous le vent qui les
chassait, le paquebot n’était pas seulement balancé, c’étaient des
balotemens qu’il éprouvait ; et de plus nous étions menacés d’une pluie
prochaine.
Mais le vent était superbe,
au dire des matelots ;
la marée
ne devait être que de trois quarts-d’heure, et rien
n’annonçant le plus petit danger, nous entrâmes gaiement à bord, nous
mîmes au large, le bâtiment se mit en route sur le babord, et dans un
quart-d’heure à peine vîmes-nous, vers l’arrière, la patrie
des
Scudery, des Lafayette, (note
XIII).
Bientôt après, les côtes
de Honfleur s’avancèrent à notre rencontre, les objets grandissaient à
vue d’œil, la mer était bouillante à l’avant, et marquait
à
l’arrière
un sillage à perte de vue : quelquefois il venait à bord
deux ou trois muids d’eau dans une lame qui mouillait tout le monde,
mais personne ne fût malade ; la traversée ne dura que cinquante
minutes, et nous arrivâmes sains et saufs à Honfleur. Nous y trouvâmes,
comme la veille, une poissonnerie abondante : des soles de 18 pouces de
long, des rayes énormes et de grands turbots, qui nous rappelèrent la
quatrième satyre de Juvenal, et la charge de Potier suivant la Cour,
que l’embarras de faire cuire un poisson de cette espèce en son entier,
fit ériger à Rome, selon ce poëte, sous l’empereur Domitien.
Un
des poissons que l’on pêche fréquemment sur la côte, et qu’on recherche
le moins, est un squale,
qu’on nomme aiguillat,
ou chien de mer
épineux (27). Il porte au-devant et à l’insertion de chacune de ses
nageoires dorsales une pointe dure, fort aigue, qui ressemble à de la
corne, et qui est un peu arquée vers la queue du poisson. Ces pointes
dures doivent être une arme ou une défense pour ce chien de mer ; mais
il n’est pas aisé de découvrir comment il s’en sert, parce qu’elles ne
paraissent pas placées avantageusement, et qu’étant fortement attachées
sur la colonne vertebrale, ce poisson ne doit avoir aucune facilité
pour s’en servir ; cependant il y a beaucoup de chiens de mer qui ont
une de ces pointes rompue, et cela porte à croire qu’ils en font usage.
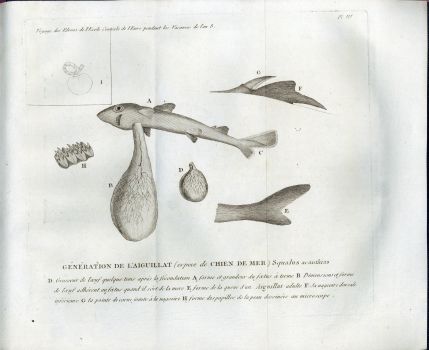
La
fig. (G) de la planche III, représente celle de la seconde nageoire,
vers la queue, sur un squale qui avait deux pieds de longueur : elle
est dessinée de grandeur naturelle.
La fig. (H) de la même Pl.
représente la forme des papilles de la peau du squale, dessinées au
microscope, et cette forme des papilles, qui paraissent de la même
nature que les pointes, explique le motif qui fait employer la peau,
dans les arts, pour polir le bois.
Au reste ce ne sont ni les
pointes, ni les papilles qui sont le plus remarquable : le
développement du fœtus et les particularités de la gestation le sont
davantage : voici les observations que nous avons eu lieu de faire à ce
sujet.
La figure (A B) planche troisième, est celle d’un fœtus
d’aiguillat, et de l’œuf
à l’aide duquel il s’est développé. L’un et
l’autre sont
unis par un prolongement des enveloppes membraneuses de
l’œuf, qui
s’attache au fœtus,
vers la région de l’œsophage et
remplit les fonctions de cordon
ombilical.
Cette figure a été
dessinée de grandeur naturelle, d’après un fœtus qu’une jeune femelle
portait avec trois autres à peu-près égaux : ils étaient contenus tous
les quatre dans la même enveloppe sans lui être unis par aucun
lien ni
par aucune attache.
Ils coulaient au contraire librement à côté
les uns des autres, et telle est la mobilité de l’œuf et du fœtus, que
pour les faire sortir de la mère, sans les désunir,
il suffit assez
souvent de la tenir, pendant quelques minutes, dans une situation
verticale.
On est donc obligé de reconnaître, dans la gestation
de l’aiguillat, une exception à la loi générale des vivipares ; car
dans cette classe nombreuse, c’est immédiatement de la mère, que le
fœtus reçoit la nourriture, au moyen du placenta ; au lieu
que dans
cette espèce de squale,
le fœtus ne tire la sienne que de l’œuf, sans
que cet œuf adhère
à la mère.
S’il nous était permis de
hasarder une conjecture, d’après ces observations, nous dirions qu’il
nous paraît probable qu’à la fin de la gestation, la femelle de
l’aiguillat est à-la-fois délivrée de l’œuf et du fœtus, sans qu’ils
cessent pour cela d’être unis. Leur isolement de la mère,
avant cette
époque, fait présumer qu’ils peuvent exister sans elle, au moins
pendant quelques temps, et les autres observations ne laissent pas de
doute sur la possibilité de cette délivrance.
S’il fallait
ensuite chercher les avantages, ou la nécessité de cette nouvelle
exception aux lois générales, il nous semble qu’on pourrait les trouver
dans les besoins même du fœtus au sortir de la mère.
Trop faible
encore à sa naissance, et trop incertain dans ses mouvemens, le jeune
aiguillat ne pourrait ni saisir une proie, ni s’élancer sur elle, et
privé des secours de la mère, à qui la nature n’a point donné les
mamelles des vivipares, il périrait bientôt si l’œuf ne continuait de
lui fournir, pendant quelque temps, ses fluides alimenteux,
au défaut
du lait maternel.
Au contraire, à l’aide de cette nourriture
supplémentaire, il prendrait des forces et les essayerait à mesure ; il
acquérrait de l’agilité par l’exercice : lorsque l’œuf cesserait d’être
utile, il cesserait en même temps d’être nécessaire, le cordon se
dessécherait….. Mais le jeune squale, instruit par l’habitude, et
conduit par l’instinct, se suffirait à lui-même et pourrait seul
pourvoir à ses besoins.
S’il en est ainsi, l’œuf nourricier
de
l’aiguillat sera comme les feuilles
seminales des plantes, qui
suivent la Plumule quand elle sort du sein de la terre, et que les
botanistes se plaisent à comparer aux mamelles des animaux, parce que
ces feuilles précieuses leur paraissent en remplir les fonctions
(note XIV).
LE
GRAND OSIER : LA CASCADE.
Il y a sur la
route d’Honfleur un osier très-gros, qu’on voit à côté d’un moulin bâti
près de la grande route (28). Quelques-uns de nous en mésurèrent les
dimensions, et ils trouvèrent qu’il avait huit pieds onze pouces (2
mètres 90 centimètres) de pourtour, trente-quatre pieds de tige
jusqu’aux branches et, par apperçu, vingt-quatre pieds de hauteur de
branches et de couronnement. On nous dit qu’il y avait, dans les
environs, un pressoir dont la grosse pièce était faite avec un osier
plus fort que celui-ci : mais il était trop éloigné de la grande route,
pour que nous pussions l’aller voir, et les dimensions qu’on venait de
mesurer, sur le premier, rendaient probable ce qu’on nous disait du
second.
Nous ne tardâmes point à retrouver la cascade de Joble,
dont nous avions différé la visite, et l’honnête propriétaire du
terrain dans lequel le courant se précipite, s’étant empressé de nous y
conduire, nous descendîmes par un ravin profond, dans une grotte
ombragée d’arbustes, sur laquelle sont suspendus des blocs de sable
concret, qui s’éboulent quelquefois pendant l’hiver, et que l’eau
désunit, en les lavant, pour en reporter les débris à la mer. Nous
reconnûmes une espèce de tourbe très-précieuse, observée par
Scanegatti, au commencement de 1789, et nous en prîmes des morceaux
dont la qualité ressemble parfaitement à la description qu’il en fit à
l’Assemblée provinciale de Haute-Normandie (note XV). Nous
admirâmes
l’aspect agreste et sombre de cette espèce de souterrain : le bruit de
l’eau qui se précipite dans les puits qu’elle creuse ; et qui s’enfuit
à travers les rochers qu’elle a minés : la fraîcheur du lieu, pendant
que tout était brûlé dans la campagne : la solitude d’un bas-fond,
au-dessus duquel passe une route fréquentée : les plantes, dont le verd
naissant et frais tranche sur la teinte rembrunie de la terre détrempée
: la mousse épaisse et rase, qui semble être une ouate étendue pour
adoucir l’âpreté de la roche.
Les végétaux qui y fuyent le jour et l’aspect du soleil, croissent en
abondance dans ce séjour obscur et humide.
Les
arbres, qu’on a plantés sur le penchant du coteau, s’élancent vers son
sommet pour y trouver la lumière : ils portent sur une longue tige, des
rameaux effilés : les feuilles n’éclosent qu’à la pointe des branches
et dans les arcs de la voûte qu’elles forment.
Nous ne trouvâmes
de plantes remarquables que la circée (29) et le rossolis (30), et nous
sortîmes du ravin, en nous entretenant de ces sites, autrement sauvages
et terribles, dont le voyageur s’épouvante : de ces cataractes, dont
le bruit se fait entendre à plus d’un mille : de ces torrens de trois
cents pieds de hauteur, dont les éruptions se brisent en tombant sur le
roc, rejaillissent avec violence et remontent, comme un brouillard
épais, jusqu’au dessus de leur source, pour retomber en pluie dans les
fleuves qu’elles grossissent (31).
Des hommes frappés de la
force et de l’importance du courant de Joble, avaient essayé de
construire au fond même de la grotte une de ces mécaniques, plus
connues en Hollande qu’en France, qui font mouvoir plusieurs scies
parallèles, au moyen d’une roue, et qu’on emploie pour refendre des
planches et pour scier
de long.
L’établissement fut-il mal
conçu, ou mal conduit ? nous n’en savons rien ; nous savons seulement
qu’il n’a pas duré cinq années et que le bâtiment, qu’on avoit élevé
sur pilotis, s’affaissa bientôt dans des éboulemens.
Néanmoins
il est également certain qu’on pourrait tirer un parti avantageux de
cette position : nous avons appris que de riches capitalistes, qui en
connaissent les avantages, ont pris à rente une petite portion de ce
terrain, et qu’ils acquittent leurs engagemens avec exactitude.
On
ignore quels sont leurs projets, mais il est aisé de concevoir à
combien d’usages peut être heureusement employé un courant rapide qui
ne tarit jamais, et qui peut avoir au-delà de quarante pieds de chûte.
OCCUPATION
DES NATURALISTES : OPÉRATION
DES
MATHÉMATICIENS : OBSERVATION SUR
LE
NOSTOC.
Après
être sortis de la cascade, nous suivîmes de longues falaises qui
dominent la mer : nous n’apperçûmes, dans cette partie du chemin, que
quelques laureoles (32).
Plus loin nous trouvâmes dans les
chenevières l’orobanche branchue (33) : cette plante doit être rangée
parmi les parasites, et nous ne l’avons trouvée, nulle part ailleurs,
que dans les chenevières. Dans le pays, on regarde ordinairement sa
fleuraison comme l’indication certaine du moment où l’on doit cueillir
le chanvre femelle, c’est-à-dire, celui qui porte la graine.
Nous
rentrâmes, avec plaisir, sous la tente ; nous déposâmes, en commun, les
fruits de nos recherches : et le lendemain matin, les uns s’occuperent
à disposer les grands varecs entre des cartons, à coller sur du papier
les fucus capillacés, tandis que les autres allèrent au bord de la
Seine mesurer sa largeur avec le graphometre (34).
Tous ne
furent pas occupés à ce travail, qui étoit particulièrement du ressort
des mathématiciens : plusieurs, en cherchant si le galet du rivage ne
leur offrirait point quelques objets curieux, trouvèrent un très gros
fragment du noyau pétrifié d’un de ces planorbes, vulgairement connus
sous le nom de cornes d’ammon (note
XVI). D’autres observèrent une
espèce de nostoc sur les bords relevés d’une ornière, et le phénomène
qui les frappa davantage, dans cette production peu connue, fut une
apparence de mouvement et de vie, qui se manifestait particulièrement
dans les intermittences des rayons solaires. Ils nous dirent qu’au
moment où la lumière touchait le nostoc, les inégalités de sa surface
produisaient une réflexion ondoyante, que son volume paraissait se
gonfler et s’agrandir ; qu’au contraire, lorsqu’un nuage ramenait
l’ombre sur le nostoc, il paraissait s’affaisser sur sa base, diminuer
de volume, et devenir sensiblement concave.
Mais ils nous
prévinrent qu’ils n’étaient pas surs que les choses fussent absolument
ce qu’elles leur avaient paru : qu’il pouvait se faire que ces
apparences ne fussent que l’effet de la réflexion de la lumière ou de
sa réfraction ; qu’ils n’avaient pu continuer long-temps leurs
observations, parce que le ciel s’était enfin totalement couvert, et
qu’il faudrait soigneusement examiner le nostoc, sous ce rapport, s’il
arrivait qu’on en retrouvât (35). On prit géométriquement, et par les
moyens mécaniques, la mesure du planorbe. Le morceau qu’on avait trouvé
pouvait être regardé comme l’arc d’une des volutes de ce crustacé, et
nous nous convainquîmes qu’en la considérant comme un cercle, elle
avait du avoir quatorze pouces de diamètre.
Du reste nous ne
sommes pas certains que ce fût le plus grand cercle du planorbe, parce
que ni l’une ni l’autre des extrémités du tronçon ne paraissait
indiquer la bouche.
La coquille adhérait encore en plusieurs
endroits à ce fossile ; il portait en quelque sorte avec lui les titres
de son origine, et donnait exactement la forme du creux dans lequel il
s’était moulé.
LA
BARRE.
Le même jour nous vîmes une
particularité remarquable des marées. Les pilotes du Hâvre lui donnent
le nom de verhôle, on lui donne celui de mascaret, dans les ports du
midi ; et sur toute la partie de la Seine, où ce phénomène se fait
sentir, on lui donne le nom de barre. Cette dénomination a du moins
l’avantage de se rapprocher de la forme qu’il présente.
La barre
n’est pas également sensible dans toutes les marées, elle n’est même
pas apparente dans le plus grand nombre : ce n’est que dans les marées
de la pleine et de la nouvelle lune qu’elle est très-élevée : c’est
surtout dans les équinoxes qu’elle a les plus grands effets.
Ce
phénomène consiste dans la manière brusque et rapide avec laquelle le
flux remplit le lit de la rivière, aux époques de la pleine et de la
nouvelle lune. Dans d’autres temps, le flux est toujours moins
impétueux ; il couvre le rivage progressivement et sans secousse
marquée : mais dans la pleine et la nouvelle lune, c’est par irruption
qu’il se gonfle, le rivage est inondé presque subitement, et le premier
flot, qui s’élève tout-à-coup de plusieurs pieds au-dessus du niveau de
la rivière, se répand avec assez de rapidité, pour qu’un homme puisse à
peine le suivre en courant.
Il est même très-dangereux pour les
barques d’une construction médiocre. Quand il les heurte par le côté,
il les culbute infailliblement, et ce n’est qu’en les
présentant debout
à ce flot impétueux, qu’on les préserve des accidens qu’il
peut causer.
Ce phénomène est l’effet de la différence qui se
trouve entre la largeur de la rivière à son embouchure, et celle de la
baie qui forme une espèce de golfe sur l’ocean.
Le flux,
toujours plus sensible dans les syzygies (36) que dans les quadratures
(37), élève dans la baie un très-grande quantité d’eau qui doit bientôt
se répandre dans l’embouchure que la rivière lui présente : mais cette
embouchure est beaucoup plus étroite que la baie, et les côtes, qui la
rétrécissent de plus en plus, ne permettant point à la marée de couler
rapidement, l’eau doit nécessairement se gonfler et s’élever d’autant
plus, sur la rivière, que le flux est plus abondant. Il nous semble que
la même chose doit se faire remarquer aux embouchures de toutes les
rivières, et que la
barre doit y être plus ou moins sensible, selon
que les causes que nous lui assignons sont plus ou moins grandes.
LA
POINTE DE LA ROQUE : LES PLANTES :
LES
FOSSILES.
Le
lendemain fut le jour fixé pour aller voir un site intéressant, dont
nous avions plusieurs fois entendu parler, et que nous avions tous les
jours en perspective. Il est ordinairement désigné sous la dénomination
de pointe de la
Roque, du nom même de la commune où il est placé, et
de la pointe de rocher qui termine ce terrain.
Nous savions
qu’après les éboulemens causés par la gelée des hyvers un peu rudes, on
y trouve une grande quantité de coquilles : nos mathématiciens
voulaient vérifier les mesures qu’ils avaient prises de la largeur de
la Seine : les dessinateurs voulaient prendre des points de vue : nous
partîmes donc pour cette expédition avec les instrumens de
mathématique, la chambre obscure, le télescope, quelques lunettes, des
crayons, des corbeilles ; et des outils pour extraire les fossiles.
Nous
traversâmes toute la vallée de la Risle, à l’embouchure de la rivière.
Nous remarquâmes sur un paturage, qui appartient à la commune de
Conteville, une très-grande quantité de gentiane, improprement appelée
petite centaurée, et nous en cueillîmes plusieurs faisceaux, parce
qu’elle nous parut avoir cette précieuse qualité fébrifuge qu’on lui
attrîbue (38). Nous cueillîmes encore, dans l’étendue de ce terrain,
que nous parcourûmes, différentes plantes que nous n’avons point
trouvées ailleurs (39).
Enfin nous passâmes la Risle et nous parvînmes, en cotoyant la
montagne, à la
pointe de la Roque.

D’un
côté de cette pointe, vers l’orient, est un vaste terrain que la mer
couvrait autrefois, et qui forme une anse de plus de deux lieues de
profondeur, sur environ trois lieues d’ouverture. De l’autre côté, vers
l’occident, est la vallée que la Risle arrose, et qui peut avoir trois
quarts de lieue de large.
Ainsi, des deux côtés de cette pointe,
le terrain, très-uni dans toute son étendue, offre un sol plus ou moins
fertile et parfaitement nivelé, tandis que sur la ligne, qui sépare ces
deux plages, on voit se prolonger une montagne étroite et longue, qui
se dirige en pointe vers la Seine, mais qui ne se termine pas en pente
adoucie. Au contraire sa coupe escarpée s’élève
perpendiculairement à sa base, et présente des pics isolés que la
dureté de leurs assises a préservés de la chûte, dans les éboulemens
annuels.
Du haut de la montagne jusqu’au sol où elle pose, c’est
un aspect rude et scabreux de roches et de sables arides, d’arbrisseaux
à moitié déracinés, de blocs saillans, de crevasses profondes et de
ruines menaçantes ; tandis qu’au pied de la montagne, c’est un terrain
fertile, couvert d’une herbe succulente, qui nourrit des troupeaux sans
nombre.
Nous considérâmes, avec surprise, ces bancs de silice et
de terre calcaire, alternativement superposés, ne laissant voir de
différence entr’eux que dans leur épaisseur, gardant le plus parfait
parallelisme, sur une longueur de plusieurs lieues, offrant l’image
d’une construction semblable à celle de la maçonnerie, et representant
les assises régulières des pierres que les ouvriers intelligens
alignent, dans les gros murs qu’ils veulent rendre solides.
C’est
particulièrement dans les pics de cette roche, qu’on remarque cette
disposition des différens lits dont elle se compose ; et s’ils étaient
transposés sur un autre sol, il ne serait pas étonnant qu’on les prit
pour un ouvrage de la main des hommes, tant les assises sont
uniformes et paralleles.
Ce spectacle avait agi sur
l’imagination de nos dessinateurs ; quelques-uns avaient déjà les
crayons à la main, d’autres cherchaient des points de vue, afin de
varier les sites ; et tandis qu’ils se préparaient à nous en conserver
le souvenir, les mathématiciens choisirent des points, établirent leur
base et se promirent une vérification exacte des opérations de la
veille.
Les botanistes allèrent cueillir des plantes ; (40) les
naturalistes, armés de leurs marteaux et de leurs ciseaux à froid,
gravirent sur les rocs entassés, dont les cassures offraient des
fossiles, et parvinrent à ramasser des vis (41), des cornets (42) et
des rouleaux (43), des buccins (44) des oursins de toutes les espèces
(45), des peignes (46), des cames, des cœurs (47) et des petites masses
éparses d’oxide fer (48).
Ils trouvèrent encore des fossiles
longs et arrondis, offrant dans la coupe une sorte d’enveloppe ou
d’écorce calcaire sur un noyau de silex, semé de points opaques et
représentant les cavités d’un ancien tissu cellulaire.
Au
premier aspect, on eût pris ces fossiles pour des os pétrifiés ; mais
ils nous parurent être des madrépores : nous en avons mis, sur la
meule, quelques fragmens qui ont pris un assez beau poli.
Enfin
on trouva plusieurs pierres figurées connues sous le nom de dendrites,
et des cailloux, dont la cassure offrait des nuances très-vives de
différentes couleurs ; mais ces couleurs n’ont point été à l’abri de
l’action de l’acide carbonique de l’atmosphère, ou du contact de la
lumière, et elles se sont ternies très-promptement.
Toutes ces
recherches prirent beaucoup de temps, sans que personne se fatiguât de
leur longueur ; et quand les excursions furent terminées, on se réunit
une seconde fois au pied de la montagne, on se communiqua le fruit de
ses recherches : les dessinateurs, malgré les obstacles que leur
opposait le vent qui soufflait avec force, étaient parvenus à esquisser
différentes vues ; nous adoptâmes unanimement celle qui est gravée,
planche 4, comme exprimant un plus grand nombre de détails (49).
Cependant
nous ne connoissions encore qu’une partie des avantages de ce terrain,
nous n’avions vu que le pied de la montagne, et les botanistes, qui
s’étaient élevés jusqu’au sommet, nous confirmèrent tout ce qu’on nous
avoit dit de l’étendue de l’horizon et de la beauté des différens
points de vue dont on y jouissait.
Il faut donc arrêté que nous
y reviendrions le lendemain matin, et nous retournâmes à la tente, avec
les collections dont nous étions chargés.
LES
ANTIQUES : LES DÉSERTEURS :
On
nous avait apporté, pendant notre absence, divers objets d’antiquité
que nous examinâmes à notre retour. Parmi ces objets, il y avait une
médaille du bas-Empire, dont le revers attira toute notre attention :
sa légende n’eût pas eu plus de justesse et de vérité, quand elle eût
été faite pour les circonstances glorieuses où la France se trouvait
alors.
La figure était celle d’un guerrier, s’appuyant d’une
main sur son bouclier, et de l’autre présentant une branche d’olivier ;
on lisait, autour de la médaille, les mots latins, Marti pacifero
(50). Les dessinateurs la copièrent, sous de plus
grandes proportions,
parce que cette médaille n’est que de petit bronze : les traits en sont
gravés avec exactitude planche 5.e lettre B.
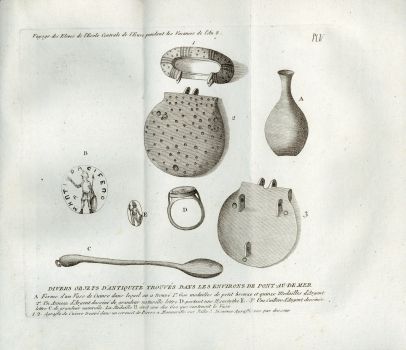
Les figures de la
même planche, sont celles d’autres objets qui furent trouvés, il y a
quelques années, dans la commune de Préaux, près le Pont-Audemer. La
pierre de l’anneau (D) est une hyacinthe dont la gravure présente
l’image d’un soldat romain sous les armes (E). Cette pierre est mal
gravée ; elle était montée en argent, et son grand axe se trouvait dans
le plan du cercle de l’anneau. La fig. C. représente une petite cuiller
d’argent, dessinée de grandeur naturelle.
Ces objets furent
trouvés presqu’à fleur de terre, dans un terrain couvert de ronces,
qu’on défrichait alors pour le rendre à l’agriculture : ils étaient
renfermés, avec 600 médailles de petit bronze et quelques autres
médailles en argent, de la même grandeur, dans un vase d’airain, que
représente en
petit la fig. A. Ce vase était fait au marteau : sa
hauteur était d’un pied, et l’on a scrupuleusement suivi ses
proportions dans le dessin qu’on en a fait.
Ce qu’il y eût eu,
selon nous, de plus important à conserver : ce dont nous déplorâmes
très-vivement la perte, était un morceau de toile, ou d’étoffe, qu’on
nous dit avoir été trouvé, dans ce vase, avec les antiques.
Le
seul récit qu’on nous en fit, nous affecta comme si nous eussions eu
cet objet présent : il nous semblait qu’il eut été du plus grand prix,
par les indications qu’il eût pu fournir sur les fabriques de ce
temps-là. Mais les hommes qui l’avaient trouvé, ne virent à sa
conservation aucun motif d’intérêt. « Il était tout consommé » dit
naïvement l’un d’eux « il n’était propre à rien, on le jetta dehors. »
Nous
mîmes alors en usage divers moyens, pour leur faire entendre que cette
étoffe était infiniment au-dessus de tous les lingots d’argent que le
vase eût pu contenir, nous leur donnâmes des regrets sur la perte
qu’ils avaient faite, et depuis cette époque nous avons fait ce qui
dépendait de nous, afin d’inspirer du respect pour tous les objets
d’antiquité qu’on déterre : nous desirons que cela puisse servir à les
faire conserver avec plus de soin.
Les mêmes citoyens nous
donnèrent encore deux autres pièces de cuivres (1 et 2). La figure 3
présente le dessous de la même pièce, dont le dessus est indiqué n.° 2.
Nous n’attachâmes point un grand prix à ces objets, que nous regardâmes
comme l’agraffe d’un baudrier ; nous n’en avons conservé les traits
qu’à cause de la grossièreté du travail, et parce qu’il est néanmoins
vraisemblable, que cette agraffe avait appartenu à quelque homme de
marque. En effet elle a été trouvée dans un cercueil de pierre, qu’on a
déterré depuis quelques années, avec beaucoup d’autres, à une demi
lieue de Pont-Audemer. Les lignes paralleles de la figure n.° 1. sont
des sillons creusés, à la lime, dans l’épaisseur de la pièce, pour
tenir lieu d’ornement et de ciselure ; et il faut regarder comme un des
produits du même goût, les points enfoncés qu’on voit entre ces
hachures et sur toute la surface de la fig. n.° 2.
Nous
conservâmes ces pièces, ainsi que plusieurs médailles trouvées dans le
vase fig. A., et l’anneau fig. D., pour les porter à l’Ecole centrale
avec nos collections.
Les insectes phosphorescens ; les
intermittences de leurs apparitions, et la cessation subite du
phénomène nous occupèrent aussi pendant le même jour. Quelques-uns
proposèrent d’aller, après souper, faire une nouvelle tentative sur le
rivage, afin d’examiner si ces insectes ne paraîtraient point ce soir
là, et tous voulurent prendre part à cette recherche. Nous ne vîmes pas
un seul insecte dans l’eau de mer que nous puisâmes, à diverses
reprises, et en différens endroits : mais nous en apperçûmes plusieurs
dans les varecs épars que le flot avait poussés sur le rivage. Cela
nous fit regretter de n’avoir pas une plus grande quantité de varec à
notre disposition : nous nous rappelâmes l’observation du Hâvre où nous
avions vu, pour la première fois, les insectes sur le varec, et nous
arrêtâmes qu’un de nous irait sur la grève de Honfleur, où nous avions
trouvé beaucoup de varec, pour prendre, sur ces végétaux, tous les
renseignemens que l’observation lui fournirait.
Nous apprimes, à
notre tour, que des ordres avaient été donnés pour la recherche de
plusieurs déserteurs qu’on disait avoir été vus marcher en troupe dans
la campagne, et sur les intentions desquels on avait des craintes.
Cette
circonstance pénible nous fit désirer vivement le retour de la paix, et
la légende de notre médaille revint à notre esprit. Nous plaignîmes la
patrie d’être réduite à se défendre contre ses ennemis et contre ses
propres citoyens : nous fûmes extrêmement affligés du tourment de ces
infortunés qui se trouvaient, par la désertion, en révolte contre les
sentimens de leur conscience, et que les angoisses, toujours
renaissantes, de leur position devaient rendre insensibles aux beautés
de la nature, que nous admirions dans toutes les heures du jour.
L’INTÉRIEUR
DES MONTAGNES : LE CAMP DES
ANGLAIS
: LES CERCLES MAGIQUES.
Le
lendemain matin, nous partîmes pour la seconde expédition de la roque.
Avant de monter sur la hauteur, nous voulûmes revoir les sites
pittoresques de la veille, les blocs suspendus, les excavations, les
éboulemens et les assises paralleles de la montagne.
Ce dernier
point nous faisait toujours une impression profonde, il nous présentait
les traces du travail successif des alluvions, dans la formation des
montagnes, et nous ne pûmes nous défendre de ce sentiment de plaisir
que donne l’évidence, lorsqu’en comparant le flanc de cette montagne,
où les bancs étaient si marqués, aux attérissemens herbés que la mer a
formés depuis, au pied de la roche, nous vîmes, dans la coupe de ce
terrain, le même mécanisme de construction, le même parallelisme des
assises, en un mot, la preuve irréfragable que les couches du banc
d’alluvion et les assises de la montagne étaient produites par la même
cause : excepté seulement que la mer, beaucoup plus élevée sur le sol,
quand elle posa les fondemens de la colline, agissait en grand avec
toute la puissance des courans et des grandes marées ; au lieu que les
bancs, qui se sont formés au pied du roc, ne sont que le produit des
dernières lames du flux et du reflux, et n’ont pas, à beaucoup près,
l’épaisseur de ces bancs de silice et de terre calcaire qu’on voit dans
la montagne.
A quelle époque ceux-ci furent-ils entassés les uns
sur les autres ? combien y a-t-il de temps que ces grandes alluvions
surmontèrent le sol primitif ? c’est un problême dont quelques heureux
hasards offriront peut être la solution ; jusqu’à présent rien ne peut
servir à la faire connaître : mais combien de siècles n’a-t-il pas
fallu pour endurcir le limon de silice, où furent enveloppés les
coquillages qu’on y voit aujourd’hui !
Nous n’osons rien
affirmer sur les conjectures que fait naître l’aspect de ces pierres
qui présentent tantôt le silex enveloppé de terre calcaire, et tantôt
la terre calcaire au sein du silex : mais il n’y a rien qui puisse
attirer plus sérieusement l’attention du naturaliste que l’intérieur de
ces masses hétérogènes.
Au milieu de leurs cassures, vous voyez
des oursins dont le centre siliceux est transparent comme l’agathe,
tandis que l’enveloppe et le creux formé dans le caillou par l’oursin,
sont assez profondément calcaires ; après cela, le silex reparait dans
une épaisseur plus ou moins grande, jusqu’à ce que sa transparence
diminuant peu à peu, et comme par couches, le bloc se confonde à la
fin, par le ton, la couleur et la dureté, avec la pierre calcaire qui
forme sa dernière enveloppe.
Nous avons cassé beaucoup de ces cailloux dans lesquels se sont
offertes ces apparences d’enveloppes et de couches roulées.
L’épaisseur
de ces couches était souvent la même, et leur succession régulière et
parallele ne servait qu’à augmenter nos incertitudes. Nous nous
demandions par quel moyen le limon de silice avait pu acquérir sa
transparence et sa dureté, à des profondeurs qui paraissaient
inaccessibles à l’action de tous les fluides répandus dans l’atmosphère
!
Cependant nous avancions vers le sommet de la colline ; déjà
des points de vue magnifiques s’offraient à nos regards, et nous
parvinmes au point le plus élevé du plateau, qu’on appelle dans le
pays le camp
des Anglais. On n’a pu nous dire d’où vient cette
dénomination : les vestiges de quelques anciens fossés, dont on voit
encore la direction, ressemblent plus à des dispositions de culture et
d’enclos rural, qu’aux lignes simétriques d’un camp.
Mais cette position est admirable par la beauté du spectacle qu’elle
offre de tous les côtés.
Des
collines cultivées et couvertes de bois vers le sud : la Seine, vers le
nord, avec les côtes du pays de Caux, couronnées de grands arbres et
vivifiées par des habitations : à l’orient, un immense terrain bordé
par une chaîne de montagnes demi circulaire, avec des attérissemens
fertiles qui s’étendent jusqu’au-delà de Quillebeuf : et vers
l’occident la superbe embouchure de la Seine et les rives qui la
bordent ; les ports de Honfleur et du Havre ; le mouvement que donnent
au tableau toutes les barques qui montent la rivière ou qui la
descendent.
Le sol lui-même nous offrit des productions que nous
n’avions pas encore trouvées : nous vîmes, sur la pelouse, un grand
nombre de ces bandes circulaires, connues sous le nom d’anneaux, ou
cercles magiques, et dans la largeur desquelles on voit un gazon plus
ou moins différent de celui qui se trouve en dehors et en dedans de ces
anneaux. La différence qu’on remarque entre la couleur des bandes et
celle du gazon environnant, n’est pas toujours du même genre ; il y a
des temps où le gazon des anneaux est plus frais et plus vert que celui
qui les entoure ; il y en a d’autres où il est au contraire sec et
fané, tandis que celui des environs conserve encore sa fraicheur
(note XVII).
Du plateau sur lequel nous nous étions reposés,
nous marchâmes vers la
pointe de la roque, afin de voir, d’en haut,
les pics et les éboulemens qui, la veille, avaient été dessinés d’en
bas. Ce fut un spectacle d’un autre genre, et presqu’effrayant par
l’âpreté de la coupe de la montagne et sa chute perpendiculaire. Les
mesures, que nous avions prises, de son élévation, avaient été
calculées, mais les calculs n’avaient point été vérifiés, et
l’estimation, que nous fîmes alors de la hauteur, nous donna quelques
inquiétudes sur l’opération de la veille.
Plusieurs pensèrent
qu’il y avait de l’erreur : un de nous le soutint même avec assez
d’assurance, pour nous faire soupçonner qu’il avait plus que des
apperçus, et il convint que pendant les opérations des mathématiciens,
il était secretement monté sur la pointe et qu’il en avait mesuré la
hauteur avec un plomb. La certitude de cette vérification fit chercher
la cause de la différence des résultats ; on la trouva dans le choix
qu’on avait fait d’un pic, comme le plus élevé, quoiqu’il ne le fut pas
réellement. En effet, sa pointe rapprochée cachait la plus grande
élévation de la montagne, et quoique l’opération et les calculs eussent
été régulièremen[t] faits, cette illusion avait cependant produit une
erreur de dix pieds.
Mais l’isolement de cette montagne et son
escarpement nous présentaient l’apparence d’une erreur bien plus grande
et nous l’eussions très-mal jugée, si les vérifications et les calculs
n’avaient été employés pour connaître la hauteur réelle (note XVIII).
La
seule plante remarquable que nous trouvâmes fut la digitale jaune (51)
; mais nous vîmes une très grande quantité de papillons, notamment des
agrestes, des petits argus de montagne, etc. (52).
Nous nous
présentâmes ensuite chez le maire de la Roque, à qui nous avions
d’anciennes obligations, parce que c’était à sa recommandation que
l’Ecole centrale devait les premiers tadornes que lui avait donnés le
citoyen Mabire, professeur d’hydrographie et de mathématiques à
Quillebeuf (53).
Nous offrîmes au maire nos remercîmens et nos civilités, et nous lui
rendîmes compte du motif de nos excursions.
LE
TÉLESCOPE : LE BORD DE LA LUNE.
Le reste du jour fut employé à des observations microscopiques ; et le
soir nous considérâmes la lune avec le télescope.
Nous reconnûmes aussi sur le disque, les taches dont nous avions vu la
figure dans les cartes du ciel.
Mais
nous ne vîmes point sans étonnement une apparence singulière, que
l’instrument nous fit appercevoir, et dont nous n’avions point encore
entendu parler. Le limbe de la planète, qui nous semblait, à la vue,
terminé d’une manière très-nette par une ligne circulaire, nous parut,
dans l’instrument, sous la forme d’une suite d’aspérités qui
présentaient l’image d’une déchirure.
Les peuplades
problématiques de cette terre inconnue ne nous parurent pas aussi
probables qu’on a quelquefois voulu le faire entendre ; l’apparence de
cette espèce de cordon
de pierre ponce, qui renfermait le disque,
nous fit présumer que le globe se dessinerait toujours de la même
manière, sous d’autres aspects. Ses nuits de quinze jours nous
semblèrent excessives, et la lenteur de caractère et de mouvement
qu’auraient les habitans engourdis de ces climats, nous parut une sorte
de léthargie organique. Nous quittâmes ce spectacle pour reporter nos
yeux sur les étoiles qui se trouvaient alors sur l’horizon : nous
reconnûmes le signe du verseau, nous vîmes le lien des poissons, le
belier, les pleïades, etc.
C’est ainsi que la superbe théorie de
Copernic doit être étudiée, plutôt encore que dans les livres qui en
établissent les bases et qui en développent les conséquences. C’est en
présence des astres que leurs révolutions doivent être expliquées, et
nous sentîmes tout ce que dut avoir d’intérêt et de charmes, pour
l’heureux magistrat de Vénise, l’ingénieux appareil de Galilée, sur les
tours de St.-Marc (54).
Nous aurions vivement désiré voir
Jupiter, mais il n’était sur l’horizon que dans les heures du jour, et
nous nous bornâmes à admirer l’usage que l’astronomie avait fait des
passages fréquens et périodiques de ses satellites.
LES
NOUVEAUX POINTS DE VUE : LES
VIEUX
HÊTRES.
Le
jour suivant nous parcourûmes ce qui nous restait à connaître des côtes
de la Roque et d’une commune voisine, nommée saint-Samson.
Les
sites que nous avions vus la veille étaient magnifiques : mais le
coup-d’œil, que nous offrit l’autre partie de cette côte, était
ravissant par les contrastes qu’il réunissait.
Dans le lointain,
la vue des grandes villes, des ports de mer et des vaisseaux, nous
rappelait les idées du pouvoir, des richesses et de l’abondance que
donnent aux hommes le commerce et l’industrie ; mais, dans les
premiers plans,
nous voyions l’image de la vie pastorale et douce dont jouit,
au milieu des champs, l’homme paisible et bon, sachant apprécier les
vrais biens que fit pour lui l’auteur de la nature.
La premiere
partie du tableau présentait à nos yeux tout ce qui peut élever l’ame,
agrandir les idées, échauffer l’imagination et donner l’éveil aux
passions vives : la seconde nous offrait tout ce qui peut remplir le
cœur de sentimens délicieux, dans une famille agricole et pure ; tout
ce qui rappèle les hommes à ces devoirs primitifs, qui les unissent par
les services mutuels, et qui les rendent heureux par la générosité et
par la reconnaissance.
Tel fut, sans doute, le site enchanté où
se reposait Horace, quand il peignit, dans la même ode, le faux éclat
des cités et l’heureuse simplicité des campagnes ; les illusions de la
fortune et les produits assurés de la charue ; la soif brûlante des
richesses et les jouissances paisibles de la médiocrité ; les crimes
que l’or fait commettre et la bienfaisance qu’inspire l’usage des dons
de la nature : enfin les naufrages où les ambitieux vont périr, et les
soins affectueux que reçoit la vieillesse au sein d’une famille
patriarchale.
Nous ne quittâmes ces heureux points de vue
qu’avec peine, et nous exprimions nos regrets en nous en éloignant,
lorsque nous découvrîmes la tente sur la côte opposée du vallon. Sa
blancheur la faisait distinguer parmi les différens tons du paysage ;
nous nous plûmes à la considérer : sa vue nous rappela les objets que
nous y avions déjà déposés ; elle nous fit penser à ceux que nous
avions encore à recueillir, et nous reprîmes nos travaux et nos
recherches, en parcourant la côte orientale de la Risle.
Son
élévation qui en fait un lieu très-agréable, pendant la belle saison de
l’année, doit en faire un séjour bien incommode pendant l’hiver. Les
coups de vent du nord-ouest exercent, à son sommet, toute leur
violence, les arbres et leurs rameaux contractent une direction
penchée, comme s’ils étaient arrêtés et maintenus par des attaches ;
les branches ne poussent point du côté du vent, c’est à l’opposite
qu’elles se tournent, et c’est de ce côté-là seul que les boutons
peuvent se développer.
Nous remarquâmes surtout deux hêtres
antiques battus par les tempêtes sur cette côte élevée. Ils tiennent au
roc par des racines noueuses et entortillées, comme le lierre tient aux
murailles ; le chevelu seul a pénétré dans les fentes de la pierre,
mais les racines n’ont pu s’enfoncer ; à mesure qu’elles ont grossi
elles ont surmonté la légère couche de terre végétale, qui couvre la
roche, et s’étendant plus loin que les branches autour du tronc, elles
présentent aujourd’hui l’aspect d’un assemblage tortueux, qu’une
végétation tourmentée a construit malgré tous les obstacles (55).
Nous
ne trouvâmes aucune plante nouvelle sur ce côteau, nous vîmes seulement
quelques insectes : les papillons nommés par Geoffroi la petite tortue,
le vulcain et la belle-Dame ; des sauterelles à ailes bleues, d’autres
à ailes rouges, la sauterelle ensanglantée et des cicadelles écumeuses,
autrefois nommées cigales
bédaudes (56).
LA
GRANDE MARE : LES EPONGES
D’EGLANTIER.
Nous
traversâmes la largeur du plateau pour découvrir, de l’autre côté, le
marais vernier à l’extrémité duquel est un lac, connu sous le nom
de la grande
mare et désigné de même dans les cartes de Cassini.
Tout
ce que nous avions entendu dire de la position et des particularités de
ce lac, de la nature du terrain marécageux qui l’entoure : ce que nous
appercevions de loin dans la manière dont on cultive ce même terrain :
les nombreux potagers qu’il renferme et qui ont la forme de découpures
longues et parallèles, nous firent regretter de ne pouvoir, dès cette
année, pousser nos recherches de ce côté-là.
Nous sentîmes de
quel intérêt il serait, pour le pays, de rendre productif un aussi
vaste marais ; de convertir, en terre labourable, une surface immense
de tourbières et de marécages, qui ne peut avoir, dans son état actuel,
que des influences pestilentielles, qui cause, dans les environs, des
fièvres automnales et donne aux riverains cette constitution
œdemateuse, qui n’a le caractère ni de la force ni de la santé.
On
nous a dit qu’une compagnie de Hollandais avoit demandé, il y a près
d’un siècle, à faire le défrichement de ce marais ; nous n’avons point
découvert la cause qui a pu faire échouer cet utile projet : les
avantages d’un pareil travail sont évidens et font désirer qu’on le
reprenne bientôt.
Nous revinmes sur nos pas, du côté de la
Risle, et nous allâmes vers une pointe de la côte, qui s’avançait dans
la vallée ; nous y vîmes des papillons que nous ne pûmes saisir, et qui
parurent être de la famille des aurores.
Nous cueillîmes des
bédéguars monstrueux sur les églantiers de la colline (57) ; nous
brisâmes quelques cailloux dont l’enveloppe quartzeuse et brillante
faisait soupçonner qu’ils renfermaient des produits curieux, mais ils
n’offrirent que les empreintes coniques et cannelées de pointes
d’oursins. Nous nous reposâmes ensuite pendant quelques instans, puis
nous descendîmes par le flanc de la colline où de nombreux troupeaux
paissaient le thym des montagnes.
LA
RENCONTRE INATTENDUE.
Nous
étions alors dans la commune de St.-Samson et nous avançons vers la
rivière qu’on traverse en cet endroit, sur un bac,…… lorsque des
citoyens armés, se montrant tout-à-coup à notre rencontre, nous
commandent d’arrêter et se présentent avec une sorte de résolution dont
nous ne concevions pas le motif. Nous n’étions pas très-éloignés les
uns des autres, mais nous n’étions pas non plus tous ensemble, et ce
fut aux plus avancés que les citoyens commandèrent de s’arrêter et
demandèrent des passeports. Cependant les derniers de notre petite
troupe ne tardèrent point à rejoindre l’avant-garde, qui se trouvait en
pour parler avec les citoyens armés, et ceux-ci ayant bientôt reconnu
l’un des membres du jury d’instruction, posèrent leurs fusils, avec un
éclat de rire qui devint plus inconcevable encore que le serieux de
leur premier abord.
Le mot de cette énigme est que notre
apparition subite et nombreuse, sur la croupe d’une de leurs collines,
s’était jointe, dans leur esprit, au souvenir des ordres qu’ils avaient
reçus la veille, relativement aux déserteurs ; dès-lors nous étions
devenus pour eux un sujet d’inquiétude publique ; l’uniforme du
pensionnat, que portaient plusieurs d’entre nous, semblait être la
preuve d’un enrôlement particulier ; nos instrumens avaient paru des
machines hostiles ; la descente précipitée que nous avions faite par le
ravin, sans aller chercher des chemins frayés, étoit comme une
irruption qui présageait une attaque réfléchie, et ces citoyens
estimables s’étaient armés pour la défense commune.
Nous devons rendre hommage à la franchise de leur caractère, qui les
fit s’amuser avec nous de la méprise qu’ils avaient faite.
LES
TOMBEAUX : LES EPITAPHES.
Le
maire de S.-Samson nous donna obligeamment tous les secours qui
dépendirent de lui, pour les recherches que nous eûmes l’occasion de
faire dans la commune.
Nous en avons fait sur des objets fort
extraordinaires, et c’est une chose assez rare, qu’une petite commune,
comme celle de St.-Samson, ait autrefois servi de retraite aux évêques
d’un diocèse éloigné, situé même dans une autre province.
On
voit encore aujourd’hui les ruines d’un vieux monastère qui fut bâti
par ces évêques, et l’on retrouve les traces d’une très-ancienne
collégiale, établie pour le service de l’église paroissiale (note
XIX).
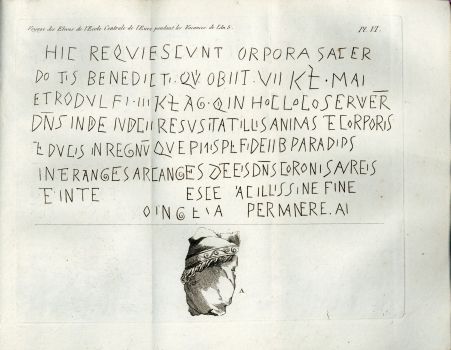 Mais
ce qui nous parut le plus remarquable est une vieille
épitaphe, dont la planche VI présente la copie figurée. Nous ne savons
précisément qu’elle date il faut donner à cette pièce, parce que son
auteur, qui marquait avec soin les jours du décès des deux
prêtres Raoul
et Benoît,
n’a pas eu l’attention d’en indiquer, en même
tems, l’année. Mais
ce qui nous parut le plus remarquable est une vieille
épitaphe, dont la planche VI présente la copie figurée. Nous ne savons
précisément qu’elle date il faut donner à cette pièce, parce que son
auteur, qui marquait avec soin les jours du décès des deux
prêtres Raoul
et Benoît,
n’a pas eu l’attention d’en indiquer, en même
tems, l’année.
C’est donc uniquement d’après la comparaison, que
nous avons faite, des caractères de cette épitaphe, avec d’autres
caractères anciens, et sur-tout avec ceux que Montfaucon a fait graver,
qu’il nous semble que cette épitaphe peut être du neuvième siècle.
Nous
avons cru devoir la conserver comme un des monumens de l’écriture de ce
tems-là, et de l’état où les lettres et l’instruction se trouvaient
alors. Nous croyons d’ailleurs pouvoir affirmer que les caractères ont
été fidèlement copiés, malgré les difficultés que nous éprouvâmes,
non-seulement à cause des dégradations que la pierre avait souffertes,
mais encore à cause des lichens
dont elle était couverte, en quelques
endroits, et que nous n’osions enlever de peur de causer de nouveaux
dommages (58). Il y eut des lettres que nous prîmes la peine de
relever, avec de la cire, pour être surs de leur vraie forme ; en un
mot nous fîmes, de ce travail, une sorte d’étude pour toute
autre
occasion dans laquelle il s’agirait de déchiffrer un monument d’une
plus grande importance ; nous avons même essayé de suppléer à ce que le
temps a détruit et à ce que nous avons considéré comme des abréviations
dans l’écriture, et nous avons copié dans la note XX l’épitaphe, ainsi
completée, avec des caractères de différens ordres (note XX).
La
pierre, sur laquelle on lit cette épitaphe, n’est plus sur un tombeau ;
elle est maintenant employée dans la construction du mur méridional de
l’église ; et dans le même mur, à dix pieds plus loin, on en voit
encore une autre dont les caractères paraissent un peu plus modernes ;
mais dont le style est correct et la conception plus heureuse.
La
fig. A qui est gravée au bas de la planche VI est la tête mutilée de la
fig. d’évêque, dont nous avons parlé dans la note XIX, et que les
salpêtriers de l’an deux mirent en pièces, sous prétexte d’en tirer du
nitre ; nous en avons conservé les traits parce qu’ils peignent la
forme que les mitres avaient à des époques reculées de l’ère ancienne ;
nous lui avons trouvé beaucoup de ressemblance avec une autre mitre
qu’on voit à Rouen, sur le tombeau d’un évêque, auprès du chœur de la
Cathédrale.
LE BAC.
S.T-SAMSON : LE PASSAGE DE
LOUIS
XI.
Lorsque
nous eûmes reconnu ce qu’il y avait de curieux dans ce local, nous
continuâmes notre route vers le passage de la Risle, au bac de
St.-Samson.
Avant la construction des grandes routes ce passage
était extrêmement fréquenté. On ne prenait pas ordinairement d’autre
chemin pour aller de Honfleur à Pont-audemer ; et ce fut au bac
St.-Samson, que les échevins de cette dernière ville allèrent
présenter du
vin clairet à Louis XI, lorsqu’il revenait de Honfleur, le
3 juin
1475 (note
XXI).
De l’autre côté de la Risle nous cueillîmes,
le long des fossés, le chardon des marais (59), l’inule dyssenterique
(60), le bidens à feuille de chanvre et le bidens penché (61).
LES
PÊCHERIES DE BERVILLE : LES
HAMEÇONS
D’EPINE : LES BALEINES.
Quand
nous fûmes arrivés, nous nous hâtâmes de dîner, pour aller visiter les
pêcheries de Berville, que nous avions entrevues en allant à Honfleur.
On
y pêche avec une espèce de filet en entonnoir, dont on arrête le
pavillon sur des pieux enfoncés dans le sable (62). C’est la manière la
plus lucrative dont la pêche se fasse sur les bancs de cette commune ;
on y prend beaucoup de hareng, dans l’arrière-saison ;
beaucoup
d’un excellent poisson qui exhale, au sortir de l’eau, une odeur
très-agréable de violette (l’éperlan) ; on y prend aussi beaucoup de
crevette, appelée ailleurs salicoque, de l’œillet, un peu de capelan,
etc.
On prend encore des saumons dans la rivière, quand ils la
remontent pour frayer, et nous pourrions ajouter qu’on y prend aussi
des baleines, si les événemens de ce genre étaient plus nombreux, ou
plus rapprochés.
Il n’y avait néanmoins qu’une vingtaine
d’années qu’on en avait pris une très-grosse, lorsque l’année dernière,
au commencement du printemps, les habitans de Berville
prirent
encore un cétacé.
Nous serions portés à croire que c’était un
grand cachalot (63), s’il était permis de compter sur les rapports qui
nous furent faits ; mais les hommes à qui nous les devons, ne
songeaient à autre chose, qu’aux moyens de tirer le meilleur parti de
leur bonne fortune, et le souvenir confus, qui leur était resté, ne
nous parut pas suffisant pour garantir la description qu’ils nous
firent.
Une seule circonstance nous sembla mériter de
l’attention, et nous pensâmes qu’elle pourrait du moins servir à
déterminer, à très-peu de chose près, la grosseur du cétacé. On nous
dit que deux hommes, d’environ cinq pieds trois ou quatre pouces, qui
se trouvaient placés des deux côtés, ne se pouvaient appercevoir, au
dessus de son épaisseur, qu’en s’élevant sur la pointe des pieds :
ainsi en défalquant ce que la mobilité du sable pouvait leur faire
perdre, il parait que le poisson avait, au moins, cinq pieds de
diamètre.
On en tira quelques barils d’huile, mais on en perdit
la plus grande quantité, et du reste, rien n’a été conservé : la chair,
la peau, les os, tout a été dissipé par ceux qui en achetèrent des
pièces ou des tronçons. Le regret de ne pouvoir acquérir aucun
renseignement précis nous fit inviter les pêcheurs à donner avis, à
l’Ecole centrale, des évènemens de ce genre, s’ils se
renouvellaient, et si quelque baleine venait encore échouer sur les
bancs de sable.
C’est en effet au grand nombre de ces bancs, et
peut-être aussi à leur instabilité, qu’on doit la prise des deux
dernières, parce qu’ils forment, dans l’embouchure de la Seine, des
espèces de parcs
naturels au milieu desquels la mer laisse, en se
retirant, les poissons d’un grand volume lorsqu’ils s’arrêtent trop
long-temps après le reflux.
Mais il n’est pas aussi facile de
découvrir les causes qui font divaguer ces monstres exotiques, et qui
conduisent, sous des latitudes tempérées et douces, ces habitans des
mers du nord.
Les filets nommés guideaux, ne sont pas les seuls
moyens qu’on employe pour pêcher à Berville : on prend en outre des
plies (64), des flondres (65) et autres poissons plats (66), avec des
lignes. Les pêcheurs vont tendre ces lignes au bord de la Seine, et ils
les arrêtent sur le sable, avec des pieux ou des pierres. Ces lignes
ont environ un pied de longueur ; elles sont attachées à une maîtresse
corde qui se prolonge fort loin, et sont toutes armées
d’hameçons
faits avec des pointes d’épine.
Pour faire ces hameçons, les
pêcheurs employent, avec la pointe d’épine, une petite portion de la
branche qu’ils aiguisent, en-sorte que ces hameçons prennent la forme
d’un angle droit, semblable à celle d’un clou à crochet dont
les deux
pointes seraient égales.
Nous ne pûmes jouir du spectacle
d’aucune de ces pêches. En effet, avant nous nous fussions présentés
pour y prendre part, les pêcheurs avaient reçu la défense de continuer
la pêche, jusqu’à ce qu’ils eussent prouvé qu’ils ne s’écartaient point
des anciennes dispositions de l’ordonnance sur cet objet de police.
LES
MAISONS DE CAMPAGNE : LES
BRUYERES.
Nous
longeâmes la rivière, pour remonter sur les côteaux que nous avions
devant nous, et nous jouîmes encore une fois du spectacle magnifique
que l’embouchure de la Seine offre de toutes parts.
On voit, au
pied d’un de ces côteaux, une maison de campagne, agréablement située
dans un vallon fertile, entourée de bosquets, décorée de terrasses et
de pièces d’eau (67).
C’est aussi sur le même côteau, qu’on
trouve une propriété remarquable par ses plantations nombreuses et bien
ordonnées, ainsi que par les sites heureux qui l’entourent (68). De
toutes parts ce sont ou des points de vue qui se prolongent sur la mer,
entre des avenues et des quinconces, ou des tableaux rapprochés de
culture et de pâturages ; tantôt c’est un point élevé que le soleil
fait briller d’une lumière vive, et tantôt c’est une percée dans de
jeunes taillis, qui donne une ombre agréable et fraîche.
Le
plateau de cette colline est couvert d’une couche de terre végétale,
qui n’a pas une grande profondeur : mais avec une culture soignée et
des engrais, on la rend productive et même fertile.
Il y en a
cependant une partie qui n’est couverte que de bruyère, ou de genêt
épineux (69) et ne présente que l’image de la stérilité la plus
absolue. Cette partie du plateau est un terrain communal dont
les usagers
enlèvent le gazon, à mesure qu’il se reproduit, pour le
brûler comme de la tourbe. Ainsi au lieu de s’améliorer, avec le temps,
par les dépôts terreux que les tourbillons élèvent et par les débris
des végétaux que l’atmosphère y fait croître, ce terrain,
successivement pelé de place en place, n’offre à l’œil que le caillou
mis à nud, avec l’aridité brûlante de la pierre et du sable.
Il
est à souhaiter qu’on trouve les moyens d’améliorer les côteaux de
cette espèce, qui sont en grand nombre dans le département.
On
croit généralement que les plantations dont le besoin se fait de plus
en plus sentir, sont les plus avantageux qu’on puisse prendre ; il faut
espérer que l’industrie agricole portera enfin ses regards sur cet
objet. Ce serait le moyen de procurer aux hommes peu fortunés, un
meilleur chauffage que la tourbe médiocre qu’ils vont chercher sur ces
côteaux.
LABOURAGE
: TROUPEAUX : ECONOMIE
RURALE.
Au pied
de cette colline aride, est une campagne peu étendue, mais fertile, que
nous traversâmes pour retourner à la tente. Ce fut dans ce trajet, que
nous donnâmes une attention particulière à la manière dont on cultive
la terre.
On fait communément deux
saisons, c’est-à-dire, on
seme du froment tous les deux ans, et dans l’année où l’on n’en sème
pas, la terre se repose en jachère, à moins qu’on n’y sème ce qu’on
appèle dans le pays des menus grains, ce qui comprend les
pois, la
vesce, etc.
Le bled qu’on sème après la récolte de ces menus
grains, s’appèle bled de froissis,
apparemment parce qu’au lieu de
donner à la terre les tours accoutumés de charrue, on ne fait en
quelque sorte que la froisser par celui qu’on lui donne, avant de semer
le grain. Il est de notoriété que ce bled de froissis ne vaut
pas
souvent la moitié de celui qui vient dans la terre de jachère, et qu’on
nomme bled de
voret.
Il y a même des cultivateurs qui ont
compté ce que le bled de jachère donnerait de grain, au-delà de ce que
fournit celui de froissis,
et qui assurent qu’il y a de la perte à
faire du froissis
et à ne pas accorder à la terre le repos d’une
année. Cependant il est bien à regretter que les cultures décrites par
Arthur Young, et suivies avec succès dans plusieurs parties de
l’Angleterre, ne prennent encore en France aucune faveur ; il est à
regretter qu’on néglige des moyens qui doublent si avantageusement les
produits dans une île où l’on est obligé de suppléer, par le travail et
l’industrie, au peu d’étendue que présente le sol.
Les charrues
employées dans le territoire que nous avons parcouru, sont d’une
construction plus forte que celles des parties orientales du
département ; les sillons sont aussi plus profondément labourés, ils
sont beaucoup moins larges et plus arrondis.
Cette disposition
multiplie les surfaces, elle augmente le contact de l’air et facilite
l’écoulement des eaux pluviales, par les raies qui se trouvent entre
chaque sillon.
Cette forme n’est cependant pas la même pour
toutes les qualités de terre ni pour tous les genres de culture, et
elle n’est adoptée que pour le seigle et le bled, dans les terres
fortes ; dans les autres cultures et dans les terres sabloneuses, ou
contenant des cailloux, on fait de larges sillons applatis, qu’on
appelle planches.
Les propriétés, qui ne sont pas encloses,
sont, pour la plupart, séparées des propriétés voisines par de gros
cailloux qui leur servent de bornes, et c’est la meilleure précaution
qu’on puisse employer pour prévenir toute espèce d’usurpation. Mais il
y a des terres dont les limites ne sont pas ainsi déterminées, et quand
il s’élève à ce sujet des difficultés, que les titres ne peuvent pas
détruire, on a recours à la loi suprême de l’ancienne possession.
Quelque défigurées qu’on en suppose les traces, on parvient presque
toujours à les reconnaître, dans la terre, par la couleur ou le ton des
veines, des filons et des couches qui attestent les anciennes cultures.
On
enferme toujours les vergers d’habitation (note XXII), et
souvent
aussi les pâturages, dans des clôtures qu’on appèle fossés. Cette
expression comprend non-seulement la fosse pratiquée autour du terrain
qu’on enclôt, mais encore une butte qu’on élève, sur le bord de la
fosse, avec la terre qu’on en a tirée : on distingue
seulement ces deux parties de la clôture, en donnant à la
fosse
le nom de creux
de fossé, et en appelant masse de fossé, la
butte
élevée sur le bord du creux.
Ces masses de
fossés sont couronnées
d’épines et plantées de grands ormes dont la tige droite et les ramées
feuillues forment des palissades très-agréables, sur le bord des
chemins.
On seme du froment dans les terres fortes, du seigle
dans les terres plus légères, et beaucoup de petits haricots dans
toutes les espèces de terre. On cultive aussi du chanvre et du lin ;
mais il est vraisemblable qu’on attend trop tard pour semer celui-ci,
et la différence étonnante qui se trouve entre les époques de cette
culture, par rapport aux pays voisins, est peut-être une des causes de
celle qu’on remarque dans sa qualité. L’exposition qu’on en fait
pendant long-temps à la rosée, avant de le faire rouïr, contribue sans
doute encore à le détériorer.
Les bestiaux qu’on nourrit sont
des brebis et des vaches, on ne voit point de chèvres et l’on engraisse
rarement des bœufs. On élève encore des cochons dans les fermes et dans
les vergers d’habitation ; on sait cependant qu’il y a peu de profit à
faire sur ces animaux, mais l’argent qu’on en retire est le résultat
des soins économiques et des dépenses, presque imperceptibles, qu’on
fait chaque jour pour les nourrir. Ce résultat qu’on reçoit en somme,
quand on les vend, paraît comme un gain réel qu’on applique aux besoins
domestiques.
On élève d’ailleurs ces animaux pour un autre
motif, c’est-à-dire, pour l’avantage qu’en retirent les arbres
fruitiers, par l’engrais qu’ils répandent ; on a même coutume de
transporter leur auge au pied des arbres qui languissent, afin que
l’habitude qu’ils prennent de s’y rendre, devienne salutaire
et fertilisante.
On voit un assez grand nombre de troupeaux de
moutons ; mais on n’a point encore l’usage de les parquer, et nous
sommes portés à croire qu’on les tond trop tard, vû la grande quantité
de laine qu’ils laissent sur les épines et dans les buissons. Une
observation qui nous a frappés, est relative à la manière dont on lave
quelquefois la laine. Nous venons de dire qu’on attend en quelque sorte
qu’il y en ait une partie de perdue pour la tondre, mais il en est
autrement de l’époque du lavage : on la devance et on lave la laine
avant même que les brebis soient tondues.
Ce n’est pas un léger
travail que de laver ainsi un troupeau entier, et l’on y employe
communément beaucoup de monde. On conduit les brebis au bord de la
rivière ; une partie des laveurs entre dans l’eau jusqu’à la ceinture
et reçoit les brebis que présentent, l’une après l’autre, ceux qui
restent à terre pour ce service. Il faut deux personnes pour laver une
brebis ; l’une tient la tête élevée hors de l’eau pour préserver
l’animal de suffocation, pour le présenter au laveur sur tous les côtés
; la fonction de celui-ci est de bien mouiller la laine, de la manier,
d’en exprimer l’eau, enfin de la nettoyer des ordures et du suint
dont elle se salit dans les étables. Ce travail est un vrai tourment
pour les hommes qui le font, comme pour les brebis qui l’endurent, et
malgré tous les soins qu’on se donne pour le bien faire, il est
toujours beaucoup moins parfait qu’il ne le serait si l’on attendait
que la toison fut enlevée pour la laver ; 1.° on pourrait
employer de l’eau tiède et la lessive en serait meilleure ; 2.°
l’opération serait moins longue et beaucoup plus facile ; 3.° elle
serait moins dispendieuse ; 4.° enfin l’animal s’en trouverait mieux,
et nous croyons que cette considération n’est point à négliger, parce
que la souffrance de l’animal doit toujours avoir des résultats
fâcheux, quelqu’insensibles qu’on les suppose.
FIN
PROCHAINE DU VOYAGE : EGLISE
SOUTENUE
PAR UN IF : CERCUEIL
DE
PLATRE : AGARIC REMARQUABLE.
L’époque
de notre retour devenant très-prochaine, nous prîmes un jour entier
pour recueillir les différentes notions que nous avions acquises dans
nos courses. Tandis que ce travail nous occupa, l’un de nous se rendit
à Honfleur pour vérifier les doutes que nous avions sur les insectes
phosphorescens, et d’autres allèrent à St.-Samson faire de nouvelles
recherches sur l’ancien tombeau de cette église.
Leurs
recherches furent infructueuses : ils apprirent que le cénotaphe avait
été déplacé il y a cent ans, et il leur fut impossible de reconnaître
le véritable lieu où le cercueil avait été mis.
Mais le voyage
de St.-Samson ne fut pas entièrement inutile : ceux qui en avaient été
chargés observèrent, en revenant, un if remarquable par sa position, sa
taille, et les particularités du sol sur lequel il est planté. On le
voit dans la commune de Foullebec,
à l’angle sud-est du chœur de
l’église, qu’il soutient, et qui s’écroulerait dans un ravin profond,
sans l’apui que l’arbre lui prête.
Les observateurs employèrent
d’abord des moyens mathématiques pour mésurer son diamètre : mais ayant
trouvé des sarmens de clématite, ils en firent un lien avec lequel ils
reconnurent que cet arbre (mesuré à trois pieds au-dessus des racines)
a vingt-un pieds de pourtour (70).
Sous cet if, et dans un
terrain de sable et de cailloux, on voit la coupe d’un cercueil de
plâtre dont la direction est de l’ouest à l’est comme celle de
l’église. Il est facile de reconnaître, par le diamètre de la coupe du
cercueil, et par les tibia
du squelette, qui percent la terre, qu’il
n’y en a qu’une petite partie de rompue ; que c’est l’extrémité
répondant aux pieds qui s’est cassée dans l’éboulement du sol, et que
le milieu de l’if répond au milieu du cercueil. Cela fait présumer que
cet arbre fut autrefois planté, à dessein, sur le tombeau dans lequel
dut être mise une personne de considération.
Les mêmes
observateurs apportèrent un agaric blanc, sec et dur, dont la surface
inférieure offrait l’image d’un tissu réticulaire et connait à cet
agaric, l’apparence d’un os blanchi ; c’était sur l’if qu’il avait pris
naissance, et cette circonstance contribuoit à rendre la singularité de
sa contexture plus frappante : il semblait que tout ce qu’on trouvait
dans ce lieu, portât l’empreinte de la mort (71).
LES
CRAPAUDS.
Ce
fut encore auprès de St.-Samson, qu’un des observateurs eut occasion de
voir de quelle manière les crapauds happent les insectes dont
ils
font leur pâture. Il examinait, depuis quelques instans, un de ces
animaux qui s’approchait lentement et avec une sorte de précaution, de
la branche d’une ronce, abaissée vers la terre ; le crapaud faisait un
ou deux pas et s’arrêtait aussi-tôt ; il recommençait ensuite la même
manœuvre, et il la continua jusqu’à ce qu’il eût la tête auprès d’une
des feuilles de la ronce. Il y avait sur la feuille un de ces grands
moucherons qui ressemblent aux cousins et qu’on nomme tipules ; c’était
lui que le crapaud convoitait, et ce fut sur lui qu’il fit brusquement
tomber sa langue, pour l’enlever comme un harpon.
On n’ignore
pas que c’est avec la langue que les crapauds prennent leur nourriture
: cette observation fut faite, en Angleterre, sur un très-gros crapaud
qu’on avait eu la patience et le singulier courage d’apprivoiser. Mais
le mécanisme de la langue n’ayant point été suffisamment développé,
nous ajoutons ici le détail que nous donna l’observateur qui avait été
témoin de l’enlèvement du moucheron.
La langue du crapaud, deux
fois plus longue que sa tête, ne peut être contenue entre les
mâchoires, qu’en se pliant sur elle-même, au milieu de sa longueur : la
pointe est alors renversée sur la base, comme les feuilles d’une
charnière sont couchées l’une sur l’autre, quand elle est fermée.
S’agit-il d’enlever une proie, la gueule du reptile s’ouvre de toute sa
largeur, la langue se redresse brusquement et s’abat comme une trappe ;
l’insecte qu’elle étourdit, en le frappant, se trouve englué dans
l’humeur muqueuse dont elle est enduite, et la langue, en se repliant,
le précipite dans l’æsophage avec une prestesse que l’œil a peine à
suivre (72).
VARECS
ETINCELANS : NOUVELLES
DIFFICULTÉS
: OBSERVATION
CONSTATÉE
: SPECTACLE BRIL-
LANT.
Nous
étions encore occupés des différens rapports que nous faisaient nos
observateurs, lorsque nous vîmes arriver d’Honfleur, celui qui était
allé examiner les varecs. Il rapportait une assez grande quantité de
ces plantes marines, avec quelques poissons qu’il voulait nous faire
connaître. Il nous apprit que les essais qu’il avait faits, pour
découvrir quelques insectes dans l’eau de mer, n’avaient eu aucun
succès. Il nous dit qu’il ne craignait point d’assurer qu’il n’y en
avait plus dans la mer : mais il ajouta que les varecs en étaient
remplis et que les étincelles qu’on y voyait briller, quand on les
agitait, ressemblaient aux aigrettes lumineuses du fluide électrique,
quand il parcourt la limaille de cuivre, ou les parcelles d’avanturine
sur des plateaux de verre.
Le moyen qu’il nous dit avoir mis en
œuvre, pour s’assurer que les plantes étaient chargées d’insectes, au
moment même où il les prenait, est aussi simple qu’il est infaillible.
Il avait fait faire un cône de fer-blanc dont il plaçait la bâse sur le
varec, ensuite il mettait l’œil au sommet du cône, et il lui était
alors très-aisé d’appercevoir la lumière des insectes, dans l’ombre
intérieure de cette espèce de chambre obscure.
Il exposa donc
devant nous les varecs qu’il avait apportés pour nous faire jouir du
même spectacle : mais nous n’eûmes pas la satisfaction qu’il avait
voulu nous procurer, parce que les insectes avaient péri dans le
transport.
Nous nous livrâmes à toutes les conjectures que faisait naître la
singularité des mœurs de ces animalcules.
Comment
se fait-il, disions-nous, que quelques jours seulement après avoir paru
remplir l’immense bassin de l’océan, ils soient tous à-la-fois relégués
dans le varec, et qu’il ne s’en détache pas un seul pour flotter dans
l’eau de mer ? Vont-ils chercher, dans les rameaux du varec un abri
contre l’hiver, comme nous voyons des milliers de mouches se mettre à
couvert de la gelée dans des crevasses et dans des troncs d’arbres ? Y
sont-ils réunis pour la reproduction, comme divers insectes se
ressemblent sur des branches et sur des feuilles pour la même fin (73),
ou sont-ils grouppés dans le varec pour y terminer leur carrière, comme
nous voyons les hannetons du printemps se réunir au bord des mares dans
lesquelles ils périssent ?
Mais encore, par quel changement
d’organisation deviennent-ils capables de gagner les varecs, dans une
saison où tous les insectes commencent à languir,… eux qui, dans une
température plus favorable en apparence, n’ont aucun mouvement
progressif, eux qui ne peuvent se déranger de la perpendiculaire, par
laquelle leur légéreté spécifique les porte lentement à la surface de
l’eau, quand elle est en repos et tranquille ? Faut-il dire que les
varecs, arrachés par les courans, recueillent ces insectes, en flottant
au milieu des vagues ? ou plutôt les insectes qui brillent et qui
étincelent sur les varecs, sont-ils bien les mêmes que ceux qu’on voit
briller dans la mer, ou ne sont-ils point une espèce différente ou une
variété ? car notre observateur avait reconnu la présence des aigrettes
lumineuses, et nous ne pouvions révoquer en doute les faits qu’il avait
constatés, mais il n’avait pu extraire ces insectes du varec ; il ne
les avait pas comparés et il ne pouvait nous dire s’ils étaient les
mêmes que ceux qu’il cherchait (74). Nous fîmes donc des vœux pour que
l’histoire de ces animalcules fut étudiée par des naturalistes capables
de la suivre avec succés : nous regrettâmes de ne pouvoir nous livrer
plus long-temps à cette recherche.
Mais avant de quitter
l’article de ces insectes, dont le seul souvenir a pour nous beaucoup
d’attrait, nous consignerons ici l’opinion dans laquelle nous sommes,
d’après plusieurs expériences, qu’il faut nécessairement le
concours
de l’air atmospherique pour faire briller les insectes, et que malgré
l’agitation de l’eau dans laquelle ils sont, leur lumière ne paraît
point lorsque cette eau les recouvre entièrement.
Enfin nous
ajouterons que si l’on veut jouir du spectacle le plus brillant de ce
genre qu’on puisse se figurer, il faut réunir la plus grande quantité
possible de ces insectes dans une bouteille d’eau, et verser cette eau
dans l’obscurité, soit à terre, soit dans un vase transparent : la
lumière qu’elle donne en coulant, peut être comparée aux éclairs du
métal liquefié que le fondeur verse du creuset dans les chassis (75).
LA
DORÉE : LA VIVE ET SES ÉPINES.
Les
poissons apportés d’Honfleur étaient des dorées (76) et des vives (77).
Les premiers ne sont connus des pêcheurs que sous le nom de lune, et
ce nom qui ne leur convient pas, leur vient peut-être de la tache ronde
qu’ils ont de chaque côté, comme cette même tache leur a fait donner
ailleurs le nom de poisson
de St. Pierre.
La Dorée, dont la
chair est excellente et de très facile digestion, n’est point connue
dans le pays sous ces deux rapports : elle y est au contraire négligée
et l’on n’y vend les plus grosses que quatre à cinq sols la pièce (20
ou 25 centimes). (note XXIII).
Les Vives paraissent plus
estimées, quoi qu’elles ne soient pas meilleures, mais on a coutume de
les rechercher, et cela suffit pour qu’elles se vendent plus cher.
Elles sont armées de fortes épines, dont trois sont particulièrement
redoutées des pêcheurs : les deux plus fortes sont placées aux
extrémités des opercules (78) et la troisième est au milieu de la
nageoire dorsale. On assure que la piqûre de ces épines est cruelle et
que la plaie qu’elles font est accompagnée d’irritation, de chaleur et
d’âcreté. On ajoute que le malade a souvent des accès de fièvre, et que
les accidens ne s’appaisent qu’au bout de quelques jours.
La
police defend d’exposer les vives en vente, avant que les épines ayent
été coupées, parce que la blessure est réputée aussi fâcheuse après la
mort de l’animal, que pendant sa vie. Mais il existe une opposition
très-bizarre entre la précaution sagement commandée par la police, et
la volonté permanente des acheteurs qui mettent moins de prix à la vive
dont les épines sont coupées, et qui payent plus cher celle qui les
porte encore. La poissonnière qui a des vives les serre dans ses
paniers et ne les expose pas ; elle attend qu’on lui en demande, ou
elle les propose elle-même : quand on paraît vouloir en acheter elle
les découvre, et quand on est convenu de prix elle coupe les épines
pour livrer le poisson.
Il est inconcevable qu’on laisse
subsister un pareil danger, pour donner un peu plus de prix au poisson
qui peut causer des accidens graves ! Il ne faudrait que l’accord des
pêcheurs qui couperaient les épines au sortir de l’eau, pour faire
perdre aux acheteurs le desir aussi déplacé qu’inutile de les voir
couper eux-mêmes.
Nous n’avons pu examiner cette arme de la Vive
au microscope, mais on assure que ce n’est qu’en déchirant les chairs
qu’elle cause de la douleur, et qu’il n’est répandu dans la plaie
aucune liqueur venimeuse : cela paraît d’ailleurs assez vraisemblable,
s’il est vrai que la blessure soit aussi douloureuse après la mort de
la Vive, qu’elle l’est auparavant.
LE
NIVELLEMENT : LA RÉDACTION :
LES
VISITES : LES ENCOURAGEMENS :
LA FIN.
Le
temps qu’il nous avait été possible d’employer à notre voyage, était
sur le point d’expirer ; il y avait près de vingt jours que nous étions
en marche et l’époque de l’ouverture des nouveaux cours approchait :
ainsi malgré l’imperfection de toutes nos observations, nous fûmes
obligés de songer à notre retour.
Nous terminâmes nos opérations
par le nivellement du sol où nous étions campés, et nous trouvâmes que
l’emplacement de la tente était à quatre-vingt-quatorze pieds au-dessus
du niveau de la rivière de Risle. La veille de notre départ, nous
reçûmes la visite de plusieurs citoyens qui voulurent honorer nos
travaux de leur présence ; des membres du jury d’instruction publique
et le maire de la commune étaient de ce nombre.
Ces citoyens
exigèrent que nous lussions devant eux les différentes notes que nous
avions recueillies, ils les écoutèrent avec indulgence, ils eurent même
la bonté d’encourager nos premiers essais.
Le maire déclara que
les Elèves de l’Ecole centrale n’avaient donné aucun sujet de plainte,
pendant le séjour qu’ils avaient fait dans la commune.
Si l’un
de nous eût mérité le moindre reproche, il se fût rendu doublement
coupable dans un pays dont tous les habitans nous avaient témoigné de
la bienveillance, et avaient paru prendre un intérêt réel à nos
recherches.
Nous partîmes animés d’un nouveau zèle et pénétrés de reconnaissance.
FIN.
________________________________________
CERTIFICAT
DES MAIRE ET ADJOINT
DE
CONTEVILLE
~
~
Nous,
Maire et Adjoint de la commune de Conteville, arrondissement de Pont
audemer, Département de l’Eure, attestons que plusieurs Elèves du
Pensionnat de l’Ecole centrale de l’Eure se sont présentés devant nous,
le dix-sept fructifor dernier, qu’ils nous ont déclaré s’être rendus
dans cette commune, située dans la vallée de Pont-audemer auprès de
l’embouchure de la Risle et de la Seine, pour faire, dans les environs,
des recherches et des observations d’histoire naturelle ; qu’ils se
sont constamment occupés de cet objet pendant le séjour qu’ils ont fait
dans la commune, d’où ils ne sont sortis que le deuxième des
complémentaires, et que pendant ce temps-là ils se sont conduits avec
honneur et dignité, ce dont nous leur avons accordé le présent
certificat.
A Conteville, au
bureau de la mairie, le troisième des complémentaires an huit de la
République Française.
Signé
GRESSENT, Maire
; GROUARD, Adjoint.
NOTES :
(1) Les Notes indiquées dans le Texte, par des chiffres romains, sont à
la fin du volume. [A la
suite des notes en chiffres arabes]
(2) Navarre
est une propriété de la maison de Bouillon. Ce nom lui vient
de Jeanne de France, comtesse d’Evreux et Reine de Navarre. C’est un
lieu très-agréable : Chaulieu s’y plaisait beaucoup. On croit que c’est
de là qu’il écrivait au marquis de Dangeau, gouverneur de Tourraine,
Avouez, Marquis, que sans peine,
Pour voir cette charmante cour,
Vous quitteriez votre séjour
Et tous les muscats de Tourraine.
(3)
Il fut long-temps incertain si le déjeûner
trouverait place dans le
journal. Plusieurs avaient lu le fameux voyage de deux hommes célèbres,
et ceux-là sur-tout étaient inexorables ! A la fin on pensa qu’une
vingtaine de vers ne tirait point à conséquence : on convint d’ailleurs
qu’on n’en recevrait pas d’autres ; et l’amitié plaidant la cause du
poëte, le
déjêuner devint un des articles du voyage.
(4) La
distance fixée pour chaque jour de marche étant remplie, les élèves
font halte, et les bagages s’arrêtent ; etc. Les élèves dressent leurs
tentes pour passer la nuit, etc. Règlement du Pensionnat.
(5) Si
les objets dont il s’agit sont des monumens anciens, les
historiographes en recherchent l’origine dans les histoires de la
ci-devant province, et s’occupent de constater, s’il est possible, tout
ce qui tient à l’époque et aux motifs de leur construction, aux
différens périodes de leur durée. Régl. du Pensionnat.
(6) Les
ingénieurs mesurent les limites et les formes des anciens monumens :
ils en lèvent le plan et prennent toutes les notes nécessaires pour en
bien constater l’état actuel. Les mécaniciens se joignent à eux pour en
mesurer l’élévation et s’assurer de toutes leurs dimensions autant
qu’il est nécessaire pour en exécuter ensuite le relief en terre cuite,
si l’objet en est jugé digne. Ext. du Réglement.
(7) On voit, sur
le mur méridional de cette église, une inscription qui se termine par
ces mots : « Et fut cette église commencée neuve, l’an de grace 15[1]8,
V.e de Juillet. »
On lit sur une autre inscription, près du grand
autel, le vieux mot cliquer,
employé pour signifier le tintement
lugubre des funérailles.
(8) On s’occupait alors à réparer les ponts
sur lesquels on ne pouvait passer sans danger depuis long-temps. Les
Magistrats n’avaient point voulu faire établir de contributions
particulières pour ce travail : ils avaient sagement préféré d’inviter
leurs concitoyens à faire volontairement une dépense dont tout le monde
sentait le besoin pressant, et les fonds ayant été le fruit d’une
soumission libre, l’ouvrage se faisait très-bien, et l’on n’entendait
point ces murmures désagréables que les contraintes et les rôles forcés
entraînent toujours après eux.
(9) La forme de ce couteau n’est pas
nouvelle, et depuis long-temps il est employé dans la corroyerie, sous
le nom de couteau
à revers : mais il est rarement fait avec le soin
qu’il exige.
(10) Les mémoires observent que c’était la première
fois qu’on entendait le canon en Normandie. Ils sont d’accord sur ce
point avec les historiens contemporains.
(11) Géométrie de Bézout, 2e partie. Résolution des triangles
rectangles, pag. 25, édit. de l’an VI.
(12) Par le cit. Richer.
(13) Par le cit. Lenoir.
(14) Par le cit. Richer.
(15)
La forme de ces insectes phosphorescens, est dessinée planche 3. fig.
I. les dimensions de ce dessin sont celles qu’à présentées le
microscope, sous l’objectif duquel les insectes étaient placés.
(16)
On dirait qui
se précipite, si l’on voulait employer l’expression
consacrée par la chymie. Un peu moins d’exactitude dans l’emploi des
mots, sert quelquefois à faire mieux entendre les idées qu’on veut
transmettre et les faits qu’on veut expliquer. Nous voulons dire
: Qui
se sépare des autres principes dont le bois est formé.
(17) Nous
avons sçu depuis, que ces femelles de lampyres avaient déposé dans la
terre un grand nombre d’œufs, et que ces œufs ont été lumineux pendant
long-temps. On les a collés au fond d’une boëte, et l’on en a formé une
suite de lettres qui ont été très-lisibles dans l’obscurité.
(18)
L’abbaye fut seule rebâtie, puis détruite et dépouillée de tous ses
biens en 1363, par les anglais, puis enrichie par les mêmes anglais,
cinquante-cinq ans après. Neustria
Pia.
(19) Hist. du Hâvre, par Pleuvri.
(20)
Zoophytes qu’on nomme actinies
et qui présentent une forme
assez ressemblante à la fleur des anémones. Leur force de reproduction
est prodigieuse ; il suffit de les couper par morceaux, pour avoir
bientôt autant d’actinies
qu’on a fait de tronçons. L’abbé Diquemare
décrivit ces zoophytes, dans un grand détail, et le gouvernement fit
graver les dessins que le naturaliste avait faits.
(21) Les Méduses
; vulgairement connues sous le nom d’orties de mer errantes
ou libres
: les pêcheurs leur donnent celui de Sagonne. On a
quelquefois appelé les actinies,
orties de mer fixes.
(22) Méduse bleue, medusa
aurita.
(23) Fucus
plumosus.
(24) Fucus
conferroides
(25) Fucus
palmatus.
(26) Fucus
vesiculosus.
(27) Aiguillat Squalus
acanthias Lin. Squalus acanthias sive spinax.
Aldrov.
(28)
Quoique cet arbre nous ait présenté les caractères du saule
blanc, salix
alba, nous lui avons cependant conservé le nom d’osier, qu’on
lui donne dans le pays, parce que l’osier
saule ou osier jaune
prend tous les caractères du saule blanc, quand
il n’est pas
tronçonné. Voyez
Joli-clerc, Phytol.
univ.
(29) Circœa luteciana. Lin. 2. dria. Monogyn.
(30) Drosera rotondi-folia. Lin. 5. dria. 5 gyn.
(31) Les cataractes de Vologda, en Moscovie, de Niagara, dans le
Canada, la cascade de Terni, en Italie, etc.
(32) Daphné laureola. 8. – Dria. 1. – Gyn.
(33) Orobanche ramosa. L. Dydin. angiosperm.
(34) Ils employèrent d’abord la méthode des triangles semblables.
Cette
méthode, extrêmement simple en théorie, n’est point sans difficulté,
dans l’application, à cause de l’exactitude avec laquelle il faut
mesurer les lignes, qui deviennent les termes connus de la proportion,
et à cause des obstacles que présentent souvent les inégalités du
terrain.
(35) Nous pensons que ce nostoc était celui que Linné
désigne sous le nom de tremelle nostoc gélatineux, plissé, ondulé, d’un
verd pâle. Lin.
Cryptog.
(36) Epoques de la pleine et de la nouvelle lune.
(37) Epoques des deux quartiers.
(38)
Nous avons appris que ces faisceaux fûrent suspendus sous un hangard,
pour être desséchés à l’ombre, et qu’on les trouva, quelque temps
après, entièrement remplis de perce-oreilles. Ce serait un moyen fort
simple pour détruire ces insectes qui sont quelquefois très-incommodes
dans les fruitiers.
(39) Arenaria
tenella } L. 10. – Dr.3. –
Gyn. Arenaria
rubra. Apium graveolens.
} 5. – Drin. – 2. – Gyg. Sonchus
maritimus. } Syngen. polyg.
æqualis. Sonchus
arvensis.
(40)
Ils trouverent le chelidomium
glaucum, ou pavot cornu, le crithmum
maritimum, criste marine, ou fenouil marin, ombellifere
qu’on trouve
en abondance dans les fentes au pied de la montagne, le plantago
maritima. (4. – Dria.
1. – Gyn.)
l’aster maritima (Syngen.
polyg.
superflua.)
(41)Turbinites.
(42) Volutites.
(43) Cylindrites.
(44) Buccinites.
(45) Echinites.
(46) Pectinites.
(47) Bucardites.
(48) Pyrites.
(49)
Elle a été dessinée, à très-peu de choses près dans le plan du cercle
horaire de dix heures, l’observateur étant tourné vers le sud.
(50) A Mars
Pacificateur.
(51) Digitalis lutæa. Lyn. Dudin. angiosperm.
(52)
Le papillon appellé par Linné le comma ; et ceux que Geoffroy nomme la
bande noire, le plein chant, la grisette et le satyre.
(53)
Maintenant professeur à Rouen. Les tadornes sont une espèce de canard,
fort jolie. Ces oiseaux ne font point leurs nids sur les eaux
dormantes, ou dans les marécages comme les autres oiseaux de rivière ou
de mer ; ils vont déposer leurs œufs dans des terriers de
lapin. Hist.
nat. de Buffon.
(54) Spectacle de la Nature, tom. 4.
(55) Il ne
faudrait qu’un peu plus de régularité, dans cet entrelacement des
racines, pour qu’on put le comparer aux parquets à cases,
que les
orfèvres et les joailliers placent sous leurs établis, et qu’ils
nomment grillage
ou claie.
(56) La larve de ces insectes se
nourrit du suc des végétaux ; c’est elle qui forme ces petits flocons
d’écume blanche, qu’on voit au printemps sur les herbes, ou sur les
jeunes rameaux des arbustes, et qui ressemblent parfaitement à de la
salive. Nous croyons connaître le moyen que cette larve employe pour
former l’écume sous laquelle on la trouve : cependant nous n’osons pas
encore rendre compte de nos observations ; nous voulons les vérifier le
printemps prochain.
(57) Bédéguar : éponge ou mousse d’églantier ;
les cinips de ces bédéguars sont éclos, à l’école centrale, dans les
premiers jours de floréal.
(58) Nous avons regardé ces Lichens comme ceux
que Linné désigne sous le nom de Lichen rupicola.
Chryptog.
(59) Carduus palestris. Lin.Syng. Poly. æq.
(60) Inula dyssent.Syng. Polyg. superflua.
(61) Bidens tripartita : Bidens cernua. Syng. Polyg. æq.
(62) Ces filets sont décrits et figurés, sous le nom de guideaux, dans
le traité de la pêche, de la collection in-folio
des arts et métiers, et dans l’encycl.
(63) Physeter maximus.
(64) Pleuronectes
platessa.
(65) Le Flet ou Picaud. Pleuronectes
flesus.
(66) Pleuronectes.
(67) La Pommeraye appartenant au citoyen Masson-St.-Amand, Préfet de
l’Eure.
(68) La terre de St.-Pierre.
(69) Ulex Europeus. Vulgairement connu sous le nom de jonc marin. Lin.
Diadelph. dec.
(70)
Il en existe un autre, à trois lieues de là, qui a plus de vingt-quatre
pieds de tour. Les ifs ont dans ce pays la mauvaise réputation qu’ils
ont en beaucoup d’autres endroits. Nous ne pouvons ni les excuser de
malignité, ni les en convaincre : nous avons seulement observé qu’ils
étaient remplis de nids de moineaux et que plusieurs oiseaux, notamment
les fauvettes, les grives, les merles, dévoraient leurs baïes avec
avidité ; ces baïes sont extrêmement douces et sucrées.
(71) Cet
agaric est déposé dans le muséum, avec les autres objets qui ont été
recueillis dans le voyage. Nous n’avons pu le reconnaître dans les
descriptions des botanistes, et quand nous en parlons, nous ne le
nommons point autrement que l’agaric funéraire, ou l’agaric des
tombeaux.
(72) Cette observation n’ayant été faite qu’une fois, nous
nous promîmes de la répéter quand l’occasion s’en présenterait. Mais
aucun de nous ne put dire que, pour le plaisir de constater
l’observation, il voulût apprivoiser un crapaud et se mettre en
familiarité avec un reptile dégoûtant, dont les approches ne sont pas
d’ailleurs regardées comme entièrement exemptes de venin.
(73) Les
punaises rougeâtres des jardins, au mois de germinal, (Pun. demi-ailée
cimex apterus.) les petits hannetons d’été à la fin du jour, dans le
mois de thermidor (Scarabeus solstitialis), etc.
(74) Les beroès
répandent aussi une lumière brillante. Plusieurs espèces de pennatules
sont également phosphorescentes…. Et nous ajoutons à ces deux espèces,
les néréides (tableau élément. de l’hist. nat. des anim. par le cit.
Cuvier.) si l’espèce que nous avons voulu reconnaître n’est pas
elle-même la
néréïde.
Il en est ainsi des lampyres ou vers luisans dont
il y a plusieurs espèces.
(75)
Puisez de l’eau de mer quand elle est lumineuse ; laisse-la reposer
dans des vases à goulot étroit, les insectes seront bientôt portés à la
surface, d’où vous pourrez les enlever aisément pour les mettre dans un
réservoir.
(76) Gallus marinus. Zeus faber.
(77) Draco marinus. Trachinus draco.
(78) Pièces écailleuses qui recouvrent les ouïes.
(I) LE
BEC fut fondé vers l’an 1040, dans une vallée profonde, au milieu des
bois. Cette abbaye éprouva de grands malheurs et souffrit beaucoup, des
guerres civiles. Cependant le bec était devenu une place assez
forte, malgré sa position désavantageuse, lorsqu’en 1421 les Anglais
démolirent les fortifications, dont on voit encore les ruines. Deux
cents ans auparavant, l’abbaye avait été totalement brûlée, la grosse
tour s’était écroulée à la suite de l’incendie, et ce dernier
évènement, malgré son peu d’importance, devint la matière d’un poëme,
dont voici les quatre premiers vers :
« L’an de
grace, mil deux cents
»
Soixante-treize, virent gens
» La
maître tour du Bec descendre
»
Lendemain du jour de la cendre. »
Neustria pia. artic. Beccum.
(II)
Nous avons appris sur les lieux, que l’archevêque de Rouen (de
Tavannes) qui supprima ce couvent d’Annonciades, frappé de la béauté de
l’église, engagea les habitans de Montfort à la conserver pour en faire
leur église paroissiale. Il offrit même d’affecter des fonds à
l’entretien de ce monument : mais il y eut des habitans qui craignirent
que cela ne devint par la suite une source de dépenses ruineuses : la
proposition de l’archevêque ne fut point admise, et l’église fut
démolie. Le citoyen Hébert, membre du Conseil du département,
nous a fait voir une table d’un assez beau granit, qui provient des
matériaux de cet édifice.
(III) Les
cris de guerre que les passions adoptent, ne présentent presque jamais
d’idées claires et precises, et l’histoire ne conserve ordinairement
que les mots, sans pouvoir en donner ni la signification positive, ni
la juste étymologie. Telle est la dénomination de Huguenot,
dont les historiens et les critiques n’ont encore pu déterminer
l’origine ; de sorte qu’on ne peut assurer si ce mot vient de deux
autres mots Huc
nos, par où commençait une harangue latine, ainsi que
plusieurs ont essayé de le faire croire, ou de la prononciation
défectueuse des mots Suisses eid-gnossen, qui
signifient liés par
serment, comme le disent Ménage, Voltaire et l’Encyc., ou enfin de
l’expression bizarre, mais proverbiale de Roi Hugon, que la
portion
ignorante du peuple employait alors en Tourraine, pour signifier
un phantôme et
une vision nocturne. Pasquier, auteur contemporain, est
de ce dernier avis dans ses recherches. Il fait entendre que cette
dénomination fut donnée aux réformés, parce qu’ils ne se réunissaient
que la nuit. C’est ainsi que deux siècles après, la dénomination
de Chouan,
qui vient à peu près du même pays, n’est empruntée que de
la prononciation populaire du mot Chat huant, parce
que les
rassemblemens armés ne se sont faits, dans les commencemens, que
pendant la nuit. « Le plus grand malheur qui puisse advenir »,
dit le sage Pasquier : « C’est lorsque soit par fortune, soit par
discours, l’on voit un peuple se bigarrer en mots de partialité !....
Ce sont histoires, ajoute-t-il, qui méritent d’être cornées aux
aureilles d’une longue postérité ! »
(IV) On lit dans la description des vertus du Catholicon, le
passage suivant : «
Ayez le front ulcéré et le visage honni comme les infidèles gardiens du
Pont-Audemer et de Vienne, frottez-vous un peu les yeux de ce divin
électuaire, et il vous sera advis que vous serez prud-homme et riche ».
Voici les détails qui se trouvent dans les mémoires de Pont-Audemer, et
qui donnent l’explication de ce passage. Au
mois de juillet 1590, Hacqueville de Vieux-Pont, frère du gouverneur du
Neubourg, fut nommé gouverneur de Pont-Audemer. La ligue n’étant pas
alors très-puissante, Hacqueville fit les protestations les plus
solennelles de dévouement au service du Roi. Depuis cette époque la
ligue prit des forces, le Roi fut même obligé de lever le siège de
Rouen, et Hacqueville, croyant que la ligue l’emporterait, pratiqua des
intelligences avec le duc de Mayenne, et livra Pont-Audemer à Villars,
qui s’en empara au mois de juillet 1592. Cependant la ligue
ayant été vaincue par Henri IV, ce Roi des Français fit proclamer une
amnistie. Hacqueville sçut en profiter : il se replia même si bien,
qu’il gagna la confiance de l’amiral Biron, et resta gouverneur de la
place. Ces particularités expliquent parfaitement le passage de
la satyre, qui ne nomme pas Hacqueville, mais qui le dépeint assez pour
qu’il fût reconnu dans ce temps-là. Elles suffisent aussi pour détruire
une tradition érronée du pays, d’après laquelle on croit, mal-à-propos,
que la ville fut livrée par un Montgeron. C’est
une erreur qui peut
venir de ce qu’on a mal entendu un passage de la même satyre, (Disc. de
l’arch. de Lyon) dans lequel Hacqueville est accolé à Montgeron pour
des faits semblables ; mais ce Montgeron était gouverneur de Vienne. Il
y a dans le secrétariat de la Mairie onze clefs passées dans un anneau
de fer et clouées sur une poutre. On croit communément que ces clefs
servirent à ouvrir les portes par ou Villars entra : cependant on n’en
trouve pas la preuve dans les mémoires. Ce qu’on y lit à ce sujet,
présente plutôt l’image de ces dénonciations vagues, qui se
reproduisent fréquemment dans des temps de troubles, qu’on reçoit alors
précipitamment, mais qui ne méritent point qu’on s’y arrête. D’ailleurs
ces clefs sont trop courtes de tige, pour avoir pu servir aux énormes
serrures qu’on plaçait autrefois aux portes des villes. Enfin était-il
besoin de faire onze clefs pour livrer une ville ? N’est pas toujours
par une seule issue bien désignée, que les traîtres introduisent
l’ennemi ?
(V) Il faudrait peut-être
compulser beaucoup de volumes pour retrouver l’origine ou les traces
d’un droit
que s’arrogeaient les officiers du Roi, quand il était en
voyage. Les mémoires de Pont-Audemer en font mention, et c’est
dans le compte des dépenses occasionnées par le passage du Roi, que
ce droit
est énoncé. « Item « disent les échevins comptables » un
ducat d’or aux maîtres de l’artillerie, pour le droit qu’ils dirent
avoir de prendre sur chaque cent pesant de métal de cloches qui avaient
sonné à l’entrée du Roi. » Les comptes rendus et les mémoires de
dépenses, sont presque toujours des articles intéressans pour
l’histoire ; ils répandent ordinairement une lumière certaine et fidèle
sur des usages entièrement oubliés, sur l’état de richesse ou de
pénurie du siècle où l’on fit ces dépenses ; ils caractérisent
le goût
d’après lequel elles furent ordonnées, quelquefois même les
opinions politiques qui en furent l’occasion ; ils montrent le luxe qui
les étendit, ou ils marquent la sagesse qui sut les régler ; ils font
briller les sentimens expansifs et généreux qui les commandèrent ; ils
décèlent aussi la corruption qui les rendit quelquefois indispensables,
etc. Nous ne citerons pas tous les articles qui pourraient présenter de
l’intérêt sous ces différens rapports, nous nous bornerons aux deux
suivans. « Item, est-il dit en 1515, onze sols au cuisinier des carmes,
pour avoir soin de nettoyer et curer la fontaine publique. » « Item,
est-il dit ailleurs, deux cents francs au secrétaire de l’intendant,
pour bons offices. »
(VI)
« Le comte de Dunois et plusieurs autres chevaliers et écuyers,
jusqu’au nombre de 2500, et le comte d’Eu, de St.-Pol, les sires de
Savennes, de Roys, de Moy, et plusieurs autres, jusqu’au nombre de
trois cents lances et quatorze à quinze cents archiers chevauchaient
d’un côté et d’autre, et se trouvèrent tous devant la ville du
Pont-Audemer, et premièrement du côté du comte de St. Pol, fut assailli
si vigoureusement tellement et longuement qu’il emporta d’assaut ladite
ville, jaçoit ce que les Anglais qui étaient dedans firent bien et
grandement leur devoir de la garder et défendre, et du côté du seigneur
de Dunois y eut aussi de moult et belles armes faites…. moyennant aussi
et par le feu de fusées qui furent jettées par dedans les fossés où ils
étaient en l’eaue jusqu’au col, qui était une belle proësse. Monstrelet liv. 3. Chronique de
Normandie, an 1449.
(VII)
La correspondance invariable du mouvement de la mer avec les révolutions
lunaires, la hauteur même des marées sous les différentes
latitudes, sont maintenant une de ces parties de l’enseignement public
qu’on n’est pas excusable d’ignorer quand on a reçu de l’instruction…..
A quelle distance des sciences exactes, des connaissances naturelles et
de l’art d’observer faut il donc croire qu’étaient les hommes instruits
il y a deux mille ans, lorsque nous voyons le plus grand capitaine de
son siècle mettre en danger sa flotte et son armée, parce qu’il ne
connaissait pas les marées de la pleine lune….. Quand nous voyons
CÆSAR, aussi grand homme de lettres que grand général, avouer que les
Romains n’avaient jamais entendu parler de cette particularité de
l’Océan. « Eadem nocte accidit ut esset luna plena quæ
maritimos æstus maximos in oceano efficere consuevit nostrisque id
erat incognitum. » Cæs. Comm. lib. IV. Il est vrai
qu’alors,
les connaissances d’un siècle étaient presque toujours perdues pour les
siècles suivans. Les livres des savans ne pouvaient se multiplier :
nous ne voyons même pas que ces bibliothèques éparses, formées par
quelques rois amis des lettres, aient été d’un grand secours pour les
sciences. Les hommes de génie, enflammés du desir de savoir ;
étaient isolés les uns des autres ; ils avaient toujours à vaincre les
premières difficultés ; ils se consumaient en efforts, et laissaient en
mourant la carrière aussi embarassée pour les autres, qu’elle l’avait
été pour eux. C’est à l’époque de l’établissement du
christianisme, qu’il faut rapporter celle de la transmission des
livres, parce que les livres même tenaient à l’opinion religieuse, et
que les réunions chrétiennes formées sous l’empire de cette opinion,
conservaient et multipliaient les livres par principes. Le même
esprit anima dans la suite ces corporations permanentes, composées
d’écrivains et de copistes, dont le travail pénible, mais opiniâtre,
conserva du moins les livres ou les multiplia, jusqu’à ce que
l’imprimerie vint répandre les livres et les lumières par torrens ;
unissant dans un seul faisceau les connaissances de tous les siècles,
et ne faisant du monde entier qu’une seule école, où les hommes de tous
les pays et de toutes les langues se rallieront peut-être un jour, aux
mêmes principes et aux mêmes opinions !….
(VIII)
Les titres anciens de cette abbaye, et sa légende en parchemin, sur le
premier feuillet de laquelle était peinte l’histoire de la fondation,
se voyaient avant la révolution dans le chartrier. Il y était dit que
Herluin, comte de Conteville, couvert de lèpre, et ne trouvant point de
soulagement à cette maladie, fut averti dans un songe qu’il ne
guérirait qu’en dotant des moines et en leur construisant un couvent à
Grestain. Depuis ce temps les sources qui coulent abondamment
dans le vallon, et dont l’eau est d’une excellente qualité, ont été
regardées dans le pays, comme très-utiles dans les maladies de peau les
plus hideuses. Mais il existe une lecture qu’un évêque de
Lisieux écrivit au Pape, dans le douzième siècle, pour lui rendre
compte de l’abbaye de Grestain, située dans le diocèse de cet évêque.
Entre autres plaintes très-nombreuses contre les moines, cette lettre
articule un fait grave, qu’elle dénonce au pape : il y est dit que les
moines prétendaient guérir la fièvre en plongeant les malades sept fois
dans une fontaine de leur couvent, à laquelle ils attribuaient une
grande vertu. L’évêque ajoutait qu’il était urgent de remédier à de
pareils abus, et citait, pour exemple, une femme qu’on avait tant de
fois plongée dans la fontaine, qu’elle y avait enfin perdu la
vie. Neustria
pia. cap. Grest.
(IX)
« Le 17 janvier 1450, le roi partit de Jumièges et alla coucher à une
abbaye nommée Grestain, à deux lieues dudit Honnefleu, et tous ceux qui
étaient audit siège firent grans approches, fossés et mines, et
assortirent bombardes, canons et engins volans, qui moult ébahirent
ceux de ladite place….. Et furent tellement ébahis les Anglais, que
paour et nécessité les contraignît d’eux rendre, pourquoi fût faite
composition de rendre ladite place, le dix-huitième jour de février
ensuivant, au cas qu’ils ne seraient combattus….. Et pour combattre
audit jour firent les Français grandes diligences de ordonner et clorre
le champ où ils étaient….. Mais les-dits Anglais n’y vinrent point et
ne comparurent aucunement. » Chronique de Normandie.
C’était
l’usage, dans ce temps-là, que les assiégés, sommés de se rendre,
demandassent, au préalable, à combattre les assiégeans en champ clos,
soit en troupe, soit en duel. Cela tenait à l’opinion du siècle et à
l’orgueil des camps. On pouvait convenir de la supériorité de
l’ennemi sous le rapport du nombre de ses soldats, de la force de ses
machines, ou de la faiblesse de la place attaquée : mais on ne pouvait
pas convenir de cette supériorité en valeur et en courage, et c’était
une chose indispensable pour l’honneur, de demander à se mesurer corps
à corps : cela se faisait presque toujours, et nous en trouvons une
autre preuve au siège d’Harcourt. « Les Anglais douptant fort
les canons, composèrent à rendre le château, au cas qu’ils ne seroient
les plus forts en champ un jour dit, qui fut le vendredi, et de ce
baillèrent hôtages, auquel jour ils ne se trouvèrent point, et pour ce
rendirent ledit château. » Monstrelet
(X)
» Le vomissement est l’effet du mouvement convulsif de l’estomac, et
ces convulsions peuvent être produites par différentes causes ; celles
qui sont la suite d’un état maladif, ne peuvent être appaisées que par
la guérison des affections qui en sont la source ; mais celles que des
mouvemens insolites occasionnent se guérissent d’elles-mêmes, après
avoir fait beaucoup souffrir les personnes qui en sont
attaquées. Il y a des physiologistes qui placent dans l’œil,
et même dans la
retine, la première source du mal : les mouvemens apparens des objets
extérieurs donnent un commencement de vertige, et les affections se
communiquent de proche en proche jusqu’à l’estomac qui entre en
convulsion. M. Ruelle a trouvé que l’éther, ou la liqueur
éthérée de Frobenius était un remède souverain contre ces accidens.
Cette liqueur appaise les vomissemens et facilite la digestion, etc….
Pour prévenir cette incommodité, l’on n’aura donc qu’à prendre dix ou
douze gouttes d’éther sur du sucre que l’on avalera, en se bouchant le
nez, de peur qu’il ne s’exhale ; ou bien on commencera par mêler
l’éther avec environ dix ou douze partie d’eau, on agitera ce mélange,
afin qu’il s’incorpore au moyen d’un peu de sucre en poudre, qui est
propre à retenir l’éther et à le rendre plus miscible avec l’eau, et
l’on boira une petite cuillerée de ce mêlange, ce qui empêchera le
vomissement ou le soulèvement de l’estomac que cause le mouvement de la
mer. » Encyclopédie.
Art. vomiss. de mer.
(XI)
« Icelle ville de Harfleur était moult forte de murs et tours moult
épesses, fermée de toutes parts, ayant grands et parfonds fossés….. fut
mise en la main du roi d’Angleterre, le jour St. Maurice 1414, à la
grande et piteuse déplaisance de tous les habitans et aussi des
Français, car c’était
le souverain port de toute la duché de
Normandie. » Le roi Charles VII, se partit de sa cité de
Rouen
septembre 1449, armé d’une brigandine, et par-dessus d’une jaquette de
drap d’or, accompagné du roi de Cécile et des autres de son sang en
grans habillemens et richesses, et par espécial le comte de St. Pol qui
avait un chamfrein à son cheval, prisé trente mille écus,
et
chevaucha le roi mettre le siege à Harfleur….. et fut en personne èz
fossés et èz mines sa salade sur la tête et son pavois en sa main….. Et
fut le premier janvier 1460, après la reddition des clefs de Harfleur,
ôtée la bannière des Anglais, qui était sur une des tours du Havre là
Champblanc, et une croix rouge parmy ; et après, par deux héraults, fut
mise la bannière du roi de France, en laquelle mettant il y avait
grande crierie et réjouissement de peuple. » Monstrelet. Le
mot Havre,
ne signifie dans ce passage, que le port d’Harfleur. C’est
un mot générique comme le mot Anglais harbour, qui
signifie comme lui port
de mer, et qui a la même origine. Il n’est pas le seul
qui rappele l’ancien mélange des deux langues. On formerait un petit
volume, si on voulait recueillir tous les mots semblables, tous les
dérivés, toutes les étymologies, toutes les racines que la comparaison
des deux langues ou des idiômes locaux donnerait lieu d’observer. La
ressemblance est si fréquente et si marquée, qu’on est tenté de donner
une origine anglaise à beaucoup de noms qui se rapprochent de cette
langue. Tels sont ceux qui se terminent en fleur, et qui sont
en
très-grand nombre dans le voisinage de la mer. Prenons pour
exemple, Harfleur
et Honfleur.
On écrivait autrefois Harfleu,
Honnefleu. Hard, en anglais, signifie fort, grand, puissant
; flew,
signifie courant,
rivière, flux, flot, et leur composé Harfleu
signifiait que les marées s’élevaient fort haut en cet endroit de la
rivière, que le mouillage était avantageux à Harfleu, qu’on
pouvait
entrer dans ce port et en sortir à volonté. Honnefleu, composé
de flew, flux,
flot, etc., et de One un, seul,
donnait à entendre
qu’on ne pouvait entrer à Honnefleu
qu’en certain temps, et que
toutes les marées ne présentaient pas la même facilité pour le
mouillage.
(XII) Le nouveau bassin
n’est point encore achevé, les murs seuls et le parapet sont finis. Ils
sont construits avec deux espèces de pierres, l’une coquillière et
l’autre granit micacé : on tire cette dernière des isles de Chosay.
Parmi
les particularités remarquables de la ville, on peut compter, 1.° les
balustrades gothiques des frontons des deux croisillons de l’église
Notre-Dame, dans lesquelles, au lieu de balustres, l’architecte a
découpé les premiers mots du Pater et de l’Ave qu’on voit
encore. 2.°
Le portail de cette église, qui menaça ruine pendant quelque temps, et
dont la chûte paraissait inévitable, parce qu’il était sensiblement
sorti de son à-plomb. On assure qu’un simple maçon se chargea de le
redresser, et qu’il réussit en creusant la terre au pied, du côté
opposé à la pente, et en rappelant la masse dans la perpendiculaire,
par le seul effet de sa pesanteur. (Histoire du Havre, par Pleuvri.)
3.°
Une épitaphe, dans la même église, dite l’épitaphe des trois Raullins.
Il est constant que ces trois frères furent massacrés en plein jour
dans l’hôtel de ville, sous les yeux et par les ordres du commandant,
jaloux de leur mérite. L’épitaphe dit modestement, qu’ils décédèrent
tous les trois à la même heure, au Havre, le 16 mars 1559.
Le
Havre souffrit beaucoup pendant les dernières guerres civiles. Il tomba
même au pouvoir d’Elisabeth, par suite de la convention que le parti
des réformés fit avec cette reine, en 1562. Hist. du Havre.
Certes
nous n’examinerons point dans quels cas les persécutions et
l’oppression peuvent rendre légitime une résistance armée…… mais elles
ne peuvent jamais rendre excusable l’appel aux étrangers, ni l’entrée
qu’on leur donnerait dans la moindre portion du territoire de la patrie
!
(XIII) Scuderi fit un poëme
intitulé Alaric,
et le dédia à Christine, reine de Suede, qui promit
au poëte une chaîne d’or de mille livres ; mais dans l’intervalle de la
dédicace à l’impression, la reine disgracia le comte de Gardies dont
l’éloge était dans le poëme, et l’on conçoit bien que la reine voulut
faire supprimer l’éloge. Le poëte répondit qu’il faisait le plus
grand cas des dons de la reine, mais qu’il ne renversait pas les autels
sur lesquels il avait brûlé de l’encens ! (Encyclop.) En ne
citant que quelques noms célébres nous sommes loin d’insinuer que le
Hâvre n’ait pas donné naissance à beaucoup d’autres personnes de
mérite. Il en est qui ne sont pas très-connues et à qui les arts ont
des obligations réelles ; par exemple le Hantier qui a donné des règles
et une méthode particulière pour mettre les objets en perspective. Il a
non-seulement écrit sur cette matière, mais il a mis ses principes en
pratique avec succès, et il a peint en différens endroits des racourcis du plus
grand effet. Le Hantier n’eut point une grande célébrité, point de
fortune, point de protecteur zélé, il n’eût que des talens et des
ennemis.
(XIV)
Deux fœtus d’aiguillat, que nous conservons à l’Ecole centrale, nous
ont fourni la solution d’une difficulté qu’on élevait contre la
conjecture que nous avons hasardée.
Si l’aiguillat, disait-on,
sortait de la mère avec l’œuf pendant à l’æsophage, il serait entraîné
par le poids et ne pourrait se mouvoir. D’ailleurs ce squale, comme
tous ceux du même genre, ne saisit sa proie qu’en se tournant sur le
dos ; or, le poids de l’œuf, sa forme, son volume, seraient pour le
jeune aiguillat un obstacle invincible à cette manœuvre. Voici ce que
le hasard nous a fait reconnaître. 1.°
L’œuf est spécifiquement plus léger que l’eau de la mer. 2.° Le poisson
est plus pésant que la même eau, d’où il suit que dans l’immersion du
jeune aiguillat et de son œuf, celui-ci s’élève et flotte au-dessus du
poisson, comme les ballons précèdent les aréonautes dans l’atmosphére.
Ainsi la position renversée devient très-facile à prendre, elle est
même la plus naturelle de toutes pour l’aiguillat. Peu s’en faut
que nous ne comparions cet œuf et son cordon aux lisières protectrices
qui servent à l’enfance de préservatif et de support ; …….. mais
combien d’apparences l’observation n’a-t-elle pas souvent démenties ?
(XV)
Le citoyen Scanégatti, de l’académie de Rouen, fut chargé en 1788, par
le bureau intermédiaire de l’Assemb. provin. de haute Normandie, de
faire des recherches sur les tourbières et les mines de charbon de
terre : voici l’extrait de son rapport, inséré dans celui du bureau,
page 184. « A Joble, il existe à un quart de lieue de la Seine
un banc de quinze pieds d’épaisseur apparente, d’une tourbe concrete,
laquelle brûle comme l’amadoue, sans s’éteindre, jusqu’à sa totale
réduction en cendres ; sa flamme, d’un jaune bleuâtre, est très-ardente
; son odeur est sulphureuse et non pas nidoreuse, comme celle des
marais, sur laquelle sa compacité lui donne encore l’avantage de
résister à l’action du soufflet du maréchal. Une excavation de douze
pieds a augmenté d’autant l’épaisseur apparente de ce banc, en
fournissant encore une matière plus compacte. On ignore sa profondeur
totale, ainsi que sa longueur, qui se prolonge dans la colline,
composée supérieurement d’environ 130 pieds de crayon et de deux pieds
de terre plus ou moins végétale à sa surface. La facilité de
l’exploitation et la proximité de la rivière, rendent cette
découverte précieuse. » Si, dans des essais qu’on a faits à
Paris, il y a quelques années, on a pu convertir de la tourbe en un
charbon, avec lequel on soudait à la forge des douilles de bayonnettes,
on pourrait certainement tirer le même parti de cette tourbière.
(XVI)
Le nom de cornes
d’ammon, sous lequel ces fossiles ont été
vulgairement connus vient, 1.° de ce qu’ils ont un peu de ressemblance
avec certaines cornes de bélier ; 2.° de ce qu’ils étaient autrefois
consacrés à Jupiter Ammon, comme propres à révéler aux hommes
l’interprétation des songes. Quoiqu’ils n’ayent plus aujourd’hui
le même crédit et que les naturalistes les ayent avec raison classés
parmi les nautiles, ils ont conservé leur nom primitif et
sont
toujours appelés cornes
d’ammon. Si nous leur donnons ici celui de
plan-orbes c’est uniquement pour désigner leur forme par un seul mot.
Au surplus ce nom qui pourrait devenir générique leur convient au moins
autant qu’à certains mollusques
de nos rivières, pour lesquels il
parait avoir été composé.
(XVII)
Valmont de Bomare, dans son dictionnaire d’histoire naturelle, parle
ainsi de cette espèce de phénomène, au mot cercle ou anneau
magique :
« C’est un phénomène que l’on voit assez souvent à la campagne, qui est
une espèce de rond que le peuple supposait autrefois avoir été tracé
par les fées, dans leurs danses. On voit un gazon pelé en rond, à la
largeur d’un pied, tandis que le milieu de sept à huit toises au moins
de diamètre est vert. Quelques-uns attribuent ce phénomène au
tonnerre, d’autres prétendent que ces cercles sont formés par les
fourmis : quelle qu’en soit la cause, elle est naturelle et non
magique. » Cette description n’est pas suffisante, et nous
croyons pouvoir ajouter, pour l’explication de ce phénomène, des
particularités dont nous nous sommes rendus certains.1.° Il y a
beaucoup plus de bandes interrompues et d’arcs, proprement dits, qu’il
n’y a de cercles entiers. 2.° Il y a des bandes et des cercles
de toutes les dimensions, depuis deux pieds de rayon jusqu’au de-là de
quarante pieds de diamètre. 3.° La seule uniformité qu’on remarque dans
ces bandes, est leur largeur, qui presque par-tout est la même. 4.° Le
gazon des bandes n’est pas toujours sec et pelé, il est au contraire
d’un très-beau vert dans quelques circonstances. 5.°
Il y a beaucoup de ces bandes qui se coupent sous différens angles,
avec plus ou moins d’excentricité, et l’on n’en trouve nulle part de
concentriques. 6.° Enfin, il n’y a pas un cercle, pas une seule bande
où l’on ne trouve des champignons, ou des débris de champignons.
D’après
ces observations, il parait évident que ce phénomène ne doit absolument
son origine, qu’à quelques espèces de champignons qui croissent dans
l’étendue des bandes. Il est vrai qu’en attribuant à l’influence des
champignons l’état du gazon dans lequel ils se trouvent, il faut que
les champignons affectent de pousser en rond, et
peut-être cela
paraîtra-t-il aussi difficile à expliquer que l’anneau de gazon lui
même ; mais toute la difficulté se réduit à savoir si les champignons
sont toujours semés en
rond, et cela ne paraîtra peut-être pas
invraisemblable, si l’on considère, 1.° que tous les champignons
répandent autour d’eux quand ils sont mûrs, une poussière abondante
plus ou moins noirâtre ; 2.° que cette poussière est universellement
regardée par les naturalistes comme la graine du champignon ; 3.° enfin
que cette poussière examinée au microscope, présente réellement toutes
les apparences d’une graine. On peut donc considérer chaque champignon
comme le chef d’une nombreuse famille, et le centre de la
génération future. Les
feuillets, qui sont en dessous du chapeau, contiennent la poussière
noire qui doit produire les champignons de l’année suivante ; le
chapeau qui les a recouverts pendant l’accroissement de la plante,
change de forme à l’époque de sa maturité ; de convexe qu’il avait été
jusqu’alors, il devient concave, et les feuillets relevés en dehors, se
trouvent le plus convenablement disposés pour lancer au loin la graine
qu’ils renferment. C’est alors que par la contraction subite des
fibres, cette graine est projettée plus ou moins loin selon la force du
champignon. Nous voyons la même chose arriver dans la dispersion des
graines du génêt, de la balsamine, de la fraxinelle, (dictamnus) du
concombre sauvage (momordica
elaterium), et mieux encore dans
l’explosion de cette espèce de champignon spherique, connu sous le nom
de vesse de loup : on sait en effet que son enveloppe se déchire à
l’époque de sa maturité, pour donner issue à la graine que ce
champignon lance, sous la forme d’une poussière noirâtre. Si
l’on admet une fois cette supposition, que tout concourt à rendre
probable, il ne sera plus mal aisé d’expliquer la forme circulaire que
présentent les semis de champignon. 1.° La graine sera semée
en rond, parce qu’elle sera lancée, avec une égale force, de
tous les points du chapeau.
2.°
Il n’y aura jamais de bandes concentriques, elles seront au contraire
toutes excentriques, parce qu’il n’y a qu’un champignon générateur,
pour chaque bande dont il est le centre ; et les bandes se couperont
lorsque deux champignons seront assez voisins l’un de l’autre, pour que
les rayons de leur force expansive se croisent et que la projection de
la graine forme des cercles ou des arcs excentriques. 3.° Les
cercles seront parfaits lorsque le chapeau
n’aura été blessé dans
aucun point de sa circonférence ; et il n’y aura que des portions de
cercle ou des arcs, lorsque le chapeau endommagé par la pluie, entamé
par le vent, brûlé par le soleil, vicié par la carie, rongé par des
limaçons ou paralisé par les piqûres des insectes, n’aura conservé sa
vertu productive que dans une partie de ses feuillets. La
citation que nous avons faite de l’explosion de la vesse de loup,
(lycoperdon bovista)
nous donne occasion d’ajouter que dans le même
bois où l’un de nous prit les femelles de làmpyris, ou vers
luisans,
il y avait plusieurs vesses de loup de quatorze à quinze pouces de
diamètre ; nous avons déposé une de ces productions monstrueuses au
muséum de l’école.
(XVIII) La coupe
perpendiculaire de la pointe de la Roque, l’isolement de ses pics et
l’étendue de son horizon, contribuent ensemble à faire regarder sa
hauteur comme beaucoup plus grande qu’elle ne l’est en effet. Tous ceux
à qui nous avons dit qu’elle ne s’élève qu’à cent cinquante pieds, en
ont été surpris ; peut-être même eussent-ils douté de nos opérations si
la vérification qu’on en avait faite, avec un plomb, n’eût pas levé
toute incertitude. Cette vérification nous a donné la preuve,
qu’on ne peut apporter trop d’attention aux mesures qu’on prend sur le
terrain ; qu’il faut continuellement vérifier le travail, et qu’on ne
peut se donner trop de soins pour constater toutes les opérations. Il
y avait autrefois, sur la pointe de la Roque un hermitage, dont on n’a
conservé que le souvenir sous le nom de grotte de St.-Berenger
; les
cartes de Cassini en marquent encore l’emplacement, et le Neustria
pia attribue l’origine au dégoût de Geremer
abbé de Pantalle,
que
les moines voulurent faire périr une nuit, lorsqu’il revenait de prier
à l’Eglise. Neust.
pia cap. pantallium, sæc, septimo.
(XIX)
Cette commune et trois autres communes voisines, enclavées dans
l’ancien territoire des diocèses de Lisieux et de Rouen, dépendaient
autrefois, par
exemption, d’un diocèse de l’ancienne Bretagne, et la
tradition, les historiens, les chroniques locales sont d’accord sur la
demeure temporaire que quelques évêques de Dol ont faite à St.
Samson-sur-Risle : 1.° Lobineau dans son histoire de Bretagne, tome
I.er, page 75, dit que « Childebert donna plusieurs propriétés situées
dans les environs de Pont Audemer, à St. Samson, de Dol, qui bâtit en
cet endroit un monastère. » 2.° Une épitaphe qu’on lisait avant
la révolution, dans l’abbaye de Préaux, à deux lieux de là, attestait
qu’un évêque de Dol, nommé Baudry, (Baldéricus) était enterré dans
l’église de cette abbaye. 3.° Au commencement du dernier siècle,
on trouva dans l’église de St.-Samson, dont on pava le sol, une crosse
au fond d’un cercueil qui était près de la grande porte. 4.° On
voyait encore, il y a dix ans, dans cette église, un cénotaphe
grossièrement construit, sur lequel était une figure d’évêque en habits
pontificaux, avec un pallium, signe d’un privilège que les
évêques de
Dol ont pendant long temps prétendu conserver. 5.° Une
inscription qu’on lit sur un pilier de l’église, vis-à-vis de la porte
latérale, prouve que les prebendés
de St. Samson furent, il y a cent
ans, condamnés par arrêt de la cour à faire l’office canonial.
L’histoire
nous apprend que vers le milieu du 6.e siècle, St. Samson, originaire
de la Grande Bretagne, vint en Armorique, et que s’étant efforcé
d’appaiser des troubles et des dissentions entre les princes
d’Armorique, il y parvint en employant la recommendation de Childebert,
qui le prit lui-même en grande affection. D’après cela il n’est
point invraisemblable que Childebert ait donné des terres à St. Samson,
qui n’était qu’évêque régionnaire : cela suffit pour expliquer ce qu’il
y a d’étonnant dans l’exemption
des quatre communes, et pour
justifier les manuscrits de diverses bibliothèques conventuelles, qui
s’accordent à raconter le fait de la même manière.
(XX)
Les majuscules représentent les lettres conservées, les petites
capitales sont employées pour remplacer ce que le temps a détruit, et
les italiques pour développer les lettres doubles et les
abréviations.
![[Epithaphe] - Voyage des élèves de l'Ecole Centrale de l'Eure - An 8 [Epithaphe] - Voyage des élèves de l'Ecole Centrale de l'Eure - An 8](../images/frever09_t.jpg) HIC
REQUIESCUNT CORPORA SACERDOTIS BENEDICTI QUi OBIIT. septimo kalendas.
MAI (25 avril) ET RODULFI. tertio
kalendas Augusti. (30 juillet) Qui IN HOC LOCO SERViERunt DomiNuS IN DiE JUDiCII
RESUSITAT ILLIS ANIMaS et
CORPORIS et DUCIS IN REGNUM
QUod Est Pro MIssum (ou QUEm Pro MIttis) SPE FIDE II
Beati (ou Beatum) PARADIsum PoSSIDEANT INterR ANGelis
ARCHANGelis
Det EIS DomiNuS CORONIS auREIS et INTER
SANCTOS (ou
SANCTIS) ESCE ACILLIS SINE FINE CUM CHRISTO IN GLORIA
PERmaneRE.
AMEN. HIC
REQUIESCUNT CORPORA SACERDOTIS BENEDICTI QUi OBIIT. septimo kalendas.
MAI (25 avril) ET RODULFI. tertio
kalendas Augusti. (30 juillet) Qui IN HOC LOCO SERViERunt DomiNuS IN DiE JUDiCII
RESUSITAT ILLIS ANIMaS et
CORPORIS et DUCIS IN REGNUM
QUod Est Pro MIssum (ou QUEm Pro MIttis) SPE FIDE II
Beati (ou Beatum) PARADIsum PoSSIDEANT INterR ANGelis
ARCHANGelis
Det EIS DomiNuS CORONIS auREIS et INTER
SANCTOS (ou
SANCTIS) ESCE ACILLIS SINE FINE CUM CHRISTO IN GLORIA
PERmaneRE.
AMEN.
Le style de cette pièce rappèle un passage de
Grégoire de Tours, dans lequel il s’appliquait à lui-même ce qu’on eût
pu dire à l’auteur de l’épitaphe. « Sæpius pro masculinis
fœminea pro fœmineis neutra et pro neutris masculina commutas : pro
ablativis accusativa et rursùm pro accusativis ablativa ponis.
» Greg.
Turon. Prœf. lib. de glor. confess. La seconde épitaphe
qui
paraît un peu
plus moderne, est beaucoup moins longue et beaucoup
meilleure ; elle a même cet avantage, qu’elle paraît avoir été faite ou
demandée par celui dont elle marquait le tombeau. « Quod es fui, quod
sum eris, precor te ora pro me peccatore ad Dominum Patrem nostrum. »
(XXI)
Ce voyage de Louis XI sur une frontière importante, par des chemins
difficiles et couverts, où l’on ne pouvait aller qu’à cheval et à
petites journées : le passage du roi et de toute sa suite dans un bacq
de 20 pieds de long sur dix de large, nous firent concevoir l’embarras
et les lenteurs que la difficulté des communications devait apporter
autrefois dans les affaires, l’incertitude que cela jettait dans les
délibérations, et les partis que cela donnait lieu de former dans des
temps de troubles. C’est principalement dans les époques
reculées de notre histoire, qu’on peut voir de quels désastres ces
inconvéniens étaient la source. « Dans la Gaule, dit Cæsar, Comm. lib. I., on
n’a communément de connaissance d’un pays éloigné,
qu’autant que les passans et les marchands forains peuvent en donner.
Tout le monde les entoure quand ils paroissent, pour leur demander des
nouvelles : ceux-ci, interrogés à droite et à gauche, accablés de mille
questions, forcés de parler des pays d’où ils viennent, alors même
qu’ils ne savent rien de ce qui s’y passe, répondent au gré des
questionneurs, et ne leur donnent souvent que des détails controuvés,
qui deviennent pour ceux-ci la source des plus grands malheurs et des
regrets les plus amers, à la suite des delibérations hasardées qu’ils
prennent sur les affaires les plus importantes. » Avec un peu
plus de facilité dans les communications, rien de tout cela ne fut
arrivé ; et ces voyes Romaines construites dans les Gaules et dans tous
les pays conquis, étaient peut-être un des plus grands moyens que la
politique des généraux joignit à la force de leurs armes, pour asservir
les peuples ou pour les contenir sous le joug. En effet, en les
établissant, pour la communication des garnisons et des camps, les
conquérans réunissaient, en peu de temps, des forces immenses et
dissipaient, avant qu’ils fussent dangereux, les rassemblemens que la
difficulté du pays empêchait elle-même de grossir et de devenir
formidables. Qu’on se rappèle, ce qu’on a du remarquer pendant
la révolution : cette rapidité de communication d’un bout à l’autre de
la France ; cette profusion de feuilles périodiques qui parlaient à
trente millions d’hommes à-la-fois ; cette influence magique des
courriers sur les déterminations de la majorité ; cette impossibilité
d’accréditer de faux bruits et de former des partis, quand tout le
monde était instruit des vrais résultats et que les conquêtes du plus
fort ne pouvaient être démenties par personne ! Quelles sont
donc les chances incalculables que la civilisation présente aujourd’hui
pour la conservation des corps politiques : depuis qu’il est plus
facile à deux peuples de communiquer entre eux, qu’il ne l’était
autrefois à un suzerain d’écrire à son vassal ; ou plutôt depuis la
multiplication des grandes routes, l’établissement des postes et
l’invention de l’imprimerie ? ajoutons la découverte du télégraphe.
(XXII)
Nous employons ici l’expression de verger d’habitation, pour faire
entendre qu’autour de la maison il y a toujours un terrain enclos et
planté comme un verger ; mais ce n’est pas ainsi qu’on a coutume de
nommer ces enclos. On leur donne souvent le nom de cour qui leur
convient très bien et souvent aussi celui de masure, qui par
tout
ailleurs ne signifie qu’un vieux bâtiment tombé en ruines. Cette
acception locale du mot masure,
pour signifier un enclos
d’habitation, quelque étendu qu’il soit, produit quelquefois dans les
actes, la plus grande opposition qu’il puisse y avoir entre deux mots
et les idées. Item,
une belle masure en bon état avec plusieurs
bâtimens tout neufs. Ce mot vient du latin mansio, mansile,
mansura,
masura, masure. (Ducange.)
(XXIII)
Un auteur Anglais qui a écrit sur la pêche, rend plus de justice aux
bonnes qualités de la dorée, et nous citerons ici le passage où cet
auteur appuie ce qu’il écrit, sur le témoignage d’un Epicurien assez
connu de son temps, pour qu’il pût l’invoquer comme une preuve sans
réplique. « La chair de la dorée est très-tendre et facile à digérer,
elle est même assez délicate pour qu’elle soit préférée par plusieurs
personnes à celle du turbot. Les chasse-marées en apportent beaucoup à
la poissonnerie de Londres, où elles se vendent fort cher, et le
célèbre Epicurien M. Quin, a souvent exalté le mérite de la dorée, en
disant qu’elle était, pour le goût, au-dessus de tout ce qu’il y avoit
de poissons dans la mer. » the
art of Angling by R. Brookes. Il
est cependant un reproche que pourraient lui faire des acheteurs, qui
songent plus à la quantité qu’à la délicatesse de leurs mêts : c’est
qu’il n’y a pas beaucoup à
prendre dans la dorée, et que la panse en
est énorme.
_______________________
Nota.
Les élèves ont
fait un second voyage et de nouvelles observations pendant les vacances
de l’an 9 ; mais au lieu de voyager tous ensemble, ils ont formé deux
divisions : la première a commencé ses recherches au point où les
observateurs de l’an 8 s’étaient arrêtés, et elle a parcouru un espace
de vingt-cinq lieues sur les limites des départemens de l’Eure et de la
Seine-Inférieure, en partant du confluent de la Risle et de la Seine.
La seconde a visité une partie de l’intérieur du département, et des
limites qui le séparent de celui de Seine et Oise. Ces
deux divisions correspondaient entre elles, et se faisaient
mutuellement part de leurs découvertes ; la première portait le nom
d’expédition de l’ouest ; la seconde s’appelait l’expédition de
l’Orient, et le zèle qui les animait leur faisait mettre à leurs
travaux l’intérêt le plus vif. Ces travaux n’ont point été sans
quelques succès. Les divers objets d’histoire naturelle et d’antiquité
recueillis par les élèves, ont été exposés à l’ouverture solemnelle des
cours de l’an 10, et le public les a vus avec satisfaction. Le
Conseil d’instruction, jaloux de soutenir l’émulation des élèves,
publiera leur correspondance lorsqu’il aura pu faire graver leurs
dessins. Il regrette vivement que ces petits voyages n’ayent pu avoir
lieu plutôt : l’expérience de deux années lui en a fait sentir tous les
avantages, et s’il avait été possible de les commencer dès
l’établissement de l’Ecole centrale, comme il en avait eu le projet, on
aurait peut-être acquis un grand nombre de précieux détails sur des
objets qui restent ignorés, et qu[’]il faut presque toujours aller
étudier sur les lieux.
FIN.
|
![[Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](../images/frever01_t.jpg)
![[Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](../images/frever02_t.jpg)
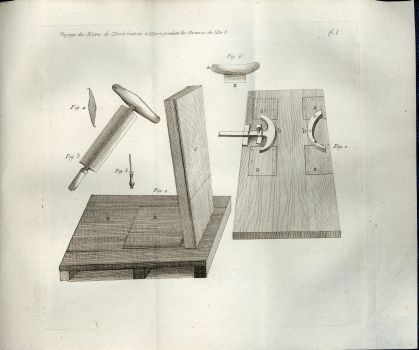
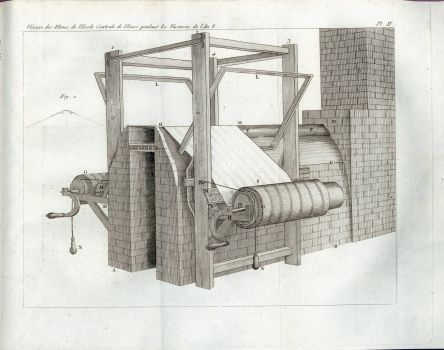
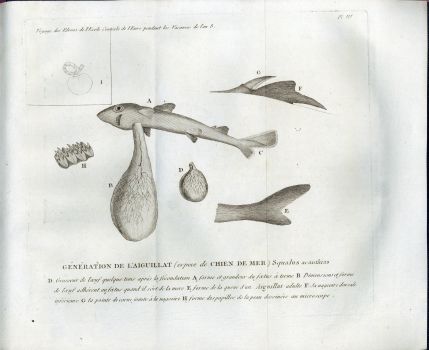

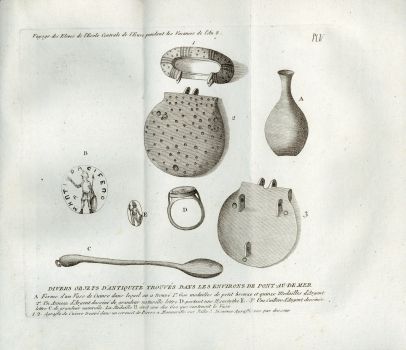
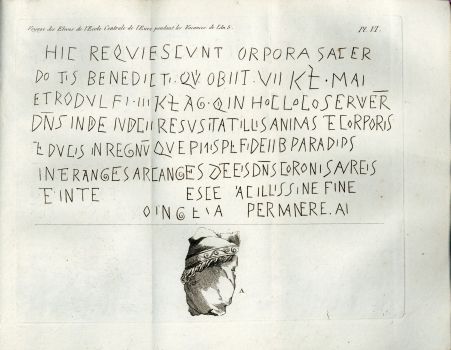
![[Epithaphe] - Voyage des élèves de l'Ecole Centrale de l'Eure - An 8 [Epithaphe] - Voyage des élèves de l'Ecole Centrale de l'Eure - An 8](../images/frever09_t.jpg)