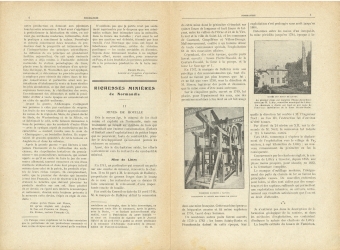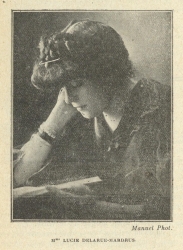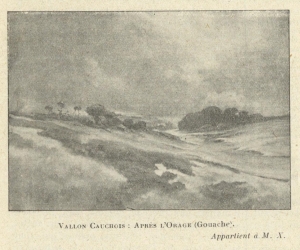La Vie Rurale
Et la Production Agricole
Au Pays Normand
(Deuxième article de la
série.)
II
LE CALVADOS : SES RÉGIONS NATURELLES : LE BESSIN, LE
BOCAGE NORMAND, LA PLAINE DE CAEN ET LE PAYS D'AUGE. — LES FORMES
D'EXPLOITATION DU SOL : PRAIRIES ET HERBAGES. — LE CIDRE DE NORMANDIE
ET LES POÈTES NORMANDS. — LA POMOLOGIE DU CALVADOS. — LA CONTREFAÇON
ALLEMANDE. — UN PRÉCIEUX PATRIMOINE.
Les Normands peuvent être fiers, à juste titre, des flatteuses
appréciations émises, par les hommes les plus éminents, sur la
Normandie et sur ses habitants.
Dans son
Economie rurale —
qui est bien une des plus brillantes études publiées sur cette
question, en France — Léonce de Lavergne dit : « Si j'avais à désigner
la plus heureuse partie de la France, je n'hésiterais pas, je
désignerais la Normandie. »
A cette bonne parole, à cet éloge du célèbre agronome, il convient
d'ajouter que l'attrait offert par la province normande tient non
seulement à cette impression générale de bien-être et de richesse, et à
la beauté des sites, mais aussi à l'amabilité de la population normande
qui est l'image, le reflet du riant pays au milieu duquel elle passe sa
vie ; et c'est là, en vérité, une preuve de plus à l'appui de la
théorie des psychologues sur l'influence des milieux.
Faire connaître ces milieux, en donner une description utile,
instructive, c'est aider, croyons-nous, à la progression de l'idée de
décentralisation et travailler en faveur du régionalisme, en
intéressant à cette belle cause de nouveaux et ardents prosélytes.
Telles sont du moins, nos aspirations. Et il semble que pour faire un
examen consciencieux des diverses sources de production de la terre
normande, on doit envisager les éléments favorables à cette production,
les caractères généraux, agrologiques et géologiques, de ce pays, tout
en soulignant ses charmes naturels. C'est ce que nous allons faire, en
continuant notre étude sur le Calvados, par un exposé des traits
caractéristiques des différents pays dont on a formé, en 1790, ce beau
département.
Le Calvados, en effet, comprend plusieurs régions naturelles, ayant
chacune son caractère propre, sa physionomie particulière et se livrant
à des industries agricoles distinctes. Les formations géologiques très
diverses auxquelles appartiennent la plaine de Caen, le pays d'Auge, le
Bessin, le Bocage, expliquent ces différences. Voici tout d'abord, à
l'ouest du département, le Bessin. Le sous-sol de cette région, formé
par les argiles dits de Port-en-Bessin, assure au sol une humidité très
favorable aux herbages ; aussi, toute cette région des environs de
Bayeux représente une immense prairie où on entretient de nombreuses et
belles vaches laitières. C'est là que se fabrique le beurre d'Isigny
dont on connaît l'universelle renommée, et qui est partout considéré
comme le beurre le plus fin, le plus exquis parmi tous les beurres du
monde entier. A lui seul, l'arrondissement de Bayeux produit, en temps
normal, chaque année, pour 20 à 30 millions de francs de beurre.
Au sud de l'arrondissement de Bayeux, nous nous trouvons dans le Bocage
normand, caractérisé par ses granits, ses grès rouges, ses schistes,
ses plateaux semés de grands blocs de rochers ; ses maisons construites
avec des matériaux de couleur sombre lui donnent un aspect un peu
sévère, mais c'est un pays très pittoresque et très accidenté. Le sol y
manque souvent de calcaire et d'acide phosphorique, mais le cultivateur
du Bocage normand a su améliorer ce sol et là où le rocher ne se montre
pas à nu, des vergers de magnifiques pommiers entourent les fermes. Par
sa patience et son labeur, l'homme a su triompher de l'ingratitude du
sol, car le travail a toujours été la vertu du paysan du Bocage.
La plaine de Caen s'étend sur une partie des arrondissements de Caen et
de Falaise. Au lieu de ce pays accidenté qu'est le Bocage, aux collines
formées de grès et de schistes, à couches redressées presque
verticalement ; au lieu de ces champs entourés de haies garnies de
grands arbres, et donnant à l'ensemble du pays l'aspect d'une immense
forêt, on voit devant soi une grande plaine nue, sans arbres ; plus de
pommiers, plus de haies ; des céréales, des sainfoins, des trèfles
incarnats à perte de vue et, çà et là, encore quelques parcelles
montrant le tapis d'or du colza. Le calcaire oolithique surmonté d'une
épaisseur plus ou moins grande de limon, forme le sous-sol de cette
vaste plaine ; c'est un terrain essentiellement sec et perméable,
calcaire. Avec la pierre formant ce sous-sol on a bâti les maisons et
les églises du pays, et cette pierre, dite « pierre de Caen », facile à
travailler, a permis d'élever, jusque dans le moindre village, des
clochers finement dentelés sur le modèle du célèbre clocher de
Saint-Pierre de Caen ; les maisons elles-mêmes, les fermes bâties avec
cette pierre de Caen ont un aspect riant et gai. Ici, l'élevage du
cheval de demi-sang constitue la principale source de revenus ; et la
célébrité du carrossier anglo-normand a fait le tour du monde.
A l'est du Calvados, c'est la vallée d'Auge, c'est le « pays d'Auge »,
terre classique de l'herbe, aux collines plantées de pommiers, qui y
sèment, au printemps, la neige odorante de leur belle floraison, et se
chargent, à l'automne, d'une abondante fruitée. Ce pays d'herbages par
excellence engraisse des milliers de bœufs dans les vallées qu'arrosent
la Dive et la Touques ; de Lisieux à Mézidon, on n'aperçoit que des
herbages avec leurs vergers de pommiers. Des poiriers et des rosiers
grimpants, le long des habitations, ajoutent encore au charme du
paysage. Ces vallées de la Dive et de la Touques formées par le mélange
de divers terrains : marnes oxfordiennes, calcaires du cénomanien,
argiles à silex, sont naturellement riches, fertiles. Là, suivant
l'expression populaire, « l'herbe pousse le bœuf » et il semblerait que
tout se passe sans l'intervention de l'homme, — comme le dit l'éminent
Baudrillart, dans ses études sur les
Populations
agricoles de la France, — car dans la solitude des riches
pâtis, la bête bovine semble régner comme dans un domaine qui lui
appartiendrait par droit de nature. Cette plantureuse région est
caractérisée par des coteaux arrondis, par des vallées à grands
prolongements ou découpées, pour ainsi dire, en damiers de verdure,
qu'arrosent la Dives et la Touques, qui y coulent tantôt d'un cours
régulier, tantôt avec une surabondance qui en grossit et en précipite
le cours. Le pays d'Auge comprend ce territoire qui s'étend sur les
arrondissements de Pont-PEvêque et de Lisieux.
Tandis que, dans le pays d'Auge, on pratique spécialement
l'engraissement, le Bessin, aux immenses nappes de verdure, est
merveilleusement doté pour l'industrie laitière. C'est là que pâturent
les belles vaches cotentines, dont le lait abondant et riche en
principes gras a fait donner à cette région le nom de « pays du beurre.
» Mais si le sol du Bocage est moins riche, et sa production moins
plantureuse que celle des autres régions du Calvados, par contre,
l'élevage du bœuf y est prospère et il alimente les régions où on se
livre à l'engraissement de même qu'il fournit les vaches laitières pour
le lait destiné à la fabrication du beurre et du fromage.
En somme, on peut faire cette curieuse constatation que le département
du Calvados, par sa situation même, représente l'ensemble de la
Normandie agricole et ethnographique, car il renferme, dans sa
composition géographique, une partie plus ou moins étendue des
anciennes divisions de la province, et comme il présente les cultures,
les productions de chacune de ces régions, il permet d'apprécier la
puissance productive du sol de notre belle Normandie tout entière. Mais
bien des améliorations, sont encore à réaliser en culture. C'est ainsi
qu'il faut apporter aux terres du Calvados la chaux et l'acide
phosphorique qui leur sont nécessaires pour remplacer, dans les
herbages, les énormes quantités de phosphates calciques que l'élevage
et la production du lait enlèvent au sol. Une prairie soigneusement
phosphatée donne une herbe dont la puissance nutritive et l'influence
sur la production du lait dépassent, par leurs résultats si favorables,
les frais de fumure de la prairie. D'autre part, on doit regretter la
disparition de la culture du colza, car cette culture rendait de grands
services aux cultivateurs ; le colza, figurant en tête de l'assolement,
préparait la terre à une bonne culture de blé. Cette plante a été
remplacée partiellement par des plantes sarclées dont il
conviendrait de généraliser la culture, afin d'accroître les rendements
en blé.
C'est à ses richesses pomologiques, à la haute valeur de ses crûs, que
notre Normandie doit la grande renommée de sa production cidricole et
le Calvados, en particulier, s'inscrit en première ligne pour
l'excellence de la boisson à laquelle tous les Normands restent
fidèles, comme, du reste, tous les bons appréciateurs, tous les vrais
amateurs de cidre : Qu'on offre, à ceux-là, du vin, du vin venant de
loin, de Narbonne ou de Bordeaux, ils répondront comme Jacquemin, dans
Le Flibustier, de Jean Richepin :
...Quand il viendrait de Rome !
Il ne vaut pas le cidre, âpre et fleurant la pomme.
Ah ! j'en ai bu, là-bas, toutes sortes de vins,
Pris chez les Espagnols, des plus vieux, des plus fins,
Alicante, Xérès, Porto, que sais-je encore !
Mais nul, de quelque nom fameux qu'on le décore,
Ne m'a fait oublier la boisson des aïeux,
Ce bon cidre normand, raide au cœur, clair aux yeux.
Qui vous ragaillardit le courage et la mine,
Et qui, lorsqu'un rayon de soleil l'illumine,
Ressemble aux cheveux d'or des filles du pays !
Et de fait, les Normands — qui ont toujours conservé, avec un soin
jaloux, l'excellence de leurs crûs et, par conséquent, leur réputation
d'honnêtes producteurs — n'ont pas été exposés à ces avatars éprouvés,
jadis, par certains viticulteurs du Midi qui, pour conjurer la crise
viticole, noyaient leurs idées moroses, non pas dans le vin, mais dans
la « liqueur de feu », dans l'absinthe qu'ils aimaient trop. Il est des
gens qui ont le vin triste, tandis que les buveurs de cidre ont pour
eux la verve et la gaîté. Aussi loin que nous remontions dans
l'histoire de notre vieille province, nous voyons les littérateurs et
les poètes exalter les vertus de la divine boisson « qui mêle à ses
flots d'or une mousse argentée ». Et cet enthousiasme de nos vieux
poètes normands, nous le voyons se manifester avec une belle ardeur,
par exemple, dans les écrits de Basselin, l'auteur des
Vaux de Vire, pour ne citer que
celui-là. Basselin n'a-t-il pas écrit ceci sur le
Sidre de Normandie :
De nous se rit le François,
Mais vraiment, quoiqu'on en die,
Le Sidre de Normandie
Vaut bien son vin quelquefois.
Coule, avale et loge, loge :
Il fait grand bien à là gorge.
Ta beauté, ô Sidre beau,
De te boire me convie,
Mais pour le moins, je te prie,
Ne me trouille le cerveau.
Coule, avale et loge, loge :
Il fait grand bien à la gorge.
Nous serions tenté, en vérité, de consacrer ici, aux mérites, à la
gloire du cidre de Normandie, tous les souvenirs qui attestent, par
d'éloquents panégyriques, par des écrits humoristiques, par des odes et
par des chants, que le « breuvage étincelant » excita, de tout temps,
la verve, le talent de nos écrivains et inspira la muse de nos poètes.
Mais, à ce long exposé rétrospectif, le cadre forcément limité de cette
Révue ne suffirait pas. Bornons-nous, pour aujourd'hui, à rappeler que
le poète lexovien, Amédée Tissot, vanta avec lyrisme et humour les
vertus de la pomme et du cidre de Normandie. Il composa, sur la pomme,
notamment, une spirituelle, chanson dont nous citerons seulement cette
malicieuse strophe :
De la vigne on exalte l'âge,
Mais dans le paradis perdu,
Adam ne voit que son feuillage
Et la pomme est fruit défendu.
Bien avant que Noé se grise,
La pomme se fit apprécier.
Eve aussi se trouva surprise
... Sous un pommier.
La production des fruits à cidre et la fabrication du cidre sont, avec
l'élevage, les principales grandes richesses du département du
Calvados. On évalue à environ 20.000 hectares la superficie de terre à
labour, prairies naturelles et prairies artificielles complantée en
pommiers à cidre, dont le nombre est d'environ 1.220.000 produisant, en
année normale, 550.000 à 600.000 hectolitres de pommes.
Les pommes à cidre du Calvados appartiennent à plusieurs catégories,
qui se classent en trois saisons : Les
premières saisons : amer-doux,
railé, douce-dame, etc., entrent pour un quart seulement dans la flore
pomologique de la contrée. Les
deuxièmes
saisons : gros-bois, gagne-vin précoce, rouge-bruyère,
staltot-feuillard, cartigny, etc., comptent pour moitié. Les
troisièmes saisons : gagne-vin,
muscadet, monsued, bidan, filasse, etc., comptent pour un quart.
Malheureusement, il y a, dans la production, encore trop d'alternatives
de hausse et de baisse : Bonne récolte tous les quatre ou cinq ans, les
deux suivantes étant bien moins bonnes, parfois médiocres ou même
franchement mauvaises. Il en résulte de brusques courants commerciaux
et d'extraordinaires variations de prix, d'une année à l'autre, pour
les pommes et le cidre. En bonne saison, le commerce transite une
moyenne de 250.000 hectolitres environ. A Bayeux, Nonant, Molès, etc.,
on fabrique un cidre de luxe fort apprécié dans le pays et qui fait
l'objet d'exportations rémunératrices. On fabrique, pour le commerce,
deux sortes de cidres : le gros ou pur jus, destiné à la boisson de
luxe ou à la vente en gros pour les débitants, et le mitoyen, ou
boisson de consommation courante. Il faut améliorer nos récoltes,
régulariser notre production en donnant aux pommiers tous les soins
nécessaires. Il faut aussi s'appliquer à perfectionner la fabrication
du cidre, en suivant des méthodes modernes, rationnelles, dont la
pratique a sanctionné la valeur. Pomologie et cidrerie constituent deux
branches de production dont la prospérité est intimement liée à
l'interprétation des principes scientifiques. La diffusion de ces
principes est grandement facilitée aujourd'hui. On sait quels éminents
services a déjà rendus à l'industrie cidricole normande la station
pomologique de Caen, placée sous la direction technique d'un
spécialiste distingué, M. Warcollier, qui s'est appliqué, notamment, à
déterminer les procédés pratiques à employer pour obtenir des cidres
doux de longue conservation et permettre ainsi aux pomiculteurs
d'échelonner la vente de leurs récoltes les plus abondantes, ce qui
doit avoir, pour conséquences heureuses, la stabilisation des cours,
l'accroissement des débouchés et enfin la possibilité d'offrir à toute
époque au consommateur un cidre de qualité uniforme.
Avant la guerre, l'Allemagne s'adjugeait nos pommes à cidre par
centaines de wagons. Les fruits de nos vergers allaient approvisionner
les usines de la région du Mein, du grand-duché de Bade, du Wurtemberg
et de la Silésie, où se fabriquait le
sekt,
cette boisson mousseuse à base de pommes, que les soudards d'outre-Rhin
— avec le cynique esprit de contrefaçon qui les caractérise — osaient
vendre sous le nom de « Champagne », en bouteilles ficelées. Ils
exportaient de grandes quantités de cette boisson en Angleterre et dans
les colonies.
Après la grande guerre — qui libérera à tout jamais l'humanité et la
civilisation des audacieuses, des stupéfiantes tentatives du
prussianisme — nos pomiculteurs normands, qui auront appris ce qu'il en
coûte de faire le jeu du commerce allemand, sauront conserver en vue
d'une meilleure utilisation et dans leur propre intérêt comme dans
celui de la patrie, les produits réputés de leurs riches vergers. Ils
comprendront, enfin, que le premier des devoirs qui incombe à tout bon
Français, c'est de réserver à la France d'abord le bénéfice que doivent
procurer les produits récoltés sur son sol. Bien pénétré de ce devoir,
eu égard aux intérêts économiques et nationaux, chacun aura toujours
présente à la mémoire cette devise, érigée en règle de conduite :
J'aime qu'un Russe soit Russe,
Et qu'un Anglais soit Anglais.
Si l'on est Prussien en Prusse,
En France, restons Français (1).
N'oublions pas que la patrie n'est pas seulement représentée par le
drapeau que nos admirables soldats font triompher sous la mitraille,
dans la fumée des batailles ; c'est aussi le sol que nos ancêtres ont
défriché, fécondé par leur travail, c'est l'héritage que nous ont légué
de laborieuses générations, avides de victoires pacifiques — les seules
enviables et fécondes. Soyons donc fermement résolus à ne négliger
aucun effort, aucun sacrifice, pour conserver au Pays, et faire
fructifier, le précieux patrimoine dû à la puissance productive de la
terre normande.
Henri BLIN,
Lauréat de l'Académie
d'Agriculture de France.
(1) Puisque nous exprimons ici la ferme conviction que le
patriotisme de nos producteurs contribuer et leurs vertus civique sont
un sûr garant qu’ils voudront contribuer au triomphe, dans la
lutte économique, en repoussant toute idée de commerce, après la
guerre, avec le Boche, — ce barbare universellement stigmatisé, voué à
l'exécration du genre humain —ce nous est l'occasion de signaler que le Journal Officiel du 22 avril
1917 a publié un décret attribuant à la commune d'Allemagne (Calvados) la
dénomination de FLEURY-SUR-ORNE.
H. B.
*
* *
RICHESSES MINIÈRES
de Normandie
II
MINES DE HOUILLE
Dès le moyen âge, le minerai de fer était connu et exploité en
Normandie, mais son traitement se faisait au charbon de bois qui
nécessitait une énorme consommation d'arbres et limitait ainsi
l'exploitation à de petites forges qui ne pouvaient, faute de
combustible, prendre le développement qu'auraient permis les richesses
en minerai.
Aussi, dès le dix-huitième siècle, les efforts s’orientèrent vers la recherche du combustible minéral.
MINE DE LITTRY
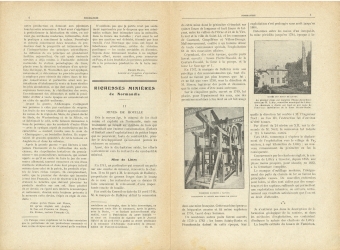
En
1741, un particulier qui creusait un puits sur une couche de minerai,
rencontra le charbon. Il en fit part à M. le marquis de Balleroy,
propriétaire de grosses forges dans le bourg de ce nom ; les recherches
que ce dernier fit faire amenèrent le relèvement d'une importante
couche de houille.
Par arrêt du Conseil en date du 15 avril 1744, M. le marquis de
Balleroy obtint la concession de cette mine dont le périmètre
s'étendait sur quinze lieues de longueur et huit lieues de largeur,
entre les vallées de l'Orne et de la Vire, la mer et la ville de
Saint-Lô, et les communes de Caumont, Goupillères et Villers-Bocage.
Malheureusement, confiée à un homme dénué de toute connaissance
spéciale, l'exploitation fit de très mauvaises affaires.
Cependant, dès cette époque, quatre puits furent ouverts : fosses
Pierre-Raould, de la Couture-Raould, la fosse à la pompe, et la fosse
Le Sauvage n° 1.
En 1747, le marquis de Balleroy céda son privilège à des
concessionnaires qui, tout d'abord ne furent pas plus heureux que lui ;
ce ne fut que vers 1758, sous la direction de M. Bisson, ingénieur des
ponts et chaussées, que la mine cessa d'être aussi onéreuse.
Sur le cinquième puits, ouvert en 1749, fut placée, pour l'épuisement
des eaux, une des premières machines à feu dont on ait fait usage dans
une mine française. Cette machine éprouva de fréquentes avaries et fit
même explosion en 1755, tuant deux hommes.
De nombreux autres puits furent ouverts de 1759 à 1763 ; les fosses
Sainte-Barbe et Frandemiche datent de cette époque, leur exploitation
s'est prolongée sans arrêt jusqu'en 1864.
Retombée entre les mains d'un incapable, la mine périclita jusqu'en
1784, époque à laquelle la direction fut confiée à M. l'Ingénieur Noël
: en l'an III, l'extraction fut d'environ 27.000 tonnes.
Par décret du 24 nivôse an XII, sur la demande de M. Noël, la concession fut réduite à 115 kilomètres carrés.
Vers 1844, commença à s'opérer le déplacement de l'exploitation vers le
village de Fumichon, à sept kilomètres de Littry ; un nouveau
remaniement du périmètre en fut la conséquence.
Concurrencée par les charbons anglais, la concession de Littry a
traversé, depuis 1856, une phase moins prospère, pour aboutir, en 1882,
à la fermeture complète.
Le manque d'outillage moderne, l'éloignement des puits du chemin de fer
en furent les principales causes. De nouvelles recherches sont faites,
si elles sont aidées par des compétences et des capitaux suffisants qui
permettent une exploitation intensive, on arrivera certainement aux
résultats satisfaisants que l'on est en droit d'attendre.
Je n'entrerai pas dans la description de la formation géologique de la
contrée, ni dans les méthodes d'exploitation, me contentant d'indiquer
la nature des charbons de Littry.
La houille extraite du bassin de Fumichon, le dernier exploité,
appartient au type des houilles grasses, à longue flamme ; elle
renferme une proportion de matières schisteuses et donne une quantité
de cendres très variable, suivant les parties de la couche dont elle
provient (3,2 % à 49,6 %).
Cette proportion considérable en cendres, empêchait l'emploi de ces
charbons pour la fabrication du gaz d'éclairage et des agglomérés, qui
demandent des combustibles relativement purs.
En face de cette situation, la Compagne des mines de Littry introduisit, vers 1863, le lavage des menus.
Cette opération a transformé les menus de Littry, en charbons
excellents pour la forge et pour la production du gaz d'éclairage ; ils
avaient pris rang parmi les meilleurs charbons à gaz et la mine ne
pouvait plus satisfaire à toutes les demandes qui lui étaient faites.
Ces menus donnaient un gaz présentant un pouvoir éclairant dépassant de
6 à 7 pour cent le titre exigé à Paris. C'était pour eux une grande
supériorité, car elle permettait de les mélanger à des charbons moins
convenables à ce point de vue.
A côté de cette supériorité particulière, les charbons de Littry
donnaient un coke plus dense et un peu moins avantageux, pour les
ventes s'opérant à la mesure, que le coke provenant des charbons
anglais ou belges ; il n'en serait pas de même pour des ventes au poids.
On a vu plus haut que la fermeture de la mine de Littry était due à
deux causes principales : le manque d'outillage moderne, auquel il sera
facile de remédier, et l'éloignement des puits du chemin de fer.
En effet, le transport, par voiture du carreau de la mine à la gare de
Molay-Littry, située à huit kilomètres des fosses de Fumichon, coûtait
environ 3 francs par tonne ; c'était le plus clair des bénéfices. Dans
certaines mines, même, on n'obtient pas cet écart entre le prix de
revient et le prix de vente.
Il faudrait donc, sur la concession de Littry, rechercher la houille à
proximité de la voie ferrée qui la traverse et établir, entre celle
voie et les puits qui seront ouverts, des moyens de transport plus
économiques que celui par banneaux, autrefois employé.
Ainsi que je le disais dans un précédent article, le gouvernement, sur
les instances de M. Henri Chéron, le dévoué sénateur du Calvados,
devait prendre les mesures nécessaires pour assurer une sérieuse
prospection de ce bassin houiller. Il est à souhaiter que cette, étude
soit menée rapidement et que des mesures immédiates soient prises pour
assurer la mise en exploitation intensive de ces richesses du sous-sol
normand.
A. MACHÉ.
*
* *
FIGURES NORMANDES
Mme Lucie Delarue-Mardrus
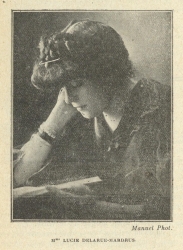
J'ai
eu le plaisir, et mieux, l’honneur, de voir Mme Delarue-Mardrus, à un
thé, chez Mme Marguerite Crissey, une autre femme charmante et qui, si
elle n'écrit pas, traduit admirablement l’âme des fleurs. Il y avait,
ce soir-là, Georges Trouillot — mort depuis prématurément et aussi
l'actrice Moreno. Je fis, plus tard, dans le Paris-Journal
, un article sur le livre : Une Française en Argentine
,
(que Moreno venait de donner à Crès, et de cet article, qu'on me
permette de découper en manière d'anecdote, ce fragment relatif à
l’auteur normand : « Enfin, Lucie Delarue-Mardrus survint, et la
conversation s'accrut en beauté, mais d'une même beauté, d'une même
valeur... Je revoyais bien, en l'auteur d'Un Cancre
, celle que les Arabes nomment La Princesse Amande
...
Des traits rieurs et fins où les brumes nordiques se mêlent à l’âme des
crépuscules d'Orient, mais en Occident, comme en Orient, ne rêve-t-on
pas ? On réclama des vers....
— Connaissez-vous Le Drapeau ?
me demanda Georges Trouillot...
Et comme je me montrais assez franc, et donc sincère, et pas flatteur :
— En voilà un, s'exclama-t-il, se tournant vers Delarue-Mardrus, qui ne connaît pas Le Drapeau !
Elle sourit finement et dit : «
Il n'est pas « patriote ! » Elle dit elle-même, admirablement, son
poème, non sans avoir, au préalable, et malicieusement, mis Georges
Trouillot à contribution... »
Voilà la femme, telle qu'elle
m'apparut, fugitivement... Et je me souviens encore qu'elle m'adressa
une fois la parole pour me dire, avec un sourire où permanait comme une
grâce des prairies et des cités normandes : « Alors, vous êtes de Rouen
? » Et cette simple demande était pour moi toute une évocation de la
terre natale ! Pour le reste, j'ai lu ses œuvres de ci de là, les
poèmes, des romans ou des articles — ou contes — descriptifs en
quantité, car Mme Delarue-Mardrus a beaucoup écrit... J'en ai entendu
qui le lui reprochaient, et allaient jusqu’à rééditer telle réflexion
virulente de Sainte-Beuve à propos des femmes de lettres !... Il est
sûr, en tous cas, que Lucie Delarue-Mardrus est un merveilleux
écrivain, malgré les cris poussés dans les « volières ». Le poète
Charles-Théophile Féret, mon grand aîné et ami, a dit de l'auteur de Ferveur
, dans son Mécanisme des Images
: « De la race ! » L'on peut, en somme, compter les femmes qui écrivent, c'est-à-dire celles qui ont « de la race ! »
Le père de Mme Delarue-Mardrus,
maître Georges Delarue, avocat à la Cour de Paris, est de bonne souche
normande ; sa mère est parisienne. En 1900, la fille aînée de maître
Delarue épouse le docteur J.-C. Mardrus, auteur d'une version
définitive des Mille et une nuits
.
Ils habitèrent longtemps — ceci à titre d'anecdote — telle vieille
maison de l’Ile-Saint-Louis, où naquit le poète Félix Arvers, dont le
fameux sonnet n'est sans doute si célèbre que parce qu'il traduit une
aventure assez banale en amour... Mme Delarue-Mardrus a donné ses
œuvres principales à Fasquelle, d'autres parurent chez Tallandier, et à
la Revue-Blanche
. Parmi les œuvres poétiques, l'on peut citer : Occident
(1901) ; Ferveur
(1902) ; Horizons
(1904) ; La Figure de Proue
(1908) ;
Par vents et marées
(1910).... La production, en romans, est
considérable : Marie, Fille-Mère
(1908) ; Le Roman de six petites
filles
(1909) ; Comme tout le monde, L'Acharné
(1910) ; Tout l'Amour
(1911) ; L'Inexpérimentée
(1912) ; Douce moitié
(1913)... Et notre
bibliographie demeure, à coup sûr, insuffisante... Ces livres naissent
ainsi, selon une sorte de rythme, dans le temps... A notre sens, la
prose de Mme Delarue-Mardrus est peut-être moins nerveuse, moins
originale que son vers, mais elle est tout de même d'une valeur assez
considérable, car parmi les femmes qui écrivent, les prosatrices se
comptent... Une ironie gaie, douloureuse..., parfois, caractérise sa
manière... Quand il faut dire quelque chose, l'auteur a toujours
l'esprit pour le dire, et, après tout, l’on admet facilement ce
franc-parler d'une femme qui sait aussi s'émouvoir avec tant de
tendresse continue — lisez Un Cancre
— devant un transcendant idéal...
Mme Delarue-Mardrus fit représenter Sapho Désespérée
(deux actes en
vers), au théâtre d'Orange, et La Prêtresse de Carthage
, au théâtre
antique de Carthage... Reine de Mer
fut représentée aux « Chorèges
Français », en 1907, au Pré Catelan, et Phaon Victorieux
(pièce où l'on
vit l'auteur remplacer, au pied levé, dans le principal rôle, l'artiste
qui devait le jouer), au théâtre des Champs-Elysées... Mme
Delarue-Mardrus collabore à L'Œuvre
, aux Annales
, au Journal
, où elle
donne des contes d'une observation réaliste, et d'où la bonne humeur
(plutôt l'humour) n'est jamais exclue, même quelquefois une mauvaise
humeur, un peu satirique, et qui n'est au surplus, chez elle, qu'une
délicieuse mauvaise humeur...
Elle a chevauché à travers
l'Orient, et elle connaît à merveille la langue arabe, et les Arabes
l'ont justement appelée La Princesse Amande
... Ils rendent ainsi
hommage, instinctivement, à celle qui naquit sur la côte de Grâce
d'Honfleur, et cette côte n'est-elle pas riche vraiment en
Nôtres-Dames-de-Grâces ?
L'une, dans sa modeste
chapelle, où naviguent de petites goëlettes de bois, aux « figures de
proue », protège les matelots et recueille leurs vœux dans les cœurs de
ses ex-votos
, l'autre a remonté la Seine, conquérante, une lyre en
mains... Elle nous apporta tout cet âpre parfum du terroir normand, et
bien qu'elle aimât l'Orient, cela ne l'empêchait pas de répéter : « Ah
! je ne guérirai jamais de mon pays ! »
C'est qu'il est beau aussi ce
pays, et le talent de Mme Lucie Delarue-Mardrus n'est-il pas la plus
belle manifestation de sa splendeur spirituelle ?
GABRIEL-URSIN LANGÉ.
*
* *
Normandie publiera dans son prochain numéro :
Eussions-nous cent ans ! poésie de Jean M
IRVAL (Georges L
EBAS) ; Paysages Normands :
L’Angélus à Jumièges, par Gabriel-Ursin L
ANGÉ ;
Normandie, poésie de Gaston L
E R
ÉVÉREND ;
Pieusement pour la Patrie (Louis M
ÉNAGÉ), par C
AMY-R
ENOULT, et des pages signées : Henri B
LIN, Georges N
ORMANDY, A. M
ACHÉ, etc.
*
* *
POUR L'AGRICULTURE
A la suite d'une interpellation de M. Louis Quesnel, sénateur de la
Seine-Inférieure, sur la main-d'œuvre nécessaire aux agriculteurs pour
la moisson prochaine, le Sénat a adopté, à mains levées, l'ordre du
jour suivant présenté par les sénateurs de la Seine-Inférieure, et
accepté par le gouvernement :
« Le Sénat signalant au gouvernement la gravité de la situation
agricole, qui est l'une des causes essentielles de la crise du
ravitaillement, confiant en lui pour prendre, d'extrême urgence, toutes
les mesures qui pourront faciliter et intensifier la production de la
terre, en assurer la libre circulation et pour coordonner dans ce but
les efforts des départements ministériels intéressés, l'invite
notamment à attribuer, en temps utile, aux agriculteurs toute la
main-d'œuvre dont l'autorité militaire peut disposer et à faire
accorder judicieusement, dans la mesure compatible avec les besoins des
armées, des permissions agricoles aux soldats cultivateurs et ouvriers
des champs, passe à l'ordre du jour. »
*
* *
Les Châtaigniers
Plus un berger aux champs. Un orage. L'averse.
Un ciel d'encre. Les noirs Châtaigniers éperdus
Gémissent et sans fin, meurtris, blessés, tordus :
On croirait que déjà l'ouragan les renverse.
Fuis chez l'hôtesse et bois le vin qu'elle te verse,
Puis reviens et regarde : aux cieux d'azur tendus,
Ils se dressent plus beaux, plus forts, inattendus
Et tout dorés de l'or du soir qui les traverse.
Ainsi, lorsque sur nous la tourmente a passé,
Que garder le plus frêle espoir semble insensé
A notre accablement qui chancelle et qui doute,
Rions, et par la sente et par les échaliers
Courons à la moisson, la voulant faire toute,
Et relevons plus haut nos fronts humiliés.
Robert DE LA VILLEHERVÉ.
Deuil
En ce très vieux château venu au temps de fleurs,
Vous l'avez consolé de tant d'heures moroses.
Belle et suivant l'année en ses métamorphoses,
Vous portiez des saisons les changeantes couleurs.
Près de vous, il semblait qu'on fût loin des douleurs.
Vous rayonniez parmi les êtres et les choses.
Pourquoi, sous les cils d'or des paupières mi-closes,
Ai-je vu, tendre amie, hélas ! couler vos pleurs ?
Dans la jeunesse ayant accepté d'être veuve,
Nul n'a dit qu'un seul jour vous ayez de l'épreuve
Ou sondé le mystère ou cherché le motif.
Et comme vous faisiez au Maître du ciboire
Votre soumission, le deuil définitif
A sur votre beau corps moulé sa robe noire.
Paul HAREL.
*
* *
Notre éminent collaborateur, M. Georges Normandy, consacrera tous les trois mois une chronique à la Vie littéraire, artistique et économique en Normandie.
La
première de ces chroniques paraîtra en juillet. Toutes les
publications, toutes les informations et tous les documents concernant
cette rubrique doivent lui être adressées directement, 51, rue du Rocher,
à Paris (8e arrond.)
*
* *
Colombine sauvée
ballet-pantomime en un acte et quatre tableaux
par
Jean Lorrain
La chambre de C
OLOMBINE.
Intérieur aisé, rustique, plafond à solives apparentes, armoire de
chêne sculptée, lit à baldaquin drapé de soie cramoisie. Au milieu de
la chambre, une grande table encombrée de bouquets de fiancés tous de
roses blanches et fleurs d'oranger ; dans un pot de grès flamand, une
grande gerbe de lys. Une large fenêtre à vitraux octogones et à
demi-ouverte sur la campagne : on aperçoit une vallée ensoleillée, le
clocher d'un village et des collines boisées.
______

Au lever du rideau, C
OLOMBINE, assise sur une chaise, sommeille,
appuyée sur la table, le visage appuyé sur ses bras nus. Un rayon de
soleil glisse par la porte entr'ouverte.
La chaleur et l'odeur des bouquets l'ont engourdie. Elle est toute de
blanc vêtue, robe courte et corsage décolleté, une rose blanche dans
les cheveux.
La fenêtre du fond, entrebâillée, s'ouvre lentement, toute grande,
comme poussée par une main invisible ; grimpé sur une échelle, on
aperçoit un Arlequin, un arlequin mauve et noir pailleté d'argent,
masqué de noir, portant une guitare en sautoir. Il se penche
curieusement dans la chambre, aperçoit C
OLOMBINE, et le
doigt sur la bouche, il se penche en arrière comme faisant signe à un
invisible compagnon, puis il enjambe la fenêtre, s'asseoit, jambes
pendantes dans la chambre, et accorde sa guitare. Un autre Arlequin
pareil au premier, apparaît à mi-corps sur l'échelle, il accorde aussi
sa guitare. Musique endiablée et corruptrice parlant de galanteries et
de fêtes inconnues dans des parcs lointains hantés de belles dames et
peuplés de statues ; aubade de séduction invitant C
OLOMBINE à l'embarquement pour Cythère... ou ailleurs.
Pendant toute l'aubade, C
OLOMBINE ensommeillée s'agite
comme oppressée ; elle porte la main à son front, fait le geste de
repousser quelqu'un avec le bras, mais malgré elle, ses pieds
frétillent en cadence.
Les Arlequins qui l'observent manifestent leur contentement. Tout à
coup, on gratte à la porte ; le doigt sur la bouche, les Arlequins
pincent un dernier accord, l'un enjambe la fenêtre, la referme à demi,
l'autre redescend l'échelle et le premier le suit - et l'échelle
disparaît. La scène reste vide.
On refrappe plus fort à la porte. C
OLOMBINE s'éveille
lentement en s'étirant : quel cauchemar affreux ; elle est tout
étourdie. Elle se lève et fait quelques pas en avant ; en portant la
main à son front, elle rencontre la rose qui est dans ses cheveux :
c'est cette fleur qui l'aura entêtée ! Elle la retire
et la jette loin d'elle.
On refrappe une troisième fois et plus fort. C
OLOMBINE entend et court précipitamment ouvrir ; entre Madame Cassandre, la mère de C
OLOMBINE, et T
RIVELIN, le cordonnier du village. Il apporte les souliers de C
OLOMBINE pour la noce du lendemain. C
OLOMBINE fait la révérence et pirouette ; Mme C
ASSANDRE avec de grands gestes, demande à C
OLOMBINE pourquoi elle n'ouvrait pas ; C
OLOMBINE explique qu'elle s'était endormie. Indignation de Mme C
ASSANDRE
: « Dormir la veille de ses noces et la tête dans les fleurs ! Ce n'est
pas étonnant qu'elle ne s'éveillait pas ; elle aurait pu mourir. » Mme C
ASSANDRE prend tous les bouquets et les emporte, sauf le vase de lys, cependant C
OLOMBINE s'est assise, et T
RIVELIN, à genoux devant elle, lui essaye ses souliers de bal. Mme C
ASSANDRE rentre et demande à sa fille si elle est contente.
C
OLOMBINE se lève et marche à petits pas, en regardant ses souliers. Danse. Pas seul.
T
RIVELIN et Mme C
ASSANDRE la contemplent tout ébaubis.
A un moment de la danse, on entend une réminiscence de l'aubade des Arlequins. C
OLOMBINE
s'arrête toute triste ; elle n'est plus à ses souliers, à son prochain
mariage : elle est là-bas, ailleurs dans les parcs enchantés des
Cythères lointaines ; et comme Mme C
ASSANDRE et T
RIVELIN lui demandent quelle mouche la pique et comme T
RIVELIN insiste, elle retire ses souliers et les lui jette au nez !
Mme C
ASSANDRE n'en croit pas ses yeux ; sa fille est devenue folle ; elle calme T
RIVELIN
qui ramasse les souliers et les pose sur la table, le congédie et
s'avance, les bras croisés, pour sermonner sa fille qui l'attend,
assise en battant du pied. A ce moment, musique joyeuse dans
l'escalier. Mme C
ASSANDRE se précipite vers la porte.
Entrée des jeunes filles du village, compagnes de C
OLOMBINE,
toutes en blanc, apportant des bouquets et escortant la coffrée de la
mariée, la robe de noce et le voile portés par deux gars à la veste et
au chapeau enrubannés. Les jeunes filles accueillies avec force
démonstrations par Mme C
ASSANDRE, qui leur montre C
OLOMBINE
s'obstinant à bouder, s'approchent curieusement de la table ; la
coffrée est déposée aux pieds de la maussade qui, devant les bouquets
et les mains tendues, se met à sourire en se levant, va à tour de rôle
embrasser ses compagnes et donner la main aux porteurs de la coffrée.
Mme C
ASSANDRE, ravie, va chercher une bouteille dans l'armoire et emmène boire les deux paysans ; sous la fenêtre, des vivats éclatent.
C'est P
IERROT le fiancé, avec les gars du pays qui
demande à entrer (les gars en blanc) ; une des jeunes filles se détache
du groupe et va à la fenêtre faire signe qu'ils rentreront quand C
OLOMBINE sera habillée.
Les jeunes filles entourent C
OLOMBINE, la déshabillent
et l'habillent en dansant, lui épinglant tour à tour la couronne et le
voile, deux des jeunes filles suivent tous les pas de C
OLOMBINE, en tenant devant elle un miroir.
Au plus fort de la danse et de la joie de C
OLOMBINE, le motif des Arlequins éclate en réminiscence. Tristesse de C
OLOMBINE
qui, de nouveau, s'arrête, traîne ses pas mélancoliques et écartant ses
compagnes empressées autour d'elle, va douloureusement s'asseoir. Les
jeunes filles n'y comprennent rien.
(A suivre.)
*
* *
UN GRAND PEINTRE NORMAND
André Paul-Leroux
« …. Il est dans le lieu natal un attrait caché,
je ne sais quoi d'attendrissant qu'aucune fortune
ne saurait donner et qu'aucun pays ne peut rendre...
Heureux qui revoit les lieux où tout fut aimé,
où tout parut aimable, et la prairie où il courut
et le verger qu'il ravagea ! Plus heureux qui ne vous
a jamais quitte, toit paternel, asile saint ! »
« BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. »
« …. Oh ! les grands labours dans la plaine
et les sillons fumant dans la brume aux premiers
froids d'octobre, quand hommes et chevaux s'en
reviennent plus las ! Chaque soir m'enivrait
alors comme si je sentais l'odeur de la terre
pour la première fois. J'aimais alors m'asseoir
au revers d'un talus, à l'orée des champs, et
j'écoutais avec délices mourir au loin des voix,
voix de laboureurs, bruit éteint de charroi.
J'aimais aussi l'odeur des feuilles rouies,
la fraîcheur de la pluie et des branchages
mouillés, — et mon âme défaillait toute,
en regardant le soleil exténué si fondre à l'horizon. »
« Jean LORRAIN. »
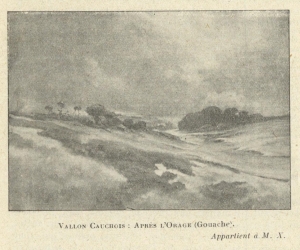
A Fécamp, le 28 juillet 1912, au pied du monument que nous venions
d'inaugurer à la gloire de Jean Lorrain, le plus grand écrivain
descriptif de la littérature française, je m'écriais, en terminant une
période au cours de laquelle j'énumérais les fastes de notre cité
natale : « ... Souvenez-vous de cette journée. Elle vous montre une
ville, de province, petite par son étendue mais grande par son passé et
aussi par son présent : elle a eu un roi pour abbé ; elle a fait d'un
de ses abbés un pape ; elle a eu Bois-Rosé, brave entre les braves ;
elle a formé Guy de Maupassant ; elle a vu naître Jean Lorrain ; elle a
construit une incomparable abbaye ; elle possède encore le vénéré
docteur Léon Dufour, fondateur des Gouttes de Lait qui sauvent cent
mille existences d'enfants chaque année, — et aussi un grand peintre
que je vais surprendre beaucoup et de qui je vais mettre la modestie à
une terrible épreuve, (car il travaille dans un secret presque absolu)
: j'ai nommé André Paul-Leroux. » J'ai terriblement surpris, en effet,
ce jour-là, André Paul-Leroux ; je crois, en outre, que nous pourrons
nous employer dix, vingt, cent critiques, à répéter —longtemps — que
cet Artiste est doué d'un magnifique talent, sans réussir à le
convaincre que son œuvre n'est pas tout à
fait sans intérêt.
Aussi bien, cette défiance de soi-même, voire cette injustice envers
soi-même, est fréquente chez les hommes de valeur exceptionnelle ;
peut-être est-elle l'une des conditions du talent véritable.
La sévérité d'un maître envers son œuvre ne diminue pas la valeur de cette dernière.
En ce qui concerne André Paul-Leroux, la rigueur de son autocritique
eut, pourtant, une conséquence qui aurait pu être fâcheuse pour un
tempérament autre que le sien, — lequel en profita plus qu'il ne
souffrit.
Depuis de longues années, André Paul-Leroux travaille avec acharnement
mais dans un secret presque complet, un secret systématique, un secret
jaloux, même. Peu d'hommes franchirent le seuil de son atelier si
beaucoup eurent le plaisir d'entrer dans sa paisible et claire demeure.
Cette... réclusion artistique est fatale à tous les individus peu
racés, à toutes les volontés hésitantes, à toutes les natures
incomplètement douées. La plupart des solitaires, ne possédant pas un
excès de substance suffisante pour leur permettre de vivre sur
eux-mêmes, tournent en rond sans progresser ou s'affolent et divaguent,
ou encore s'épuisent et meurent dans l'impuissance et le découragement.
Seuls, quelques êtres d'exception supportent ce redoutable régime :
alors leur vigueur se concentre dans une sobriété de grand style, leur
personnalité se développe et se précise en toute liberté, leur facture
s'affirme et s'assouplit sans recourir aux trucs d'atelier, aux
procédés d'école, aux routines, aux manies des professeurs officiels ou
autres — trucs, procédés, routines, manies qui sont la négation de
l'originalité et la séduisante barrière fermant la route de la
Perfection, — André Paul-Leroux est manifestement un de ces êtres
d'exception.
Le fait d'être normand lui conférait
de plano
une sorte d'originalité native et, en s'adonnant au paysage, il a, en
dernière analyse, suivi la norme dégagée par A.-H. de Liesville dès
1871 : « Il nous semble voir chez les artistes de Normandie, écrivait
l'érudit régionaliste, une prédisposition de paysagistes. C’est dans le
paysage qu'ils montrent le plus d'originalité ou que leurs efforts sont
le mieux soutenus et le plus heureux » (1). Mais combien cette
originalité racique s'est développée ! Comme cette prédisposition s'est
métamorphosée en prédilection, en vocation, en passion !... Peu
d'artistes vivants ont autant profité du travail dans la solitude, — ce
régime des forts !... — Hormis Hanicotte, français devenu hollandais à
force de ne pas quitter Volendam ; François Nicot rivé à sa Bourgogne —
quoiqu'il ait voyagé plusieurs fois en Orient et en Riviera, — et
Antonio Parreiras, le maître brésilien, durant la première partie de sa
carrière, — je ne vois guère, parmi les artistes vivants, que le
bas-normand J.-L. Rame, découvert par Albert Boissière, qui se soit
soumis avec profit à la discipline de l'isolement. Mais J.-L. Rame
conserve, avec son amour des herbages, une insensibilité de berger, —
alors qu'André Paul-Leroux vibre, cherche et pense. J.-L. Rame voit
tout. André Paul-Leroux
vit
tout. Je ne puis par conséquent les mettre en parallèle, — sauf en ce
qui concerne leur naissance, et leur ascension de la vie populaire à la
vie artistique. Encore l'analogie entre deux carrières serait-elle plus
frappante entre le jeune maître fécampois et son confrère parisien Jean
Bidon, lauréat du Salon comme lui, et comme lui ancien ouvrier peintre.
A la vérité, il faut, en ce qui concerne André Paul-Leroux, prendre le mot
ouvrier
dans son magnifique sens de jadis, — car le père de l'artiste, —
noblement tourmenté lui-même par ses goûts artistiques — dirigeait la
meilleure entreprise de peinture et de décoration de Fécamp, au temps
de mon enfance. Si André Paul-Leroux put, de bonne heure, consacrer
tous ses instants à créer de la beauté, c'est, en partie, au labeur de
son père qu'il le doit, — et s'il a endossé, de bonne heure, la blouse
du tâcheron, c'est encore par la volonté prévoyante du chef de famille
qui, comme tout
fils de ses œuvres
de cette époque, riche d'expérience et conscient de ses
responsabilités, voulut armer sa progéniture contre les ressacs
possibles de la vie en lui « mettant un métier dans les mains. » Aussi
dès l'âge de treize ans et demi — André Paul-Leroux naquit à Fécamp le
25 janvier 1870, — le jeune maître commença-t-il, sous la direction
paternelle, l'apprentissage du métier de peintre en bâtiments. Il
s'initia, dans les maisons bourgeoises, dans les usines de la ville et
dans les châteaux des environs, aux secrets de la pose... et de la
casse des carreaux ; il s'achemina vers la peinture de marine en
couvrant de teintes variées les carènes et les cabines des bateaux
pêcheurs et des terreneuviers. Il n'a, du reste, conservé de ce
laborieux passé aucune amertume ; seule une sensation de fatigue
physique et de lassitude intellectuelle rétrospectives, demeure en lui
parce que contre elle l'étude de la nature fut un tonique puissant.
Il ne lui était possible de peindre, pour lui, que le dimanche — « et
encore pas tous les dimanches, confesse-t-il, car dans les saisons de
presse il fallait ignorer le repos hebdomadaire. » Il faut l'entendre
évoquer avec une émotion simple, douce, charmante, ces « dimanches de
peinture » qui figurent parmi les meilleurs souvenirs de toute son
existence.
Plus tard, beaucoup plus tard, quand il fit mieux que balbutier sa
manière,
il eut, par un heureux hasard, de précieux conseils techniques. Les
parisiens villégiaturant à Yport, avaient, à cette époque, l'habitude
de venir faire leurs emplettes tous les samedis au marché de Fécamp. O
marchés du samedi pleins de couleur, de discussions pittoresques et
d'odeurs champêtres ! O rose et blanche mère Vincent qui, du
Bec-de-Mortagne, apportiez des paniers si pansus, pleins d'un beurre
qui semblait avoir volé toute sa saveur, en chemin, aux noisetiers des
talus limitant les
cavées !…
A l'instar d'Etretat, Yport a, de tous temps depuis Alphonse Karr,
abrité une colonie estivale d'hommes de lettres et d'artistes. La
plupart de ces artistes étaient liés amicalement au père d'André
Paul-Leroux. Ils lui rendaient visite le jour du marché — et c'est à
ces circonstances que le maître Fécampois dut de connaître Guillemet
qui, le premier, reconnut ses dons. Grâce aux conseils de Guillemet, le
jeune peintre put d'abord éviter bien des tâtonnements, achever
d'apprendre l'indispensable
métier
de son art — et goûter, dès 1893, la joie profonde de voir une de ses
œuvres admises au Salon. Oh ! cela ne le grisa guère : si, depuis, son
envoi annuel au Salon fut la seule manifestation publique qu'il accorda
à son labeur, il affirme, — avec la mesure, la bonhomie, la sincérité,
qui sont les caractéristiques et les séductions de son caractère, — que
cela est, en somme « une manière de stimulant qui nous aide à faire des
efforts et à gagner cette... fausse considération que le public
accorde, en province, à ceux qui exposent au « Salon de Paris ».
De 1893 à 1910, il mena de front le Paysage et l'entreprise de peinture
qu'il dirigea après la disparition de son père ; puis, l'art le prenant
de plus en plus, il se retira définitivement des affaires, en juillet
1911, s'installa dans sa gentille demeure de la rue Paul Casimir-Périer
érigée à l'endroit où s'éleva jadis la vénérable église de
Saint-Fromond, et, sur toute la gloire éteinte de ce qui fut le vieux
Fescan en Normandie, poursuivit dans le silence, la retraite et le travail, la construction de l'œuvre qui fera sa gloire.
Je sais qu'il en doute, au point qu'il m'écrivait naguère : « ... Avant
cette malheureuse guerre qui a tout arrêté, je commençais, peut-être, à
entrevoir le moment où j'aurais pu constater les premiers résultats des
efforts de toute ma vie. » Il doutera ainsi de lui-même jusqu'à sa
mort, — mais il sera seul à douter. Il m'apparaît dès à présent, pour
Fécamp, comme l'équivalent de ce que Boudin reste pour Le Havre, — et
son œuvre est, à mes yeux, d'une qualité d'émotion bien supérieure à
celle du peintre de la côte havraise.
André Paul-Leroux n'est pas un promeneur, un amateur, un passant qui
cueille une impression au hasard, sans insister, sans appuyer, sans
rien donner de lui-même. Or, toute valeur personnelle mise à part, il y
aura toujours une différence singulière entre la peinture du pays faite
par l'homme de ce pays et les essais du spectateur qui s'extasie et va
plus loin. De Liesville, que je citais tout à l'heure, remarque
judicieusement, à ce point de vue, « que les Flamands et les
Hollandais, par exemple, ont bien conservé le privilège d'être
artistiquement maîtres de leur pays ».
André Paul-Leroux a totalement acquis ce privilège quant au pays de
Caux et surtout à la séduisante région fécampoise. L'immense travail de
fusion et de nivellement qui s'opère dans la capitale n'a eu ni la
moindre action, ni même la moindre prise sur lui, qui manifeste avec
les dons d'une nature d'élite et l'habileté d'un praticien sûr de sa
technique, le tempérament local dans son intégrité. Il a su, il a pu
rester étranger à la terrible synthèse générale de l'art dans laquelle
disparaissent tout entiers le caractère régional et l'accent de
l'individualité. Cette synthèse est si violente qu'elle a parfois
paralysé, sinon anéanti, des talents, même venus des régions les plus
lointaines et en apparence les plus réfractaires à cette sorte
d'absorption. Le peintre Domingos Vasquez, de Rio-de-Janeiro, pourtant
prodigieusement doué, y perdit ses meilleurs dons, sa personnalité et
même son courage, — car il mourut de chagrin (2).
Autodidacte presque intégral, André Paul-Leroux n'a été ni surpassé, ni
même égalé, par personne dans l'art de marier le sol, la mer et le ciel
du pays de Caux de manière à ce que la vie intense de chacun de ces
trois éléments pittoresques s'additionne, s'amalgame à celle de
l'élément voisin pour former un tout exact, contenant le maximum
d'animation, d'émotion et de poésie.
Il ne donne un titre à ses toiles, à ses panneaux, à ses cartons, que
rarement. La plupart de ses études portent, au dos, une date et une
heure : 24
décembre, 3
heures du soir, — 14
août 10
heures du matin...
André Paul Leroux regarde sa petite patrie comme un enfant inquiet
observe les expressions changeantes du visage de sa mère.
L'ensemble de cette œuvre patiente, obstinée, attendrie et variée,
forme et formera de plus en plus un monument unique, d'un intérêt
puissant, élevé à la magnificence de nos nuages ; de nos sillons et de
nos vagues.
L'art d'André Paul-Leroux est sûr de lui-même. Sa peinture est d'une touche franche, dédaigneuse des
pignochages quoique soucieuse du détail
utile.
Il manie la gouache avec une prédilection visible et avec une habileté
rares. Je connais de lui des gouaches « grandes comme ça » qui disent,
en quelques taches, toute la mélancolie de nos automnes striés d'ondées
amollissant l'argile des sillons et flagellant les vagues gémissantes,
— toute la douceur et toute la clarté de nos printemps débordants de
pommiers fleuris, nos printemps à la fois chauds et frais sous le
soleil revenu et la brise maritime accourue de l'horizon où les flots
s'allongent comme une bande de vieille soie, — toute la douleur de nos
hivers neigeux étoiles de sombres vols d'oiseaux migrateurs, — toute la
magnificence de nos étés qui font de nos campagnes un océan d'or soudé
à l'océan bleu, — tout le pittoresque de nos
valleuses
dégringolant entre deux falaises criblées de scabieuses et de joncs
marins, — toute la paix de nos chaumières à colombages, faîtées de
touffes de rhubarbes et de lames d'iris, — toute la splendeur
tourmentée de la Manche, « cette éternelle geigneuse, grosse de rêves
et de sanglots, la grande diseuse de légendes » résumant en elle « la
plaine et la forêt, plaine mouvante des vagues, forêt bruissante
d'algues et de madrépores » comme l'a chantée Jean Lorrain qui — dans
une des deux seules critiques des Salons annuels qu'il consentit à
signer — signala, il y a quinze ans au moins, l'un des envois du jeune
maître, son compatriote.
Au moment de la déclaration de guerre, André Paul-Leroux commençait une
importante série d'études de nos falaises, — nos falaises blanches,
grises, dorées, majestueuses, éclatantes et spectrales tour à tour, qui
fuient à droite, qui fuient à gauche, toujours diminuées vers l'infini.
Au lieu de contempler ces parois à pic de la grève ou de la côte
voisine, il les « prenait » du sommet en regardant le vide —
interprétation audacieuse et neuve qui semble bien être le meilleur
moyen d'unir et de faire sentir au spectateur la grandeur immobile du
calcaire et la grandeur mouvante de l'eau.
Je ne désespère pas d'amener André Paul-Leroux, — malgré la résistance
opiniâtre qu'il m'opposa toujours lorsque je voulus le mettre au rang
qu'il doit occuper — à réunir dans une exposition d'ensemble ses œuvres
de naguère, ses falaises vues du faîte, les panneaux sur lesquels il a
reconstitué, telle qu'elle fut à la fin du dix-septième siècle, notre
vieille abbatiale fécampoise — dont le silence se peuple si volontiers
des vibrations endormies de son illustre passé — et ses travaux de
demain. Ce serait pour les amateurs de Paris et d'ailleurs une
révélation.
Certes, jamais Fécamp n'a manqué d'enfants remarquables dans toutes les
branches de l'activité humaine. Au seul point de vue artistique cette
antique ville a fourni, à l'époque contemporaine, des peintres, des
sculpteurs, des aquafortistes nombreux encore que de valeurs diverses,
— tels : Max Claudel céramiste et statuaire habile, dont le
Robespierre mourant
n'est pas indifférent ; Alexandre-Saturnin Bertin qui eut le tort
d'être le trop docile élève de Cabanel et celui, plus grave encore, de
quitter son pays ; François Devaux, auteur du
Monument du Docteur Fauvel,
érigé à Pavilly, et des statues décorant le portail de l'église de
Caudebec-lès-Elbeuf ; Paul Vasselin, dont ma petite enfance ne connut
que par ouï-dire l'accoutrement dixhuitcentrentesque et la pipe
alsacienne, — que je possède encore : Victor-Emile Hamel, élève du
précédent, auteur d'une
Ferme à Criquebeuf digne d'attention ; Louis-Alexandre Devaux, créateur d'un estimable
Buste de Louis Brune, etc. ; — mais aucun ne peut, même de loin, être comparé à André Paul-Leroux.
A l'heure présente, une véritable
Ecole de Fécamp
s'adonne à l'art pictural, non sans bonheur. Citerai-je les
intéressants efforts dignes d'être encouragés (et suivis), d'Henri
Burel, de l'Abbé Denis, de René Crevel, de Charles Laperdrix, élève de
Paul-Colin — Paul-Colin qui appuya si souvent de belles nymphes à
l'écorce argentée des saules de chez nous ! — de Marcel Simonin,
d'Emile Caniel, de Maurice Talbot ?...
La tentation m'est souvent venue de placer cette curieuse et vivante
Ecole de Fécamp sous l'égide d'André Paul-Leroux, — mais je n'ai pu obtenir qu'il
reconnaisse
qui que ce soit d'autre que les conseils donnés par lui, de loin en
loin, à M. Henri Burel. Au Surplus, depuis plus de deux ans, — plus
austère en cela que nos « poilus » eux-mêmes qui nous demandent de les
entretenir d'autre chose que de guerre — Leroux ne veut pas parler de
peinture. Il s'est donné tout entier à l'installation de l'
Hôpital du
Casino, que dirige avec tant de noblesse et de bonté Lady Guernsey.
M. Duglé, le vaillant maire de notre ville (anglo-belge, pour l'heure,
et fière de l'être) l'associe à toutes les manifestations de la
philanthropie locale. S'il arrive au jeune maître fécampois de risquer
une étude, il ne le fait qu'avec une sorte de honte et de remords : il
lui semble, je crois, que son Art dérobe des heures au service de la
Patrie.
Que cette rapide étude — de laquelle il me gardera peut-être rigueur,
mais je fais toujours mon devoir sans me préoccuper des conséquences, —
lui rappelle que fixer de la beauté demeure, après l'accomplissement
d'exploits militaires et d'actes philanthropiques, une des plus nobles
manières de servir durablement la Petite et la Grande Pairies.
Georges NORMANDY.
(1)DE LIESVILLE. Les Artistes Normands au Salon de 1874 (Champion éditeur). Imprimé à Caen, Chez Le Blanc-Hardel, à 156 exemplaires
(2) « …….Vasquez partit pour l'Europe afin d'y étudier sous la
direction d'Hanateau. Ce dernier, de qui la grande réputation —
imméritée — l'attirait, fit, en peu de temps, un « maniériste » du
disciple préféré de Grimm, lui imposa ses recettes, ses tics et une
façon étroitement académique et conventionnelle de peindre le
paysage... » Quand Vasquez revint du Brésil quelques années plus tard,
« ses nouvelles productions péchaient par le manque de perspective
linéaire et surtout aérienne. Les ciels avançaient sur les
premiers-plans, s'aplatissant horriblement sur les lointains. La poésie
autrefois si fréquente dans les tableaux de Vasquez avait disparu. En
son lieu et place on ne voyait que la préoccupation de copier la nature
mécaniquement, servilement. De là, la monotonie des tableaux peints par
Vasquez à cette époque, monotonie si grande qu'en unissant une toile à
l'autre, l'ensemble n'aurait formé qu'un seul tableau, — si réguliers
étaient l'égalité des tons, la répétition des lignes et jusqu'au choix
du sujet. Mêmes teintes, même lumière, mêmes ombres, mêmes touches,
mêmes effets partout comme si tous ces tableaux eussent été peints au
même endroit, en même temps, sous le même éclairage et avec des
couleurs invariables ! Quand un artiste se répète et se maniérise de la sorte, il est perdu. Et Vasquez prit conscience de sa chute ». ANTONIO PARREIRAS, Grimm et ses disciples. (Traduit du texte original publié par le Jornal do Cornmercio.)
*
* *
Don au Musée d'art normand :
Une reproduction de la Flèche de la cathédrale de Rouen.
— Il vient d'être offert par le maître ferronnier, Ferdinand Marrou, au
Musée d'art normand, une pièce fort intéressante pour l'histoire
locale. C'est la reproduction en fer, sur une échelle réduite mais
exacte de la Flèche en fonte de la cathédrale de Rouen, due à
l'architecte Alavoine. Cette sorte de petit modèle dressé sur les plans
de M. Barthélémy, alors architecte diocésain et exécuté par la maison
Filleul, avait été fait dans le but de servir à M. Ferdinand Marrou,
pour l'étude des quatre clochetons ou pinacles, hauts de 25 mètres,
établis et exécutés par lui en cuivre repoussé au marteau, à la base de
la Flèche actuelle.
BOURG-ACHARD
Une belle initiative vient d'être prise par le
Syndicat agricole du Roumois
que préside avec une superbe activité, malgré ses 77 ans, superbement
portés, le bienfaisant ami de l'Agriculture qu'est M. Emmanuel Boulet,
de Bosc-Roger-en-Roumois, commandeur du Mérite agricole, fondateur du
fameux
Club Français du Chien de berger,
et créateur de l'illustre race de chiens qui porte son nom : le grillon
Boulet. M. Emmanuel Poulet a tenu, au nom du fort utile
Syndicat agricole de Roumois à récompenser spécialement les cultivatrices (et les jeunes travailleurs) «
QUI ONT ENSEMENCÉ TOUTES LEURS TERRES ET OBTENU DE BONNES RÉCOLTES PENDANT L'ABSENCE DE LEURS MARIS MOBILISÉS. »
Les récompenses ont été décernées le mardi de Pâques, à dix heures du
matin, dans une réunion publique, tenue à Bourg-Achard dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville. Malgré un temps affreux, rafales de neige et
de grêle, une assistance nombreuse se pressait dans la salle. C'était
une véritable réunion de famille, où n'avaient été convoqués que des
lauréats et les membres du
Syndicat agricole du Roumois,
mais par son caractère même, elle avait une portée générale. M.
Emmanuel Boulet en a exposé l'objet dans une allocution empreinte de ce
culte passionné, patriotique, qu'il porte aux choses de la terre et
d'une sorte de sentiment paternel pour tous ceux qui la travaillent et
la font produire. Nous tenons à reproduire le passage suivant de son
discours simple, sincère et fort émouvant :
« ...Notre réunion d'aujourd'hui est spéciale. Nous la faisons sur la
demande de plusieurs de nos collègues el de M. Beaudelin, l'un des plus
dévoués membres de notre Comité, à Bourg-Achard situé presque au centre
du Roumois, pour faciliter la présence de nos lauréates habitant aux
extrémités. Elle a pour but, selon la décision prise, au deuxième
anniversaire des hostilités, la remise de diplômes d'honneur et de
mérite aux cultivatrices, femmes de nos adhérents mobilisés qui, en
l'absence de leurs maris ont su, par leur organisation prévoyante, par
leur travail opiniâtre, par leur activité et leur labeur quotidien,
mener à bien la culture de leurs fermes, ensemencer toutes leurs terres
et obtenir de bonnes récoltes.
C
ES FEMMES, D'UNE VAILLANCE INCOMPARABLE, disait l'an dernier M. le ministre Méline, à l'Académie d'Agriculture,
ONT TROUVÉ LE MOYEN DE SUFFIRE A TOUT ET LA FRANCE LEUR DEVRA DE N'AVOIR PAS CONNU LA FAMINE. »
Nous avons fait imprimer ces paroles sur les diplômes parce qu'elles
émanent d'un homme que tous les cultivateurs français doivent vénérer
pour les services qu'il a rendus à l'agriculture pendant près d'un
demi-siècle, et que nous avons l'honneur de compter parmi nos collègues
du Syndicat depuis sa fondation. Nous allons aussi décerner des
diplômes à une jeune fille et à des jeunes gens âgés de 14 à 18 ans qui
nous ont été désignés comme ayant, avec courage, énergie et
intelligence, beaucoup aidé leur mère dans les travaux et la direction
de la ferme. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et
avons l'espoir qu'ils resteront tous à la terre, qu'ils suivront
l'exemple, de leurs parents et qu'ils feront comme eux de bons
agriculteurs. Toutes nos lauréates ont été désignées par les membres du
Comité après attestation de MM. les maires et de MM. les présidents des
Comités communaux d'action agricole. Nous les avons inscrites par
lettres alphabétiques, parce que d'après les dossiers et les
renseignements reçus, le classement par ordre de mérite n'était pas
possible ; beaucoup d'entre elles méritaient également la première
place. Nous sommes heureux et fiers de vous en féliciter, Mesdames.
Nous savons aussi que d'autres cultivatrices très méritantes également
et qui travaillent durement tous les jours du matin au soir n'ont pu
cependant remplir les conditions exigées pour obtenir le diplôme à
cause du manque de main-d'œuvre principalement de
charretiers-laboureurs. Nous le regrettons profondément, d'abord parce
que des terres destinées à être emblavées n'ont pu être labourées et
que la récolte du blé s'en trouvera réduite, ensuite parce que les
sachant très travailleuses et très dignes sous tous les rapports et les
ayant en grande estime nous eussions été heureux de pouvoir leur
décerner également des diplômes. Dire les mérites de certaines
cultivatrices est chose impossible, on ne peut trouver de qualificatifs
suffisants pour leur rendre hommage, on ne les citera, on ne les
récompensera, on ne les honorera jamais trop. Si leurs maris, leurs
fils, leurs frères font la guerre pénible des tranchées, elles font la
guerre économique, moins dangereuse sans doute, mais demandant un
effort considérable et un travail de tous les instants. C'est grâce à
elles, souvent aidées par leurs ascendants et leurs enfants, que nos
armées ont pu être alimentées. C'est grâce à elles que jusqu'à présent
nous avons tous pu ne manquer à peu près de rien. »
Et nous sommes particulièrement émus de lire au palmarès les noms
d'aussi vaillants petits français que ceux dont les noms suivent : Mlle
Marthe Fouquet, à Flancourt, âgée de 17 ans. — M. Mary Caillouel, à
Epreville-en-Roumois, 19 ans. — M. Marcel Grout, à Rougemontiers, 18
ans. — M. Edouard Lefrançois, à Epreville-en-Roumois, 17 ans. — M.
André Leroy, à Rougemontiers, 15 ans. — M. Gilbert Martin, à
Berville-en-Roumois, 16 ans. — M. Eugène Mary, à Rougemontiers, 17 ans.
— M. André Perrier, à Bosc-Roger-en-Roumois, 14 ans. — M. Maurice
Rouas, à Saint-Ouen-de-Thouberville, 18 ans. Si nous donnons une
importance exceptionnelle à cette manifestation dans nos colonnes où la
place est si mesurée, c'est que nous désirons vivement voir
l'initiative de M. Emmanuel Boulet se propager partout pour le plus
grand bien de notre vaillant et cher pays normand.
CAEN
— La Chambre de commerce de Caen a adopté à l'unanimité le rapport de
M. A. Marie sur l'avant-projet du nouvel élargissement du canal de Caen
à la mer, ainsi que la combinaison financière permettant d'exécuter ces
travaux dont le montant s'élèvera à dix millions de francs, la moitié
de cette dépense devant incomber à la Chambre de Commerce. A celle-ci
viendra s'ajouter la somme de 2.850.000 francs, part contributive de la
Chambre de Commerce dans l'exécution de la première partie du projet
d'ensemble des travaux à exécuter au port de Caen, qui ont été déclarés
d'utilité publique par décret du 1er février 1917.
Le Congrès des Maires des principales villes de l'ouest. — Le Congrès des maires de l'ouest, qui s'est tenu à
Caen,
sous la présidence de M. René Perrotte, maire de cette ville,
réunissait les représentants des villes suivantes : Nantes, Le Havre,
Brest, Rennes, Tours, Le Mans, Lorient, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc,
Niort, Chartres, Dieppe, Elbeuf, Alençon, Sotteville-lès-Rouen,
Saint-Malo, Saint-Lô, Gran-ville, Falaise, Bayeux, Vire, Pont-Lévêque,
Quimper, Dreux, Bernay.
HONFLEUR
L'OMBRE DE LA CHAPELLE. — Sous ce titre, notre collaborateur, M.
Camy-Renoult, a réuni un choix de ses meilleures poésies. Les éditions
de
Lettres et Arts, 7, rue
d'Amboise, à Paris, viennent de mettre sous presse ce petit livre qui
va paraître sous forme de plaquette de luxe, sous couverture illustrée,
qui sera vendue un franc cinquante. Lucie Delarue-Mardrus a écrit
pour
L'Ombre de la Chapelle...,
une préface qui en doublera l'intérêt. « Chez nous », chacun voudra
lire ce livre d'un Honfleurais, présenté par une glorieuse
Honfleuraise. Afin de faire participer l’
Œuvre de secours aux prisonniers honfleurais au bénéfice de son édition, l'auteur a décidé de réserver un nombre limité d'exemplaires,
numérotés à la presse et signés (hors commerce)
aux souscripteurs qui se feront inscrire dès à présent pour un
versement minimum de trois francs sur la liste ouverte et en tête de
laquelle MM. R. Poincaré, E. Flandin, etc., figurent déjà.
___________________________________________________________________________________________________________
L'abondance des Matières nous oblige, à notre grand regret, à remettre au prochain numéro la publication du PALMARÈS NORMAND.
____________________
Le Gérant : MIOLLAIS.
_________________________________________________________
IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur.
[3e de couv.]
La Naissance de « Normandie... »
... A été saluée avec la plus grande sympathie par la plupart des
journaux et des revues de notre glorieuse région. Que,
particulièrement, Le Nouvelliste d'Avranches. Le Journal de Rouen,
L'Echo de la Vallée de Bray, La Dépêche de Rouen, L'Elbeuvien, L'Avenir
du Vexin, L'Impartial de Dieppe, Le Patriote Normand (de
Flers-de-l'Orne), Le Journal de Flers, Le Courrier de Domfront, La Race
(de Marseille), etc., et dans la capitale, Paris-Journal, La France,
etc., reçoivent ici nos remerciements. Nous essaierons de mériter
entièrement leurs éloges déjà très chaleureux. LA REDACTION DE
NORMANDIE.