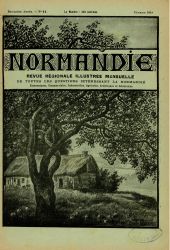Vers une Action Normande
VII. – LES MAUX DU MONDE
AGRICOLE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
O nimium
agricolas !
Je m’excuse de la sécheresse, de l’aridité de cette partie de nos
études. Les lecteurs de «
Normandie » voudront encore bien me tolérer
le « genre ennuyeux » pour un article ou deux. Le rôle des Cassandre
n’a jamais été enviable, bien qu’il ne manque pas d’être utile : j’aime
encore mieux le jouer que celui trop facile et si néfaste de « bourreur
de crânes ». N’oublions pas, au surplus que nous dressons un bilan, un
inventaire et que de tels travaux n’ont jamais été considérés comme
attrayants. Mais comment s’en passer ? Un commerçant qui veut connaître
où en sont ses affaires, avant de repartir sur des bases nouvelles, ne
peut s’y soustraire. Si nous voulons voir clair dans la tâche de
demain, débrouiller le travail immense qui nous attend, il nous faut
bien faire comme l’honnête et diligent commerçant. Continuons donc
notre examen par celui des maux dont souffraient le monde agricole
d’abord, le monde industriel et commercial ensuite, dans les années qui
ont précédé le cataclysme mondial.
A)
La Crise agricole
Je ne puis écrire ce titre sans que reviennent à ma mémoire, les mots
par lesquels commence ce chef-d’œuvre de touchante poésie qu’est :
The
Deserted Village, d’Olivier Goldsmith :
O sweet Auburn, o the loveliest village of the Plain ! (1)
Ce vers retentit douloureusement dans mon cœur. Moi aussi je suis né à
l’ombre d’un « Clocher dans la plaine », et le cher village dans lequel
s’éveilla ma sensibilité normande est bien près de partager le sort du
village chanté par le poète anglais : morne, désert, abandonné !
Et si, sur la ligne de feu, dans les abris profonds de notre terre de
France, l’idée m’est venue, à moi, que rien ne désignait
particulièrement pour cette tâche, d’apporter ma pierre à l’édifice de
demain, c’est que je m’y suis senti poussé par cette force
inexplicable, mystérieuse mais
qui est, et dont Maurice Barrès a
donné l’heureuse formule : La Terre et les Morts ! Et si je n’ai
pas résisté à cet autre appel du sol, c’est que je crois, en toute
conscience, avoir comme tant d’autres, ma part de responsabilité dans
la désertion de mon village natal. Ce n’est qu’aujourd’hui, à l’âge de
la maturité, que j’ai compris que ne pas rester fidèle à sa terre,
c’est manquer à un devoir sacré : quelle plus noble tâche que celle de
faire sortir du sol nourricier, légué par les ancêtres, les blonds épis
! Quel labeur plus utile ! Quelle profession est plus
indépendante et – ce qui achève de la rendre enviable entre toutes –
quelle vie est plus saine et plus justement honorée ?
Cependant, nos campagnes de France se dépeuplent avec une effrayante
rapidité. Et les plus riches provinces sont les plus mortellement
touchées. Qu’on se reporte pour notre opulente Normandie, aux études si
probes, si documentées, de ce bon ouvrier de lettres, de ce clairvoyant
compatriote qu’est Henri Blin, et l’on sera édifié. Je lis chaque mois
dans cette revue, avec un intérêt sans cesse accru, les sages conseils,
les consciencieux exposés de cet homme de bien, et je crois reconnaître
chez lui aussi – déraciné comme moi – la Voix de la Terre et des Morts.
Je m’en voudrais d’insister après lui : il a tout dit sur cette grave
question. Qu’il me permette seulement d’apporter à l’appui de ses
judicieuses et affligeantes statistiques, le fait suivant :
Au temps de ma toute prime enfance, mon village avait encore les
apparences de la prospérité – je dis les apparences, car bien des
ménages n’avaient qu’un ou pas d’enfants, bien des nids étaient sans
oiseaux ! – mais toutes les maisons étaient habitées et la vie y
paraissait normale.
Deux ans avant la guerre, le chiffre de la
population était tombé de 40 % : les vieux s’en étaient allés reposer
sous les pommiers bas, dans l’enclos funèbre à l’ombre d’un clocher,
dont les voix se sont à peu près tues ; deux ou trois enfants uniques,
malgré leurs jeunes années, les y avaient prématurément rejoints ; des
filles ont quitté le « derrière des vaches » pour les villes
prochaines… et décevantes, les garçons ont fait de même. Aujourd’hui,
beaucoup de maisons de mon village sont fermées : la vie se retire, les
actuels occupants se lamentent sur les difficultés qu’on rencontre à
trouver la main-d’œuvre nécessaire… c’est la « Terre qui meurt !
» Cependant « pastourage et labourage n’ont pas cessé d’être les
mamelles de notre grasse Normandie, ses vraies mines d’or du Pérou » :
cependant la guerre a démontré, ainsi que je le disais au début de ces
études, que la Race n’a rien perdu de ces magnifiques qualités qui en
ont fait une des premières du monde ! Lisez la
Douce France, de René
Bazin, lisez cette série d’études publiées dans l’
Echo de Paris sur
l’héroïsme des femmes de la terre pendant la grande guerre, feuilletez
enfin cet autre livre d’or des rudes et des obscurs héros du front de
l’arrière ; les discours sur les prix de vertu, et vous verrez que la
Race de nos admirables paysans de France n’a pas dégénéré au vrai sens
du mot. Pourtant il n’est que trop vrai que l’histoire de mon village
natal n’est qu’un exemple pris entre mille et que le cri d’alarme de
René Bazin répond à une angoissante réalité. Il n’est que trop vrai que
le paysan ne veut plus d’enfants pour ne pas diviser le patrimoine,
qu’il rêve de faire, de son fils unique, un bourgeois habitant de la
ville, parasite souvent, déraciné toujours. Et cependant Bourget dans
l’
Etape, après le Barrès des
Déracinés, a montré le danger de ces
transplantations sans transition. Par quelle aberration ce sage, cet
observateur, ce méditatif au labeur lent et patient, qui sait que le
temps, l’effort, la continuité sont les facteurs nécessaires des
entreprises prospères a-t-il été amené à commettre ces fautes contre
ses véritables et lointains intérêts ? Nous essaierons de l’expliquer ;
mais dès maintenant, en présence de contradictions aussi étranges, nous
pouvons bien dire qu’entre la Race et le Milieu il y a incompatibilité…
Alors ?... Que conclure, si ce n’est que cette race vigoureuse observe
une hygiène déplorable, que son véritable milieu vital lui fait défaut,
qu’elle respire un air empoisonné, se nourrit de fruits qui ne
conviennent pas à sa vraie nature ! Lorsque nous examinerons les
causes, nous verrons quelles idées fausses ont fait adopter ce
détestable régime et nous constaterons une fois de plus que les idées
sont des forces, qu’elles tuent aussi sûrement que les balles et les
obus lorsque du domaine de l’abstraction elles passent dans celui
des faits concrets.
Cette désaffection pour la terre des aïeux se trouve aggravée de ce
fait que l’Individualisme forcené auquel nous avons déjà fait allusion
s’est profondément enraciné dans le cœur du paysan où il a trouvé un
terrain exceptionnellement favorable. Si la terre est féconde, elle ne
l’est pas sans effort : souvent elle est dure à l’homme des champs. Les
intempéries, l’inclémence des saisons, parfois, anéantissent en un clin
d’œil, le fruit d’un labeur persévérant et opiniâtre. Et le paysan rude
à lui-même l’est aussi aux autres. En un siècle où la richesse, la
prospérité, le développement économique ne valent que par comparaison,
où la loi de la concurrence est devenue internationale, mondiale, et
nécessite des groupements, des ententes de plus en plus étroites, le
paysan de France est demeuré un isolé, vivant encore trop souvent
replié sur lui-même, les yeux rivés à terre, indifférent à des progrès
d’ordre scientifique, économique et social d’un intérêt vital pour lui
cependant. Loin de moi la pensée de méconnaître les effets bienfaisants
dans beaucoup de régions de France, des Syndicats agricoles,
Associations, Mutuelles d’assurances (contre la grêle, la mortalité du
bétail), des Groupements laitiers, puis des Sociétés de Crédit
agricole, mais franchement nous ne faisons qu’entrer timidement dans
une voie où se sont engagés à fond et pour le plus grand profit du
petit et du moyen cultivateur, des pays beaucoup moins riches que le
nôtre au point de vue agricole. Le Danemark, la Hollande, la Suisse
même pour ne citer que les tout petits, nous donneraient à cet égard,
des leçons de choses pénibles pour notre amour-propre national. Les
revues anglaises et allemandes d’avant-guerre, témoigneraient si
c’était nécessaire, des avantages insoupçonnés chez nous, qu’en des
régions presque déshéritées par la nature, les étrangers ont su tirer
des associations pour les achats et les travaux en commun. C’est en
vertu des mêmes causes que des routines tenaces s’opposent à la «
modernisation » des maisons de paysan, à l’industrialisation de
certaines branches agricoles ainsi qu’à une solution plus avantageuse
pour patrons et ouvriers, du problème de la main-d’œuvre dans les
campagnes. Je ne veux pas anticiper, mais je note en passant, que notre
Enseignement primaire et que nos professeurs d’agriculture sont loin
d’avoir fait tout ce qu’ils pouvaient pour modifier la mentalité
paysanne à ces différents points de vue.
Il serait injuste enfin de clore cette sorte d’inventaire sans y
inscrire que les familles rurales les plus riches, les plus éclairées,
sont souvent les plus coupables ; elles ont leur large part de
responsabilité dans la crise de la Terre. Au lieu de porter ailleurs, à
la ville le plus souvent, l’or péniblement amassé, mais si honnêtement
dans les sillons du champ paternel, elles devraient consacrer leur
intelligence, leurs ressources à cette Terre dont elles sont issues.
L’aristocratie du sol manquant aux devoirs que lui dicte la Tradition,
donnant l’exemple de la désertion des domaines ruraux, « réalisant »
pour jouir, c’est bien le plus démoralisant tableau qu’on puisse donner
au paysan et ce tableau – faisons notre
meâ culpâ ̶ nous
l’avons offert souvent.
L’élite semble l’avoir compris et le retour à la Terre est plus qu’une
belle formule, mais comme il faudra le favoriser encore. Soyons fiers
de notre village natal, et redisons avec le poète Ch. Péguy, tombé
joyeusement au début de cette guerre :
Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu,
Et les pauvres honneurs des maisons paternelles !
G. VINCENT-DESBOIS.
__________
(1) Oh mon doux Auburn, le plus aimable village de la Plaine !
═════════════════
L’abondance des matières nous oblige à remettre au prochain numéro : La suite de l’Etude sur les
Richesses minières de Normandie et le
Carnet de route d’un Architecte, par Charles Chaussepied.
*
* *
La Vie Rurale
Et la Production Agricole
Au Pays Normand
(Onzième article de la série.)
_______
XI
LES CULTURES ET LE COMMERCE AGRICOLE DANS L’ORNE. – LES CÉRÉALES : BLÉ,
ORGE, AVOINE, SARRASIN. ̶ LES ORGES ET LA BRASSERIE. – LES
MARCHÉS AUX GRAINS. – POMOLOGIE ET CIDRERIE. – LES FRUITS A CIDRE ET
LES PÉPINIÈRES DE POMMIERS. – LES INDUSTRIES DE LA POMME A DÉVELOPPER.
̶ LES MARCS DE POMMES SÉCHÉS. – L’AVENIR DE L’INDUSTRIE CIDRICOLE.
____
La précédente étude sur les transformations de l’agriculture dans le
département de l’Orne (1) a montré que la diminution de la population
de ce département a déterminé une orientation de plus en plus marquée
vers le régime herbager, au détriment de la superficie qui, jadis,
était consacrée à la culture arable (terres de labour.)
Nous étudierons de plus près, aujourd’hui, les éléments de prospérité
de l’agriculture et de l’élevage dans l’Orne, département qui comprend
une partie du Haut-Perche ou Grand-Perche, subdivision territoriale
ayant Mortagne et Bellême comme villes principales. Cette région qui
présente une suite de collines et de vallons couverts de prairies
sillonnées de cours d’eau ou de petits ruisseaux, est remarquable
autant par son ensemble panoramique que par sa grande fertilité.
La nature argileuse et fraîche des terrains est favorable à
l’exploitation du sol en herbages et prairies de vaste étendue,
c’est-à-dire à l’élevage des animaux des espèces chevaline et bovine.
Mais l’agriculture proprement dite a aussi une grande importance malgré
les transformations résultant de l’abaissement des effectifs ruraux et
des difficultés que l’on rencontrait, bien des années déjà avant la
guerre, pour trouver la main-d’œuvre de culture. Sous ce rapport, le
département de l’Orne ne paraît ni mieux ni plus mal partagé, pour son
agriculture, que les autres départements normands.
A la faveur d’une rénovation grandement désirable, l’agriculture de
l’Orne, lorsqu’elle disposera des ressources de main-d’œuvre
nécessaire, pourra certainement mettre en valeur tous les éléments dont
elle dispose. En effet, les produits agricoles qui donnent lieu, dans
ce département, aux transactions les plus importantes, en temps normal,
sont nombreux, et l’on sait que la richesse agricole d’un pays
s’apprécie surtout à l’importance et à la variété des produits du sol
qui, dans l’ordre naturel des choses, acquièrent une valeur d’autant
plus élevée que les terres sont plus fertiles, la culture plus soignée,
et les débouchés assurés. Nous voyons que les denrées agricoles faisant
l’objet du commerce le plus actif, sont les céréales (blé, avoine,
orge, sarrasin) ; les produits de laiterie (beurre et fromages) ; les
fruits à cidre ; les plants maraîchers, et les plants d’arbustes.
Avant la guerre, l’Orne consacrait environ 60.000 hectares à la
production du blé, qui, en année moyenne, atteignait un million
d’hectolitres environ, dont 400.000 hectolitres pour le seul
arrondissement de Mortagne. Cette production était – et à plus forte
raison l’est-elle actuellement – manifestement insuffisante pour
subvenir aux besoins de la population du département ; aussi, pour
combler le déficit, importait-on, bon an mal an, 100.000 hectolitres de
blé sous forme de grain ou de farine. Il est certain que les
difficultés de recrutement de la main-d’œuvre agricole pendant la
guerre ont augmenté considérablement le déficit de la production.
Le commerce du blé s’est modifié avec les années, dans cette région de
la Normandie. C’est ainsi qu’autrefois les cultivateurs apportaient
tout leur blé aux halles, le jour du marché ; mais depuis une quinzaine
d’années, le commerce se fait presque tout entier sur échantillons. Les
meuniers ou minotiers, ou leurs acheteurs commissionnés, achètent aux
100 kilogr., et les livraisons se font directement au moulin. Sur les
halles, on vend, le plus souvent, à la mesure, au double-décalitre, à
l’hectolitre et demi (120 kilog.). Dans les campagnes a subsisté
l’habitude, chez les petits cultivateurs, de porter leur blé au moulin
et de faire eux-mêmes leur pain. Actuellement, avec les réquisitions,
les taxations et les restrictions, les vieilles coutumes de nos braves
gens des campagnes ont dû se plier aux exigences de la situation.
L’usage de porter le blé au moulin pour rapporter la farine à la ferme
et y faire ce bon pain de ménage – que le travailleur de la terre
apprécia toujours comme l’aliment traditionnel – a disparu sur bien des
points et c’est pourquoi les petits moulins utilisant les meules ont
disparu peu à peu, eux aussi, pour faire place aux moulins à cylindres,
ou du moins ne subsistent-ils que là où on les emploie à écraser les
grains destinés à la nourriture du bétail. Bon nombre de cultivateurs
achètent leur pain aux boulangers, ou bien ils fournissent leur grain
en échange d’une quantité déterminée de pain.
La culture de l’orge occupe, dans l’Orne, une superficie de moins de
20.000 hectares, en temps ordinaire ; la moitié de cette superficie
intéresse le seul arrondissement de Mortagne. Sur les 350.000
hectolitres produits, la plus grande partie est consommée dans le pays
même et sert à la nourriture des animaux. Le reste est acheté sur les
marchés, ou sur échantillons, par les marchands grainiers ou par des
commissionnaires. On en vend aussi une certaine quantité aux brasseries
et les orges de la contrée, bien travaillées d’après les bons principes
de fabrication, donnent une bière dont les qualités sont très
appréciées.
Les marchés les plus importants pour la vente des orges sont : Alençon,
Mortagne, Rémalard, Bellême, Sées, Argentan, où l’on trouve des orges
de brasserie, puis Domfront, Flers-de-l’Orne et La Ferté-Macé. De tout
temps, la culture de l’avoine a occupé une large place dans l’Orne. La
plus récente statistique indique 55.000 hectares et une production de
plus d’un million d’hectolitres. Cette production est consommée presque
en totalité sur place ; généralement, il est peu de fermes qui aient un
excédent de la production sur la consommation. C’est que l’élevage du
cheval a besoin de fortes quantités de ce grain. Les vigoureux et
massifs chevaux percherons, en particulier, sont de gros mangeurs
d’avoine, et celle-ci leur doit être d’autant plus nécessaire, que le
régime habituel à l’orge cuite et au son se trouve modifié, du fait des
circonstances actuelles.
L’avoine amenée sur les marchés est achetée par les éleveurs de chevaux
de demi-sang ou les propriétaires de chevaux de luxe. Des achats sont
faits, également, par le commerce et l’industrie utilisant des chevaux
de service, et par les marchands grainiers. C’est un grain qui, en tout
temps, se paie toujours bien, c’est dire que la culture de l’avoine est
une des plus avantageuses parmi les cultures de céréales qui se font
dans l’Orne.
Dans l’arrondissement de Domfront, et les cantons limitrophes, on
cultive le sarrasin ou blé noir ; la superficie occupée par cette
céréale secondaire est de 15.000 à 18.000 hectares. On évalue la
production à 300.000 hectolitres, environ. Les marchés de
sarrasin sont, ordinairement : Domfront, Flers-de-l’Orne, La
Ferté-Macé, Tinchebray, Alençon, Ecouché et Sées.
*
* *
Un bel avenir s’offre à la cidrerie industrielle. C’est une branche de
production vraiment intéressante, une industrie agricole qui permet de
faire acquérir aux fruits à cidre le maximum de valeur commerciale et
de multiplier les débouchés les plus rémunérateurs de la pomiculture.
Les pommes se vendent tantôt sur les marchés, tantôt les fabricants de
cidre vont faire leurs achats dans les fermes. Les fruits à cidre sont
produits dans tout le département, qui possède des pépinières de
pommiers assez nombreuses et importantes, principalement dans les
communes de Tinchebray, Messei, Mantilli, Passais, La Ferté-Macé,
(arrondissement de Domfront) ; Vimoutiers, Almenêches, Le Merlerault
(arrondissement d’Argentan), Courtomer, Alençon (arrondissement
d’Alençon) ; Saint-Maurice-les-Charencei, Mortagne, Rémalard
(arrondissement de Mortagne).
Pour ce qui concerne les pépinières d’arbustes et de plants divers, on
trouve ces pépinières notamment à Vimoutiers, Le Merlerault, Laigle
(arrondissement de Mortagne) et Alençon. En année ordinaire, un certain
nombre de producteurs fabriquent du cidre qu’ils vendent dans le pays
ou expédient sur Paris. Il conviendrait de développer la vente du cidre
sur le marché de Paris, et ce développement commercial serait
grandement facilité par l’industrialisation de la fabrication du cidre
comme le font quelques producteurs avisés, malheureusement trop rares
dans ce département. Bien des années avant la guerre, MM. Rotrou, à
Dorceau, étaient signalés comme s’étant engagés, avec succès, dans
cette voie.
Il y aurait à annexer à l’industrie pomologique, dans l’Orne, comme
dans les autres départements normands, le sèchage des fruits à cidre –
industrie naissante que nous aurons à étudier dans cette revue dévouée
aux intérêts de nos producteurs normands – de même que l’utilisation
des marcs de pommes, notamment par la dessiccation. Nous observons
qu’actuellement les marcs séchés, provenant des cidreries, sont achetés
en totalité par l’Intendance ; c’est pourquoi on ne trouve pas, sur le
marché, ces marcs séchés qui ont une utilisation avantageuse dans
l’alimentation du bétail et peuvent contribuer à solutionner le
problème, en ce moment si complexe, du rationnement économique de nos
animaux de ferme (2). Il y aurait encore une industrie rémunératrice à
développer, après la guerre, celle des cidres champagnisés, qui peut
compter sur des débouchés constants et permettre à nos producteurs
normands de se livrer à l’exportation dans le monde entier. Ils
n’auront pas de peine à concurrencer, au point de vue de la qualité, de
la valeur du produit, ces prétendus cidres mousseux que les Boches,
grâce à leurs emprunts faits à la chimie, osaient présenter comme des
produits de marque, et d’origine française.
Il appartient à notre belle et riche Normandie si heureusement dotée,
sous le rapport du climat, de mettre à profit les trésors de Pomone, de
faire valoir ses richesses fruitières et les hautes qualités de sa
production cidricole, comme les résultats des progrès accomplis dans
l’industrialisation de la pomme. C’est là une œuvre à la fois
patriotique et d’intérêt régional, et qui contribuera à accroître la
renommée des produits du Pays normand sur le marché mondial.
Henri BLIN,
Lauréat de l’Académie
d’Agriculture de Franc.
___________
(1) Voir Normandie, n° 10, de janvier 1918.
(2) Nous consignons ici cette observation pour répondre aux
préoccupations des cultivateurs et propriétaires normands qui
désireraient se procurer des marcs de pommes séchés. Nous complétons
ces renseignements par l’indication de cidreries normandes faisant la
dessiccation des marcs de pommes : MM. Saffrey, à Lisieux ; Périer, à Mesnil-Guillaume (Calvados) ;
Molinié, à Saint-Sever (Calvados) ; Leblanc et Mauduit, à Cormeilles
(Eure) ; Jeanne à Cherbourg ; Turquet, à Pontaubault (Manche). – H. B.
═════════════════
LE CONGRÈS ANNUEL DE LA F. R. F.
________
Le prochain Congrès annuel de la
FÉDÉRATION RÉGIONALISTE FRANÇAISE tiendra ses assises de 1918, à Paris, le jour de la Pentecôte. Il étudiera le passionnant sujet suivant :
LA DIVISION DE LA FRANCE EN RÉGIONS.
Nous croyons inutile de souligner l’importance capitale et du problème
posé et du Congrès qui s’appliquera à le résoudre. Il faut que les
questions économiques capitales, qui devront être rapidement examinées
après la guerre, trouvent nos provinces prêtes à recevoir
l’indispensable organisation nouvelle. Toutes les communications
relatives au Congrès de la *
Fédération Régionaliste Française* doivent être adressées à M. Charles
BRUN, délégué général, 22, rue Delambre, à Paris.
Organisez-vous, car à l’heure de la paix, il ne faudra pas être pris au
dépourvu. C’est d’ailleurs votre intérêt et celui du pays.
*
* *
ACTIVITÉS RÉGIONALISTES
________
Courrier Trimestriel
________
En avril 1912, Octave Uzanne écrivait, à l’occasion du projet d’un
monument à ériger, à Rouen, lancé par M. Pierre Varenne : « …La vie de
Saint-Amant aurait pu tenter un esprit amoureux d’aventures véridiques
et imaginaires à la fois. Cette vie ne fut ni profondément explorée, ni
noblement écrite… La physionomie du
Bon Gros est l’une des plus
solliciteuses qui soient pour un écrivain de loisir nourri d’études du
grand siècle. Le père Dumas aurait pu magnifier quelque peu, à la façon
des imagiers d’Epinal, cette figure poétique ; mais un pur littérateur,
curieux fervent, passionné, ferait mieux assurément que l’auteur de
Monte-Cristo.
» Le projet de M. Pierre Varenne n’a pu aboutir jusqu’à
présent, malgré le concours du sculpteur Fernand David, qui exposa, au
Salon des Artistes Français, une charmante maquette du monument, malgré
la constitution d’un comité réunissant toutes les constellations du
monde des lettres et des arts, malgré la publication d’un manifeste,
malgré l’organisation de spectacles et de conférences, malgré
l’impression de listes de souscriptions élégantes, malgré tout enfin…
Cela alors que nos places publiques sont encombrées d’horreurs
coûteuses célébrant la gloire, pourtant nettement viagère,
d’innombrables politiciens vite oubliés et de tant de grands hommes de
sous-préfecture !... A la vérité, les efforts de M. Pierre Varenne ne
furent pas absolument improductifs puisque, nous déclare-t-il, il reçut
« avec toutes sortes d’encouragements, de marques de dévouement et de
haute estime littéraire, la somme globale de 687 francs, qui ne
suffit même pas à payer les frais de la maquette du monument ». Depuis,
la guerre est venue… Je veux croire, pour l’honneur de notre glorieux
pays normand, ̶ qui ne m’a pas marchandé son concours pour
une entreprise analogue que j’ai pu mener à bien, après six ans
d’efforts, il est vrai, ̶ je veux croire, dis-je, que ce
trop modeste résultat doit être partiellement attribué à l’inexpérience
relative de M. Varenne. Je suppose, en outre, que l’auteur de
Sylvette ou
le Devoir domestique n’a pas abandonné pour cela son
excellent projet. L’ouvrage précieux et charmant qu’il vient de faire
imprimer (1) m’autorise à faire une telle supposition. Cet ouvrage :
Le Bon Gros Saint-Amant (1594-1661), est déjà, lui-même, une manière
de monument, - ou d’esquisse de monument, car l’auteur de
Moyse sauvé
mérite les honneurs du grand in-folio et de l’Imprimerie Nationale – et
je ne me ferais pas beaucoup prier pour avouer que je le préfère à
toutes les effigies de bronze ou de granit.
M. Pierre Varenne semble bien sûr être « le pur littérateur curieux,
fervent, passionné », souhaité par Octave Uzanne. Qu’il considère son
livre comme un plan très détaillé et qu’il écrive, en prenant son
temps, l’ouvrage définitif encore attendu par les admirateurs du
Bon
Gros. Quel intérêt, quelle gloire on trouverait à reconstituer
l’existence de Saint-Amant en Amérique ! Car, s’il y est allé, nous
ignorons tout de ce voyage… et à peu près tout, hélas ! de ses autres
pérégrinations à Java, à Sumatra et en Afrique.
L’espace me manque pour étudier ici avec quelque détail l’existence de
Saint-Amant et l’œuvre de M. Pierre Varenne. Je veux dire toutefois que
le
Bon Gros, esprit libre, amoureux éperdu de la vie, homme, brave
homme avec des faiblesses, poète, bon poète avec des outrances,
apparaît, dans le recul des années qui ne laissent debout que ce qui
est solide, comme un prodigieux artiste du Verbe – le grand prosateur
Flaubert ne le vantait pas sans raison – comme un gaillard au brave
cœur – l’illustre crapule Tallement des Réaux ne le brocarda pas sans
perfidie – et le plus étincelant précurseur du romantisme d’hier, de
celui d’aujourd’hui, et, j’ose l’écrire, de celui de demain.
Saint-Amant mourut à Paris, après avoir vécu, depuis 1654, une
existence « de maladie, de soins pieux et d’obscurité », le 29 décembre
1661, « dans la maison du cabaret du
Petit Maure, qui existe encore
au coin de la rue de Seine et de la rue Visconti, et porte actuellement
le n° 26 de la rue de Seine – où les vieilles pierres semblent gorgées
de souvenirs que leur bref écho répète lorsqu’un passant à l’esprit
fantasque et rempli de lectures l’éveille dans le silence qui ne règne
là, sous les étoiles éternelles, qu’entre minuit et deux heures du
matin…
M. Pierre Varenne a bien du talent. Nous le savions.
Cela se saura de plus en plus.
En attendant la publication (chez Lemerre) impatiemment attendue du
Poème du Bugey ̶ événement régionaliste d’importance – le
poète bugiste Pierre Aguétant se passe la fantaisie d’offrir au public
un volume de prose :
La Tour d’Ivoire, impressions et pensées (les
femmes, le monde, l’amour, le cœur), préfacé avec délicatesse et avec
une éloquence paisible par Mme Alphonse Daudet, bon poète elle-même et
meilleur prosateur encore.
Cette fantaisie de Pierre Aguétant a beaucoup plus d’importance qu’un
caprice ordinaire. Il y a des esprits qui transfigurent ainsi tout ce
qu’ils touchent et qui, sans effort apparent, créent des œuvres très
durables. Je crois que les parrains (et les marraines) de Pierre
Aguétant : Herriot, la princesse Hélène Vacaresco, Mme Alphonse Daudet,
entre autres, peuvent être déjà fiers de leur filleul en lisant
La
Tour d’Ivoire (2). Pierre Aguétant a eu assez de force d’âme, non pour
s’abstraire de la tourmente actuelle dans une solitude orgueilleuse,
mais pour essayer de résumer les aspirations éternelles, les erreurs
généreuses, le destin moral de « la douloureuse et belle humanité ».
La Tour d’Ivoire est l’œuvre bien personnelle d’une nature d’élite,
qui ayant connu la bonne souffrance et a su s’élever vers la sérénité
confiante, quasi divine, par les chemins de la réalité et de la sagesse
chèrement acquise. D’une expression personnelle, ces pensées, qui
apparentent leur auteur aux grands moralistes classiques, sont parfois
relevées d’un soupçon d’ironie souriante, mais, dans leur vol hardi,
elles sont soutenues par les ailes de l’amour et de la foi. Les âmes
contemporaines, martyrisées par l’effroyable épreuve à laquelle le
monde est soumis, voudront connaître ce bréviaire apaisant, où
certaines phrases rendent le son grave de l’
Imitation : elles y
trouveront aide, lumière et réconfort.
Pierre Aguétant qui, par ses premières œuvres nous faisait de
splendides promesses – desquelles Emile Faguet prit acte publiquement –
en tient déjà plusieurs.
Il les tiendra toutes.
Ж Philéas Lebesgue, le grand régionaliste normanno-picard – de la
Neuville-Vault (Oise), où il partage ses heures entre l’agriculture et
l’art littéraire – écrit dans la brochure collective consacrée par la
Revue
Les Humbles (3) au poète et à l’historien
A.-M. Gossez :
« … Si l’émotion devant la vie, au milieu des paysages familiaux, a
formé le lyrique impressionniste qu’il est devenu, c’est bien le culte
de la Province, voire de la Région, le dessin pieux de rendre justice
aux grands morts du Terroir, de mettre en lumière leur effort généreux,
qui a dirigé l’Historien dans la voie féconde des recherches
strictement documentées et suggéré au Sociologue ses vues de
fédéralisme intégral.
« L’un des fondateurs et directeurs du
Beffroi, [revue publiée par un
intéressant groupe littéraire de Lille, qui comprenait, vers 1900, des
poètes de grande valeur tels que Léon Bocquet devenu parisien et Théo.
Vorlet, devenu méditerranéen] il avait su créer un centre
véritablement autonome de culture provinciale, en conformité d’idées
qui avaient, en 1848, guidé son propre aïeul maternel, Alphonse
Bianchi, dans la carrière politique.
« A.-M. Gossez possède au suprême degré le sens de la liberté dans
l’ordre ; c’est pourquoi il échappe à notre détestable travers
contemporain : il n’esquive aucune responsabilité. De ce fait, il
n’entreprend rien sans y mettre toute sa conscience d’homme, d’artiste
et de poète. Educateur, il aime susciter des initiatives, éveiller des
vocations et quoique jeune encore, il compte parmi ses anciens élèves
plus d’un écrivain d’élite. Homme de goût, il possède le sens inné des
beaux arrangements et, en toutes choses, éclate son esprit inventif,
son génie de l’organisation.
Même si Marcel Lebarbier, Francis Yard, Rémy Houssin, Camille Belliard,
Rémi Bourgerie et Emile Lebarbier, n’avaient pas voulu disposer autour
du nom d’A.-M. Gossez leurs jeunes palmes et leurs rameaux de laurier
vert, les lignes que je viens de transcrire suffiraient à donner une
légitime fierté à l’auteur du
Département du Nord sous la Deuxième
République et des
Mémoires de l’ouvrier Fr. Leblanc.
Je ne partage pas toutes les idées poétiques de A.-M. Gossez, mais
descendant comme lui d’un modeste héros de 1848, je comprends sa
prédilection pour cette époque encore très mal connue (tant de
documents, hélas ! furent détruits par ordre : ô ignominie !) – cette
époque fiévreuse, où tout a été dit, envisagé, discuté, prévu et
pressenti – cette époque admirable, où la nation tout entière
frémissait devant tant de belles idées viables et de splendides utopies
toutes neuves ; ̶ cette époque trop courte et trop remplie
pour aller au delà de la gestation. ll y aurait à écrire une étude
curieuse, dépouillée et tendue, pour établir que le talent et la
mentalité d’A.-M. Gossez reflètent nettement, fidèlement et
complètement l’esprit général de la génération de 48.
Jamais le grand poète normand Paul Harel, le « Mistral d’Echauffour
», ̶ dont la
Société Libre de l’Eure et la
Société
historique et archéologique de l’Orne ont fait leur président, ce qui
honore également l’un et les autres – jamais Paul Harel n’a montré plus
d’esprit, plus de talent, plus de régionalisme de bon aloi que
Un
Mariage au XVIIIe siècle (4), petit roman en vers, aussi bien
construit, aussi alertement mené qu’un ouvrage de bonne prose. Une
œuvre pareille ne s’analyse pas en quelques lignes. Sa technique et sa
doctrine valent une longue étude. Quand Joseph l’Hôpital, mieux désigné
que personne, l’écrira-t-il ?... Un seul moyen est ici à ma
disposition, pour donner une idée exacte d’
Un Mariage au XVIIIe
siècle sans trahir le Poète : citer !
A cheval, ce deux mai dix-sept cent quatre-vingt,
Le Bailly du Tremblay, messire Poidevin,
Trottine vers le beau logis des Chauvinières.
………………………………………………………
Plus il trottine, plus le domaine s’allonge.
Souriant et replet, Monsieur le Bailli songe
Que cette année, avec le métayer Pilon,
Il a peuplé la côte et peuplé le vallon
Mais qu’il est temps enfin que le propriétaire,
Louis-Jean Ducastel, vienne exploiter sa terre.
Il murmure : « Ceci doit être, ô mon neveu,
Conforme à ta raison et conforme à ton vœu.
Ton frère Alain ayant suivi ta sœur Elise
Au tombeau, tu ne peux, jeune homme, être d’Eglise.
Au logis, l’orphelin vaut mieux que l’étranger.
Louis-Jean Ducastel, tu seras herbager !
Au Tremblay, quand la vieille et sévère abbaye
Par de hauts pèlerins se trouvait envahie,
Très humble, accompagnant le Prieur ou l’Abbé,
Je te voyais, de loin, dans ton rêve absorbé.
Tu portais la lévite et chaussais les sandales,
Puis, tombant à genoux et le front sur les dalles,
Tu répandais dans l’ombre une belle oraison.
Du cadet le Seigneur a changé la maison.
Il a, d’un pauvre clerc, changé la destinée.
Pour obéir à Dieu, tu viendras cette année
Dans ta gentilhommière endosser le pourpoint.
Au lieu du chapelet, tu verras à ton poing
La solide courroie et le bâton de frêne,
Ou, montant, comme moi, le cheval qu’on réfrène,
Ami, tu t’en iras dans le pays herbeux
Voir tes veaux, tes moutons, tes juments et tes bœufs
Et tes quatre moulins chantant sur deux rivières.
Le soir, à ton bidet donnant les étrivières,
Brûlant la politesse à Monsieur le Bailli,
Tu rentreras chez toi pour manger le bouilli
Avec une compagne aimable – blonde ou brune,
Blonde plutôt. Eh ! Eh ! Cadet, j’en connais une…
Et voilà le sujet d’
Un Mariage au XVIIIe siècle, agréablement,
alertement et complètement exposé. Louis-Jean Ducastel quittera
l’abbaye pour la gentilhommière, après maintes péripéties fort
attachantes. Il reprendra la tradition des Ducastel que Messire
Poidevin a su si fidèlement maintenir. Il faut l’entendre, ce bon
bailli, plus « popote », à dessein, en apparence qu’il ne l’est ; il
faut l’entendre se glorifier de ses aïeux devant Mlle de La Palu, la
plus insupportable descendante d’un maréchal de camp, de deux généraux
d’armée et d’une kyrielle de nobles inutiles sans mésalliance ! Ce
passage est un des plus brillants de l’œuvre ; il est le cri d’amour et
de fierté d’un homme bien racé pour son irréprochable hérédité
roturière dont la noblesse réelle vaut bien toutes les autres
noblesses…, trop souvent nominales sans plus. Lisez :
Mlle DE LA PALU
… Allons droit au sujet :
Oncle du prétendant, vous allez, j’imagine,
Nous éclairer au moins sur sa double origine.
… Parlons d’abord des Poidevin.
J’espère (nous verrons si mon espoir est vain),
Que vous allez montrer ici quelque droiture.
LE BAILLI, s’inclinant
Madame, nous comptons cinq cents ans de rôture.
……………………………………………………….
…. Avocats ou meuniers, c’étaient de braves gens
On trouve aussi, chez eux, des baillis, des sergents…
Mlle DE LA PALU
Et si vous y trouviez un peu de valetaille ?
LE BAILLI, redressé.
Je ne cèderais pas un pouce de ma taille,
Car, dans tout ce passé profond, je n’ai pu voir,
Dieu merci ! que des gens fidèles au devoir.
Et je puis ajouter, sans que cela vous blesse :
Ces vieux fastes obscurs prouvent quelque noblesse.
Les meuniers, librement, exploitaient leurs moulins.
Les avocats, toujours dévoués et malins,
Se levaient pour le droit du client qu’on pressure
Et les baillis jugeaient fort bien, je vous l’assure.
Donc, nous revendiquons la toque et le bonnet.
Quant aux sergents royaux, coiffés du bassinet,
Portant la hallebarde ou la hache danoise,
Aux larrons court vêtus, ils allaient chercher noise.
Plus tard, jouant aussi, faisant les freluquets,
Laissant à des porteurs la charge des mousquets ;
Mais, quand il le fallait se ruant aux batailles,
Appelant, sous le casque et la cotte de mailles,
La victoire ou la mort en des cris singuliers.
Braves, non plus sergents, mais presque chevaliers.
Le prêtoire, le camp, le moulin, la caserne,
Voilà, de mon côté, tout ce qui nous concerne.
Les Ducastel, je dois le dire, sont plus grands.
Ce sont des herbagers, presque des conquérants.
Ils eurent, m’a-t-on dit, pour ancêtre un colosse,
Avec quelques troupeaux, un jour, venus d’Ecosse.
Sur un vaste domaine ils ont nourri le bœuf
En dressant des chevaux pour le roi Charles neuf.
En ces temps, dites-moi, sans vous prendre à partie,
Votre gentilhommière était-elle bâtie ?
Or, deux cents ans plus tard, Thiville, La Palu,
Ducastel des Aubiers figuraient, je l’ai lu,
Avec Roger du Sap et Philbert de Carrouges,
Tous comme lieutenants dans les Escadrons rouges.
Ils se battaient au son du fifre et du tambour
Sous François, maréchal et duc de Luxembourg ;
Et quand il les lança par les plaines de Leuze,
Ducastel s’abattit dans la charge fameuse.
De mon neveu Louis, c’était le trisaïeul.
L’auteur d’
En Forêt, grand poète normand, n’a jamais été mieux
inspiré et n’a jamais écrit une langue plus belle.
Un Mariage au
XVIIIe siècle mériterait de devenir populaire chez nous et hors de
chez nous… si la politique et l’argent, autant, sinon plus que la
guerre elle-même, n’enlevaient depuis longtemps à la Littérature la
place à laquelle elle a droit dans le Pays et dans le Monde.
M. Lucien de Flagny, compositeur de talent reconnu, fait imprimer ses
compositions en province, chez Grou-Radenez, à Montdidier (Somme). Il
n’a pas à s’en repentir, car l’édition des
Chansons d’Enfants (poèmes
de Pierre Alin), que je viens de recevoir, est aussi agréable que
n’importe quelle édition musicale « parisienne ». Parmi ces
Chansons
d’Enfants (5), mes préférences vont au
Bateau sur le Lac, bijou
poétique et musical, simple et gracieux, à souhait. M. Lucien de
Flagny, auteur, entre autres œuvres, de
Lauriers (sur un poème de
Rivollet, tiré des
Phéniciennes), peut légitimement prétendre à un
bel avenir.
Quelques revues recommandables :
Les Fleurs d’Or, publiées à Nice, 12, boulevard Joseph-Garnier, sous
la direction de M. Maurice Rocher, contient beaucoup moins de mots
inutiles que la plupart des jeunes revues. Parmi ses meilleurs
collaborateurs : Roger Allard, Marcel Lebarbier, Camille Le Mercier
d’Erm, Gérard de Lacaze-Duthiers, Raoul Toscan, Gaston Picard, Georges
Turpin, Eléonor Daubrée. Un numéro spécial a été consacré au grand
poète belge Emile Verhaeren avec le concours de Philéas Lebesgue, de
Guillot de Saix et de Marcel Loumaye, entr’autres. Souhaitons que les
jeunes revues acceptent généralement la salutaire et facile discipline
des numéros spéciaux aux sujets bien choisis.
Les Tablettes publiées à Saint-Raphael (Var), par M. Ch. de Magneux.
Pour n’avoir pas voulu « s’asseoir sur le banc étroit des écoles »,
Les Tablettes offrent, pêle-mêle, à leurs lecteurs les productions
les plus disparates. Nous pouvons prendre plaisir à voir un volcan – de
loin. De près, nous n’hésitons jamais à choisir des pierres précieuses
parmi des scories. Les esprits contemporains aspirent après l’Ordre –
dans la Liberté – ce qui n’est contradictoire que pour les bolchevicki.
Gallia, publiée à Buenos-Aires (Esmeralda 264), par A.-R. Resurgo est
l’organe de la colonie française établie dans la capitale Argentine.
Très vivante et très au courant du mouvement régionaliste français,
elle inscrit fréquemment à ses sommaires des noms normands : Jean
Mirval (Georges Lebas), Paul Harel, Gabriel-Ursin Langé, etc. L’effort
francophile de M. Resurgo mérite d’être apprécié et encouragé, chez
nous.
La Revue Normande, publiée à Rouen (place de la Haute-Vieille-Tour),
sous la direction de M. Aristide Frétigny, est bien connue dans nos
régions. Elle poursuit avec vaillance et méthode son magnifique effort
régionaliste. Remarqué :
En marge des grands souvenirs, croquis exact
et vibrant d’Albert Herrenschmidt,
Rouen, la ville aux belles
verrières, attachante et pieuse étude du savant docteur Ed. Tulasne,
Glose sur un tercet de Paul Harel, par Fernand Mazade, et son digne pendant :
Glose sur un quatrain de Fernand Mazade d’Henry
Gauthier-Villars, qui signe Willy lorsqu’il oublie d’être sage –
c’est-à-dire poète et historien –, de premier ordre d’ailleurs.
M. Gaston Le Révérend, lexovien, est un poète de la grande race et
même de la grande tradition, oserai-je écrire – car la sagesse insigne
qu’il manifeste déjà éteindra dans quelques années les flammes
superficielles du marinettisme dont il se déclare dévoré trop
volontiers. L’
Epître à Damon (6) qu’il vient de faire tirer à petit
nombre, enlève d’ailleurs tout mérite à ma prédiction.
Voici quelques bons vers de l’
Epître à Damon :
Damon, je n’irai pas vous rejoindre à Paris.
Là, naïf, égaré parmi les beaux esprits,
Inhabile à changer d’âme et de caractère,
Doutant de mon génie et sûr de ma misère,
Je gagnerais mon pain plus durement encor.
Laissez-moi – l’aile est courte, au pauvre, pour l’essor –
Végéter, satisfait des loisirs que procure,
Dans la petite ville, une besogne obscure
Et, revenu de mes beaux rêves d’autrefois.
Pour d’indulgents amis écrire quelquefois.
……………………………………………………
………………………………………………
Je bannis de mes vers autant que je le peux
Les maussades splendeurs d’un lyrisme pompeux.
Patient ouvrier, d’une forme très claire,
J’attends les mots qui font naître de la lumière.
A Lisieux, ma cité, Courtonne, mon village,
Je goûte ces plaisirs qu’un ancien prête au sage.
A l’ombre d’un vieux chaume ou des maisons de bois,
Je fais, mon âme, égale aux âmes d’autrefois,
Des voyages menus, des promenades brèves,
Changent mes horizons, alimentent mes rêves
Puis, vite las d’errer par la plage ou le bourg,
Je reviens me blottir au foyer, dans l’amour.
……………………………………………………
… Et l’on ne sait de moi chez mes meilleurs voisins
Que ma figure maigre et mes regards lointains
Enclin au rêve, épris de lecture et d’étude,
J’ai, naguère, sauvage, aimé la solitude :
Je la fréquente encore et préfère toujours
La rancune des sots à leurs pauvres discours.
…………………………………………………….
Ici, n’espérant rien, toujours prêt pour la tombe
Jusqu’à ce qu’en l’effort de vivre je succombe,
Peut-être plus qu’un jour, peut-être encor trente ans,
Je veux, frugalement, disposer de mon temps.
La raison me conseille et le devoir m’oblige ;
Rien, pas même un vieux rêve ignoré, ne m’afflige
Et je reste, en province, à jamais enterré
Le rimeur le plus fier et le plus ignoré.
Nous n’avons pas souvent l’occasion de lire des vers de cette valeur.
Je voudrais que tous les jeunes que le démon littéraire tourmente,
lussent l’
Epître à Damon, comme les prêtres lisent leur bréviaire.
Que Gaston Le Révérend, déjà nanti d’une enviable renommée d’ailleurs,
se souvienne qu’entre autres, Mistral ne quitta pas plus Maillane,
qu’Achille Millien ne quitta Beaumont-La Ferrière et Jean Revel Rouen
et Conteville. La vraie sagesse porte en elle-même sa récompense – et
le reste vient par surcroît.
Georges NORMANDY.
(
A suivre.)
NOTA. -
Tout ce qui concerne la rubrique :
ACTIVITÉS RÉGIONALISTES doit être adressé directement à M. GEORGES NORMANDY, 51,
rue du
Rocher, Paris (8e arrond.)
_____________________
(1) Chez Lecerf, fils, 46-48, rue des Bons-Enfants, à Rouen.
(2) Plon-Nourrit, éditeur, 8, rue Garancière, à Paris, 1 vol., 3 fr. 50.
(3) 4, rue Descartes, à Paris.
(4) Imprimerie Alençonnaise, 11, rue des Marcheries, Alençon.
(5) Dépôt général à Paris (XVIe), aux éditions Sinfonia, 25, rue de
La tour.
(6) A l’Image Saint-Ursin, 10, rue de la Paix, et chez l’auteur, 23,
rue de Rouen, à Lisieux.
*
* *
Au moins cher et pour le mieux
A Georges NORMANDY.
« All’ a passé l’ pas », murmuraient les travailleurs en passant devant
la ferme du père Déculbat. Précisément, il sortait. Tous le saluèrent
avec cette gêne coutumière aux paysans peu habitués aux civilités.
Sec, taillé à coups de serpe, le fermier, plus sévère qu’à l’habitude,
s’acheminait vers la petite église pour annoncer au bon vieux curé,
oublié dans ce soin de campagne, le malheur qui venait de le frapper.
Evidemment, il y était préparé depuis longtemps puisque le médecin, dès
sa première visite, ne lui avait laissé aucun espoir.
« La drogue », disait-il en parlant des tisanes ordonnées, « n’pouvait
point la conduire bien loin, car no a bieau dir’, c’est point aveuc du
tilleul ou n’importe d’qué qu’no se r’fait un tempé’ament. No se ruine
cor ed’ plus, un point c’est tout. Ah ! si all’ avait seul’ment pu
absorbé eun’ tit’ goutt’ éd’café aveuc eun’ larm’ éd’ Calvados (du
vieux qu’il gardait précieusement dans sa cave), p’t’êt’ bin alors
qu’ça l’aurait remontée. »
C’était du moins ce qu’il pensait tout en s’inclinant devant les
ordonnances rédigées en caractères illisibles « pour vous embrouiller
cor ed’ plus » par les représentants de la science qui avaient une
importance énorme à ses yeux.
« J’me d’mande comment qu’la têyte leu’ pette point », disait-il en
parlant du curé, du médecin et de l’instituteur, trinité imposante pour
lui.
« Faut dire aussi qu’c’était point eun’ femme à n’point savè qui fè
d’ses dix doigts comme no en vèye tant à l’heure d’an’hui. No élève pa
six mioches, sans compter la volaille et les vieaux, sans s’user à c’te
besogne ! Ça dure c’que ça dure, mais tout n’a qu’un temps… »
Toutes ces idées l’absorbaient, et il se trouva devant la porte de la
sacristie sans pouvoir se rappeler comment il était entré dans l’église.
Le vieux prêtre, qui revisait le registre des naissances en constatant
avec peine qu’elles diminuaient de plus en plus, crut entendre frapper,
mais si doucement, qu’il attendit un instant pour ouvrir.
« Ah ! bonjour Maître Déculbat. M’apportez-vous de bonnes nouvelles ?
La Providence veille sur vous et tant qu’il y a une lueur de vie, il
faut beaucoup espérer d’elle. »
Sans doute notre homme craignit de contredire « m’sieu l’cuè », car il
se contenta de lever les épaules et de tourner sa casquette à pont en
baissant la tête.
Le prêtre reprit : « Alors, toujours le même état ? » L’occasion de
parler se présentait et le fermier ne la laissa pas passer. D’une voix
bégayante, il annonça la triste nouvelle, en essuyant des larmes qui
coulaient de ses yeux vifs et fouineurs, avec la paume de ses mains
trapues.
« Ça y’est… ça y’est, m’sieu l’cuè, à s’est laisséye aller en pleine
connaissance… mêm’ qu’ all’ m’a d’mandé si l’méd’chin r’viendrait, par
rapport qu’à’ trouvait qu’c’était peine inutile. Vous la connaissiez
su’ c’chapitre-là ? Eun’ femme d’ordre et d’économies…. pis allante,
pis bonne, hein !... C’est dur, allez !
- Je partage votre peine, mon vieil ami, et je vous promets que je
prierai pour l’âme de ma plus méritante fidèle que Dieu vient de
rappeler dans son céleste séjour.
- C’que vos f’rez s’ra bien fait, m’sieu l’cuè… je v’nais justement…
Devinant où il voulait en venir, le prêtre ne le laissa pas achever.
« Oui, vous voudrez, et je vous approuve hautement, des funérailles
dignes de votre brave femme…
- J’vâ vos dir’ é m’sieu l’cuè, c’est qu’j’y connais rien. Faut avè
passé par là pou’ êt’ renseigné, c’quest point man cas. Dit’s mè vos
prix car je n’veux point aller plus loin qu’ma bours’ n’me l’permet.
- Naturellement, naturellement, répliqua le curé en lui montrant des
chiffres alignés sur le registre destiné à cet effet.
Le fermier, gagné par l’instinct des affaires examinait attentivement
et répétait : « Mais qu’c’est cher, mais qu’c’est-y cher èd’ mou’ï !
Pour qui qui faut mou’ï ?...
Il s’avisa de demander : « Si no n’pouvait point rogner eun’ p’tieu.
C’que j’vos en dis, m’sieu l’cuè, c’est autant pour respecter les
volontés d’ma défunte, que pour n’point gaspiller l’ergent qu’no gagne
si difficilement. »
Et, détaillant tous les accessoires que comportait la cérémonie, il
ajouta :
« J’vèyes deux cierges d’écrits. J’vos d’mande un peu, deux cierges
!... c’est-y cha qui i r’donn’ra la vie, hein ! pas vrai !... Y
m’semble occo l’entendre èm’ dire : « Mait’ Ugène, m’brûle point la
candelle par les deux bouts ! » Y’ pas, faut m’rogner un brin. »
Les prix étaient les prix, et malgré l’éloquence du prêtre voulant
décider le fermier à faire des funérailles dignes à sa bourgeoise, il
décida « qu’no s’en tiendrait à eun’ avant dernié’ et qu’no verrait
plus tard », songeant peut-être à une exhumation possible en vue de
refaire des funérailles grandioses !
Pour faire diversion, quelques paroles furent échangées sur la pluie et
le beau temps, puis notre homme prit congé du curé pour se rendre à la
mairie où, devant un secrétaire du midi (puisque fonctionnaire !) il
s’éternisa dans les détails, aussi savants qu’ahurissants, d’une
généalogie apprise par cœur.
« Véyons, pis que j’vos dis qu’ma défunte femme était eun’ fille
qu’avait pour nom Brigitte Cathérène Vautreux, qui y fut donné du
deuxième lit, pis qu’san pé défunt était mait’ Leroux qui t’nait la
ferme qu’est an-hui la sienne a’pé Cloubin. Donc, ma bourgeoise, eun’
Leroux du premier lit, était née le 12 janvier dix-huit
chent-chiquante-très. A s’est trouvée orpheline queuqu’temps auparavant
d’nout’ mariage, pis qu’mait’ Vautreux, son deuxième pé, qui’ dans
l’fait, y était rien, san bieau-pé si vos préférez, est mort à son tour
et sa mé eun’tout’. »
Le secrétaire n’écoutait plus. Il noircissait quelques feuilles, plus
ou moins timbrées, pour justifier la dépense prévue.
En possession des pièces signées et contre-signées, le fermier fit
cette réflexion :
« En faut’y d’s affés pou’ se n’aller dans l’aut’monde ! M’est avis
qu’c’est pus pou’ l’bonheu’ des vivants qui vivent dans l’s écrivages
que pou’ l’s arrangements des morts ! Malhu d’malhu ; y vont m’tondre
comme un mouton ! »
Restait à régler la question du cercueil. Certain de rencontrer mait’
Laplanche, l’unique menuisier de la commune, au café de « la Ponette »,
il s’y rendit en revisant mentalement tous ses comptes.
Lorsqu’il entra « aveuc son air absorbé », le silence se fit.
Mait’ Laplanche terminait une partie de dominos avec la patronne de
l’établissement, plus veinarde que bonne joueuse ! Sur un signe du
fermier, il vint vers lui et nos deux hommes s’installèrent à une
petite table en chêne, merveilleusement encaustiquée.
Le traditionnel café commandé, ils absorbèrent la grave question.
Mait’ Laplanche, ému pour la forme, et très désireux de traiter une
bonne affaire, fit ressortir son amitié désintéressée pour son vieux
partenaire aux dominos, auquel il proposa du chêne qu’il gardait dans
son grenier depuis fort longtemps, et qui était supérieur. Mais ce bois
ne convint pas à cause du prix fabuleux que demandait l’ami, et surtout
pour respecter les goûts simples de la bourgeoise qui n’avait jamais
voulu remplacer le lit en bois blanc qu’elle tenait de sa grand’mère.
« J’ai m’n’idèye. J’veux qu’a dorme san dernier sommeil dans
s’n’élément….. Mait’ Laplanche, no n’peut point chamailler su eun’
question d’çu genre. Tu sais cobien qu’j’étais attaché à ma Cathérène,
ça s’rait donc péché d’marchander ; seul’ment, j’me sentirais point
quitte envers elle si j’faisais c’qu’a’ n’aurait point permis d’son
vivant. Veux-tu que j’traitions en cofiance pou’ décider d’même ? »
C’était l’avis du menuisier. On s’arrêta au bois blanc « qu’était pas à
dédaigner, surtout quan’ t’no sait choisir les planches », et, pour «
coclure » le marché on prit « eun’ rinchette pour n’point s’quitter su’
eun’ note aussi triste. »
Allégé, satisfait d’avoir accompli les volontés de sa défunte femme, le
père Déculbat regagna la ferme où l’attendaient quelques amis venus
pour lui serrer la main et lui proposer leurs services.
Tout fut simple – aussi simple que la vie de la brave Cathérène – aussi
simple que leur vie où la mort est un événement qui ne doit pas
déranger les habitudes.
Peut-être marche-t-il un peu plus courbé, mais cela ne l’empêche pas de
supporter courageusement son chagrin.
A ceux qui lui rappellent les qualités de la « bin honorâble défunte »,
il répond en baissant la tête :
« C’est dans mè que j’la pleure… J’ai voulu qu’a’ sèye enterrée aveuc
honneur mais sans épate. j’sieux certain qu’aveuc ses habitudes
d’épargne, si all’ avait pu juger de c’que j’ai fait par ses propres
yeux, a’ m’aurait occo dit que j’faisais les choses trop en grand. »
Et plus il le répète, plus il se persuade qu’il a fait son devoir, tout
son devoir. Certitude qui le tranquillise et le console.
Gaston DEMONGÉ,
(Mait’ Arsène).
*
* *
Le Prévôt de Malétable
(Suite.)
II. – LE DEPOSUIT
Le narrateur suspendit un instant son récit pour placer sur la table de
sa tonnelle le crâne qu’il avait gardé dans sa main, puis, humant une
prise de tabac, il se mit à nous expliquer la cérémonie du « Change ».
Elle a lieu, le jour de la fête patronale, à l’église, pendant que le
chœur chante le verset du Mangificat : «
Deposuit potentes… »
Il s’agit, pour les quatorze frères composant la Charité, de « changer
de place ». Il y en a sept qui s’en vont après deux ans de service et
les sept qui ont déjà servi un an remplacent les sept partants,
auxquels succèdent sept nouveaux venus.
Voici le cérémonial suivi :
Le sacriste a posé la croix sur un coussin au bas des marches de
l’autel. Au coup du
Deposuit, le Prévôt sortant va chercher le
premier échevin par la main et le conduit au pied de la croix qu’ils
embrassent.
Tous deux vont ensuite quérir le futur échevin, le mènent adorer la
croix, puis l’accompagnent jusqu’à la place du premier échevin. Alors
le Prévôt et l’Echevin se dépouillent de leurs insignes, entr’autres du
chaperon de velours à franges et à broderies d’argent. Le premier
échevin, revêt les ornements du Prévôt qui redevient un paysan en
blouse bleue ; le futur échevin qui est habillé d’un veston de gros
drap brun, prend le chaperon et la barrette violette de l’échevin.
Ensuite, le greffier sortant invite le sous-greffier à adorer la croix.
Ils vont chercher le novice, adorent ensemble la croix, puis retirent
leurs insignes. Le greffier sortant cède les siens au sous-greffier ;
celui-ci abandonne également les siens au nouvel arrivant ; de telle
façon qu’à la fin, les sept frères sortants ont pris place sur le banc
où étaient assis les sept postulants, tandis que ces derniers occupent
les stalles des premiers.
Et exaltavit humiles !
Rien n’est pittoresque comme le chassé-croisé de ces hommes frappant
lourdement les dalles avec leurs gros souliers ferrés et le cérémonial,
pour être exécuté par des rustres, n’en est pas moins solennel et
impressionnant. Aussi, les enfants de chœur ne chantent plus ; les
femmes restent debout dans leur banc pour mieux voir.
Par cet après-midi de juin, il faisait dans l’église une chaleur
étouffante, et Ambroise Colin avait bien soif. Certes, il eût cédé
volontiers contre une bonne bouteille de cidre mousseux quelques-unes
des prérogatives de son nouveau grade. Si encore, il était demeuré
simple frère, s’esquiver pendant l’office pour se rafraîchir lui eût
été facile. Il en aurait été quitte pour une amende. Mais de la part
d’un Prévôt cela ne se pouvait point. Et puis n’avait-il pas fait
devant Lejar vœu de sobriété ? Il se souvenait des meilleures beuveries
de son existence et en gardait un savoureux remords !
L’abbé Monsavoir, qui devinait les louables efforts d’Ambroise Colin
pour chasser le démon tentateur, se promettait de l’en féliciter
ultérieurement.
Il jugeait toutefois plus prudent d’attendre pour cela la fin du dîner
de Frairie !
III. – CHANSONS DE FRAIRIE
C’était la coutume qu’un repas gigantesque réunit le soir même du «
Change » les quatorze frères, ainsi que les sept anciens qui venaient
de résigner leurs fonctions. On l’appelait le dîner des amendes. De
tout temps, les curés de Malétable avaient tenu à ce que ce dîner eût
lieu au presbytère, sous leur présidence, afin d’éviter qu’il dégénérât
en orgie.
La règle voulait que chaque frère apportât son barillet de cidre ou de
poiré que l’on buvait l’un après l’autre. Aussi était-ce une émulation
à qui fournirait la meilleure boisson. On devine si, cette année-là,
Ambroise Colin se soumit volontiers à cette coutume. Il fit amener au
presbytère une grosse dame-Jeanne d’eau-de-vie et de la vieille !
Le repas fut cordial et gai, l’indulgente bonhomie de l’abbé Monsavoir
enlevant toute contrainte aux charitons.
- Eh bien ! Jean Tétart, demanda-t-il à ce grand mangeur, voulez-vous
encore un petit morceau ?
- Merci, Monsieur le Curé, j’en ai ma suffisance.
Du moment que Jean Tétart avait repoussé de la poularde du Mans, on
pouvait croire que tous les autres estomacs étaient « à ras » !
La clarté des hauts chandeliers illuminait des figures cramoisies et
plissées de gros rires. Plusieurs convives racontaient en effet les
différentes circonstances de leur vie dans lesquelles ils s’étaient
trouvés ivres et, comme Adonis Lejar paraissait préoccupé, ne prenait
point part à la gaieté commune, on lui en fit la remarque. Il se
souvenait avoir creusé au cimetière une fosse trop étroite que l’on
serait obligé d’élargir au moment de l’inhumation. Et cela le
tracassait car il n’y avait plus de temps à perdre.
- Vous vous lèverez demain au petit jour, et tout sera dit, fit-on pour
le remonter.
Enfin, l’heure des chansons arriva :
- L’honneur de commencer revient de droit au nouveau Prévôt, dit l’abbé
Monsavoir.
- Bien honnête, Monsieur le Curé, mais je vous dirai que je chante
comme une barrière mal graissée. Je cède ma place à notre sacriste :
c’est son art à lui.
Tout se récrièrent, tant et si bien qu’Ambroise Colin, après quelques
excuses banales, dut se lever.
- J’en connais une bonne, dit-il, qui est plus vieille que moi.
Il avait le verre en main et sa face ronde et rougeaude était celle qui
convenait aux chansons bachiques.
De sa voix rauque et caverneuse, il entonna les couplets suivants :
Quand Noé planta la vigne,
Il voulut boir’ de son jus ;
Il n’y a rien d’superflu (sic)
A cette liqueur divine !
REFRAIN
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ne m’apportez pas
Jamais d’eau sur une table
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
Ne m’apportez pas
Jamais d’eau à mon repas !
Si vous voulez que je gronde
Faites-moi venir de l’eau.
Ça me réduit au tombeau
Ainsi que bien d’autre monde !
Si vous voulez que je chante
Il faut m’apporter du vin,
Cela bannit mon chagrin
Et me rend la voix charmante.
Je voudrais que les bécasses,
Les perdrix et les levrauts
N’euss’ jamais d’autres tombeaux
Que le fond de ma carcasse !
Je voudrais que les rivières
Les fontain’ et les ruisseaux
Ne coulurent (sic) jamais d’eau
Que pour y rincer mon verre !
Chacun des convives, en chœur, reprit le refrain :
Ah ! Ah ! Ah !
avec enthousiasme et tous applaudirent à outrance, étant en communauté
de sentiments avec le chansonnier.
- Faut remplir votre verre, criait-on à Ambroise. Faut avoir le verre
plein pour chanter çà !
Mais Adonis Lejar, qui s’était placé près de Colin pour le surveiller,
lui toucha le bras, en disant : « Modérez-vous ! » Tandis que lui-même
vida son verre d’un trait. Ça ne lui faisait pas de mal !
Après Colin, maître Louis Berrier, l’ancien prévôt, chanta les
Hirondelles, de Béranger. Puis le fils Tétart, le « clergeot »
commença de sa voix flûtée :
Adam était en effet
Le premier des hommes
Aurait-on cru qu’il était
Un croqueur de pommes ?
Là, il se gratta la tête : « Je ne me rappelle plus. »
- Passe au second couplet, mon enfant, fit paternellement le Curé.
A la santé de Noé
Patriarche insigne
Qui le premier a planté
Sur terre la vigne,
A l’exemple de ce saint
Laissons l’eau, buvons le vin.
La troupe in pin pin
La trou fi fi fi
La troupin, la troufi
La troupe infidèle
Aura l’eau pour elle.
- Ah ! dame, ça, c’est tapé ! s’écria Jean Malicorne, le greffier, et
tous d’applaudir.
Mais, c’est au troisième couplet sur Moïse et la mer Rouge que la joie
monta au délire, quand le clergeot chanta :
Il l’a pas pas pas,
Il l’a sa sa sa
Il l’a pas, il l’a sa
Il l’a passa toute
Sans en boire une goutte.
- Nous en aurions tertous fait autant, déclara avec conviction le
porte-bannière, Philippe Lerat, qui, en mémoire de son père, portait
comme ce dernier un veston à larges boutons, une culotte de velours
brun attachée au genou avec un ruban jaune, lequel retenait des bas
bleus.
Il se levait, disposé à « pousser » sa romance, quand la voix de
crécelle de la vieille Josepha vint comme un rabat-joie, mettre fin à
la gaieté exubérante des convives : « Il va être minuit, Monsieur le
Curé », cria-t-elle. Aussitôt l’abbé Monsavoir, se levant de table, en
secouant légèrement sa ceinture pleine de miettes :
« Mes chers amis, dit-il, il est une sainte coutume que nous avons de
ne pas dépasser minuit. Tout a d’ailleurs une fin ici-bas, même les
meilleurs repas… Et avant de nous séparer, je tiens à vous féliciter
tous de votre bonne tenue et de votre modération. Vous savez que
suivant un pieux usage, je dirai à 9 heures précises du matin l’
Obit
pour le repos de l’âme des frères défunts de votre Confrérie. C’est un
devoir pour vous tous d’assister à cette messe en grande tenue,
barrette et chaperon, et je suis convaincu que personne ne manquera à
l’appel ! Allons ! que chacun rentre chez soi pour se livrer à un
sommeil réparateur ! »
(
A suivre.)
Paul VAUTIER.
*
* *
Un Honnête Homme
UN ACTE EN PROSE
(Suite.)
________
GERMAIN. (
A Marguerite.)
T’en plaindrais-tu par hasard ?
MARGUERITE. (
Ton gris.)
Oh ! non bien sûr…
GERMAIN. (
Rude.)
Voyons, Marguerite, qu’est-ce qu’il te prend ? Cela n’est pas clair…
RAYMOND.
Tu ne vas pas nous refaire une scène je suppose ?... En voilà une
conversation de five o’cloke !.., Aussi, c’est de ma faute : je suis un
chenapan. J’ai dit des horreurs. Excusez-moi… et parlons d’autre chose.
Voyons… Tu dois avoir des ennuis pour justifier cette humeur de
porc-épic !... Des ennuis… Cherchons : tu as fait un héritage ?... Tu
vas être décoré… ? Tu…
GERMAIN.
Farceur !... Non… J’attends mon père.
RAYMOND. (
Stupéfait.)
Tu attends ton… ?
MARGUERITE. (
A Raymond.)
C’est vrai.
RAYMOND.
Mais tu ne m’as donc pas raconté ?... Je vous croyais brouillés depuis
votre mariage.
GERMAIN.
Nous sommes restés en relations commerciales.
RAYMOND.
C’est-à-dire plus ennemis que si vous étiez étrangers. Je ne savais
pas. Tu ne m’avais pas dit…
MARGUERITE.
Je vais vous expliquer, Monsieur Favier… Germain me le permet (
Regard
à Germain impassible.) Il hésite à parler de ces choses : il a eu tant
d’ennuis… Monsieur Druard père fut si dur à cause de ma qualité
d’artiste lyrique (
Baissant la voix) et de ma vie d’autrefois… Mon
mari m’a toujours défendue, oh ! oui… Seulement, il en souffre…
GERMAIN.
Je ne regrette rien. J’ai fait mon devoir en honnête homme. je t’ai
arrachée à l’atmosphère pernicieuse (
Jeu de Raymond) où tu vivais, et
je savais très bien quelles responsabilités j’assumais.
MARGUERITE. (
A Raymond.)
Germain souffre, bien qu’il ne veuille pas l’avouer…
GERMAIN. (
Rude.)
Je ne regrette rien, te dis-je !
MARGUERITE.
… Et Monsieur Druard souffre aussi…
RAYMOND.
Oh ! ça m’étonne bien ! Monsieur Eusèbe Druard et Cie n’est pas un
homme à …
MARGUERITE.
Monsieur Eusèbe Druard est père… Et je crois d’ailleurs que cette
commande pour laquelle il doit venir ici, n’est qu’un prétexte… Elle
n’exige nullement de conférence spéciale puisqu’elle est déjà preste
toute discutée…, n’est-ce pas Germain ?
GERMAIN.
Sûrement.
MARGUERITE.
Moi, je crois à une tentative de réconciliation.
GERMAIN.
Peut-être, mais pas nettement exprimée. J’aime la franchise… Et
d’ailleurs, il te doit des excuses pour ce qu’il a osé te dire…
MARGUERITE.
Je lui pardonne moi, tu le sais bien : c’est ton père !
RAYMOND.
Ta femme a raison. Il faut arranger ça.
MARGUERITE.
Assurément… Si tu es malheureux…
GERMAIN. (
Violent.)
Je te défens de dire que je suis malheureux ! C’est faux. Je t’ai
épousée parce que cela m’a plu. J’exige tous les respects pour Madame
Druard. Je ne sors pas de là… Mon devoir est de te défendre… Mon père
est un honnête homme, c’est entendu, un travailleur qui a droit à notre
reconnaissance. Mais il t’a manqué d’égards. Il te doit des excuses…
D’autant plus que j’ai toujours marché sur ses traces. (
Un temps). Ah
! si j’étais comme Favier, un artiste, un j’menfichiste !... mais je
suis, comme mon père, un homme d’ordre et d’étude. Je suis du monde des
industriels appliqués à leur besogne, je suis de ceux qui entretiennent
et qui augmentent la richesse nationale. Je marche sur les traces de
mon père, et je suis son égal maintenant, étant comme lui un homme
d’affaires.
RAYMOND. (
Ironique.)
Tu arranges bien ceux de mon monde au profit de ceux du tien. Tout de
même, il n’y a pas que vous qui…
GERMAIN.
Il y a nous d’abord pour maintenir l’ordre économique,… Nous sommes les
architectes de l’édifice social… Vous n’en êtes que les décorateurs…
RAYMOND. (
Se lève et salue.)
Il n’y a pas à dire, ça c’est envoyé ! Mais là-dessus, je vous quitte.
Je ne me soucie pas d’être là pour l’arrivée de Monsieur Druard père,
que les artistes ont le don de mettre en fureur.
GERMAIN.
Tu vas me faire le plaisir de rester. C’est une façon indirecte de lui
prouver que, s’il veut la réconciliation, il faudra qu’il achève de
faire des avances.
RAYMOND. (
Hésitation.)
Soit, mais ce n’est pas très folichon pour moi. Il a toujours des
compliments spéciaux à me faire, des insinuations particulières… Et
dame…
GERMAIN.
Si, reste. Je veux savoir s’il osera manquer une seconde fois, fût-ce à
peine, à Marguerite. Ah ! si cela arrivait…
RAYMOND.
Si cela arrivait ?
GERMAIN.
Si cela arrivait, je lui dirais ceci : « Mon père,… je vous défends de
manquer de respect à ma femme. Je l’ai soustraite à une atmosphère
pernicieuse pour l’élever d’un échelon social. Elle a droit maintenant
à être traitée comme toutes les femmes et son mari est là pour le
rappeler à quiconque serait tenté de l’oublier. »
Voilà ce que je dirais à mon père, Raymond. Tu m’entends ?
RAYMOND.
En principe, certes, tu as absolument raison. Cependant si… (
Coup de
sonnette.)
MARIE. (
Annonçant.)
Monsieur Eusèbe Druard.
(
A suivre.)
Georges NORMANDY.
*
* *
Pater Noster
____
Notre Père, Roi des cieux,
Protégez les malheureux ;
Faites que sur cette terre
Leur souffrance soit légère
Et donnez-leur, chaque jour,
Pour une simple prière,
Un peu de pain et d’amour.
Notre Père, à la fortune
Je préfère, blonde ou brune,
Qui, fidèle, m’aimerait
Et près de moi vous dirait :
« Plus rien ne nous importune,
Par vous nous sommes joyeux,
Notre Père, Roi des cieux. »
V.-Louis M
ARTIN.
═════════════════
Vers le nouveau Pays
____
Ne désespère point sur cette route austère,
Et franchis la douleur comme un sombre tunnel.
Ce voyage trop long, pour certains éternel,
Te mène, cahoté, sous des cieux de mystère.
L’homme qui t’aiguilla sur cette affreuse artère
Ne profitera point de son jeu criminel.
Rassure-toi. Voici le moment solennel
Où la nuit va finir et le fracas se taire.
Regarde, et tu verras l’espoir, point lumineux,
Trouer la profondeur du mur fuligineux
Et rayonner, ardente et magique fenêtre.
La lumière s’étale et devient de l’azur.
Un soleil dévoilé veille, au bord du ciel pur,
Sur le nouveau pays où nous allons renaître.
Jean M
IRVAL.
═════════════════
Encore un chant plaintif dans la nuit étoilée,
Accent que l’âme écoute et que l’esprit entend,
Harmonieux concert des cloches en volée,
Doux angélus du soir qui vers l’homme descend.
Encore un rêve immense, un seul, celui que j’aime,
Qui dit le grand amour, qui dit l’aube sans fin…
… Encore un frais baiser avant que le jour sème
L’or trop vif du Réel où s’allume un matin !
André MARÉCHAL.
*
* *
ÉCHOS ET NOUVELLES
______
Mort de M. Claude Aguétant. – On annonce le décès à Jullié (Rhône) de
M. Claude Aguétant, ancien maire d’Ambérieu-en-Bugey. Il était le père
de l’écrivain bugiste connu Pierre Aguétant et du lieutenant Charles
Aguétant, mort glorieusement à l’ennemi.
Le régionalisme français perd beaucoup en perdant cet homme de bien.
Nouveaux Chantiers de Constructions navales à Caen. – Les Chantiers
navals français viennent de se rendre acquéreurs de la Fonderie Nizon,
à Caen, et d’immenses terrains entre la rivière l’Orne et le canal de
Caen à la mer, pour la construction de plusieurs cales sèches.
Société d’électricité du littoral normand. – Le coupon d’obligation
n° 12, à échéance du 31 décembre 1917, est mis en paiement à raison de
net : 12 fr. 50 pour les titres nominatifs et au porteur.
Les paiements sont effectués par les soins de la
Banque française pour
le Commerce et l’Industrie, 17, rue Scribe, à Paris.
Laboratoire d’Etudes et d’Enseignement supérieur de la Chimie à
Rouen. – La Société Industrielle de Rouen et la Société Normande
d’Etudes viennent de réaliser le projet qu’elles avaient formé de la
création à Rouen d’un laboratoire d’études et d’enseignement supérieur
de la chimie.
Dans l’esprit des fondateurs, cette école doit préparer pour les
industries de la région normande des techniciens armés d’une haute
culture scientifique et aptes à faire progresser ces industries.
Il a été spécifié que pour être admis à suivre les cours du laboratoire
les élèves devaient justifier de connaissances chimiques suffisantes.
Le programme d’enseignement prévu pour la première année comporte :
Grosse métallurgie. – Alliages et aciers spéciaux. – Analyse thermique.
– Métallographie microscopique.
Grosse industrie chimique. – Electro-chimie.
Chimie organique : série acyclique.
Chaleur appliquée aux fours industriels et à l’étude des moteurs.
Electrotechnique : Courant continu et courant alternatif.
Application des colorants à la teinture et à l’impression.
On peut, pour obtenir des renseignements, s’adresser à la Société
Industrielle, 2, rue Ampère, à Rouen.
____________________
Le Gérant : MIOLLAIS.
_________________________________________________________
IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur.