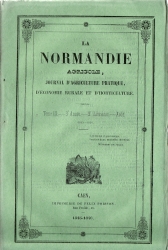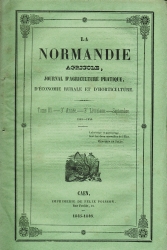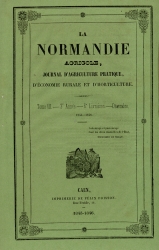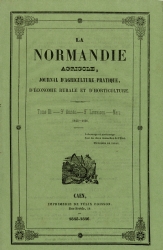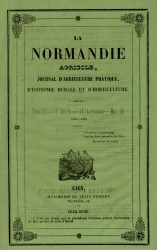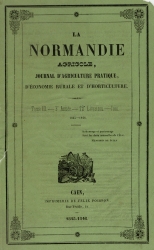La
Normandie agricole, journal
d’agriculture pratique, d’économie rurale et d’horticulture. Tome III.-
3e année.- 1845-1846.- Caen : Impr. de Félix Poisson, 18 rue froide,
1845-1846. ; 22,5 cm.
Numérisation : O. Bogros pour la collection électronique
de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (27.X.2013).
[Ce texte n'ayant
pas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement des
fautes non corrigées].
Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,
B.P. 27216,
14107 Lisieux cedex
-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01
Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]
obogros@lintercom.fr
http://www.bmlisieux.com/
Diffusion
libre et gratuite (freeware)
Orthographe
et
graphie
conservées.
Texte
établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm
n.c.) du tome III, seul conservé, de la Normandie Agricole pour l'année 1845-1846. Ce journal a paru de juillet 1843 à juin1848.
La
Normandie agricole,
Journal
d’agriculture pratique,
d’économie rurale et d’horticulture.
[Sélection d'articles]
~*~Tome III.- 3e année. - 1re livraison. - juillet 1845
 | | HÉBRUS, (fils de Don Quichotte) appartenant Mr Gve Marion. "Le
cheval dont nous publions le dessin est né et a été élevé dans la
Normandie. Il appartient à M. Marion fils, marchand de chevaux à
Blainville près Caen. Ce cheval très fortement membré, d'une taille de
1 mètre 639 mill. est fort beau trotteur. Il était depuis 6 semaines à
l'entrainement l'orsqu'il a été dessiné." |
UN MOT À NOS LECTEURS.
Fondée au mois de juillet 1843, la Normandie Agricole
est arrivée à sa troisième année d'existence, et l'accueil qu'elle a
reçu dès son début a été pour les fondateurs un témoignage de l'utilité
de celle publication.
En créant cet organe aux intérêts agricoles si importans, si variés de
nos départemens, nous avons, malgré notre désir de bien faire, beaucoup
moins compté sur nos propres forces que sur le concours des hommes qui,
par leurs éludes spéciales ou par une longue et intelligente pratique,
pouvaient nous aider à répandre d'utiles notions et de bons
enseignemens.
Nous remercions ici, au nom du pays, ceux de nos concitoyens qui ont
bien voulu nous seconder dans notre entreprise, et nous faisons encore
et toujours appel à la collaboration de toutes les personnes de savoir
et d'expérience, en faveur d'une œuvre que nous avons placée sous le
patronage de tous les amis des progrès pacifiques.
Car la Normandie Agricole est,
ainsi que nous l'avons dit dès la première page de cette publication,
un livre d'enseignement mutuel, où chacun peut venir déposer le fruit
de ses observations. Bien décidés à marcher en dehors de toute idée
systématique, de tout esprit d'exclusion, nous avons accueilli et nous
accueillerons toujours avec empressement toutes les communications qui
nous seront adressées, en nous réservant seulement et en réservant à
tous le droit de discussion et de critique , mais de cette critique
grave et raisonnée qui n'a pour but que d'éclairer, sans froisser les
amours-propres, d'arriver à la vérité sans blesser les susceptibilités
personnelles.
Appuyer de tous leurs efforts ce qui leur paraît bon et utile,
combattre les erreurs ou les abus, sans passion, sans aigreur et en se
maintenant sur le terrain nettement tracé à une mission spéciale, telle
a été la pensée des premiers fondateurs et telle sera la pensée qui
présidera constamment à la publication du recueil.
Au surplus, nous avons aujourd'hui à produire comme gage de nos
intentions et comme indication du but que nous nous proposons, les
travaux des deux premières années, de ce tems que nous appellerons
d'épreuve, le plus difficile en toute entreprise. Nous n'avons point la
prétention d'offrir ce produit de nos efforts comme une œuvre dont nous
devions nous glorifier : nous le présentons pour ce qu'il vaut, comme
un simple spécimen de la publication que nous allons poursuivre, et
dont l'utilité sera d'autant plus grande et le succès plus assuré, que
l'on voudra bien nous prêter un concours plus actif.
Ce n'est pas dans un intérêt personnel que nous travaillons, mais dans
celui de notre pays, et à ce titre tous les hommes éclairés nous
doivent aide et assistance.
La commission désignée par les premiers fondateurs de la Normandie Agricole se compose de :
MM. Thierry, professeur de chimie à l'Académie royale de Caen, Decourdemanche, propriétaire ; G. David, négociant ; Person, directeur de l'École d'équitation ; Le Barillier, propriétaire-cultivateur ; Caillieux, médecin vétérinaire ; et Manoury, professeur d'horticulture.
Directeur : A. SEMINEL.
CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE.
QUESTION CHEVALINE.— (Suite).
Du
rapport de la commission il résulte que, dans son sein, la question a
été envisagée sous cinq points de vue principaux : population,
production, amélioration, encouragemens, voies et moyens. 1°. POPULATION.
Suivant
les uns, elle serait suffisante, quant au nombre ; seulement, elle
serait impropre à satisfaire d'une manière complète certains besoins,
notamment ceux du luxe et de la cavalerie. Suivant les autres, au
contraire, elle pécherait à la fois par le nombre et la qualité ; et la
preuve, c'est que les prix augmentent chaque jour, et que l'on est
obligé d'avoir recours aux étrangers. Laquelle de ces deux opinions est
la vraie ? C'est une question qui ne laisse pas que d'offrir une
certaine importance, et de réclamer un sérieux examen. Que
nous importions chaque année dix-huit à vingt mille chevaux de commerce
; que dans les moments de crise, comme 1830 et 1840 , nous ayons dû
demander à l'étranger de quoi suffire aux besoins extraordinaires de
notre cavalerie, ce sont là des faits malheureusement hors de doute, et
que, tout en les déplorant, il n'est permis à personne de méconnaître.
Portant à vingt mille le nombre de chevaux que nous ne pouvons livrer
au commerce ; supposant que de dix mille chevaux que réclament les
remontes de la cavalerie, nous ne lui en fournissions que la moiti, il
en résulte un déficit annuel de vingt-cinq mille, et conséquemment, si
nous calculons à dix ans la durée des services du cheval, nous arrivons
à cette conclusion que la population indigène est de deux
cent-cinquante mille chevaux de luxe et de troupe, plus pauvre
qu'elle ne devrait être. Ce calcul est évidemment exagéré ; mais, en
pareil cas, mieux vaut dépasser le but que de ne pas l'atteindre :
aussi, irai-je encore plus loin et porterai-je le déficit à trois cent
mille. Personne ne niera, j'espère , que si la France produisait
annuellement trente mille chevaux de luxe et de troupe de plus qu'elle
ne produit en ce moment, elle ne fût en état de satisfaire largement
aux exigences de toute
nature.
Voilà donc une chose entendue : vainement chercherait-on dans
la population indigène trois cent mille individus qui devraient s'y
trouver. En faut-il conclure que cette population ne soit pas
suffisamment nombreuse, qu'elle soit trop nombreuse même ? En aucune
façon. Car si, au lieu de ces chevaux que nous n'avons pas et que nous
devrions avoir, nous en nourrissons deux ou trois fois davantage qui ne
sont propres à rien, ou du moins qu'à des services desquels nous
aurions intérêt à nous passer, il est évident que c'est la qualité
seule qui manque et non la quantité. Avant d'aller plus loin ,
qu'il me soit permis d'expliquer ici ce que j'entends par des services
dont nous aurions intérêt à nous passer. Les travaux agricoles exigent
l'emploi de moteurs dispendieux à élever et à nourrir. L'agriculture
cependant est d'autant plus prospère que ses travaux lui coûtent moins.
Elle doit donc donner la préférence au moteur qui lui offre le plus de
chances de rentrer dans ses débours. Mais comment rentrer dans les
débours occasionnés par un animal dispendieux à élever et à nourrir ?
En trouvant, à une époque quelconque, un acquéreur qui, ayant à son
tour besoin de lui, consente à le payer assez cher pour couvrir cette
dépense. Pour le cheval, il existe trois grandes catégories d'acheteurs
: le luxe et l'armée, les postes et les diligences, le roulage. En
conséquence, toutes les fois que l'agriculture l'emploie, elle doit
s'attacher à ce qu'il soit propre à l'un de ces trois services, et dans
ce cas son attente ne saurait être trompée , attendu que pour eux le
cheval est un objet d'indispensable nécessité. Il faut conséquemment
diviser l'existence de celui-ci en deux périodes : la première qui,
commençant à sa naissance, se prolonge jusqu'au moment où, parvenu à la
jouissance de la totalité de ses forces, il se trouve en
état d'être livré au consommateur ; la seconde qui, datant de cette
époque, ne finit qu'avec sa vie. La première période appartient de
droit à l'agriculture qui seule peut, sans inconvénient, exiger de lui
les travaux que nul autre ne pourrait impunément lui demander. La
seconde période arrivée, au contraire, il faut qu'elle s'en défasse, si
elle vent être indemnisée des dépenses qu'il lui a occasionnées. Mais
pour y réussir, il faut comme je le disais à l'instant qu'il réponde à
quelqu'un des besoins à satisfaire, ou, en d'autres termes, qu'il
puisse trouver un acheteur ; autrement elle se trouve dans la nécessité
de l'user , et conséquemment de supporter tous les frais d'élevage et
d'entretien sans compensation, puisqu'il diminue journellement de
valeur, et que dans un temps donné même, il cesse d'en avoir aucune.
Or, si les services qu'il rend peuvent l'être également par un autre
animal pour lequel il existe toujours un débouché certain, et qui
conséquemment ne peut manquer de restituer tout ou partie des dépenses
qu'il a occasionnées, il en résulte évidemment que partout ou
l'agriculture emploie un cheval impropre à satisfaire quelqu'un des
besoins ci-dessus mentionnés, elle a le plus pressant intérêt à se
passer de ses services et à les remplacer par ceux du boeuf. Il
y a donc pour elle, si elle persiste à faire usage du cheval, nécessité
absolue de l'approprier aux besoins du consommateur, et conséquemment
de le mettre dans le cas de trouver un acheteur. Mais pour le trouver
cet acheteur, il ne suffit pas que le cheval soit propre à son service
, il faut encore qu'il en ait besoin. Ainsi, autant l'intérêt public
exige que la production se maintienne constamment au niveau de la
consommation, autant l'intérêt de l'agriculture exige à son tour que ce
niveau ne soit jamais dépassé. Autrement l'agriculture, malgré la
qualité de ses produits, retomberait dans le même embarras qu'elle
aurait voulu éviter, avec cette différence toutefois que sa perte
serait augmentée de tous ses frais d'amélioration, Pousser la
production hors des limites de la consommation serait donc une faute
des plus graves. Des gens à courte-visée, je le sais, ne
manqueront pas de le nier, et de proclamer comme une importante
découverte, que plus les produits seront abondants, et moins les prix
seront élevés. C'est que précisément il faut que les prix soient
élevés. En effet, la qualité des produits exigeant pour première
condition des soins et des alimens qui occasionnent des dépenses
considérables, ces dépenses doivent nécessairement être remboursées.
Autrement si, par suite de surabondance, la vente se fait au-dessous du
prix de revient, elle ruine le producteur qui se trouve ainsi condamné
à produire à meilleur compte, c'est-à-dire plus mal.
Ici, d'ailleurs, l'intérêt du pays en général se trouve
parfaitement d'accord avec celui de l'agriculture, et il ne lui importe
pas moins qu'à elle que la quantité de chevaux qu'elle élève ne dépasse
pas le nombre strictement nécessaire aux besoins de la population. Le
cheval est essentiellement consommateur : traité comme il le doit être,
il n'en est pas un qui n'absorbe la nourriture de plusieurs hommes, et
personne ne doit oublier qu'à côté de ces nobles coursiers dont
s'énorgueillit l'Angleterre, et auxquels , dans
des mangeoirs de marbre et des rateliers d'acajou, elle prodigue la
nourriture la plus recherchée et la plus abondante, et que, dans des
appartements confortables, elle a journellement à constater la mort de
familles entières moissonnées par le froid, la misère et la faim. Ce
n'est pas à dire pour cela que nous ne devions pas produire le
nombre de chevaux dont nous avons besoin ; mais, un de plus, nous ne
devons pas le désirer, et dans toute localité où l'agriculture fait
usage d'un cheval, qu'une cause quelconque rend impropre à satisfaire
les besoins de la société, l'intérêt public demande qu'elle lui
substitue le bœuf qui, lui du moins, n'absorbe pas sans compensation
les fruits de la terre, et restitue à l'alimentation les emprunts qu'il
lui avait faits. De ce qui précède, n'est-on pas autorisé à
conclure que la population chevaline de la France est suffisante et
plus que suffisante, numériquement parlant ? Ce n'est donc pas
précisément à l'augmenter que doivent tendre les efforts de l'industrie
et de l'administration ; mais bien à faire en sorte qu'elle soit mieux
appropriée à certains services. A quel moyen recourir pour atteindre ce
résultat de la manière la plus prompte, la plus complète et la plus
durable ? A ce sujet il s'est produit un singulier raisonnement qui,
tout étrange qu'il puisse paraître au véritable homme de cheval, n'en a
pas moins trouvé, dans le congrès d'assez nombreux défenseurs, parmi
lesquels nous n'avons pas vu sans surprise quelques hommes d'un mérite
incontestable : preuve nouvelle, s'il en était besoin, combien cette
question des chevaux , si simple en apparence et que chacun se croit
apte à résoudre, présente cependant de difficultés réelles. Mais ce que nous avons à dire sera mieux placé au titre, de la production. F. PERSON.
(La suite à un prochain numéro).
LES PARASITES. — LE GUI DES POMMIERS.
Le Gui, ce végétal dont l'existence est si singulière, qui vit et se
développe aux dépens de l'arbre auquel il s'est attaché, comme certains
insectes s'attachent aux animaux pour leur sucer le sang ; le Gui, qui
autrefois était une plante sacrée et à ce titre en grand honneur, est,
de nos jours, bien déchu de son ancienne splendeur. Ce n'est plus cette
panacée universelle qui préservait ou guérissait de tous les accidens
et de tous les maux : c'est tout simplement une plante malfaisante que
tout cultivateur, jaloux de la bonne conservation de ses arbres, doit
extirper avec soin.
Ce parasite se développe sur presque toute espèce d'arbres ; mais, dans
nos départemens, c'est aux pommiers et à quelques variétés du peuplier
qu'il s'incruste de préférence, et dont il ne tarde pas à appauvrir la
végétation, chez les premiers surtout, si on le laisse croître à son
aise.
Le Gui s'implante dans le liber des arbres et vit de la sève qu'ils
charrient. On prétend même que quelquefois sa racine traverse la
branche et va former une seconde touffe du côté opposé. Il est aisé de
comprendre le tort que ce parasite fait aux arbres, puisqu'il absorbe
les sucs destinés à les nourrir.
Ce végétal est aux arbres ce que le chardon est à nos champs ;
non-seulement il nuit au développement de l'arbre auquel il s'est fixé,
mais il infecte de ses produits tous les arbres de la contrée. Ses
baies sont enduites d'une matière visqueuse, gluante, qui le colle sur
le végétal où elles se trouvent transportées par les oiseaux. Car il
est d'observation que les oiseaux qui se nourrissent du fruit du gui ne
le digèrent pas, en sorte qu'il est quelquefois, à des grandes
distances, déposé sur les branches des arbres avec la fiente qui
l'enveloppe. La plante doit avoir encore d'autres moyens de se
répandre, car on la rencontre sur des arbres et dans des contrées que
les oiseaux qui mangent le fruit du gui ne fréquentent jamais.
C'est au mois de mai que le gui commun de nos localités (celui à baies
blanches) est en fleur, quelque tardive que soit la végétation de
l'arbre sur lequel il vit. Le fruit ne mûrit qu'en automne, et c'est
pendant l'hiver qu'il devient la pâture des oiseaux.
En général, dans nos départemens, on se préoccupe peu de la destruction
de cette plante, qui fait cependant un tort considérable aux arbres et
finit par envahir tout un plant et souvent toute une contrée. Il en est
autrement dans d'autres départemens, et, sur les bords de la Loire
notamment, les cultivateurs sont très-soigneux de purger leurs arbres
de cet ennemi. Dans quelques parties de la Manche, où l'on donne un
soin tout particulier aux vergers, on voit peu de gui : son absence est
le signe d'une culture bien entendue.
Que nos cultivateurs sachent bien que le gui et la mousse sont deux des
fléaux des pommiers. La mousse est très-difficile à combattre lorsqu'un
plant est déjà âgé : quelques précautions que nous indiquerons
ultérieurement, peuvent, sinon l'empêcher complètement d'envahir les
jeunes arbres, du moins les en préserver en partie. Mais, quant au gui,
le cultivateur n'est pas excusable de ne pas le détruire, car
l'opération n'est ni longue ni difficile. Pour en purger les pommiers ,
il suffit d'un morceau de fer tranchant, tel qu'un bout de faucille
emmanché d'une gaule ou même une faux pour les parties basses de
l'arbre ; avec cet instrument on coupe la plante parasite le plus près
possible de l'écorce. Si l'on n'a pas cette précaution, un verger tout
entier est en quelques années infecté du gui.
Et cette négligence n'est pas préjudiciable seulement ou cultivateur qui s'en rend coupable
— c'est le mot — , elle l'est également à ses voisins qui, plus
soigneux que lui, ont coupé le gui dans leurs arbres ; car les oiseaux,
ainsi que nous l'avons dit, portent dans son champ les semences qu'ils
ont mangées dans le champ voisin, comme les vents transportent sur les
terres du bon cultivateur la graine des chardons qu'un mauvais fermier
laisse prospérer sur son exploitation.
Dans le Calvados, la vallée d'Auge est sur différens points infectée de
gui. Plusieurs fois déjà l'incurie, qui est cause de ce mal, a motivé
des réclamations de la part des cultivateurs intelligens, et c'est une
réclamation de ce genre, adressée récemment à la Société d'agriculture
de Caen, qui nous a amenés à parler de ce parasite.
IRRIGATIONS
Un propriétaire cultivateur du département de la Manche, qui a su tirer
des terrains qu'il exploite un parti assez avantageux pour que ses
observations, sur les améliorations à introduire dans notre
agriculture, méritent d'être examinées et discutées, nous adresse la
communication suivante :
« Au moment où tant d'esprits sérieux se préoccupent vivement de
l'avenir agricole de la France, permettez-moi de vous soumettre
quelques-unes de mes idées à ce sujet. J'ai à vous parler d'abord d'un
moyen de procurer l'irrigation à une grande quantité de terrains
improductifs, ou d'un produit presque nul, parce qu'ils sont privés des
arrosemens qui les féconderaient.
« Sur beaucoup de points, dans les contrées accidentées comme le sont
plusieurs parties du déparlement de la Manche, il existe un grand
nombre de petits moulins qui sont devenus sans valeur depuis que
l'industrie a fondé ses grandes minoteries, et qui ne peuvent reprendre
la valeur perdue, aujourd'hui que des communications faciles sont
établies entre ces usines et la masse des consommateurs.
« Pour ne parler que de l'arrondissement de Cherbourg, on citerait
vingt petits moulins vulgairement désignés par le nom caractérisque de Écoute-s'il pleut,
parce qu'ils n'ont suffisamment d'eau pour marcher que quand les
ruisseaux qui les alimentent sont grossis par la pluie. Ces moulins
sont les uns en chômage perpétuel, les autres loués à un prix bien
inférieur de celui qu'ils avaient il y a une quinzaine d'années
seulement. Chacun de ces moulins fait perdre une quantité d'eau qui
permettrait d'irriguer au moins dix hectares de terre en nature de
prairie.
« La valeur locative ou vénale d'un hectare de terre de cette nature
est généralement double d'un hectare de terre en labour. Cette
différence de valeur vient de ce que le premier rapporte plus que le
second et à moins de frais, et que d'ailleurs les prairies sont
indispensables pour nourrir les bestiaux, sans les quels point
d'engrais et point de bonnes récoltes.
« Tous les cultivateurs savent d'expérience qu'un hectare de terre bien
fumé produit plus que deux qui manquent d'engrais. Or, les fermes de
notre arrondissement n'ont pas, la plupart, assez d'herbages ou de
prairies pour nourrir le nombre de bestiaux qui donneraient à
l'exploitation un engrais suffisant pour les terres en labour. Encore
moins en ont-elles pour améliorer leurs herbages.
« S'il était besoin de preuves à l'appui de l'avantage des irrigations,
je citerais, sur ma propre exploitation, une pièce de terre de la
contenance de 4 hect., qui ne produisait que des fougères, des bruyères
et des ajoncs, et que, par des irrigations, et sans engrais, j'ai
changée en une bonne prairie.
« Ces faits posés , cherchons le remède au mal que nous signalons :
« La loi Dangeville sur les irrigations n'est véritablement qu'un des
articles de la législation réclamée de toutes parts sur cette
importante matière. Pour la compléter, on a demandé la faculté
d'appuyer, moyennant indemnité, un barrage sur la rive opposée ; une
loi portant règlement sur l'emploi et la police des eaux semble
également indispensable.
« Dans l'économie de cette loi, ne serait-il pas convenable de laisser
au gouvernement le droit de désigner une commission d'ingénieurs, soit
même de créer un corps spécial d'ingénieurs chargés spécialement
d'étudier le meilleur emploi à faire des eaux ? Ces ingénieurs, après
avoir reconnu le parti que l'on pourrait tirer, dans l'intérêt général,
des eaux absorbées ou du moins détournées de leur destination naturelle
par des moulins sans valeur, indiqueraient ceux qui devraient être
expropropriés pour cause d'utilité publique. Les mêmes ingénieurs
proposeraient alors un règlement qui déterminerait d'une manière
précise l'usage des eaux devenues du domaine public. Par ce moyen,
toutes les eaux seraient utilisées, et le règlement qui attribuerait à
chaque fond sa part de ce principe de fécondation préviendrait les
nombreux, souvent interminables et parfois ruineux procès qui, dans
l'état de choses actuel, s'élèvent journellement entre les
propriétaires des fonds riverains.
« On objectera sans doute que celte mesure entraînerail de grandes dépenses.
« A cela on répond que les terres en labour devenues prairies
arrosables prendraient une valeur double de celle qu'elles ont
aujourd'hui ; que des prairies médiocres deviendraient d'excellente
qualité, et que le gouvernement, en donnant ainsi une plus-value au
sol, rentrerait bientôt dans ses avances, par les droits de mutation
plus élevés qu'il recevrait.
« Résumons en chiffres :
« 1,000 moulins dont la chute d'eaa serait en moyenne de 6,000 fr. l'un, coûteraient 6 millions.
« En supposant que chacun de ces moulins s'oppose à l'irrigation de 10
hectares de terre, cela fait 10,000 hectares. Supposons encore que,
dans l'état actuel, dans une partie de la Normandie, l'hectare de terre
médiocre en labour ait une valeur locative de 50 fr., convertie en
prairie, il serait loué au moins 150 fr. : plus-value locative 1,000
fr. par hectare, soit un million par an.
« Il est bien entendu que l'on ne doit comprendre dans les moulins à
exproprier que ceux qui ont perdu une valeur qu'ils ne peuvent
reprendre ; et qu'il faudrait exclure de la mesure d'expropriation ceux
dont les eaux ne pourraient recevoir un utile emploi, de même que ceux
qui, ayant une grande puissance d'eau, pourraient être transformés en
un genre quelconque d'usine.
« Il y a beaucoup, pour ne pas dire qu'il reste tout à faire en matière
d'irrigation. Chacun doit le tribut de ses idées pour éclairer la
question et aider à l'amélioration. C'est dans ce but que je vous ai
soumis les miennes et que je me joins à vous pour appeler sur cet
important sujet les réflexions de toutes les personnes dont il a pu
fixer l'attention.
« Dans un prochain numéro , je vous adresserai quelques observations sur les moyens d'amélioration des chemins ruraux.
« Agréez, etc.
D*. Cultivateur à Tourlaville, arrond. de Cherbourg. »
*
* *
Tome III.- 3e année. - 2e livraison. - août 1845
CHEVAUX AU PIQUET
DANS LES PRAIRIES NATURELLES.
Depuis long-temps il est d’usage, dans la plupart des contrée de
nos départements, de tenir les vaches et les chevaux au piquet
dans les prairies artificielles. Il est reconnu que ce procédé réunit
le double avantage de laisser aux animaux une demi-liberté, en plein
air, chose utile à leur santé, et de tirer le meilleur parti des
herbes, en empêchant le gaspillage.
Nous avons indiqué ce que c'est que le piquet (v. tome 1er, page 155.)
Nous pourrons revenir plus tard sur ce sujet. Ce que nous avons à
signaler aujourd'hui , c'est une innovation récemment introduite dans
l'usage du piquet, par un des cultivateurs et éleveurs intelligens de
notre pays, par M. Marion , père, à Caen.
M. Marion qui avait, par une pratique longue et éclairée, constaté les
bons résultats de cette méthode, a pensé que le piquet pour les chevaux
pouvait être employé aussi bien dans les prairies naturelles que dans
les prairies artificielles.
En 1843, pour la première fois, M. Marion fit l'essai de ce système,
dans des herbages situés à Colombelles, près Caen, sur la rive gauche
de l'Orne. Ces herbages, sans être de qualité supérieure, sont bon
fond, plutôt froids que chauds, plutôt secs que mouillans, ce qui est
la meilleure condition pour obtenir d’importans résultats que nous
avons à mentionner.
Depuis trois ans les expériences ont été continuées, et si nous n'en
avons pas parlé plus tôt, c'est que nous voulions parler plus sûrement.
Nous pouvons dire actuellement que le succès a été complet , et nous
appelons l'attention des cultivateurs sur le mérite du procédé.
M. Marion aménage le sol dont il peut disposer, de telle manière que
les jeunes chevaux qu'il tient au piquet y restent depuis la mi-avril
environ, époque où les herbes commencent à pousser, jusque vers la
mi-octobre. A cet effet, il divise en deux soit herbage. Les chevaux
sont piqués dans la première partie, tandis que la seconde est
dépouillée par des boeufs d'engrais ou par des moutons, jusqu'au
moment où il convient de retirer ces animaux, pour laisser reposer les
herbes et préparer aux chevaux une nourriture suffisante.
Le piquet est changé de place, c'est-à-dire avancé vers la partie à
dépouiller, une on deux fois en 24 heures, et la corde est lâchée une
ou deux fois, ce qui équivaut à trois ou quatre changements de piquet.
Le premier changement se fait le matin de 4 à 5 heures selon la saison
; à 11 heures, au moment où l'on apporte à boire et dle l'avoine aux
chevaux , — lorsqu'il entre dans les calculs de l'éleveur de leur
donner ce supplément de nourriture, — on lâche le noeud de la corde
pour donner plus de longueur, et le soir pour la nourriture de la nuit,
le piquet est changé de nouveau.
Dans toute sa longueur la corde à 7 mètres, ce qui donne aux chevaux
un espace suffisant pour prendre de l’exercice. - Dans la première
partie de la journée la corde reste raccourcie d'un tiers.
Tous les jours le crottin est étendu avec soin.
Les herbes sur lesquelles les chevaux ont été piqués sont maintenues à
une hauteur égale, par un troupeau de moutons que l'on fait passer
successivement sur tous les points où elles tendent, à s'emporter.
Pendant une dizaine de jours après que les chevaux sont retirés, les
moutons restent sur les parties de l'herbage qui ont été les premières
dépouillées.
Après dix à douze jours de repos de l'herbage, les boeufs y sont
introduits, c'est-à-dire vingt jours après que les chevaux en sont
sortis.
Il convient d'ajouter que, par suite d'observations judicieuses dont
nous allons parler, M. Marion laisse s'écouler une année avant de
mettre de nouveau des chevaux dans le méme herbage.
Pour
lui la raison en est, — et celle raison est fondée sur
l'expérience — que les herbages se comportent d'autant mieux, sont
d'autant plus fertiles que l'on prend plus de soin de varier les
espèces d'animaux qui Ies dépouillent. Ainsi M. Marion fait passer
successivement chevaux, moutons et bêtes à cornes sur le même herbages.
Par ce moyen, il n’a jamais d’ herbe de refus, comme cela arrive quand
on met continuellement sur les mêmes herbes la même espèce de bestiaux,
- d’où résulte pour l'herbager une perte notable.
Tout le monde sait que les chevaux en liberté font beaucoup de tort aux
herbages : en galopant jour et nuit, ils défoncent le sol et détruisent
une partie de l’herbe, ce qui fait dire communément que le cheval
consomme plus par le pied que par la dent. Aussi, dans tous les baux
existe-t-il une clause qui défend de mettre les chevaux dans les
herbages, ou qui en limite strictement le nombre.
Au moyen du piquet cet inconvénient disparaît. La longueur de la
corde donne au cheval l'espace nécessaire pour prendre l'exercice qui
convient à sa santé, mais pas assez pour qu'il prenne ses grands ébats.
En second lieu, par les urines et le crottin qu'il est forcé de laisser
sur que lui limite sa corde, il dépose successivement de l’engrais sur
chaque partie de l’herbage. M. Marion estime que cette fumure équivaut
au moins un franc par are.
Les faits sont là pour justifier cette assertion : l’amélioration du
fond sur lequel les chevaux ont passé est telle que l’oeil le moins
exercé reconnaîtrait, à leur végétation, les parties des herbages
dépouillées par les chevaux au piquet et celles dépouillées de toute
autre manière.
Les propriétaires des herbages exploités par M. Marion ont d'ailleurs
si bien reconnu les avantages du piquet, pour l'amélioration du fond,
qu'ils lui ont laissé la pleine faculté de faire dépouiller
successivement toutes les herbes par des chevaux.
Voici un autre avantage du piquet : la reprise des herbes dix jours
après que les moutons les ont quittées, soit vingt jours depuis que les
chevaux ont été retirés, donne un fourrage d'une qualité bien
supérieure aux regains ordinaires des prairies. Ces herbes ont du
corps, sont substantielles, et les bestiaux s'en trouvent très bien,
tandis que souvent les herbes molles des regains relâchent le corps des
bestiaux qui, au lieu de s'amender, s'y détériorent tout d'abord,
quoiqu'ils soient en pleine herbe, jusqu'à ce qu'ils aient le corps
fait à celle nourriture.
Résumons : avec le piquet, loin d'avoir à craindre que le fond ne soit
détérioré par le pied des chevaux, l'expérience a démontré qu'il est
devenu meilleur ; isolés les nus des autres, les chevaux ne peuvent se
blesser mutuellement, et il leur suffit de quelques jours de piquet
pour être bien accoutumés à la corde ; placés dans l'impossibilité de
se donner un exercice exagéré, ils profitent mieux de la nourriture
qu'ils prennent, peuvent par conséquent être nourris et entretenus en
bon état, sur un espace de terrain bien moins étendu, et ne sont pas
sujets aux affections que leur occasionnent fréquemment les
refroidissemens, après les courses échauffantes auxquelles ils se
livrent quand ils ont leur pleine liberté. Derrière eux , un troupeau
de moutons, proportionné à l'étendue du terrain, peut vivre, et après
eux les bêtes à corne trouvent une reprise d'herbes d'une qualité
supérieure aux regains.
Pour bien préciser l’amélioration du sol, disons que M. Marion peut
mettre, année moyenne, 25 boeufs dans des herbages où il n’en plaçait
précédemment que 16 ou 18, et que ces 25 boeufs s'y amendent beaucoup
mieux qu'auparavant les 16 ou 18 autres. Et de plus un troupeau de
moutons a trouvé une partie notable de sa nourriture derrière le piquet
des chevaux.
Les chevaux, gardés et soignés par un seul homme, seront restés du 15
avril environ jusqu'a la fin de septembre. - Et 25 boeufs les
remplaceront dans les mêmes herbages, pour y séjourner jusqu'à Noël ;
puis des boeufs dits trembleurs, y passeront l'hiver jusqu’à la
mi-mars, et y trouveront une partie de Ieur nourriture.
Le troupeau entretenu par M. Marion est toujours de 150 têtes. Il a
vendu cette année, 60 brebis grasses et 80 agneaux.
Tels sont les avantages qui résultent du procédé. Tout le monde peut
constater l'exactitude de ce que nous avons rapporté et en tirer cette
immense conséquence qu’avec ce petit système on peut, sur le même fond,
nourrir un tiers plus de bestiaux.
Le succès, du reste, est si manifeste que déjà plusieurs cultivateurs
du pays se sont empressés de suivre l’exemple de M. Marion. Nous
savons en outre que des essais, dont le résultat peut d’avance être
considérés comme certain, vont être faits pour l'engraissement des
bêtes à cornes, par le même procédé. Nous ne pouvons qu’engager tous
les hommes intelligens, qui ont une exploitation convenable, à
interrogés l'expérience : les trois années d'épreuves dont nous venons
de rendre compte leur sont une garantie du succès.
A.S.
DE LA NÉCESSITÉ D'ÉTABLIR DANS LE DÉPARTEMENT UNE FERME MODÈLE.
On
dit encore tous les jours que nos cultivateurs sont ennemis des
innovations ; des gens qui ne les connaissent pas les représentent
comme des hommes livrés à l’esprit de routine et se cramponnant
opiniâtrement aux anciens usages sans aucune autre raison que leur
ancienneté même. A les en croire, nos campagnes auraient conservé au
XIXe siècle les moeurs et Ies préjugés du quinzième. Rien n'est plus
faux, et pour être répétés, ces reproches n'en sont pas moins
souverainement injustes. Aurait-on déjà oublié quel empressement
accueillit dans nos plaines la culture de la betterave, et quelles
expériences ont été tentées pour naturaliser, parmi nous, le madia
sativa, le seigle multicole, le sésame, le chou caraïbe, ainsi qu'une
foule d'autres produits équivoques répandus à profusion avec plus de
zèle que de discernement. Si depuis quelques années la foi de nos
agriculteurs s’est un peu refroidie, la faute en doitêtre imputée à ces
prétendus agronomes qui, malgré leurs bonnes intention, ont compromis
parmi nous la cause du progrès, et qui l'auraient infailliblement
perdue, si jamais elle pouvait l'être. Il faut être juste aussi
; propriétaires ou fermiers , nous avons tous besoin de la totalité de
nos revenus ; l'amour du confortable et du bien-être, la diffusion du
luxe qui n'est point d'ailleurs un aussi grand mal qu'on le dit ; les
nouveaux besoins qui surgissent de toutes parts, tout nous entraîne
dans des dépenses considérables et peut-être excessives. Nous ne
sommes plus au tems où nos pères gardaient ce qu'ils appelaient une poire pour la soif,
c'est-à-dire une année entière de leurs revenus bien enfermée dans le
tiroir de leur vieux secrétaire. Maintenant chaque année, au
contraire, épuise jusqu'au dernier sous de ses produits, trop heureux
encore quand notre petit budget domestique, moins tiraillé que celui
de l'état, peut se maintenir dans un exact équilibre et se solder sans
déficit. Dans cette situation toujours un peu précaire,
fatalement entraînés par des nécessités renaissantes, nos cultivateurs
ne doivent-ils pas craindre de s'adonne à des essais aventureux ?
Nest-il pas naturel qu'il leur répugne de compromettre un présent
assuré pour un avenir incertain, de jouer sur une carte leur bien-être
et leur repos, surtout quand l'espoir du gain est encore amoindri par
le souvenir des pertes et des déceptions de leurs devanciers ? Une
pareille réserve n'est point ainsi qu'on affecte de le dire, une
opiniâtreté routinière : c'est au contraire de la prudence, du bon
sens ; c'est une oeuvre d'homme sage et de bon père de famille. Ainsi
ces expériences que les particuliers ne sauraient entreprendre,
l'administration publique doit les exécuter. Aplanir aux populations la
voie du bien-être et du progrès, telle est la mission qu'elle a reçue
du pays, et, quand elle la néglige, elle manque à tous ses devoirs. Au
point de vue du progrès agricole, le seul qui nous occupe ici, ces
devoirs sont faciles à remplir : il suffirait de créer au centre du
département un établissement spécial , et d'y faire exécuter par des
praticiens habiles toutes les expériences qui peuvent intéresser notre
agriculture. Si cette ferme modèle était habilement dirigée, on en
obtiendrait bientôt d'importans résultats ; je me bornerai à en
indiquer ici quelques-uns. Tous les hommes qui jettent leurs
regards sur l'avenir, se préoccupent dans ce moment de la nécessité de
remplacer par un autre genre de travail la fabrication des dentelles de
soie qui décroît de jour en jour, et n’offre déjà plus aux ouvrières de
nos campagnes que des ressources insuffisantes ; l’éducation des vers à
soie et le dévidage des cocons emploiraient un grand nombre de bras,
précisément dans la saison de l'année où les travaux des champs ne sont
point ouverts ; mais on est malheureusement persuadé que les vers à
soie ont besoin pour se développer d'une grande chaleur, et que ces
insectes originaires de la Chine, ne peuvent réussir que dans le midi
c'est un préjugé, et on en triomphera sans doute. Toutefois pour le
vaincre, il faut prouver par des faits qu'il n'a aucun fondement ; il
n'y a rien au monde de plus convaincant qu'un fait, mais les argumens
de ce genre ressemblent aux témoins de Chicaneau : ils sont fort chers et n'en a pas qui veut
; nous tournons donc là dans un cercle vicieux, car nos cultivateurs ne
consentiront à risquer leur argent que quand ils auront vu de leurs
yeux et touché de leurs mains les succés de l’industrie séricicole.
Doit-on les blâmer de cette hésitation ? J'ai peine à le croire : les
plantations des mûriers, les magnaneries sont de ces premiers
établissmens qui exigent beaucoup de tems et de grands sacrifices :
peut-on exiger d'eux qu'ils les entreprennent à l'aventure? Le
département de l'Eure a obtenu de beaux résultats sans doute , mais peu
de gens parmi nous en sont instruits ; et ceux même qui les connaissent
ignorent encore pour la plupart le secret des procédés à l'aide
desquels on y est arrivé. Comment donc imiterait-on ce qu'on ne connaît
pas ? Quand une ferme modèle aura mis sous nos yeux et les produits de
la soie et les moyens de les faire naître ; quand nous auront vu une
magnanerie fonctionner et réussir à notre porte, dans les circonstances
mêmes au sein desquelles nous sommes placés, alors, n'en doutons pas,
si opiniâtres qu'elles soient, les préventions s'évanouiront et les
incrédules eux-mêmes deviendront les plus fervents apôtres de cette
nouvelle et bienfaisante industrie. Mais je ne me lasserai point de le
redire : sans une ferme modèle qui démontre la possibilité du succès,
elle court grand risque de s'arrêter encore un demi-siècle sur les
limites du département de l'Eure. Ces résultats tout importans
qu'ils soient, ne sont pourtant pas les seuls que l'on doive attendre
de cet établissement ; j'ai déjà fait remarquer l'année dernière qu'il
serait fort utile d'introduire dans nos exploitations rurales quelques
grands quadrupèdes de l'Amérique. Ces importations sont d'une part
trop dispendieuses, et de l'autre leur succès est toujours trop
incertain, pour qu'elles puissent être entreprises par des
particuliers ; mais ces obstacles n'arrêteraient point une
administration entretenue aux frais du département ; les animaux
exotiques seraient déposés dans la ferme modèle, dans une sorte de
magasin où chacun viendrait en prendre suivant sa convenance et ses
besoins, et après que son expérience personnelle lui en aurait
démontré les avantages ; de cette manière, notre pays serait, mis en
possession d'une foule de jouissances et de ressources agricoles dont
le reste de la France n'a pas même encore l'idée. Ce sont là
jeux de prince, direz-vous ; soit plusieurs principautés de
l'Italie et de l'Allemagne ne valent pas un département tel que le
nôtre ; mais si pourtant on était effrayé par le grandiose de ces
essais, on pourrait les réduire à des proportions plus modestes. De
nos jours, la mécanique s'est beaucoup occupée d'améliorer les
instrumens d'agriculture ; ces perfectionnemens ne sont presque jamais
connus que par les réclames des journaux dont le charlatanisme est
devenu proverbial. Il est donc tout naturel qu'on se tienne en garde
contre leurs éloges, et les meilleures découvertes demeurent ainsi
stériles, confondues qu'elles sont avec les chapeaux gibus ou la Pommade du lion.
Ne serait-il pas du plus haut intérêt de réunir en un même lieu et à
portée des cultivateurs, toutes les nouvelles inventions qui peuvent
leur être utiles, telles que les charrues, les semoirs, les machines à
battre, etc..., de les faire fonctionner sous leurs yeux, et de les
mettre en état d’en reconnaître par eux-mêmes les avantages et les
inconvéniens ? Il en est de même des espèces de blés récemment
introduits des pays étrangers, et des nouvelles plantes, soit
oléagineuses, soit fourragères ; des expériences soigneusement
faites permettraient de juger quelle est leur valeur intrinsèque ou
leur mérite relatif, etmettraient enfin nos agriculteurs à l'abri de
grossiers mécomptes qui, dans plusieurs circonstances, ont eu l’air
d'une véritable mystification. On sait que nous ne possédons
encore aucune synonymie de nos pommiers à cidre ; tous les essais qui
ont été tentés jusqu'à ce ce Jour, ont avorté faute de direction et
d'ensemble ; on pourrait planter dans un vaste terrain toutes les
espèces cultivées dans le département , les comparer ensuite et en
dresser le catalogue avec facilité (1). Cette mesure n'aurait pas
seulement une importance scientifique ; on arriverait à reconnaître
ainsi quelles sont les espèces qui conviennent aux différens sols,
quelles sont celles qui sont le plus généralement fertiles, qui
contiennent le plus d'alcool ou qui résistent le mieux, soit aux vents,
soit à la sécheresse, soit aux pluies. Aujourd'hui nos propriétaires
plantent absolument au hasard ; mais grâce à ces données, des
renseignemens précis viendraient enfin remplacer les vagues indications
de l’ignorance et de l'esprit de routine. Je ne pousserai pas
plus loin cette énumération , quoiqu'il nie fût très facile de
l'étendre. Si quelque membre du conseil général daigne y jeter les
yeux, elle suffira, j'espère, pour le porter à provoquer la création de
l'établissement que je sollicite. L'an dernier, le conseil s'est
particulièrement occupé des ports de mer, et sans qu'on recherchât de
trop près s'ils avaient la robe nuptiale, tous les cantons du littoral
se sont assis pèle-mêle au banquet. Je ne m'en plains pas ; au
contraire, cette égalité me plaît ; mais ne pourrait-on, cette année du
moins, réserver quelques miettes pour nos cultivateurs ? Il y aurait
bien là aussi peut-être un peu de justice, car enfin quand vient le
quart d'heure de Rabelais, c'est à eux qu'on a toujours soin de
présenter la carte. AL. DU MÉRIL.
(1)
MM. Girardin et Dut Breuil ont tenté à Rouen cette importante
classification ; mais mal secondés dans leurs efforts, ils n'ont pu
faire qu’un travail incomplet.
HYGIÈNE ET MÉDECINE VÉTÉRINAIRES.
Déjà nous avons publié dans la Normandie Agricole
plusieurs articles concernant les maladies qui affectent le plus
ordinairement les jeunes chevaux et indiqué les premiers soins à
donner en l'absence du vétérinaire. L'accueil bienveillant accordé à ce
travail nous engage à publier de nouvelles observations que nous
croyons susceptibles de présenter quelque intérêt. Parmi les
accidens auxquels sont sujets les jeunes chevaux depuis la naissance
jusqu'à l'époque où ils sont livrés au commerce ou aux remontes, ceux
qui surviennent aux extrémités sont malheureusement nombreux et
laissent presque toujours des traces fâcheuses. Au nombre de ces
accidens, il faut placer ceux qui accusent une usure prématurée, tels
que la perte des aplombs et ceux qui résultent d'efforts plus on moins
violents, qui ffont naître ces tumeurs molles on osseuses contre
lesquelles échouent trop souvent les traitemens les plus énergiques. Nous désignerons sous le titre de faux aplombs,
les conformations vicieuses qui rendent les chevaux arqués, panards,
cagneux, clos, crochus et bouletés ; défectuosités graves, presque
toujours accidentelles, dont nous signalerons bientôt les causes, et
que l'on préviendrait dans le plus grand nombre des cas, en adoptant un
système d'éducation convenable. Répéterons-nous après tant
d’autres dont les sages conseils sont trop peu écoutés, que le travail
prématuré chez les poulains et une nourriture insuffisante sont les
causes principales de l'usure des jeunes chevaux. Ce sont là des
vérités qu’il faut rappeler souvent, car les inconvéniens qui en
résultent, contribuent à déprécier le cheval normand, auquel on
reproche d’avoir peu d'énergie et d'être souvent taré avant l'âge où il
devrait rendre des services. Si le cultivateur ne peut faire
autrement que d'employer ses chevaux aux travaux agricoles, dès I'âge
de 18 mois ou 2 ans qu'il tâche au moins de comprendre qu'il est
indispensable de leur donner une nourriture abondante, substantielle et
bien choisie. Comment supposer, en effet, que nourris de vert
une partie de l'année, privés d'avoine pour la plupart, mangeant
l'hiver des foins souvent avariés, ces jeunes animaux pourront résister
à des travaux plus ou moins pénibles, et que cette alimentation
débilitante n'influera pas sur leur tempérament ? Il est évident que
l'animal faible, dont la fibre musculaire est dans un état de
relâchement apparent, s'usera beaucoup plus tôt et plus vite que chez
celui qui a de la vigueur, de la force, et de l'énergie. Cette usure
commencera par la perle des aplombs, des membres et sera bientôt suivie
du développement de tumeurs qui apparaîtront dans le voisinage des
articulations et détermineront tôt ou tard des boiteries. Nous
devons encore signaler ici une habitude pernicieuse qui contribue
puissamment à la ruine des jeunes chevaux, en développant chez eux un
tempérament lymphatique : c'est l'abus des saignées
en tous tems, mais surtout pendant l'usage du vert. Comment ne
comprend-on pas que des évacuations sanguines doivent être plus
nuisibles qu'utiles à des animaux nourris de plantes qui contiennent
beaucoup d'eau de végétation, tels que le trèfle, le sainfoin, la
luzerne, etc..., et qui le plus souvent sont mangées couvertes de pluie
ou de rosée ? Si l'on conservait pour l'examiner, le sang des animaux
soumis à ce régime, on reconnaîtrait bientôt, par le petit volume du
caillot qu'il renferme, comparativement à la quantité de sérum ou
partie aqueuse, dans lequel surnage la partie coagulée que ces
évacuations doivent être proscrites. La saignée peut-être utile, mais
seulement lorsque les plantes approchent de l'époque de la maturité. Nous pourrions encore dire un mot des sétons
que l'on considère comme un remède à tous les maux et que l'on
applique pour la plus légère indisposition. Toutefois, l'abus même de
cette médication présente moins d'inconvéniens que ceux que nous avons
signalés ; nous dirons cependant, qu'il est parfois dangereux de les
supprimer tout à coup et sans aucune précaution, comme cela arrive
fréquemment, et qu'on est souvent forcé de les employer de nouveau pour
prévenir le développement de maladies plus graves. Il est fort à
craindre alors qu'il ne produise plus le même résultat. Concluons
donc de ce qui précède qu’il faut mieux nourrir les jeunes chevaux,
exiger d'eux moins de travail et ne pas les soigner sans qu'il y ait
nécessité de le faire. Entrons dans quelques détails maintenant
sur les accidens que nous venons de signaler, et voyons quels moyens on
peut tenter pour en arrêter les progrès ou les faire disparaitre. FAUX APLOMBS.
Chevaux arqués. Lorsque le genou dépasse en avant la ligne perpendiculaire, le cheval est dit arqué, ployé ou creux dans ses genoux. Si cette défectuosité tient à une conformation naturelle, il est brassicourt.
Dans le premier cas seulement et lorsque l'animal est jeune, on
parvient quelquefois à redresser ses membres par l'usage d'une ferrure
méthodique qui consiste à diminuer la hauteur des talons et à placer
sous le pied un fer dont les éponges sont amincies en biseau et la
pince un peu relevée pour faciliter la marche de l'animal. Ce n'est
qu'après plusieurs ferrures qu'on peut obtenir un bon résultat ; mais
il faut éviter la première fois d'abattre tout d'un coup les talons, de
peur d'opérer sur les tendons un tiraillement qui ne serait pas sans
danger (1). Chevaux droits sur les membres et bouletés.
Dès qu'on s'aperçoit que les jeunes es chevaux ont une disposition à
se bouleter, il faut y apporter remède sur-le-champ, car une fois que
le boulet est porté en avant et que l'appui du sabot se fait sur la
pince, il n'est plus possible de rétablir les aplombs. Pour
arrêter les progrès de ces sortes d'accidens qui déprécient beaucoup
l'animal, il faut encore faire usage d'une ferrure convenable.
contrairement à l'avis du plus grand nombre des maréchaux , qui
prétendent qu'en abaissant les talons on reporte le boulet en arrière,
nous conseillons d’abattre la corne en pince, de conserver celle des
talons et de donner de l'épaisseur aux éponges du fer. On empêche par
ce moyen Ie tiraillement des tendons fléchisseurs, ce qu'on ne peut
éviter dans la ferrure à talons bas, et l'on voit insensiblement le
membre reprendre son aplomb naturel. Une expérience très simple
convaincra les plus incrédules ; il suffit, de placer un cheval
bouleté sur un terrain en pente, d'abord l'avant-main du côté le plus
élevé, puis en sens contraire : dans la première position , la douleur
occasionnée par le tiraillement des tendons, contraindra l'animal à
porter ses boulets en avant ; dans la seconde il prendra son appui avec
confiance, et le vice sera bien moins apparent. La ferrure que nous
indiquons, produira ce résultat. Pour rétablir les aplombs chez
les poulains arqués ou bouletés, il est indispensable , indépendamment
de l'usage d'une ferrure de ne les soumettre qu'à un travail très léger
et mieux encore à des promenades journalières, et de les nourrir
convenablement. MOLLETTES, VESSIGONS ET VARICES, autrement dits TUMEURS MOLLES.
Ces
diverses affections , que l'on sait être des épanchemens de synovie
dans le voisinage des articulations, sont toujours fort graves
non seulement parce qu'elles peuvent occasionner des claudications,
mais à cause de la difficulté et souvent de l’impossibilité de les
guérir. Les mollettes viennent aux boulets, les vessigons aux jarrets,
de même que les varices qui, Ie plus souvent, ne sont autre chose que
des vessigons qui apparaissent au pli du jarret, c'est-à-dire à la
partie antérieure, et que l'on confond avec la dilatation de la veine,
bien que cet accident soit très rare. Toutes ces tumeurs sont le
résultat du relâchement des capsules synoviales et de la peau, et
lorsqu'elles ne proviennent pas d'un effort, d'une chute, elles sont
inhérentes à la constitution et se déclarent spontanément chez les
animaux faibles et mal nourris ; ou bien elles paraissent dès qu'on les
soumet au plus léger travail. Dès l'apparition de ces tumeurs il
faut promptement y porter remède, car c'est alors seulement qu'on peut
espérer quelque succès d'un traitement sagement ordonné-. Les conseils
du vétérinaire sont donc indispensables. Nous ne pouvons prescrire ici
un traitement qui doit varier suivant le tempérament et l'âge du sujet
et selon la cause et la gravité de la maladie ; nous dirons
seulement que les applications vésicantes
sont encore ce qui réussit le mieux pour combattre ces tumeurs à leur
début, et que lorsqu'on ne peut parvenir à les faire disparaître, il
faut avoir recours à la cautérisation. Nous préférons le feu mis en
raies parallèles et longitudinales à l'usage des pointes, qui ne
produisent pas un aussi bon effet et qui laissent des traces sinon plus
apparentes, du moins plus défectueuses à l'oeil. Mais, nous ne
saurions trop le redire, des moyens préservatifs conviendraient
beaucoup mieux pour faire de bons chevaux. Et ces moyens
consisteraient dans une nourriture abondante, substantielle, tonique,
qui donnerait de la vigueur, de l'énergie et des forces, et rendrait
les jeunes animaux susceptibles de supporter saris inconvénient les
travaux auxquels on les soumet. Plusieurs fois nous avons vu
disparaître des mollettes et des vessigons récents , dès que l'on en
venait à nourrir les poulains avec des aliments secs et à leur donner
surtout une certaine quantité d'avoine chaque jour. TUMEURS OSSEUSES,
désignés sous les noms de SUROS, EPARVINS, JARDONS, FORMES, etc..
Tout
le monde connait la gravité de ces maladies des os d'où proviennent
presque toujours des boiteries qui empêchent la vente des animaux, et
desquelles, il faut le dire, la médecine triomphe rarement. Ces
maladies sont le résultat de l'épanchement des sucs osseux qui
acquièrent bientôt la consistance de l'os et forment des tumeurs ou
exostoses plus ou moins nuisibles au jeu des articulations : quelques
unes sont transmises par hérédité et par conséquent incurables ; la
plupart des autres proviennent d'efforts occasionnés par des travaux
au-dessus de la force des jeunes chevaux. Nous ne connaissons
d'autre traitement pour guérir ces maladies que l'application du feu
qui malheureusement ne réussit pas toujours. Les pointes fines dont on
se sert pour cette opération doivent traverser la peau ; lorsque les
animaux sont jeunes, elles laissent rarement des traces apparentes. Ce
moyen est donc le seul que nous puissions conseiller en pareille
circonstance. Nous dirons cependant encore ici, et l’expérience
le prouve journellement, que ces sortes d'accidens arrivent beaucoup
plus rarement chez les poulains dont on exige peu de travail et qui
sont nourris confortablement. Dans un prochain article nous
parlerons de divers accidens ou maladies qui ne reconnaissent le plus
souvent d'autres causes que celles que nous avons signalées, et dans un
article spécial sur la ferrure
, nous indiquerons les moyens de conserver au pied du cheval sa bonne
conformation , et le mode de ferrage le plus convenable pour rétablir
les aplombs chez les chevaux panards, cagneux, etc… CAILLIEUX,
Secrétaire de la société vétérinaire
du Calvados et de la Manche.
(1) On conseille, en outre, de donner à manger au cheval dans ratelier un haut placé. (Note du Réd.)
FOURRAGES. — LA CHICORÉE SAUVAGE.
Un propriétaire cultivateur de l'arrondissement de Bayeux nous adresse la communication suivante :
Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro de la Normandie agricole, du mois de juin dernier, vous avez parlé de la culture de la chicorée sauvage. J'ai cultivé cette plante en grand, et j'ai trouvé que, donnée en vert, elle était en effet un excellent fourrage.
J'habite un pays où la plus grande partie des terres sont en herbages,
où, par conséquent, le fourrage vert abonde ; aussi mon but, en
cultivant la chicorée sauvage, n'était-il pas de me procurer de la
nourriture pour les bestiaux.
Je voulais trouver une plante qui me fournît la plus grande quantité
possible d'engrais en vert, pour remédier à l'absence des pailles,
toujours très-rares et qui coûtent fort cher, et à l'emploi de la
chaux, dont trop souvent on fait abus. J'ai donc cherché à cultiver les
végétaux qui, même inutiles, même nuisibles, tels que le chardon,
l'ortie, etc., pouvaient donner une grande masse d'engrais, étant
coupés en vert. J'ai fait plusieurs essais, et celle des plantes qui
m'a donné le meilleur résultat, est la chicorée sauvage. J'en ai fait
d'abord quelques mètres carrés, et j'ai été étonné de la quantité du
produit.
L'année suivante j'en ai fait plus en grand, — un hectare au moins —
dans une terre profonde, et après six labours, sans fumier, ni engrais
d'aucune espèce. L'année précédente, cet hectare avait produit des
betteraves. La première année, la chicorée était peu abondante, mais
elle a duré fort belle pendant cinq ans.
Cette plante paraissait si appétissante que, malgré l'envie que j'avais
de la faire couper pour en faire uniquement du fumier, j'essayai d'en
faire donner d'abord aux cochons qui la dévoraient. Les moutons, les
vaches et les chevaux en sont également très-friands. Cette production
était si abondante que, pendant l'été, lorsque l'herbe est presque
nulle dans les herbages, j'en ai fait donner aux vaches qui, chaque
jour, attendaient avec impatience le moment de la manger. J'ai fait
enfermer une vache à l'étable pendant deux mois : elle a mangé
uniquement de la chicorée et rien autre chose. Quand elle est sortie,
elle était dans le même état que lorsqu'elle fut renfermée, quoiqu'elle
eût dû être plus grasse, mangeant de la chicorée autant qu'elle en
voulait ; mais cette vache avait l'habitude d'être toujours dehors et
avec d'autres vaches, et l'absence d'exercice et l'ennui lui étaient
nuisibles. Son lait, que j'ai fait mettre à part, n'a augmenté ni
diminué ; le beurre était aussi bon que celui des autres vaches,
seulement la pâte en était plus courte et parfois un peu grumeleuse,
mais il avait fort bon goût. Cette vache ne mangeait que les feuilles,
et laissait les bâtons un peu durs, qui, du reste, contribuèrent
notablement à augmenter le fumier.
Les chevaux à l'écurie mangeaient la chicorée avec plaisir, et se
portaient à merveille ; mais ils étaient un peu longtems à manger,
lorsque la plante avançait en maturité, parce qu'ils leur fallait du
tems pour éplucher les bâtons coriaces et les rejeter de dessous la
dent.
Cette gourmandise de tous mes animaux, dévorant toute ma chicorée,
m'empêcha de faire cette montagne d'engrais vert que j'avais en vue,
mais la chicorée retournait cependant en fumier sous une autre forme.
Il restait d'ailleurs les tiges qui ont donné une assez grande masse
d'engrais. Ne pouvant couper souvent toute la chicorée à la fois, une
partie de la première coupe seulement grandissait promptement. J'en ai
fait ordinairement quatre coupes par an, quelquefois cinq, mais j'ai
remarqué que-si on la coupe trop peu avancée, elle fond et se réduit
beaucoup.
Chaque année à la fin de l'hiver, je faisais répandre sur le champ de chicorée du plâtre en poudre.
Ayant été absent pendant quelques mois, les domestiques de ferme,
négligens comme ils le sont tous dans celle partie de la
Normandie, s'épargnèrent la peine de couper chaque jour la chicorée. Au
mois de juillet, à mon retour, je vis une véritable forêt d'arbustes
panachés de milliers de fleurs du plus beau bleu. Ma chicorée était un
bois touffu qu'on n'aurait pas pu pénétrer à cheval et haute de plus de
trois mètres. J'ai cru qu'elle s'était fatiguée, mais l'année suivante
elle n'en était que plus belle. Cette année-là seulement je n'ai eu que
deux coupes, mais aussi j'ai obtenu une masse d'engrais, après l'avoir
fait mettre sous les moutons. Elle fut bonne à employer comme le fumier
de paille ; et, malgré la force des tiges, comme celles-ci étaient
encore vertes, la fermentation fut active. Je ne pourrais pas dire au
juste la quantité de mètres cubes de fumier que mon hectare de chicorée
m'a donnés, mais je me rappelle que la quantité fut très-satisfaisante.
Dans ce pays où les terres labourables ne peuvent être occupées pendant
plusieurs années, parce que l'on veut faire du blé tous les deux ans,
la chicorée ne pourrait pas toujours se cultiver en grand, à moins de
ne la laisser que deux ans ou un an , comme pour faire du café, ou du
soit disant café ; mais la première année, la chicorée donne beaucoup
moins que les années suivantes. Je puis assurer qu'elle peut servir
comme excellent fourrage vert, et qu'elle peut au besoin donner une
grande quantité de matière verte. Ce n'est certes pas un terrain perdu
que celui employé à la culture de cette plante dont la végétation est
vraiment extraordinaire dans une terre profonde. Les racines pivotantes
vont chercher leur nourriture à plus d'un mètre et n'épuisent pas la
terre.
Le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire enlever ces racines avec
grand soin, autrement elles reparaîtraient après plusieurs labours.
Elles peuvent servir à faire du fumier ; et la quantité vaut la peine
de les faire ramasser.
Du blé, fait sans engrais, après cinq ans de chicorée, et quatre bons labours, a été superbe.
J'aurais pu garder la chicorée plus de cinq ans, mais elle commençait à s'épuiser un peu.
Si vous croyez, monsieur le rédacteur, que cette petite notice, qui
peut servir de complément à votre article du mois de juin, soit
intéressante et digne de votre journal, disposez-en comme vous le
jugerez à propos.
D. Un de vos abonnés fondateurs.
AMÉLIORATION DE LA RACE CHEVALINE.
Une
commission spéciale vient d'être instituée par M. le Préfet du Calvados
pour s'occuper des moyens d'améliorer la race chevaline dans ce
département. Elle se compose de MM. de Turgot, pair de France ; Delacour, maire de St.-Gabriel ; Lemyre de Villers, officier de cavalerie en retraite ; Person, propriétaire à Graye ; Ad. Le Senécal, propriétaire à Bayeux ; Henry, maire de Hottot ; Marion, père, à Caen ; Basly , propriétaire à St.-Contest ; Caillieux, vétérinaire à Caen ; Le Barillier, propriétaire à Lebisey ; Tillard, maire de Blainville ; Londe, propriétaire à Evrecy ; L. Cocquard, propriétaire à Vire ; Champin, maire à St.-Sylvain ; Viel, propriétaire à Soliers ; Lecoq, maire de Cambes ; Desbleds, maire à St.-Manvieu ; Seminel, rédacteur de la Normandie agricole.
Cette
commission s'est réunie pour la première fois le 19 août sous la
présidence de M. le Préfet. L’empressement avec lequel la plupart des
membres ont répondu à l'appel du chef de l'administration
départementale, a témoigné de l’importance qu'ils attachent à la
mission qui leur est confiée.
Après avoir indiqué à l'assemblée
le but qu'il s'est proposé en instituant cette commission , M. le
Préfet a soumis à son examen les trois objets suivants, sur lesquels il
était dans l'intention d'appeler la sollicitude du Conseil-général.
1° Primes aux jeunes chevaux castrés ;
2° Primes aux jumens poulinières ;
3° Réorganisation de l'École d'Équitation.
Sur
le premier point : Ie nombre des poulains castrés présentés pour la
prime, augmentant d’année en année, M. le Préfet du Calvados a pensé,
d'accord avec le jury du dernier concours, qu'il serait utile
d'augmenter aussi la somme allouée pour encouragemnens, afin de faire
entrer de plus en plus dans les habitudes des éleveurs l'usage de
castrer de bonne heure leurs chevaux. M. le Préfet se proposant
d'engager à cet effet le Conseil-général à porter à 3.000 fr.
l'allocation de 2,000 accordée depuis 1835, ce magistrat a invité la
commission à exprimer son opinion sur le meilleur emploi à faire de
cette somme.
Après une longue discussion, il a été, unanimement
décidé, que le système actuel, d'après lequel les 20 poulains jugés les
meilleurs reçoivent chacun une prime de 100 fr., ayant donné de bons
résultats, il conviendrait de le continuer, dans le cas où l'allocation
du Conseil-général ne serait pas augmentée.
Si cette somme était portée à 3,000 fr., la grande majorité de la commission a été d'avis qu'elle devrait être ainsi répartie :
1°
Une prime spéciale de 300 fr. à l'éleveur qui présenterait au jury le
plus grand nombre de chevaux castrés, susceptibles d'être primés et
dont un au moins aurait obtenu une prime.
2° Deux primes de 200
fr. chaque aux poulains castrés offrant le plus de distinction, et deux
de 150 fr. aux deux poulains venant après.
3° 100 fr. à chacun des vingt poulains reconnus les meilleurs parmi tous les autres.
En
établissant ainsi les primes, la commission a eu eu vue d'intéresser à
la castration de jeune âge le plus grand nombre possible de
cultivateurs, et par les primes plus élevées de les amener à castrer
des chevaux de distinction, mais dont ils auraient le vain et trop
ordinaire espoir de faire des étalons. C'est la fâcheuse illusion que
se font fréquemment les éleveurs sur le mérite de leurs jeunes chevaux,
qui les engage à les conserver entiers, et enlève ainsi au commerce un
grand nombre d'animaux, qui nous permettraient de rivaliser avec les
chevaux anglais et les allemands toujours castrés de bonne heure.
Sur
la deuxième question , relative aux jumens poulinières, la commission a
pensé que le moment était venu de convertir en annuelles les primes
qui, aujourd'hui, sont triennales. Lorsque le Conseil-général décida
que les primes de 400 fr. et de 300 fr. seraient accordées pour trois
ans, il agit ainsi dans uie pensée intelligente : il importait de
retenir dans le pays le peu de bonnes jumens poulinières qui y
restaient et que les étrangers nous enlevaient l'une après l'autre.
Aujourd'hui
que le prix élevé des poulains sortant de race distinguée est une
première prime assurée à l'éleveur ; que beaucoup de propriétaires et
cultivateurs ont compris l'avantage qu'ils ont à garder leurs bonnes
juments, il n'y a plus nécessité de faire les primes triennales.
D'ailleurs , les bonnes jumens seront toujours primées, et grâce aux
primes annuelles les erreurs auront des conséquences moins fâcheuses.
D'ailleurs encore, dans le nouveau système, il n'y aura que les jumens
suitées qui puissent concourir, ce qui assurera au département un plus
grand nombre de produits distingués, et grâce à l’élévation donnée aux
primes de première et de seconde classe les bonnes jumens, si elles ne
restent pas stériles, donneront encore à leurs propriétaires plus
d'avantages que par le passé.
En effet , les primes de la
première classe étant portées à 600 fr. et celles de la seconde à 400 ,
en trois années, !a jument qui ne pouvait obtenir que 1,200 fr. ou 900
fr. comme maximum pourra à l'avenir avoir 1,800 et 1,200 fr. de primes.
Quant
à la répartition, des primes entre les deux sections du département, la
commission prenant en considération les efforts que font aujourd'hui
différens cultivateurs de l'arrondissement de Bayeux, ainsi que le
mérite des chevaux élevés dans le Bessin, a été unanime pour proposer
de diviser comme il suit les primes :
| Argences | 3 primes de 600 fr.
6 id. de 400 fr.
12 id. de 200 fr.
---
21 | 1.800 fr
2.400 fr.
2.400 fr.
--------
6.600 |
6.600 | | Bayeux | 2 id. de 600
4 id. de 400
8 id. de 200
---
14 | 1.200
1.600
1.600
-------
4.400 |
4.400 | | En tout 35 primes d'une valeur de | 11.000 |
Jusqu'à
présent, l'allocation n'était que de 9,900 fr., mais la commission a
exprimé l'espoir qu'en vue du progrès qui doit résulter de cette
nouvelle combinaison, le Conseil-général n'hésiterait pas à voter la
somme de 11,000 fr. qu'elle réclamait.
Les deux premières primes
de la première catégorie à Argences et la première à Bayeux ,
devraient, dans la pensée de la commission, être plus spécialement
affectées aux jumens saillies par des étalons de pur sang, à mérite
égal avec celles saillies par d'autres étalons.
ÉCOLE D'ÉQUITATION.
M.
le Préfet a communiqué à la Commission une lettre par laquelle M. le
ministre de l'agriculture et du commerce lui fait connaître l'intention
où il est de concourir à la réorganisation de cette école et de
contribuer à la dépense, si le Conseil-général et la ville de Caen
consentent également à y prendre part.
Il s'agirait de fonder un
enseignement en faveur des sujets qui se destinent comme palfreniers ,
piqueurs ou cochers, à soigner les chevaux. Le gouvernement ferait les
frais de l'enseignement et fonderait six bourses, le Conseil-général
porterait à 2,500 fr. l'allocation de 1,500 fr., et aurait également
six bourses à sa disposition ; enfin , la ville remettrait les bàtimens
en état et pourrait aussi envoyer à l'école des élèves qui seraient
formés à soigner, atteler, dresser, monter et conduire les chevaux.
Il
y a long-tems qu'un homme d'expérience de notre pays a dit qu'avant de
faire des chevaux il fallait faire des hommes capables de s'en occuper.
Le projet actuel a pour objet de répondre à ce besoin.
La
Commission, tout en exprimant quelques craintes sur le peu
d'empressement avec lequel cet utile enseignement pourra être suivi,
n'a pas hésité à donner son entière adhésion au projet de
réorganisation. Elle a considéré que dans un centre d’industrie
chevaline, il était nécessaire de fonder une bonne école d'équitation,
afin de former des élèves qui, à leur tour, répandront les meilleures
méthodes de pansage et de dressage des chevaux. C'est moins la qualité
que l'éducation qui manque à nos élèves, et c'est en remédiant à ce mal
que nous nous mettrons en état de soutenir la concurrence avec
l'étranger qui amène sur nos marchés des chevaux moins bons, mais mieux
dressés que les nôtres.
M. Person a été invité à préparer un
projet de règlement qui a été soumis au Conseil-général, à l’appui de
la demande. Ce projet a dû comprendre tout ce qui concerne le mode
d'enseignement, la discipline, les conditions d’admission, etc…, de
manière à ce que l'École prenne le caractère d'institution publique.
Avant
de se séparer , la Commission a exprimé l'intention de former dans le
Calvados une société hippique, de laquelle seraient appelés à faire
partie tous les hommes qui s'intéressent au progrès de l'industrie
chevaline, cette branche si importante de notre agriculture.
P. S. Le conseil général, dans sa séance du 30, a accueilli les trois proposilions dont nous venons de parler.
D'autres observations ont été soumises au conseil, par M. G. Le
Couteulx, au nom de la commission des patentes de santé, de
l'arrondissement de Bayeux. Nous ferons connaître, dans notre prochain
n°, en rendant compte des travaux du conseil général, au point de vue
de l’agriculture, la réclamation de cette commission.
SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE DU CALVADOS
ET DE LA MANCHE.
VICES RÉDHIBITOIRES.
Entre autres questions soumises à l'examen de la Société dans sa dernière séance, ledébat a roulé sur les vices rédhibitoires.
Voici dans quels termes he procès-verbal que nous avons sous les yeux
rend compte de cette partie de la séance pages 12, 13, 14, 15 et 16.
«
La Compagnie s'occupe des questions concernant les vices rédhibitoires.
Le secrétaire communique la lettre de M. Loiset ; les observations que
ce vétérinaire adresse à la Société , fournissent de nouvelles preuves
de l’insuffisance et des difficultés que présente la loi du 20 mai 1838
dans son application.
« M. Loiset regrette qu'on ait omis de placer dans la catégorie des vices rédhibitoires le typhus
de l'espèce bovine, qui possède la fâcheuse propriété de se transmettre
aussi promptement que la clavelée, et qui occasionne des mortalités et
des dommages bien plus considérables La même observation est, selon
lui, plus ou moins applicable à la pleuro-pneumonie bovine, à la rage
et à d'autres maladies épizootiques et contagieuses dont les invasions,
quoique rares et imprévues, n'en constituent pas moins de redoutables
fléaux pour les cultivateurs, dont elles peuvent anéantir inopinément
les premières et les principales ressources. Les observations de M.
Loiset ont fixé l'attention de la Société ; elle a décidé que soit
travail serait renvoyé à l'examen de la commission chargée de
recueillir tous les documents qui pourront éclairer le gouvernement
sur la nécessité d'apporter quelques modifications à la loi sur les
vices rédhibitoires.
« L’annulation de plusieurs procès verbaux
par omission de la prestation du serment, a fait comprendre enfin
à quelques-uns de MM. les juges de paix que cette formalité est
nécessaire de la part des experts ; mais il arrive parfois que
l'éloignement du domicile de ces magistrats, et la difficulté de les
rencontrer obligent les experts à des déplacements coûteux, qui
d'ailleurs exposent l'acheteur à voir le délai de la garantie périmé.
On remédierait à ces inconvénients, dit M. Loiset, en assermentant
auprès de chaque tribunal civil les vétérinaires diplomés domiciliés
dans l'étendue de leurs juridictions respectives ; leurs noms, publiés
par ordre du ministre de l'agriculture et du commerce, seraient déposés
dans chaque prétoire de justice de paix pour que le magistrat qui le
dessert puisse choisir, parmi ceux qui ont capacité et qualité, les experts qu'il aurait à nommer conformément à la loi du 20 mai.
«
La plupart des juges de paix inscrivent, au bas de la requête
présentée, l'ordonnance de nomination des experts ; ceux-ci prêtent
serment et apposent leurs signatures à côté de celle du magistrat.
Cette manière d'agir est, à coup sûr, la plus expéditive ; mais on ne
fait pas toujours ainsi : quelques-uns de ces magistrats exigent que
leurs greffiers conservent la minute des ordonnances, et, comme il
arrive fréquemment que ces Messieurs sont hors de chez eux , il faut
que l'expert retourne plusieurs fois, souvent a une distancé fort
éloignée, avant d'être en mesure de faire son opération. Cette
formalité entraîne non-seulement à des frais plus considérables, mais
elle expose souvent l'acheteur à perdre son recours en garantie,
lorsqu'il n'a pu soupçonner l'existence d'un vice rédhibitoire que le
dernier jour que la loi lui accorde.
« Plusieurs questions se
rattachant aux vices rédhibitoires sont encore discutées avec intérêt
par la Compagnie. Quelques membres font connaître les décisions de
certains tribunaux qui n'ont pas toujours jugé dans le sens de la loi,
et dont les jugements étaient sans appel.
« Le tic
n'est rédhibitoire qu'autant qu'il n'est pas apercevable à l'usure des
dents ; mais lorsqu'il s'écoule un temps plus ou moins éloigné entre la
première visite et la contre-expertise ordonnée par le tribunal, il
arrive parfois, et ce fait a été constaté, que les derniers experts
trouvent les dents usées. L'acheteur, dans ce cas, est condamné à
garder le cheval. La Société ne voit d'autre moyen pour éviter cet
inconvénient que de rendre le tic rédhibitoire avec ou sans usure des dents.
« La Société décide de nouveau que le signe caractéristique de la pousse
est le soubresaut , et qu'il n'est pas nécessaire que cheval soit
affecté d'une toux sèche, quinteus , etc. , pour prononcer l’existence
de la maladie.
« Elle déclare encore qu'elle considère comme synonymes les expressions de cornage et sifflage,
bien que ces deux affections ne soient pas parfaitement identiques, et
que suivant l'opinion de plusieurs vétérinaires, l'une paraisse avoir
quelque gravité de plus que l'autre.
« L'épilepsie
ou mal caduc est généralement une maladie très-rare en Normandie. Le
très-petit nombre de vétérinaires qui ont été appelés à la constater,
avouent n'avoir jamais pu en rencontrer les symptômes. Chaque fois les
experts ont dû questionner les personnes qui déclaraient avoir vu la
maladie, et bien rarement les renseignements obtenus suffisaient pour
la caractériser ; quelquefois encore ces renseignements étaient
produits par l'acheteur, sa femme, ses enfants ou ses domestiques, et
ne pouvaient inspirer une confiance entière. Malgré ces difficultés,
la Société reconnaît l'impossibilité de pouvoir caractériser autrement
la maladie ; mais elle insiste sur la nécessité d'apporter la plus
grande circonspection dans les renseignements fournis par des
personnes souvent intéressées à la résiliation des marchés.
« La fluxion périodique
qui se déclare chez un cheval borgne, peut-elle entraîner la
rédhibition, lorsque la maladie apparaît sur l’oeil déjà privé de la
vue ? La Société tout entière répond affirmativement à cette question.
« Pour constater l'existence d'un vice ou maladie rédhibitoire chez un animal mort dans les délais de la garantie, la Phthisie pulmonaire
ou vieille courbature, par exemple, MM. les juges de paix , pour éviter
des frais plus considérables occasionnés par les déplacements des
experts, désignent généralement un seul vétérinaire pour faire
l'autopsie et rédiger procès-verbal ; mais il arrive fréquemment aussi
que le vendeur vient en opposition, dans l'espoir de faire annuler un
procès-verbal qu'il croit injuste, ou dans lequel il pense trouver
quelque nullité. Pour prévenir de semblables procès, dont
malheureusement on connaît plus d'un exemple, et pour mettre aussi les
experts à l'abri de soupçons injurieux, la Société est d'avis qu'en
pareille occurrence les experts conservent les organes ou viscères
susceptibles de servir de pièces de conviction, et que ces parties,
recueillies en présence du maire et de son adjoint, et de quelques
témoins soient marquées et cachetées du sceau municipal, pour être
représentées au besoin.
« En agissant ainsi, le vendeur qui n'a
pu se trouver à l'autopsie du cadavre et qui se croit mal jugé, pourra
se convaincre par lui-même, avec l'assistance d'un vétérinaire, de
l'exactitude des faits consignés au procès-verbal.
« Le renversement du vagin,
maladie assez fréquente en Normandie, occasionne souvent des procès qui
embarrassent quelquefois les tribunaux appelés à les juger. La loi dit
positivement que l'action rédhibitoire ne peut avoir lieu qu'autant
que le part a eu lieu chez le vendeur, et cependant il peut arriver que
la vache ayant été vendue plusieurs fois (et c'est ce qu'on observe
lorsqu'elle a été conduite d'une foire à une autre dans l'espace de
quinze à vingt jours), la parturition n'ait réellement pas eu lieu chez
le vendeur. Certains tribunaux ordonnent dans ce cas la résiliation de
la vente ; d'autres ne l'admettent pas. La Société pense qu'on
éviterait cet inconvénient, si l'on supprimait dans le texte de la loi
les mots : chez le vendeur, et qu'on y substituât ceux-ci : après le part récent.
«
La Compagnie décide qu'elle s'occupera dans la prochaine séance des
autres maladies rédhibitoires, dont il n'a pas été parlé à cette
réunion ».
ENGRAIS.- LES URINES.- SULFATE DE FER.
Dans
une des dernières séances de la société d’agriculture de Caen, à
l'occasion d’échantillons de sulfate de fer (couperose verte), déposés
sur le bureau, par un fabricant de produits chimiques, M. Thierry,
professeur de chimie, président de la société, a présenté quelques
observations sur l'utilité du sulfate dle fer pour la conservation des
urines au profit de l'agriculture.
Il convient de faire
remarquer, dit le savant professeur, les avantages nouveaux que
procurerait au pays, dans le double intérêt de l'agriculture et de la
salubrité publique, le mélange, avec de l'urine, d'une petite quantité
de couperose verte dont le prix est aujourd'hui si peu élevé. M.
Schattemann, l'habile directeur des usines de Bouxvillers, en Alsace, a
déjà mis sur la voie d'une pareille application, en signalant l'effet
de ce sel, pour désinfecter les fosses d'aisance, et améliorer
l'excellent engrais qu'on en retire. Ne serait-il pas à désirer qu'au
lieu de perdre journellement les urines qui deviennent (surtout pendant
les chaleurs de l'été) une cause incessante d'infection, et qui
seraient si précieuses comme engrais, qu'au lieu de les laisser
s'écouler ou séjourner sans aucune précaution, dans l'intérieur même
de nos habitations, au lieu de les disperser dans les rues, sur les
places publiques, autour de nos édifices et de nos plus beaux
monnumens, ne serait-il pas désirable, au contraire, qu'on les
recueillit avec soin, en recourant à des moyens susceptibles de
prévenir les résultats dégoûtans et insalubres de leur putréfaction,
moyens qui tendraient, en même tems, à augmenter leur propriété
fertilisante.
Il suffirait, chez les particuliers, comme dans
les grands établissemens, tels que casernes, collèges, hospices,
etc..., de les réunir dans des baquets ou des fosses. Là, par
l'addition de petites doses de sulfate de fer (quelques millièmes), on
empêcherait ou retarderait leur altération putride, jusqu'au moment
où les cultivateurs bien avisés viendraient les chercher pour les
répandre sur leurs fumiers où leur terre, ou dans des réservoirs
appropriés à cet usage. Il y aurait, sans nul doute, dans cette
pratique, grand profit pour l’agriculture (M. Tostain, notre collègue,
en a déjà acquis la preuve frappante, dans son domaine d'Ecoville, où
il fait transporter, chaque semaine les urines de la caserne de
Vaucelles, qui lui ont été livrées par abonnement), et il y aurait en
outre grande amélioration sous le rapport de la propreté de la ville et
conséquemment sous celui de la salubrité de l'air qu'on y respire.
«
L'administration municipale, en ce qui concerne la voie publique, en
faveur de laquelle la décence aurait d'ailleurs quelques réclamations
à faire, pourrait efficacement intervenir par des mesures et des
réglemens de police, que les habitans accepteraient avec
reconnaissance et empressement. Il est à souhaiter qu'elle donne
l'exemple, et l'impulsion qui viendra d'elle produira son effet dans
l’intérieur de nos habitations et dans celui de nos grands
établissemens. »
La Normandie agricole
a délà appelé l'attention de ses lecteurs sur ce nouvel et utile
emploi de sulfate de fer, ainsi que sur le préjudice qu’éprouve notre
agriculture par suite de la perte de l'un des élémens les plus précieux
de fertilisation.
Nous avons, à cet égard, une conviction que
nous voudrions faire passer dans l'esprit de tous les cultivateurs, et
dans ce but nous reviendrons, chaque fois que l'occasion s'en
présentera, sur cet important objet.
De toutes parts on
s'ingénie pour trouver de nouveaux engrais ou augmenter la masse de
ceux que l'on connaît ; on va chercher à grands frais, à des distances
immenses, le guano ; on achète à un prix élevé, les rapures de cornes
et tous les débris animaux ; on dépense des sommes considérables pour
se procurer les poudrettes et les engrais artificiels de toute espèce,
et on laisse perdre dans nos villes les matières fécales et les urines
qui serviraient à fertiliser des milliers d'hectares de terre autour de
tous les grands centres de population !
Dans notre Normandie,
citée pour l'intelligence et la sagacité de ses habitans, on est réduit
à citer le nom de quelques personnes qui savent tirer parti de cette
espèce d'engrais, quand tous les cultivateurs devraient chercher à en
enrichir leur sol, quand tous les hommes éclairés devraient en
recommander l'emploi.
C'est aux sociétés d'agriculture,
composées de citoyens influens, soit parmi les cultivateurs, soit parmi
les administrateurs des villes, à propager par tous les moyens de
fécondes notions sur les avantages que l'agriculture peut obtenir de
l'usage des matières fécales mêlées aux urines : c'est à ces matières
que la Flandre doit en grande partie une prospérité agricole dont tous
ceux qui ont visité ce pays ont conservé un durable souvenir.
Dans
ces contrées, chaque cultivateur a sur son exploitation une fosse ou
citerne dans laquelle sont réunies les matières, les urines, les
purins de fumier. La fosse est maçonnée et couverte pour empêcher toute
déperdition, et elle est établie sur un point plus élevé que celui ou
passent les voitures, de manière à ce qu'avec une pompe on puisse
aisément remplir la citerne ou la vider dans les tonneaux qui portent
sur les champs l'engrais liquide.
Chez nous, la plus grande
partie des matières fécales sont perdues ; toutes les urines sont
entraînées dans les cours et dans les rues de nos villes qu'elles
infectent ; dans les campagnes, les fumiers sont lavés par les pluies,
et les purins, qui en sont l'essence, vont se perdre dans les chemins,
au lieu de servir à féconder le sol.
Voilà ce qu'il faut dire et
redire, dans l'intérêt de notre agriculture, jusqu'à ce qu'enfin les
cultivateurs comprennent la nécessité d'employer les excellens engrais
qu'ils peuvent se procurer à bas prix , au lieu d'aller payer très-cher
des engrais qui souvent sont falsifiés. Qu'ils sachent bien qu'un
litre d'urine contient autant et plus de parties fertilisantes qu'un
pied cube du meilleur fumier et que l'une venant en aide à l'autre ils
peuvent doubler la valeur du sol.
Que nos administrateurs
secondent dans cette oeuvre les hommes de progrès ; qu'ils prennent des
mesures de sage police pour la conservation des urines, qui sont
un principe délétère quand elles se perdent dans nos centres de
population : les villes y gagneront en propreté et en salubrité et les
campagnes en fertilité.
*
* *
Tome III. - 3e année. - 3e livraison. - septembre 1845.
CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE.
QUESTION CHEVALINE (Suite).
2°.PRODUCTION.
Quelle
que soit la divergence d'opinions relativement à la population
chevaline, il est un point sur lequel l'accord est à peu près unanime ,
c'est l'impossibilité où elle se trouve de suffire aux besoins du luxe
et de l'armée ; besoins qu'il est cependant indispensable qu'elle
parvienne à satisfaire, le luxe étant nécessairement la réserve de
l'armée.
Comment faut-il agir sur la production , pour mettre la population dans le cas d'atteindre ce résultat ?
Cette
question simple en apparence, ne laisse pas en réalité que d'être
complexe, et pour obtenir une solution satisfaisante, d'exiger celle de
plusieurs autres questions accessoires. A cet effet l'on aura d'abord à
se rendre compte de la nature des besoins à contenter et de l'espèce de
chevaux qu'ils réclament ; à examiner si toutes les localités sont
également propres à l'élève de ces chevaux ; à s'enquérir quelle
influence exercent sur ceux-ci le sol, le climat, la qualité des
aliments, le genre des travaux. Avant même d'aborder ces diverses
questions, il est une chose dont il faudra préalablement s'occuper,
c'est l'examen des besoins généraux du pays, car il ne faut pas qu'un
service en fasse négliger d'autres.
Les besoins généraux du pays
peuvent se diviser en deux grandes catégories : ceux du luxe et de
l'armée qui sont identiques ; ceux du roulage plus ou moins accéléré.
A ces besoins répondent deux grandes variétés de l'espèce, le cheval de luxe, le cheval de trait.
Avant
d'aller plus loin, commencons par nous expliquer sur cette expression
cheval de luxe, dont nous faisons usage en l'absence d'un autre qui
explique mieux notre pensée. Beaucoup de gens, faute de la comprendre,
s'en effarouchent, et ne manquent pas, chaque fois qu'elle frappe leurs
oreilles, de se signer, et comme cela est arrivé même au sein du
Congrès central, de débiter les homélies les plus touchantes sur les
vanités mondaines et l'aveuglement de ces insensés qui préfèrent
l'agréable à l'utile, les plaisirs du riche au service du pauvre. Ce
sont à coup sûr des idées très-chrétiennes, et qui font le plus grand
honneur à la vertu de ceux qui Ies professent. Malheureusement, si
elles prouvent de leur part des sentiments honnêtes, elles prouvent
encore autre chose, c'est qu'ils ne se doutent guère de quoi il s'agit.
Ce
que l'on nomme cheval de luxe , parce qu'il est généralement destiné
au service personnel de celui qui l'emploie, c'est le cheval qui, dans
certaines conditions de taille et de volume, possède au plus haut
degré possible, la conformation et les qualités de ce que nous
regardons comme le type de la perfection. Ampleur, élégance, taille,
légèreté, force, vitesse, il doit tout réunir. Encourager l'élève du
cheval de luxe, c'est donc en d'autres termes, encourager le producteur
à rendre l'espèce la meilleure possible, et c'est un résultat qui ne
doit pas être moins avantageux pour le pauvre que pour le riche.
Le
cheval de luxe devant posséder des qualités originelles du cheval tout
ce qui est compatible avec une taille et un volume en rapport avec nos
besoin, il est d'autant plus parfait, qu'il se rapproche davantage du
type primitif, dont il n'est pour ainsi dire que l’exagération. Mais là
se trouve une immense difficulté. Cette taille et ce volume que
réclament nos besoins, sont toujours en raison inverse des qualités
désirées, et ne s'obtiennent qu'à leur détriment. De là lutte
perpétuelle, d'où ressort la nécessité de combinaisons incessantes de
la part de l'homme, pour maintenir l'équilibre entre deux principes
ennemis.
Chez le cheval de trait, air contraire, rien de
semblable. Le service auquel il est destiné, réclame une conformation,
et par suite des qualités entièrement différentes. Attache de tête ,
forme d'encolure, position d'épaule, configuration de, croupe,
caractère, allures, sont tout autres que leurs analogues, chez le
cheval de luxe, et l'on pourrait presque dire que pour lui la
perfection se trouve dans l'éloignement du type primitif.
Dans
cet état de choses, s'il est reconnu que le cheval de trait est
parfaitement adapté à son service, qu'il le remplit à la satisfaction
générale, et qu'il trouve d'ailleurs un débit assuré, n'est-il pas
raisonnable d'en conclure que nous n'avons à égard rien autre chose à
faire que de le maintenir dans cette position. Procéder autrement et
vouloir par des croisements irréfléchis, substituer à ses qualités
spéciales, tout ou partie de celles du cheval de luxe serait d’autant
plus imprudent que l'on pourrait le dépouiller des unes, et ne pas lui
procurer les autres.
Comme d'un autre côté il est avéré, que la
production du cheval de luxe est de beaucoup au-dessous des besoins,
qu'elle occasionne des soins et des dépenses considérables qu'elle
présente une foule de chances défavorables à l'éleveur que cependant
la puissance et le salut même de l'Élat sont intéressés à sa
prospérité, il en résulte pour le pays la nécessité de concentrer sur
elle tous ses encouragements et ses efforts.
Partant de ce qui précède , il nous devient facile d'apprécier les divers moyens proposés pour atteindre ce but.
Trois opinions principales se sont produites :
Il
existe en France, ont dit les uns, une immense quantité de chevaux trop
massifs et trop lourds : rendons-les plus légers ; il suffit pour
cela d'exiger l'emploi de véhicules plus légers, et d'améliorer les
voies de communication.
Nous possédons, disent les autres, une
masse énorme de chevaux trop petits et trop minces, il faut, au moyen
de producteurs plus grands et plus étoffés, transformer ces races qui,
en ce moment, ne sont pour ainsi dire propres à rien, et elles nous
donneront plus qu'à suffire à nos besoins.
Les races, disent les
derniers, ne sont pas seulement le produit de la souche dont elles
sortent, elles sont encore l'expression des influences du sol, du
climat, de la nourriture, du travail. Il faut, pour exercer sur elles
des modifications quelque peu importantes, un temps et des soins
excessifs, et encore ne réussit-on jamais que d'une manière incomplète.
Par ces motifs, prendre pour point de départ des races si éloignées de
ce que l'on tend à se procurer, n'est-ce pas se créer, comme à plaisir,
des difficultés, pour ne pas dire des impossibilités ? Sans doute,
s'il n'en existait pas d'autre, il faudrait bien en courir la chance :
mais si dans certaines localités il s'en trouve qui répondent
parfaitement aux besoins en souffrance, n'est-il pas cent fois plus
rationnel de concentrer les efforts sur ces localités où le passé
répond de l'avenir, et d'y développer la production jusqu'à degré
nécessaire,
Examinons ces diverses opinions.
Qu'il soit
possible de rendre plus légers un grand nombre de chevaux, c'est ce
dont nous ne faisons aucun doute ; il ne faut pour cela que laisser
agir la nature, qui tend constamment à les ramener au niveau commun :
et il ne serait peut-être ni bien long, ni bien difficile de faire
descendre le Percheron le Boulonnais, l'Ardennais, sur la même ligne
que le Breton. Serait-ce une amélioration ? C'est ce qui nous paraît
plus que douteux. Ainsi diminuées, ces races cesseraient de convenir à
certains services, sans en devenir plus propres aux autres. En effet,
l'exiguité de la taille ne changerait rien à la conformation, et cette
conformation parfaitement adaptée à la traction de force, ne convient
en aucune manière aux services qui réclament l'élégance, la légèreté,
l'action, la vitesse, et particulièrement au transport d'un cavalier.
Les prôneurs de la mesure diront que, non contents de les alléger, ils
agissent sur leur extérieur au moyen d'étalons d'autres races d'une
conformation plus en harmonie avec ces services. Jusqu'à un certain
point sans doute, la chose n'est pas impossible. Mais quel sera le
résultat de cette métamorphose ? Produit des pays de plaine où ils
exécutent admirablement les travaux agricoles ces chevaux y deviendront
moins propres à ce service. En leur rendant la tête plus légère,
l'encolure plus longue, l'épaule moins charnue, le garot plus élevé,
le, poitrail moins ouvert, la hanche moins saillante, on leur fera
perdre évidemment une partie de leurs moyens de traction, et le
roulage en souffrira ; est-ce à dire pour cela qu'ils deviendront
convenables pour le luxe ? Nous ne le pensons pas : pendant des
années, pendant des siècles, les influences d'hérédité, de sol, de
climat, de localité se feront sentir ; et tant d'efforts n'auront
abouti, comme nous le disions à l'instant, qu'à dénaturer une race sans
en créer une autre, et des services importants auront été déshérités,
sans que d'autres en profitent. En conséquence, dans l'état actuel des
choses, partout ou il existe en France des races de trait
caractérisées, chercher à les améliorer autrement que par elles-mêmes
nous semble une imprudence ; vouloir les transformer, un non-sens. Ces
chevaux que l'on appelle lourds, sont précisément ceux dont le besoin
est le plus généralement senti, ce sont ceux que nous envient les
étrangers ; les enlever au pays serait lui rendre un bien mauvais
service. La chose au demeurant ne serait pas aisée, si l'on en juge par
cette foule de localités où des étalons de trait des plus communs sont
préférés à des chevaux beaucoup plus distingués ; et, par celle
quantité de départements qui s’imposent des sacrifices pour se procurer
des étalons de même genre.
Quant aux races trop petites et trop
peu étoffées du centre et du midi de la France, certes si l'on pouvait
leur donner à la fois et plus de taille et plus d'étoffe, on n'aurait à
craindre de nuire à aucun service, car dans leur état présent, je ne
sais trop à quoi elles sont propres. Mais est-ce chose possible que de
transformer en cheval de luxe le Lorrain, le Bourguignon, le
Berrichon, le Provençal ? Enl la supposant possible, serait-il
avantageux de la tenter ? On nous répond que l’avantage est évident ;
que dans ces provinces le cheval n'a qu'une valeur minime, que si
l'éleveur en trouvait le double ou le triple de ce qu'il le vend en ce
moment, il y aurait bénéfice pour lui, et bénéfice au moins égal pour
l'acheteur, auquel il coûterait encore beaucoup moins cher que dans les
localités, qui pour l’instant, sont en possession de le fournir. Ce
raisonnement est spécieux, et si le cheval se faisait à la hache ou au
ciseau, il serait fort juste. malheureusement il n'en est pas ainsi,
et personne n'ignore que, pour obtenir des résultats durables, il ne
suffit pas d'accoupler des animaux de la taille et du volume qu'on
désire propager, il faut encore que leurs produits se trouvent dans des
conditions de sol, de climat et d’alimentation analogues à celles sous
lesquelles la race s'est développée. Or, ces conditions n'existent pas
dans les contrées dont il s'agit. A cela on nous dit que l'on sèmera
des trèfles, des sainfoins, des avoines, qu'on leur donnera une
nourriture abondante, une éducation convenable, etc. Que conclure de là
? Que du moment où ils cesseront d'être élevés dans des bruyères ou des
pâturages communaux, ils consommeront une nourriture égale en quantité
et en qualité à celle de leurs rivaux, ils reviendront à un prix aussi
élevé, avec cette différence toutefois, qu'ils seront moins bons, en
raison des influences ennemies dont rien ne saurait les affranchir.
F. PERSON.(La suite au prochain numéro).
*
* *
Tome III. - 3e année. - 4e livraison. - octobre 1845.  | | DAIO, Fils de Fortuné, Mr Marion père. "Le
cheval D[a]io dont le portrait est joint à la présente livraison, est
un étalon né en 1827, à Cerisé près Alençon, chez M. Leroux. Il est
issu d'une fille de Dio (cheval pur sang, des haras) et de Fortuné (3/4
de sang). Cet étalon, approuvé par l'administration des haras,
appartient M. Marion père. Depuis trois ans il fait la monte à
l'académie (Ecole d'équitation) de Caen." |
AMÉLIORATION DES RACES.
NÉCESSITÉ DE FONDER DES HARAS DE TAUREAUX, BÉLIERS, ETC.
Il n'est douteux pour personne qu'il y a beaucoup à faire, même dans
les contrées les plus favorisées de la nature et dans lesquelles on a
déjà fait quelque chose, pour l'amélioration des diverses races
d'animaux domestiques. Dans beaucoup d'autres contrées, tout reste à
faire.
C'est chose vraiment déplorable, surtout dans les pays où la nature
fait tant d'efforts pour seconder l'intelligence de l'homme laborieux,
que la reproduction des bestiaux qui font la richesse de ces pays, soit
en quelque sorte abandonnée au hasard. Devrait-on, par exemple, en être
à dire que dans le Cotentin et le Bessin, qui doivent leur prospérité à
l'élevage des vaches à lait, on ne trouverait peut-être pas trois races
de taureaux dont on puisse suivre la trace depuis 18 ou 20 années ? Ces
contrées possèdent d'excellentes vaches laitières dont elles ont le
plus grand intérêt à conserver et à améliorer, s'il se peut, la race,
et souvent faute de taureaux d'origine bien connue, d'étalons bien
tracés, on est obligé, au moment de faire jaillir les vaches, de
prendre le premier taureau venu.
Il est impossible, sous peine de décadence ou au moins de perte de
l'ancien renom du pays, que cet état de chose continue. Quand nous
voyons d'autres localités, dont le sol ingrat laisse si peu de
ressources à ceux qui l'exploitent, travailler avec persévérance à
améliorer leurs races de bêtes à cornes, par des croisemens et des
accouplemens habilement. calculés, prendre d'année en année une
meilleure position sur les grands marchés et dans les concours, il faut
bien que les contrées pour lesquelles la nature a tout fait, et l'homme
à peu près rien, viennent aussi en aide à la nature.
Car, avec les chemins de fer, la distance va bientôt cesser d'être un
obstacle pour l’industrie bovine de certains départemens qui, trop
éloignés du grand centre de consommation pour pouvoir lutter avec la
Normandie, ne faisaient rien pour améliorer.
Et d'autre part, le moment approche où les animaux de boucherie
paieront au poids et non plus par tête le droit d'octroi. De tous les
points et de haut on réclame cette modification, et ce nouveau mode de
perception sera tout à l'avantage des contrées qui peuvent faire
concurrence à la nôtre, puisque les animaux les plus forts paient
actuellement un droit proportionnellement moins élevé , souvent de
moitié, que ceux de petite taille.
Aujourd'hui donc que la concurrence se prépare de tous côtés, la
Normandie doit comprendre qu'il est indispensable et qu'il est urgent
d’améliorer. Le tems n'est plus où l'herbager pouvait ne prendre
d'autre soin que d'aller faire une promenade du côté de ses bestiaux,
pour s'assurer si les herbes faisaient bien, et s'il n'y avait pas
quelques animaux malades. Il faut tirer les mains de ses poches, et si
les propriétaires et fermiers veulent continuer à vivre dans l'aisance,
ils doivent faire autrement que l'on a fait jusqu'à présent.
Nous n'entendons point conseiller à nos cultivateurs du Bessin, du
Cotentin et de la Vallée d'Auge, de se lancer dans des essais
aventureux. Nous leur conseillons tout simplement, tout bonnement
d'apporter plus de soin, plus d'attention aux accouplemens, dans le
but de perfectionner par elles-mêmes leurs races de bêtes à cornes.
La Normandie, dans les contrées que nous venons de nommer possède des
races qui, sous les principaux rapports, peuvent rivaliser avec ce que
la Suisse, la Flandre et l'Angleterre peuvent présenter de plus beau.
Dans ces races, il y a des sujets plus distingués les uns que les
autres ; eh bien ! par des accouplemens judicieux et surtout avec de la
persévérance, on peut dans ces pays privilégiés améliorer notablement,
au lieu de laisser au hasard le travail de la reproduction. On nous
croira aisément — car tous les cultivateurs ont pu observer des faits
de ce genre — quand nous dirons que nous connaissons de très-belles
vaches, qui se sont admirablement reproduites avec certains taureaux et
détestablement avec d’autres : d'où cette conclusion, qu'il faut de
toute nécessité travailler à avoir des races bien tracées de taureaux
d'un mérite reconnu.
Là est toute la question d'avenir de l'industrie bovine en Normandie !
Les bonnes vaches, nous le savons, n'y sont pas rares mais il y en a
beaucoup aussi de mauvaises, et dans des contrées comme celles que nous
citons, il ne devrait pas y avoir une mauvaise vache, attendu qu'avec
de bons taureaux une vache même médiocre donnera des produits meilleurs
qu'elle ; attendu, d'un autre côté, qu'il n'en coûte pas plus de
nourrir une bonne vache laitière qu'une mauvaise, et que l'homme qui
conserve une mauvaise vache à lait dont il pourrait faire une bon
animal de boucherie, travaille contre ses intérêts.
Par un choix intelligent de reproducteurs, dans un nombre d'années
assez limité , on doit obtenir un mieux sensible, et dès que le premier
pas sera fait dans cette voie, l'amélioration marchera rapidement et
deviendra générale.
Mais quelqu'intérêt qu'ai les propriétaires du pays à créer une bonne
race de taureaux, comme il faut pour arriver à ce résultat et du tems
et des soins et des dépenses ; en outre, comme pour se récupérer, les
propriétaires des plus beaux étalons les épuiseraient souvent par des
saillies précoces et multipliées (1) ce n'est point de ce côté qu'il
faut fonder de grandes espérances : c'est au gouvernement à créer des
haras de taureaux dans les contrées où il est certain d'obtenir
promptement des améliorations.
Pourquoi en effet le gouvernement ne ferait-il pas pour la race bovine
ou plutôt pour toutes les races d'animaux domestiques ce qu'il fait
pour les chevaux ? L’amélioration de toutes les espèces de bestiaux
qui servent à l’alimentation des masses est de sa compétence, de son
devoir et de son intérêt, puisqu'il est le tuteur né de la nation, et
qu'à ce titre il doit employer et ses efforts et une part du budget
pour obtenir tout ce qui peut contribuer au bien-être général.
Sans doute la question des chevaux est essentielle, mais elle ne doit
pas absorber toute sa sollicitude. Il ne suffit pas de songer aux
éventualités de la guerre, il faut aussi songer à satisfaire à des
besoins qui sont de tous les jours, en tems de guerre comme en tems de
paix. Nous trouvons très-bien que le gouvernement encourage et seconde
la production chevaline ; nous lui demandons même beaucoup plus qu'il
n'a fait jusqu'à présent, et surtout depuis que l'administration des
haras est entrée dans un système plus en harmonie avec les besoins du
pays ; les contrées de production, les conseils généraux demandent
également que les haras étendent leur sphère d'action. Mais il ne faut
pas se préoccuper des chevaux à l'exclusion des autres animaux
domestiques, qui sont aussi indispensables que les premiers.
MM. les inspecteurs de l'agriculture ont pu s'assurer comme nous
qu'aujourd'hui encore les bons étalons des diverses espèces des
bestiaux manquent ; que nulle part, ou presque nulle part, on ne donne
une attention assez grande à multiplier et à conserver les mâles qui
peuvent améliorer les races ; que le hasard fait plus que le calcul
pour aider à l'œuvre de la nature. MM. les inspecteurs penseront donc
comme nous aussi que le gouvernement doit intervenir d'une manière
active dans la production bovine, ovine et porcine.
Déjà quelques tentatives ont été faites en ce sens, mais à un point de
vue différent de celui dans lequel nous raisonnons : des étalons de
races étrangères améliorées, des femelles aussi ont été importées. Là
on veut perfectionner par les croisemens ; ici nous demandons le
perfectionnement par les bons accouplemens.
Et que l'on veuille bien considérer que notre réclamation n'a rien
d'exclusif. Loin de blâmer, nous félicitons l'administration d'avoir
introduit en France de beaux types d'animaux qui, par des croisemens
judicieux — en appropriant convenablement ces croisemens à la race et
aux ressources de la contrée — doivent produire d'utiles résultats.
Mais les croisemens ne sont pas toujours et partout un moyen
d’amélioration, tandis que les accouplemens peuvent être pour notre
pays ce moyen désiré.
Ainsi la généralité, pour ne pas dire l'universalité des éleveurs du
Bessin et du Cotentin, où la grande question est la production du
beurre, repoussent énergiquement le croisement de leur race avec celle
de Durham. « A l'une, disent-ils, la propriété laitière, à l’autre la
faculté d'engraissement. La nature a des règles invariables : la bonne
vache à lait est toujours maigre, parce que chez elle tous les alimens
tournent à la production du lait ; tandis que dans l’autre race ils
produisent la graisse. A chaque race sa spécialité, à chaque pays sa
race particulière. Que les contrées où nous allons acheter nos bêtes d
engrais fassent des croisemens, s'ils les jugent profitables, d'accord
! Mais que l'on ne touche pas à notre race cotentine qui nous donne du
lait, du tavail et de la viande. »
Tel est le cri de nos cultivateurs : nous rappelons leurs répugnances, sans vouloir rentrer dans la discussion.
Mais en même teins que le pays se montre défiant quand il s'agit de
croisemens, il devient traitable s'il n'est question que de bons
accouplemens, d'amélioration par la race elle-même.
Or, le gouvernement peut puissamment aider à ces améliorations par un
système que préconisent la plupart des Sociétés d'Agriculture et tous
les hommes éclairés. Qu'il établisse dans la Basse-Normandie un ou deux
haras, dans lesquels il réunira les animaux les plus parfaits choisis
dans la race locale, s'il s'agit de l'espèce bovine ; les béliers et
les verrats indigènes ou étrangers qu'il croira les plus propres à
perfectionner les races ; que ces haras distribuent des étalons dans
des stations au centre des contrées où ils peuvent rendre le plus de
services, et, n'en doutons pas, bientôt, la nature aidant à l'art, nos
départemens conserveront à l'égard des autres races, queIqu'améIiorées
qu'elles soient par les croisemens avec des types étrangers, la
position relative qu'elle a toujours occupée.
Ce système d'amélioration d'une race par elle-même n'est pas nouveau,
et le conseil que nous donnons ici ne l'est pas davantage. On sait
effectivement que depuis quelques années les conseils généraux de nos
départemens allouent, pour encourager ce système, des sommes assez
considérables, et les jurys chargés de décerner les primes
d'encouragement commencent à se féliciter des bons effets qu'elles
produisent. Que les représentans des intérêts départementaux
persévèrent dans ce système, en même tems qu'avec ses haras spéciaux le
gouvernement concourra vers, le même but.
M. le ministre de l’agriculture et du commerce est plein de bonnes
intentions, et celles des chambres ne sont pas douteuses, en faveur de
tout ce qui peut faire progresser l'agriculture. Il a été proclamé
cette année, lors de la discussion du budget, que la part de
l'agriculture deviendrait beaucoup plus large aussitôt que le bon
emploi des fonds de subvention serait démontré.
Or , nous ne pensons pas que l'on puisse sérieusement contester
l'utilité du moyen d'amélioration que nous proposons. Que M. le
Ministre de l'agriculture prépare un projet sur l'établissement de
haras de taureaux, béliers et verrats ; qu'il consulte les conseils
généraux, les sociétés et comices agricoles, les sociétés vétérinaires,
sur le mérite de celle institution, et fort d'un assentiment qui
d'avance ne nous paraît pas douteux, il sera certain d'obtenir des
chambres la somme nécessaire pour doter le pays de modestes et utiles
établissements qui féconderont une des branches de la richesse
nationale.
Nous sommes certains d'être l'organe des hommes de progrès de nos départemens en portant ce vœu au gouvernement.
A. S.
(1) Il n'est pas rare de voir des taureaux épuisés dès
l'âge de deux ans, tant on les fait servir bien avant qu'ils aient
acquis tout leur développement. Un très jeune taureau petit bien
féconder une vache, mais améliorer la race, c'est autre chose !
CÉRÉALES.- PRODUCTION.
DU SOIN À APPORTER DANS LE CHOIX DES ESPÈCES.
En voyant augmenter d'année en année la population de la France, bien
des personnes se demandent comment, dans un tlems plus ou moins éloigné
la terre pourra subvenir aux besoins croissans de la consommation. Pour
peu qu'on veuille y réfléchir on se préoccupera peu de l'avenir sous ce
rapport, car non seulement il reste encore à mettre eni valeur deux
millions au moins d’hectares, et trente millions, mal cultivés,
n'attendent que des améliorations pour doubler leurs produits, il y a
aussi dans le choix des espèces de graines le mieux appropriées à la
nature du sol et au climat, d'immenses résultats à obtenir.
Nous avons déjà abordé cette question, en rendant compte dans un de nos
derniers numéros, d'une publication récente, sur la production des
céréales. (Voir 2e livraison, 3e année, page 71.)
Que l'on se reporte 25 ans en arrière de notre époque ; que l'on
considère les développemens que la plupart des cultures ont pris dans
cette courte période, et l’on comprendra, quoiqu'en disent ceux qui
prétendent que l'on ne peut pas faire mieux que ce qui est, tout ce que
l'agriculture a encore à faire pour atteindre son maximun de
production. C'est en agriculture surtout que le progrès est infini,
tant la science est loin d'avoir surpris tous les secrets de la
nature, et dit son dernier mot.
Ne nous inquiétons donc pas de l'accroissement de population :
cultivons mieux, et le sol nourrira largement, quelque nombreux qu'ils
soient, ceux qui sauront le faire valoir.
Dans la voie d'amélioration que nous indiquons, le point le départ est
dans le soin, dans l'intelligence à apporter au choix des semences.
On ne saurait méconnaître qu'il en est des plantes comme des arbres que
nous cultivons : telle espèce, telle variété même réussira très-bien
dans une contrée, et ne donnera que de médiocres produits dans une
autre localité. Il convient donc avant tout de consulter le sol, le
climat, en faisant des essais qui permettent de comparer, et par suite
d'approprier les semences à la terre que l'on travaille. Il n'est pas
un cultivateur qui ne sache fort bien, par exemple, que les blés blancs
ne réussissent pas dans une contrée où viennent magnifiques les blés
rouges ; que les blés barbus donnent de bons produits dans un sol où
les blés sans barbes se reproduisent mal , etc.
Nous ne saurions trop vivement appeler l'attention des cultivateurs et
la sollicitude des sociétés d'agriculture sur cet important objet. Que
ces sociétés se procurent les variétés de blé réputées les meilleures,
qu'elles les répandent autour d'elles, et que les cultivateurs les
secondent dans leurs efforts, avec la certitude que de ces essais,
faits avec soin, il sortira quelque chose d'utile au pays.
Pour que l'on comprenne l'importance de ce genre d’améliorations,
rappelons que la France importe en moyenne pour une valeur de plus de
17 millions de céréales par an. Cherchons les blés qui conviennent le
mieux à notre sol, et au lieu de rester tributaires de l'étranger
pour une denrée de première nécessité nous arriverons bientôt à
avoir à lui vendre un excédant de nos produits.
A l'appui de ces observations voici un fait positif sur lequel nous prions nos cultivateurs de porter leurs méditations.
Un cultivateur de la plaine de Caen, qui depuis quelque années s'est
livré à des essais sur de nouvelles variétés de céréales, a semé,
l'année dernière, dans, le même sol, dans des conditions parfaitement
identiques de compost, de ramure et avec la même quantité de semence,
quatre espèces de blé, savoir :
Goutte-d'Or ; Saumon ; Victoria et Rouge-d'Ecosse.
Sur un espace égal, mesuré exactement , les quatre variétés on donné :
la première, 106 gerbes ; la 2e, 140 ; la 3e, 150 ; la 4e, 163. Ainsi,
entre deux de ces espèces, voilà une différence de plus de moitié dans
le rendement.
Le rendement en grains a été dans la mène proportion que le rendement
en gerbes. Il résulte de là, que le blé Rouge-d’Ecosse est évidemment
celui qui doit être cultivé sur le sol où l'essai comparatif a été fait.
Nous savons aussi que l'un des cultivateurs les plus éclairés du
pays-de-Caux, a tous les ans à vendre un quart de blé de plus à la
halle de Fécamp, depuis que dans sa culture il a substitué, le blé
Rouge-d'Ecosse aux blés qu'il cultivait précédemment, c'est-à-dire que
le sol qui lui donnait 200 sacs de blé, il y a 10 ans, lui en donne
aujourd'hui au moins 250, et cela dans des conditions tout il fait
semblables.
Chacun tirera avec nous la conclusion de ces faits dont nous garantissons l'exactitude.
Que l'on ne suppose pas toutefois que ce que nous disons en l'honneur
du blé Rouge-d'Ecosse soit une recommandation spéciale en faveur de
cette variété. Nous n'avons voulu que fixer l'attention sur la bonne
appropriation des semences au sol que l'on cultive, aux engrais dont on
peut disposer. Il se peut que dans beaucoup de contrées ce soit un blé
autre que le Rouge-d'Ecosse
qui doive être préféré, mais dans les deux faits que nous venons de
relater , c'est cette variété qui a donné le produit, à beaucoup près,
le plus considérable.
L. B.
HYGIÈNE ET MÉDECINE VÉTÉRINAIRES.
(Voir 3e livraison — août 1845 — p. 62.)
CHEVAUX PANARDS, CAGNEUX, CLOS ET CROCHUS OU SERRÉS DU DERRIÈRE.
Nous avons dit précédemment que pour éviter de fausser les aplombs et
prévenir par conséquent l'usure des membres, il faut de temps à autre,
tailler et raccourcir les pieds des poulains de manière à ce que leur
appui se fasse toujours également sur le sol. Ces précautions doivent
être également prises lorsque le cheval porte un fer sous le pied ;
l’inégalité du sabot occasionne la déviation du membre en dehors ou en
dedans, et rend le cheval panard, cagneux, clos et crochu ou trop ouvert du derrière.
Ces difformités qui, parfois, peuvent déterminer des claudications, et
qui rendent presque toujours les allures défectueuses, sont souvent
occasionnées par l'incurie de certains maréchaux qui, trouvant moins de
difficulté à couper la corne du quartier interne des pieds gauches, et
celle du quartier externe des pieds droits, font ainsi porter le pied
inégalement.
Le cheval est panard lorsque
la pince ou partie antérieure du pied est un peu tournée en dehors soit
au repos, soit pendant la marche ; l'appui se fait alors sur le
quartier interne du sabot, et lorsque le cheval marche au pas ou au
trot il relève les pieds en dedans. Il est cagneux
lorsqu'il présente une disposition contraire, c'est-à-dire que la
pince est tournée en dedans ; l'appui a lieu sur le quartier externe,
les coudes sont un peu écartés du corps et les mouvements des pieds se
font en dehors.
L'une et l'autre de ces défectuosités exposent les chevaux à se couper.
C'est surtout chez les jeunes poulains qu'il faut chercher à corriger
ces vices qui, tôt ou tard, causent l'usure des membres ; à cet effet
il suffit souvent, pour les pieds panards, d'abattre les quartiers du
dehors et de conserver intacts ceux du dedans, et de faire le contraire
pour ceux qui sont cagneux. Si le cheval est arrivé à l'âge où il doit
être ferré, on appliquera des fers qui garniront légèrement en dedans,
et seront justes en dehors pour les pieds panards, et qui seront justes
en dedans et garniront en dehors pour les pieds cagneux. Quand les
quartiers qui doivent conserver le plus de hauteur sont naturellement
bas il faut donner plus d'épaisseur aux branches du fer qui porteront
dessus. (1)
Lorsque ces ferrures sont faites par des maréchaux intelligents les
membres reprennent bientôt une meilleure direction, et souvent on est
surpris de voir les aplombs rétablis, immédiatement après le premier
ferrage. Il n'est pas sans exemple non plus que des chevaux panards ou
cagneux, affectés de claudication aient cessé tout-à-coup de boiter
après avoir été méthodiquement ferrés.
Pour corriger les aplombs des chevaux clos du derrière ou de ceux qui sont trop ouverts,
on doit avoir recours aux moyens que nous avons indiqués pour les
membres antérieurs ; mais il faut convenir que les résultats seront
moins satisfaisants, surtout chez les poulains clos et crochus, car le
plus souvent ces difformités tiennent à un vice de conformation de
l'arrière-main auquel il est difficile de remédier.
Le cheval qui se coupe est
celui qui en marchant se blesse à la face interne des boulets,
quelquefois sur le canon ou aui genou avec le fer du pied opposé. Cet
accident, que l'on observe plus fréquemment chez les jeunes chevaux que
chez ceux d'un âge avancé, est ordinairement le résultat de la
faiblesse du jeune âge. Quelquefois aussi, il petit être occasionné par
une mauvaise ferrure ou bien encore, comme nous l'avons dit, par une
mauvaise conformation et des aplombs défectueux.
Les blessures qui résultent de ce défaut peuvent occasionner une
claudication qu'un repos de quelques jours fait ordinairement
disparaître ; mais lorsque les contusions sont répétées sur les parties
blessées, il survient peu à peu un engorgement qu'il n'est pas toujours
facile de faire disparaître et qui tare plus ou moins l'animal.
Lorsque ces accidents proviennent de la fausse direction des aplombs,
on y remédie par les moyens que nous avons fait connaître en parlant
des chevaux panards ou cagneux. S'ils sont le résultat d'une mauvaise
ferrure, on fera ferrer le cheval par un maréchal plus habile ; enfin,
s'il faut les attribuer à la faiblesse de l'animal, on devra faire
usage d'un fer dont la branche interne soit plus épaisse que l'externe,
et moins large, et dont le bord soit arrondi. On désigne ce fer sous le
nom de fer à la turque. Après
l'application de cette ferrure, il est convenable, lorsqu'on veut faire
travailler le cheval, de faire usage pendant quelque tems des guêtres
en cuir, surtout si les plaies des boulets ne sont pas complètement
cicatrisées.
Nous observerons que les chevaux bien nourris, doués par conséquent de
plus d'énergie, sont moins exposés à ces accidens, que ceux qui ne
reçoivent qu'une nourriture débilitante.
Boiteries des articulations, désignées sous les noms d'efforts et entorses, et vulgairement sous ceux d’écarts, allonges allonges de boulets, etc.
La difficulté de reconnaître le siège de ces diverses boiteries, à
moins d'avoir fait une étude spéciale de l'anatomie des articulations,
ne nous permet pas de donner ici des explications qui, mal comprises,
pourraient contribuer à aggraver des maux aux-quels il faut porter un
prompt remède, pour éviter de les voir durer longtemps et trop souvent
aussi devenir incurables. Nous dirons cependant que toutes les fois
qu'une boiterie de ce genre apparaîtra, il faut, quelle qu'en soit la
cause, mettre l'animal au repos, le placer sur une bonne litière et
faire appeler sans retard le vétérinaire qui peut seul, par ses
conseils, opérer une prompte guérison. L'insouciance que l'on met, trop
généralement, à soigner l'animal, dans l'espoir qu'avec le tems la
claudication disparaîtra, est presque toujours la cause de la longue
durée de ces maladies, et fréquemment aussi de leur incurabilité.
Nous n'admettons pas que le travail du labour ou l'exercice en liberté
dans un herbage, puissent guérir les efforts ou distensions
articulaires, surtout à leur début et pendant la période
inflammatoire, lorsque dans l'espèce humaine, et pour de pareils
accidens, on prescrit un repos absolu.
Lorsqu'au moyen de quelques signes extérieurs, l'engorgement et la
douleur, par exemple, on croit reconnaître le siège du mal, on peut, en
attendant l'arrivée du vétérinaire, faire usage des lotions d'eau
très-froide sur les parties malades. Ce moyen simple est souvent suivi
d'un heureux succès, mais il faut le répéter très-fréquemment. On
augmentera la propriété astringente et réfrigérante du liquide, en y
ajoutant de l'extrait de saturne (acétate de plomb) ou du vinaigre. Si
l'effort ou entorse existe au boulet, on pourra faire usage des bains
locaux, en plongeant le pied jusqu'au milieu du canon dans un sceau
d'eau froide, et en appliquant ensuite sur la partie lésée un
cataplasme, de suie délayée avec du vinaigre, et maintenu avec un linge
qui enveloppe le tout. On renouvelle et alterne les bains et les
cataplasmes deux ou trois fois en 24 heures.
Quant aux remèdes secrets employés par certains individus, auxquels on
accorde le pouvoir de guérir ces accidens par des attouchemens et des
paroles mystiques, il suffit d'en signaler tout le ridicule pour en
faire justice.
Boiteries dont le siège est au pâturon, à la couronne et au pied
Les maladies qui surviennent au pâturon et à la couronne, et qui amènent des boiteries, sont les crevasses et les formes.
Les crevasses sont
occasionnées le plus souvent par la malpropreté et les enchevêtrures
ou prises de longes ; elles peuvent aussi être inhérentes à la
constitution, et par cela même, plus difficiles à guérir. Dans le
premier cas quelques bains tièdes, des lotions émollientes, des
cataplasmes de farine de lin, suffisent ordinairement pour les faire
disparaître, surtout si l'on a l'attention d'envelopper le pâturon avec
un linge pour empêcher la boue, le fumier ou les urines de porter
dessus. Lorsqu'elles résistent à ce traitement, qu'elles répandent une
mauvaise odeur et paraissent tenir à ce qu'on appelle un état
humorique, il faire usage d'un traitement plus sérieux : L'application
d'un séton sous le ventre, est un moyen curatif, presque toujours
couronné de succès ; mais comme il faut souvent y joindre une
médication intérieure surtout si les crevasses ont une tendance à
s'aggraver et menacent de dégénérer en eaux aux jambes, il est indispensable alors d'appeler l'homme de l'art pour en triompher.
Les formes, dont nous avons
déjà dit un mot, en parlant des tumeurs osseuses, et qui surviennent
ordinairement sans causes connues, sont toujours des maladies fort
graves, à cause de leur incurabilité. Nous ne connaissons d'autre moyen
de les guérir, où plutôt d'en arrêter les progrès, que l'application
feu, mais il faut l'avouer, ce moyen ne peut offrir de succès qu'autant
qu'il est employé dès la plus légère apparition des tumeurs, et surtout
chez les jeunes chevaux.
Indépendamment des claudications qui peuvent résulter de la
conformation défectueuse des sabots, et auxquelles on remédie ou à peu
près, par le moyen d'une ferrure méthodique (2), il en est d'autres qui
sont occasionnées par des chocs extérieurs, des pressions, des
meurtrissures : telles sont les atteintes, les bleimes, les javarts ; d'autres, par le desséchement et la sécheresse de la corne, telles que les seimes
; d'autres enfin par des piques, enclouures, et des corps étrangers qui
s'implantent dans la sole pendant la marche, et qu'on désigne sous le
nom de clous de rue, chicots, etc…
Les atteintes sont produites
ordinairement par le choc du fer des pieds du cheval qui frappe sur les
talons et occasionne des blessures qui font, boiter plus ou moins
suivant leur gravité. Cet accident est facile à guérir, lorsqu'on y
porte remède sur le champ ; et pour cela il suffit de nettoyer la
plaie, de placer dessus un tampon d'étoupes imbibé d'eau-de-vie et
d'eau, et fixé avec du ruban formant plusieurs tours, pour mettre la
plaie à l'abri des corps étrangers et de la malpropreté. Si, pourtant,
la boiterie augmentait et que la suppuration vint à s'établir, il
faudrait consulter le vétérinaire, car un javart pourrait se déclarer
et tenir le cheval longtemps sur la litière.
Les bleimes. Lorsque le siège
d'une claudication est difficile à trouver, bien que le sabot ne
présente aucune chaleur, il est toujours prudent de faire déferrer le
pied de l'extrémité boiteuse, de parer la sole et de chercher, en
pinçant avec les tricoises, s'il existe quelque point douloureux. Assez
fréquemment on rencontre une surface rougeâtre ou brunâtre qui n'est
attire chose que du sang extravasé, résultant d'une meurtrissure faite
à la sole. C'est ce qu'on appelle une bleime.
Le maréchal après avoir aminci la sole, sans aller au vif, appliquera
une ferrure convenable et enveloppera le pied d'un cataplasme de
farine de lin. Lorsque la bleime est suppurée, c'est-à-dire que sous la
sole on trouve du pus, une opération devient nécessaire et réclame les
soins du vétérinaire ; car souvent il faut enlever une grande partie de
la sole et des chairs altérées. Dès que la sole a repris une certaine
épaisseur et qu'il n'existe plus de plaie, on peut soumettre l'animal à
un léger travail ; mais il faut encore garantir le dessous du pied, en
plaçant sous le fer une plaque de tôle, et faire usage pendant quelque
temps du fer à planche.
Le javart est toujours une
maladie grave, à laquelle il convient de porter remède le plus tôt
possible. Il existe des javarts tendineux, encornés et cartilagineux.
Les uns et les autres ne peuvent être traités que par un homme de
l'art.
CAILLIEUX,
Secrétaire de la société vétérinaire
du Calvados et de la Manche.
(1) Nous indiquerons ultérieurement le mode de ferrage qu'il convient d'employer pour les pieds défectueux et mal conformés.
(2) Les expressions que nous sommes obligé d'employer ici seront parfaitement comprises par tous les maréchaux.
ARBRES A FRUIT.
DÉGÉNÉRESCENCE. — HYBRIDATION.
Tout vieillit, tout dégénère dans la nature, et s'il faut en croire les
hommes les plus initiés aux secrets de la végétation, une partie des
arbres à fruit qui ont fait le bonheur de tant de générations, ou du
moins plusieurs espèces anciennes seraient en décadence. Les fruits des
uns n'auraient plus la même saveur, les autres seraient devenus plus
chétifs, pierreux, et n'auraient plus que le nom de leurs ancêtres.
Serait-ce que, comme certaines races d'animaux, certaines espèces
d'arbres auraient fait leur tems ? Et la nature aurait-elle condamné
les générations qui nous suivent à ne pas connaître et la crassane et
le beurré, et tant d'autres fruits dont le souvenir seul fait venir
l'eau à la bouche, encore bien que nous ne les ayons pas connus dans
toute leur succulence, au dire d'horticulteurs distingués dont les
assertions font foi dans l'évangile des jardiniers ?
Quoiqu'il en soit, comme il n'y a qu'à gagner à croire ces maîtres sur
parole et à suivre leurs conseils, admettons leur assertion et
demandons leur ce qu'il faut faire pour que la nature ne prive ni nous
ni nos fils d'aucune des jouissances dont qu'elle avait gratifié nos
pères.
C'est, disent-ils d'abord, de semer beaucoup, afin d'obtenir des
variétés nouvelles, des espèces jeunes et riches d'avenir. Quelques
horticulteurs à la fois intelligens et persévérans l'ont fait et ont
déjà obtenu des succès. Malheureusement, pour réussir il faut beaucoup
de soins, beaucoup de tems, et s'en rapporter pour une bonne part du
succès au hasard qui est un des souverains de ce monde. Il faut en
outre se munir de patience, car le meilleur fruit, s'il est inconnu,
sera bien moins recherché, aura bien moins de prix aux yeux de la masse
des consommateurs, que le fruit en vieille réputation, quelque dégénéré
qu'il soit.
Le hasard, nous le disons, est pour beaucoup dans le succès, quand il
s'agit d'expériences où les plus habiles travaillent en aveugles.
Toutefois, la science a fait il y a déjà un siècle, et depuis quelques
années, l'art a étudié avec attention une découverte qui, comme toutes
les idées nouvelles, a été traitée d'abord de pure rêverie, et qui
comme toute vérité a fini par trouver des croyans. Cette découverte
n'est déjà plus une chimère : il y a des résultats et de nombreux et de
positifs. C'est avec son aide que l'avenir peut apparaître moins
incertain, et que tout n'est plus aujourd'hui le pur effet du hasard,
dans la recherche des nouvelles variétés d'arbres, de fleurs et de
fruits.
Nous voulons parler de l' hybridation.
L'hybridation consiste dans le croisement, dans l'union des plantes de
la même famille, dans une fécondation artificielle, opérée par ce
rapprochement intime, Cette opération toute naturelle, qu'elle ait lieu
par l'effet du hasard ou par la main de l'homme, a enrichi la botanique
d'un grand nombre de végétaux, et ce nombre augmente de jour en jour, à
mesure que l'art vient plus fréquemment seconder à la nature.
C'est qu'il y a dans l'hybridation une source intarissable de richesses
naturelles et de jouissances pour l'humanité. C'est à elle que nous
devons les meilleures espèces actuelles de froment et de diverses
céréales, les variétés précoces ; à elle que nous devons déjà quelques
jeunes variétés de fruits ; à elle que depuis quelques années
l'horticulture est redevable de cette immense variété de fleurs qui ont
décuplé la richesse de nos serres et l'éclat de nos parterres. C'est à
elle que nous devrons et des espèces nouvelles de fruits et de légumes,
et des variétés les unes précoces, les autres hâtives, qui prolongeront
pendant plusieurs mois un plaisir qui ne dure que quelques jours ou
tout au plus quelques semaines.
Aussi, en dégustant des fruits savoureux dont les espèces actuelles ne
nous donnent pas d'idée, peut-être nos arrière-petits-fils nous
plaindront aussi sincèrement que celui de nous, qui mange ce que nous
appelons une bonne poire, plaint ses aïeux qui, il y a quelques
siècles, se régalaient avec du gland d'Espagne ou d'autres fruits
aujourd'hui aussi dédaignés des palais les moins délicats.
« La méthode sagement combinée de semis et de croisement — écrivait, il y a dix ans, un des auteurs du dictionnaire Pittoresque d'histoire naturelle
— est une voie d'amélioration des plus importantes ; elle demande à
celui qui s'y livre des soins assidus, de la constance et une volonté
ferme, éclairée par l'habitude et la connaissance des lois de la
physiologie végétale. Marchand, en 1715 , Gmelin, en 1749, et depuis
eux Koelreuter, Van-Mons et Knight oui ouvert cette carrière par des
succès ; elle est nouvelle, à-peine entamée, elle mérite d'être courue,
puisque tout annonce qu'elle fournira des résultats qui touchent aux
plus grands, aux plus puissans intérêts de l'homme. En effet, le
perfectionnement dans les variétés des fruits augmentera nos ressources
et nos jouissances, comme de nouvelles conquêtes en ce genre parmi les
céréales, parmi les plantes potagères, mettront sur tous les points les
subsistances dans un juste équilibre avec la population, et verseront
de l'aisance et du bonheur dans toutes les classes. ...»
Un expérimentateur estimable, auquel l'agriculture et l'horticulture
doivent un juste tribut de reconnaissance , M. Lecoq, de Clermont, a
publié une sorte de traité ex-professo
sur l'hybridation. Ou a vainement cherché à contester la vertu des
croisemens naturels recommandés par les botanistes : les faits sont là
avec toute leur puissance, pour répondre à l'incrédulité ou à la
mauvaise foi, et pendant que les hommes discutent, la nature opère
elle-même en silence son œuvre mystérieux d'hybridation, et transforme
les végétaux pour répondre aux besoins toujours croissans de l'humanité.
Dans un prochain numéro nous reviendrons sur cette question, et
indiquerons, d'après les autorités en cette matière, les procédés à
suivre pour arriver le plus promptement aux résultats.
*
* *
Tome III. - 3e année. - 5e livraison. - novembre 1845.

|
MENTOR, Etalon carrossier, fils de Mahométan à Mr Morin, Fils.
|
CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE.
QUESTION CHEVALINE.
§ 2.— PRODUCTION (Suite).
Si l'on veut agir utilement en France sur la production du cheval de
luxe, loin de généraliser les efforts, il faut donc au contraire les
concentrer sur les localités qui s'y montrent les plus propices et où
elle existe déjà, et l'y développer suffisamment pour atteindre le
niveau des besoins. Il y aura toute espèce d'avantage à procéder de la
sorte. D'abord certitude de réussir, ce qui est un point de la plus
haute importance, et que ne peut offrir aucune autre localité, en
raison de l'énorme différence qui existe entre créer ou simplement
améliorer : ensuite assurance, toutes choses égales d'ailleurs,
d'obtenir la plus haute perfection possible, vu que le moyen le plus
efficace pour améliorer et conserver une race, c'est de l'isoler et de
la préserver pure de mélanges hétérogènes ; ce qui ne se peut, toutes
les fois qu'il en existe simultanément plusieurs sur les mêmes points.
Et comme il n'y a pas au monde une race d'animaux qui soit soumise à
cette règle d'une manière aussi absolue que le cheval de luxe, il en
résulte évidemment qu'il est de la dernière importance d'en
circonscrire et développer en même temps la production dons un nombre
de localités assez restreint pour qu'elle s'y trouve seule et garantie
de tout contact impur.
Dira-t-on que c'est un privilège que nous réclamons pour ces localités
; une industrie dont nous demandons le monopole pour elles, et dont
elles auront seules les bénéfices ?
Quand il en serait ainsi, serait-ce donc un si grand malheur ? si c'est
le moyen de procurer au pays de meilleurs chevaux, il n'y aurait pas à
hésiter ; et nous ne voyous pas pourquoi telle province, si elle est en
position de les produire mieux, ne les fournirait pas aux autres
provinces, de même que celles-ci leur fournissent à leur tour les
produits et les denrées qui leur sont propres. Autant demander que l'on
plante des vignes et des oliviers sur toute la surface de la France,
dans la crainte que la Bourgogne et la Provence n'accaparent le
monopole des vins et des huiles. De semblables raisonnements, quand il
s'agit des diverses parties d'un même empire, ne méritent pas qu'on s'y
arrête, et qu'on les discute sérieusement.
Au demeurant, nous allons plus loin : nous soutenons, et il serait
facile de le prouver, qu'il s'en faut de beaucoup que la fourniture du
cheval de luxe, soit un avantage pour les lieux qui en sont en
possession. De toutes les productions agricoles, celle du cheval est la
moins lucrative ; de toutes les espèces de chevaux, celle du cheval de
luxe, comme spéculation, est la pire. Loin d'être une source de
bénéfices, elle n'est le plus fréquemment qu'une occasion de dépenses
et de pertes. Si nous la réclamons pour certaines localités, ce n'est
nullement dans l'espoir de les enrichir aux dépens des autres, mais
uniquement parce qu'elles nous y paraissent les mieux disposées ; et
dans cette circonstance, nous ne sommes préoccupés que d'une chose,
l'intérêt général. Nous sommes si loin du reste, en formulant ce vœu,
de céder au désir de les favoriser, que dans notre opinion bien
arrêtée, et reposant sur une longue expérience, il n'est pas de produit
analogue, bœuf, âne, mulet, cheval de trait, qui ne présente plus de
chances avantageuses à l'éleveur. Une foule d'observateurs
superficiels, nous le savons, ne manqueront pas de se récrier, de citer
les prix élevés reçus pour tel ou tel cheval ; mais ils ne diront pas
ce qu'il a fallu acheter de poulains, perdre de chevaux par mort ou
accident, éprouver de désappointemens de toute espèce, pour obtenir ces
quelques individus.
Que les provinces qui produisent le cheval de trait, se contentent donc
de le produire, en lui procurant toutes les améliorations que comporte
sa spécialité ; mais qu'elles se gardent de ces autres prétendues
améliorations qui consistent à mélanger sans discernement les races, et
n'ont d'autre résultat que de détruire ce qui est, sans rien mettre à
sa place. Système déplorable qu'il faut regarder comme une des grandes
causes de l'infériorité dans laquelle nous sommes tombés.
Que les provinces qui produisent le cheval sans taille, sans étoffe,
sans distinction, en un mot incapable de répondre aux besoins de
l'époque, se gardent d'inutiles efforts pour en faire un cheval de
luxe, et qu'elles le remplacent par le bœuf, l'une, le mulet, le cheval
de trait léger, suivant les lieux.
Que celles qui produisent le cheval distingué, mais manquant de taille
et d'étoffe, fassent naître; mais laissent élever par d’autres qui,
douées d’un sol plus fertile et d'un climat plus favorable, puissent
donner à ces produits le développement dont nous ne pouvons nous passer
aujourd'hui.
Quand à ces dernières, qu'elles seules se chargent de fournir le cheval
de luxe ; et comme il réclame de grands soins et de grands sacrifices
ainsi que nous venons de le dire, il ne paie qu’à grand’peine les
dépenses qu'il occasionne, c'est à le faire produire que doivent tendre
tous les efforts du gouvernement ; c’est aux localités qui le
produisent et l'élèvent que celui-ci doit appliquer toutes les
ressources qui sont à sa disposition et qui agiront avec d’autant plus
d'efficacité, qu'elles seront plus concentrées. Il est temps, si l'on
veut obtenir des résultats, qu’on renonce à éparpiller, comme on l'a
fait jusqu'à ce jour, ce qu’on possède de moyens améliorateurs, qui, de
la sorte, ne procurent que des résultats éphémères aussitôt détruits
qu'obtenus.
Telle est, à nos yeux du moins, l'unique voie à suivre pour amener la
France à produire ce que réclament les besoins du luxe et de l’armée,
et pour lui épargner en même temps les dépenses que ne pourrait manquer
de lui occasionner, la tentative imprudente de contrarier le vœu de la
nature.
Quant aux moyens de donner à la production du cheval de luxe, dans les
localités qui lui sont propres, un développement suffisant pour qu’elle
puisse atteindre au niveau des besoins, la chose qui nous paraît des
faciles. Nous avons vu qu'il s'agissait d'à peine 25.000 chevaux. Mais
ce n’est pas à dire que le nombre des élèves doive être augmenté
d’autant. Sans doute, il doit l'être, dans de certaines proportions, et
le petit nombre que renferment en ce moment les écuries des éleveurs se
trouvent exposé à un service trop pénible et qui devient pour eux une
source de détérioration. Mais d’un autre côté aussi, il n’estpas moins
constant que, même dans les localités les plus avantageusement douées
sous ce rapport, il existe une quantité considérable de chevaux d'une
autre nature, qui pourraient tout aussi bien être élevés ailleurs, et
conséquemment faire place à des animaux plus distingués. D'où il
résulte évidemment que l'augmentation des élèves dans ces diverses
localités, ne serait pas à beaucoup près aussi considérable qu'elle
peut le paraître au premier coup d'œil.
§ 3. AMÉLIORATION.
De ce que nous réclamons la production à peu près exclusive du cheval
de luxe, par le petit nombre de provinces qui se sont montrées jusqu'à
ce jour capables de le produire, ce n'est certes pas une raison d'en
aller conclure que nous soyons parfaitement satisfaits de ce qui s'y
trouve en ce moment, et que dans notre opinion, il n'y aurait autre
chose à leur demander que d'augmenter le nombre de leurs produits tels
qu'ils sont. Malheureusement il n'en est pas ainsi, et si la quantité
n'est pas suffisante, la qualité ne l'est pas davantage.
Comment il se fait que dans un pays aussi avantageusement situé que le
nôtre, dont le sol et le climat se trouvent dans des circonstances
aussi favorables au développement de cette industrie, nous nous
trouvions dans cette fâcheuse position ? c'est ce que nous
n'examinerons pas ici. Une telle entreprise nous mènerait trop loin.
Nous craindrions d'ailleurs que nos paroles ne devinssent le texte
d'attaques et de récriminations que nous avons d'autant plus à cœur
d'éviter, que dans l'état de détresse où nous sommes tombés, nous
n'avons pas trop des efforts de tous pour nous relever. Que des fautes,
et des fautes nombreuses aient été commises, c'est ce que nous sommes
loin de nier ; mais comme personne n'en a été exempt, ce qu'il y a de
mieux, et même la seule chose à faire, c'est d'oublier le passé, ou
plutôt de n'en garder le souvenir qu'à titre de renseignement, et pour
éviter de retomber dans les mêmes erreurs ; et de rechercher de bonne
foi et sans arrière-pensée, les moyens de remédier à l'état des choses,
sans s'inquiéter en aucune façon des personnes. Telle est du moins, et
telle sera toujours notre manière de procéder : en nous efforçant
d'indiquer ce qui nous manque, et les moyens de nous le procurer, nous
ne nous occuperons en quoique ce soit de ce qu'a fait celui-ci, de ce
que n'a pas fait celui-là. Si nous sommes assez heureux pour émet-tre
une idée raisonnable, peu nous importera par qui elle sera adoptée et
mise à exécution, pourvu qu'elle le soit. Car au-dessus des amours
propres et des intérêts privés, au-delà des amitiés et des haines, il
est un objet devant lequel tout doit s'incliner et se taire, c'est
l'intérêt général. Si, comme nous aimons à le croire, il est le but que
se proposent d'atteindre ceux qui s'occupent de cette question, nous ne
doutons pas que notre appel soit entendu et notre exemple imité.
Nous ne produisons pas une quantité suffisante de chevaux de luxe :
ceux que nous produisons ne sont pas d'une qualité satisfaisante ; il
nous faut donc faire marcher de front, l'augmentation et l'amélioration.
L'augmentation, c'est chose aisée. A cet effet, il suffit de procurer à
l'éleveur des débouchés avantageux. Tant qu'ils ne lui manqueront pas,
quels que soient les besoins, on peut être certain qu'il y suffira du
reste. Les moyens de lui procurer ces débouchés, nous nous en
occuperons au paragraphe suivant, et nous espérons y démontrer d'une
manière irrécusable, la possibi-lité d'y parvenir sans peine, le jour
qu'on le voudra sérieusement.
Reste l'amélioration : c'est là le point culminant de la question, et celui qui va nous occuper ici d'une manière exclusive.
Elle doit être envisagée sous deux faces différentes :
Amélioration proprement dite, intrinsèque, absolue, primitive,
n'importe comment on voudra l'appeler, qui consiste à procurer à
l'animal la conformation et le germe des qualités le plus en harmonie
avec les besoins à satisfaire.
Amélioration secondaire, relative, résultat d'une éducation qui
permette à cette conformation et à ces qualités d'atteindre tout le
développement dont elles sont susceptibles, et de faire ainsi parvenir
la race au plus haut degré possible de perfection.
Cette dernière face de la question ne présente aucune difficulté
réelle, et les avis sont à peu près unanimes à cet égard. Placer les
jeunes élèves dans les conditions de climat et d'alimentation les plus
propres à atteindre le but qu'on se propose ; ne leur imposer que des
travaux proportionnés à leur force ; les soumettre à des soins
hygiéniques bien entendus : tels sont les principaux préceptes qui
doivent présider à une bonne éducation et sur lesquels on est
généralement d'accord. Si l'on ne s'en éloigne que trop souvent, ce
n'est pas faute de les connaître, mais bien par d'autres causes dont
nous allons nous occuper.
F. PERSON.
(La suite au prochain numéro.)
JUMENS POULINIÈRES. — TRAVAIL.
On a, avec raison, comparé le corps humain à une machine ; et
poursuivant la comparaison, on a dit que, pour être maintenue en bon
état, il faut qu'une machine fonctionne ; que c'est la laisser dépérir
que la mettre en repos trop longtems, parce qu'elle se rouille et
devient rude dans ses mouvemens. Mais le travail doit être modéré,
c'est-à-dire en proportion avec la force qu'elle peut produire, car si
on lui demande un travail exagéré, elle s'use autant au moins que si
elle restait à rien faire.
Appliquée aux jeunes chevaux, cette comparaison nous a amené à dire que
les soumettre à un travail forcé, c'est les ruiner avant l'âge où l'on
doit en attendre un bon service ; et appliquée aux étalons, que c'est à
tort qu'on ne leur demande aucun travail, attendu que le travail est à
la fois le principe de la santé et de la vigueur. Le travail modéré
entretient le jeu des muscles et des tendons, il laisse du moelleux aux
articulations, en même tems qu'il donne à l'animal plus d'adresse et de
docilité.
On a observé que l'étalon qui travaille est plus prolifique que celui
qui ne fait rien, et que ses produits sont généralement d'un caractère
plus doux. Il y a donc double avantage à faire travailler les étalons,
puisque le travail est essentiellement hygiénique, et qu'en définitive
tout travail est un produit qui ajoute à la valeur de la propriété.
Ce qui a été dit pour les chevaux destinés à la production, s'applique
également aux jumens poulinières : c'est une erreur, c'est une faute de
les laisser oisives pendant toute l'année.
Tel est cependant l'usage dans notre pays, quand il s'agit de jumens
dont les produits sont d'une valeur au-dessus de la moyenne. L'abus
existe notamment dans la vallée d'Auge. Là, les jumens de prix restent
en liberté dans un herbage d'un bout de l'année à l'autre bout, et cela
dans la crainte que le travail ne compromette le foetus sur lequel le
propriétaire de l'animal fonde son espoir. Dans quelques propriétés,
les éleveurs inlelligens laissent un abri toujours ouvert où la jument
peut se garantir de la pluie ou du froid, mais chez la plupart,
l'animal reste exposé aux intempéries, et n'est rentré que lorsque
l'hiver devient tout-à-fait rigoureux.
Il est impossible qu'un semblable régime ne nuise pas au bon état de
l'animal : exposée à des refroidissemens, à l'influence des nuits
humides et glaciales, et de plus, n'étant soumise à aucun travail, une
jument devient raide dans ses membres, froide dans ses épaules, et
quoique l'on en puisse dire, elle transmet à ses produits ces fâcheuses
dispositions, qui, comme certains autres vices, prennent le caractère
héréditaire, si le même régime est continué pendant plusieurs
générations. Ainsi, de peur de compromettre l'animal par le travail, on
le compromet bien plus sûrement par l'oisiveté.
Telles sont les réflexions qui nous ont été inspirées, et que nous
avons entendu exprimer par des hommes dans l'expérience desquels nous
avons pleine confiance, lors du dernier concours d'Argences. Une partie
des belles jumens que l'on admirait à l'exhibition, ont paru les unes
déjà froides des épaules, les autres disposées à le devenir. Plusieurs
étaient boiteuses, et cet accident n'était pas seulement, comme on
voulait bien le dire, l'effet de la route depuis l'herbage jusqu'au
lieu du concours, mais aussi et surtout le résultat de l'oisiveté
prolongée dans les herbage.
Pour justifier cette habitude de laisser les poulinières à rien faire
pendant toute l'année, on allègue ce que nous disions, que le travail
pourrait compromettre la production, et d'autre part que dans le
Pays-d'Auge, on ne sait â. quel travail employer les jumens.
Il est difficile d'admettre l'une ou l'autre raison, car, nous le
répétons, il est de règle physiologique qu'un travail en rapport avec
la force de la machine, l'entretient en état ; et quelle que soit la
nature de l'exploitation, il y a toujours moyen d'occuper un cheval.
Chaque saison, comme chaque contrée a ses travaux particuliers : le
transport des foins, celui des pommes, celui des engrais, puis le
service du cabriolet ou de la selle, pour aller aux marchés voisins,
sont autant de travaux auxquels les poulinières de la vallée d'Auge
peuvent être employées. Qu'on les laisse au repos dans les derniers
mois de la gestation, cette précaution est rationnelle ; mais ce qui ne
l'est pas, c'est cet état de repos absolu, souvent aussi fâcheux qu'un
travail en dehors de la mesure des forces de l'animal.
Un des écrivains de l'antiquité a dit que « celui qui croit se procurer
de la santé en vivant dans l'inaction, est aussi peu sensé que celui
qui se condamne au silence pour perfectionner sa voix. »
Ce qui était vrai autrefois sous ce rapport l'est encore aujourd'hui,
et doit s'appliquer aux animaux tout aussi bien qu'aux hommes.
POMMES DE TERRE.
Ce qui doit en ce moment préoccuper les cultivateurs dans les contrées
où la maladie de la pomme de terre a occasionné le plus de pertes,
c'est de ménager les tubercules pour la semence de l'année prochaine.
Au nombre des moyens proposés pour la conservation des tubercules, il
en est un que l'expérience recommande d'une manière particulière. Il
consiste à exposer au grand air, en les retournant de tems en tems pour les faire verdir,
les pommes de terre destinées à la reproduction. En cet état, les
pommes de terre deviennent beaucoup plus rustiques et sont à peu près
certainement garanties de la pourriture. Il y a en outre à l'emploi de
ce procédé cet avantage, que les tubercules qui ont verdi ne sont plus
mangeables, ce qui forcera de les conserver pour leur destination. On
ajoute enfin que les tubercules amenés à cet état ont une végétation
plus vigoureuse que les autres et assurent une récolte plus abondante.
On conseille aussi de semer les graines de pommes de terre qui ont pu
être recueillies sur les fanes. Ces graines semées au commencement du
printems donneront des tubercules qui pourront fournir, en septembre,
une récolte dont une partie peut servira la consommation et une autre
partie à la reproduction (1).
Enfin nous renouvelons le conseil que nous avons donné précédemment, de
mettre en ce moment dans une terre bien défoncée, à une profondeur de
30 centimètres environ des tubercules qui pousseront de suite et
produiront au printems une récolte certaine. Le seul soin à prendre est
de couvrir de paille, de feuillage ou de fumier à demi consommé, les
fanes qui sortiront de terre, afin de les préserver contre les gelées.
Nous avons vu, ces deux dernières années, des pommes de terre ainsi
cultivées, et nous croyons pouvoir garantir le succès de cette culture,
malgré les assertions contraires de quelques personnes qui ont parlé
sans doute sans avoir expérimenté.
Un dernier conseil, c'est de bien préparer, de bien fumer la terre
destinée à recevoir au printems la pomme de terre. C'est le moyen
d'obtenir une bonne récolte qui dédommagera amplement le cultivateur de
ses soins et de ses dépenses. Dix ares de terre en bon état et sur
lesquels le binage et le buttage se feront en temps convenable,
produiront plus que quarante ares négligemment préparés et dans
lesquels on aura employé, pour la reproduction, trois fois plus de
tubercules que dans le premier cas.
Nous terminons en faisant observer qu'il est très-regrettable que dans
le premier moment beaucoup de tubercules pourris ou attaqués d'un
commencement de pourriture aient été jetés et perdus, car nous avons vu
dans une féculerie des produits provenant de pommes de terre gâtées en
notable partie, et ces produits ne le cédaient en rien en blancheur et
en qualité à ceux provenant des tubercules les plus sains.
En Angleterre, où la crainte d'une disette a fait sentir la nécessité
de tout utiliser, il n'y a pas eu un tubercule de perdu, et il s'est
même depuis deux mois fondé un assez grand nombre de féculeries qui
contribuent chaque jour à rendre la perte moins considérable qu'on ne
le craignait au commencement de la saison.
Ajoutons qu'après des dissertations plus ou moins savantes sur la cause
de la maladie, on s'est généralement accordé à reconnaître ce que le
simple bon sens avait indiqué tout d'abord, à savoir que le mal devait
être attribué uniquement à la température froide et humide de l'été.
Quant au champignon dont on avait tant parlé, il n'en est plus question.
(1) Nous n'entrons pas ici dans de plus amples détails à
ce sujet, car il est probable que l'on ne s'est guère occupé de
récolter les baies de la pomme de terre. Il serait cependant bien
désirable que l'on ne négligeât pas ce moyen de renouveler, de rajeunir
les espèces et d'en obtenir de nouvelles. L'année prochaine, en tems
opportun, nous publierons des instructions sur cette culture, et dès à
présent nous nous empresserons de communiquer les renseignements que
nous nous sommes procurés sur ce sujet à ceux de nos lecteurs qui
seraient à même de les mettre à profit au printems prochain.
REMONTES. — ACHAT DE JUMENS.
Une pétition couverte en quelques heures de près de mille signatures, a
été adressée après la foire Toussaint, à Bayeux, à M. le ministre de la
guerre, pour l'engager à révoquer l'ordre émané de son département, de
cesser les achats de jumens pour le service de la cavalerie. Nous
l'avons dit, cette malencontreuse suspension dans les achats de ce
genre a non seulement causé une grave atteinte aux transactions qui
devaient se faire à la Toussaint, mais en outre a porté un coup fâcheux
à l'industrie chevaline de tout le pays.
Beaucoup de cultivateurs qui avaient compté sur la vente de leurs
juments pour acheter des élèves, ont dû s'en retourner découragés par
cette irrégularité dans les achats de la guerre, et décidés la plupart
à renoncer à une industrie si chanceuse, toujours subordonnée aux
caprices d'une administration qui agit suivant son bon plaisir.
On avait espéré que le ministre ferait droit à la pétition des éleveurs
; mais jusqu'à présent aucune réponse n'a été reçue, et le
mécontentement du pays est grand. Le département de la guerre ne peut
cependant compter sur le concours de nos cultivateurs, qu'autant que
ceux-ci pourront eux-mêmes compter sur le sien ; et c'est la régularité
dans les achats qui, seule, peut les engager à élever des chevaux pour
l'armée.
Il y a quelques années, placés dans cette alternative d'élever pour la
guerre ou pour le commerce, nos cultivateurs ont travaillé à peu près
exclusivement pour la guerre. Il en est résulté que le commerce s'est
retiré de jour en jour, en voyant qu'il ne pouvait plus faire
concurrence à l'administration des remontes, et nos foires sont
désertées par les marchands étrangers qui, jadis, y venaient faire des
achats considérables.
En suivant cette voie, nos éleveurs auraient-ils agi rationnellement et
selon leur plus grand intérêt, dans la supposition que la guerre fût
bien décidée à ne remonter la cavalerie qu'en chevaux français, et que
ses achats s'opérassent régulièrement et sans intermittence ? C'est une
question que nous n'avons pas à examiner, puisque c'est l'irrégularité
dans les opérations des remontes qui motive les plaintes et
réclamations du pays.
MM. les acheteurs des remontes ont pu apprécier eux-mêmes le mauvais
effet des intermittences dans les achats, et ils ne peuvent méconnaître
la justesse des plaintes de nos éleveurs. Sans doute ils n'ont pas été
sans exprimer à ce sujet leur pensée à l'administration dont ils sont
les mandataires, et celte administration comprendrait bien mal ses
intérêts, si elle ne donnait une sérieuse attention à leurs
représentations.
Qu'elle prenne garde que la confiance en elle (confiance déjà
ébranlée), ne vienne à cesser, car nos éleveurs déçus dans leurs
espérances, tourneraient leurs efforts vers le commerce, et ne se
préoccuperaient guère du soin de ménager un acheteur duquel ils
n'auraient à attendre qu'un concours tout-à-fait secondaire, puisqu'il
serait toujours incertain.
Dans l'intérêt général, il est nécessaire que cet état de choses, que
cette incertitude également fâcheuse pour l'éleveur et pour l'acheteur
ait un terme. Le vœu de tous les conseils généraux est que désormais
tous les achats de chevaux destinés au service de l'armée soient faits
en France. Que l'on donne par une déclaration formelle satisfaction sur
ce point aux représentons des départemens ; ce point une fois réglé, il
devra être facile de s'entendre : au commencement de chaque année, la
guerre fera connaître ses besoins ; elle indiquera dans quelle
proportion les remontes devront prendre dans chaque contrée chevaux et
jumens. On se préparera en conséquence, et personne n'aura de mécomptes
à craindre, car la régularité dans les achats amènera dans l’élevage.
Nous ne voulons pas soulever ici une foule de questions qui se
rattachent à l’état de choses actuel. Notre unique but a été de
signaler le grave inconvénient de l’irrégularité dans les achats faits
par les ordres et pour le compte de la guerre.
*
* *
Tome III. - 3e année. - 6e livraison. - décembre 1845.
CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE.
QUESTION CHEVALINE.
§ 3. — AMÉLIORATION (Suite).
Si un trop grand nombre d'éleveurs laissent leurs poulains exposés aux
intempéries des saisons les plus rigoureuses ; si d'une main
parcimonieuse, et pour ainsi dire à regret, ils ne leur accordent
qu'une nourriture insuffisante ; si dès l'âge de dix-huit mois, ils les
soumettent à de pénibles travaux ; s'ils exposent aux fatigues de la
maternité les pouliches de deux ans ; qu'on n'aille pas croire qu'ils
ignorent les conséquences de ces fâcheuses habitudes. Ils en gémissent
les premiers ; et ne demanderaient qu'à s'en exempter si la chose était
possible. Malheureusement elle ne l'est pas ; et ils sont contraints de
subir la loi d'une nécessité qu'ils déplorent. Pour procurer aux jeunes
animaux un abri et une nourriture convenables ; pour n'exiger d'eux
qu'un travail proportionné à leurs forces, et dans un âge où il serait
sans inconvénient ; pour ne rendre mères les femelles qu'à une époque
où leur crue serait terminée, et leur tempérament formé, il n'en
coûterait pas moins par tête que trois cents francs, et l'éleveur ne
saurait où les trouver. Non pas que la différence qui en résulterait
dans la valeur réelle de l'animal ne fût de beaucoup plus considérable
; mais dans l'état actuel des choses, la concurrence étrangère s'oppose
à ce que le consommateur soit mis à même de l'apprécier, et
conséquemment de la récompenser.
La preuve cependant qu'aussitôt que, grâce à un prix suffisamment
rémunérateur, l'éleveur pourra entrer dans une voie plus rationnelle,
il s'empressera de le faire, c'est que depuis quelque temps l'éducation
du cheval d'arme a gagné chez nous d'une manière irrécusable. La cause
en est facile à reconnaître ; il est le seul dont en ce moment, la
vente soit assurée, bien qu'à des conditions trop peu avantageuses pour
permettre une amélioration complète.
Il nous semble donc hors de doute que du jour où le cheval de luxe
indigène trouvera un débouché certain, et à un prix, capable de couvrir
les dépenses qu'il aura occasionnées, il sera facile d'obtenir de
l'éleveur toutes les améliorations qui procèdent d'une éducation
convenable, et dont le résultat est le développement complet des
qualités innées de l'animal.
Mais pour les développer en lui ces qualités, il faut qu'il en possède
le germe ; et c'est à le lui procurer de la manière la plus étendue,
que consiste la seule difficulté réelle.
Ici quatre systèmes principaux se trouvent en présence. Amélioration
par les accouplements, — amélioration par les croisements , —
amélioration par le pur sang anglais , — amélioration par le sang arabe.
Différant essentiellement sur une foule de points, ces divers systèmes,
chose bizarre, reposent sur une base commune, l'influence de l'hérédité.
L'amélioration par accouplement consiste à choisir dans la race
indigène, et à allier ensemble des individus, semblables de taille, de
conformation, de qualités, et se rapprochant autant que possible de ce
que l'on veut obtenir. Pour démontrer la supériorité de ce système, ses
partisans disent qu'une race n'étant rien autre chose que l'expression
des influences du sol et du climat sur l'espèce, il n'est pas possible
d'exercer des modifications durables sur cette race, en dehors
d'elle-même, puisqu'il en résulterait une lutte continuelle entre
l'homme et la nature, lutte dans laquelle le premier ne saurait manquer
de succomber. Tandis qu'au contraire, en cherchant dans la race
elle-même, les éléments d'amélioration, et en accouplant constamment
les individus les plus parfaits, comme on ne demanderait rien à la
nature qu'elle n'eût déjà accordé d'elle-même, le succès ne saurait
faire faute, en vertu des lois bien connues de l'hérédité qui tendent
sans cesse à modeler les enfants, sinon toujours sur leurs pères, du
moins sur leurs ascendants.
S'appuyant sur le même principe, l'influence de l'hérédité, les
partisans de l'amélioration par le croisement, arrivent à des
conclusions entièrement opposées. Ils disent que le bon et le beau sont
répandus par parcelles sur la surface du globe, et que partout les
défauts tendent à absorber les qualités ; qu'en conséquence le système
de l'accouplement doit à la longue donner le dessus au mal, et qu'on ne
peut y remédier que par le croisement, c'est-à-dire l'accouplement
d'animaux qui, produits de sols et de climats différents, possèdent une
organisation différente, et conséquemment des qualités capables de
neutraliser leurs défauts respectifs.
Ces deux opinions sont combattues par une troisième qui soutient
qu'aucune des races septentrionales ne sont capables de se conserver ,
encore moins de s'améliorer par elles-mêmes ; que par suite des
influences d'un sol et d'une température pour lesquels la nature
n'avait pas destiné l'espèce, leur sang s'est appauvri, leurs fibres se
sont relâchées, leur conformation s'est altérée ; qu'elles ont perdu,
et qu'on ne peut leur faire recouvrer une partie de leurs qualités les
plus précieuses, qu'en versant dans leurs veines un sang plus riche et
plus généreux ; que pour atteindre ce résultat, les accouplements et
les croisements de races analogues, sont d'une égale impuissance, et
qu'on ne peut y réussir qu'au moyen d'une race à part, possédant au
plus haut degré la pureté du sang et la perfection d'organisation.
Cette opinion est celle qu'ont généralement adoptée les hommes de
cheval les plus avancés. Mais d'accord sur le principe, il s'en faut
qu'ils le soient sur son application. Pour les uns, le type
améliorateur par excellence, c'est le pur sang anglais. Pour les
autres, c'est le cheval d'Orient, et particulièrement le cheval arabe.
Les premiers disent que depuis cent cinquante ans, les Anglais
travaillent à perfectionner leur race ; qu'elle n'est autre chose que
la race arabe modifiée dans le sens de nos besoins ; que par suite des
soins infinis dont elle a été l'objet, elle a, non-seulement conservé
toutes ses qualités primitives, mais en a acquis de nouvelles, et s'est
en même temps acclimatée et appropriée à nos services, sous les
rapports de taille et de conformation ; qu'en conséquence, en adoptant
les producteurs des Anglais, c'est tirer parti de leurs travaux, et
nous mettre immédiatement à leur niveau ; que vouloir, au contraire,
prendre la race ab ovo, c'est
rétrograder volontairement d'un siècle et demi, en admettant, ce qui
n'est pas démontré, que nous eussions la patience, l'intelligence et
les moyens de faire aussi bien qu'eux.
A cela, leurs adversaires répondent que rien ne leur prouve que la race
anglaise ait gagné depuis longues années, et qu'ils doutent fort
qu'elle pût présenter aujourd'hui rien de supérieur ni même d'égal aux
hérodes Ecclipse, Childers, et autres célébrités du siècle dernier ; —
que du moment où la nécessité du pur sang est admise, on ne pourra
jamais les persuader qu'une race indigène, de quelques soins qu'elle
ait été l'objet, le puisse conserver aussi pur que le type même dont
elle est issue, et qu'elle n'ait pas plus ou moins subi les influences
du sol et du climat : que quant à l'objection de la taille et de la
conformation, personne n'ignore combien peu de générations sont
nécessaires pour que l'arabe communique à sa descendance celles que
réclament nos besoins et nos habitudes : — qu'au demeurant ils sont
loin de repousser le pur sang indigène ; qu'autant que personne, ils en
reconnaissent l'utilité, ne fût-ce qu'en raison de l'extrême difficulté
dont il sera toujours de se procurer des chevaux arabes convenables : —
mais que le pur sang anglais, et généralement le pur sang européen, qui
en est dérivé, ne répondent en ce moment à nos besoins que d'une
manière plus qu'imparfaite, attendu que cette race n'a été créée qu'en
vue d'une spécialité en désaccord complet avec le genre de service que
nous attendons de ses produits ; que quand les Anglais introduisirent
chez eux les producteurs arabes, ce qu'ils leur demandèrent, ce furent
des coureurs ; la qualité qu'ils recherchèrent avant tout, ce fut la
vitesse, toujours la vitesse ; qu'au cheval le plus vite , la plus vite
jument : telle fut la règle constante qu'ils suivirent dans les
accouplements ; que sans doute ils parvinrent ainsi à obtenir une
grande vélocité ; mais que cette qualité ne put s'acquérir qu'au
détriment d'une foule d'autres, et devint le résultat d'une
conformation inconciliable avec nos différents services ; qu'en
conséquence vouloir baser l'amélioration sur le pur sang tel qu'il
existe en ce moment, c'est démolir d'une main en édifiant de l'autre ;
qu'enfin pour obtenir des résultats réels et durables, la première
condition dont on ait à se préoccuper, c'est la création d'une race de
pur sang en harmonie avec nos besoins ; que cette race ne peut dériver
que de la race arabe, mais en suivant une marche tout-à-fait différente
de celle qu'on suivie les Anglais, et en se proposant un tout autre but.
Cette opinion, nous devons le confesser, a toutes nos sympathies : nous
aussi nous pensons que le pur sang, sous l'enveloppe dont il est revêtu
chez nous, ne peut rendre à l'amélioration que de bien minimes
services, et qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs la cause de
l'inutilité des efforts et des sacrifices que l'on fait depuis si
longtemps. Nous aussi nous pensons qu'il n'y aura chez nous de
véritable et sérieuse amélioration, qu'alors que nous posséderons une
race de pur sang qui, n'ayant aucune prétention à l'extrême vitesse,
sera amenée aux conditions de force, de carrure et d'ensemble
qu'exigent les besoins du luxe et de l'armée.
En effet, que demandons-nous ? D'une part, la pureté du sang et les
qualités qui en dérivent : d'autre part, certaines conditions de
taille, d'ampleur, de conformation. D'un autre côté, il est une loi
constante de la nature, c'est de modeler presque toujours les enfants
sur les parents, toujours sur l'une des deux ou trois générations qui
les ont précédés. Or, si la race amélioratrice possédait à la fois la
pureté du sang et la conformation voulue, il est clair comme le jour
qu'à de très-rares exceptions près, son action produirait en tout et
partout des résultats assurés, et qu'il ne faudrait, pour opérer dans
l'espèce, une révolution complète, qu'un nombre très limité d'années.
Qu'arrive-t-il, au contraire, aujourd'hui ? La race amélioratrice, ou
soi disant telle, possède, il est vrai, la pureté du sang, mais comme
avant que de songer à la faire productrice, on a visé à la faire
coureuse, la conformation est en désaccord complet avec celle du cheval
de service. La conséqnence, c'est que toutes fois que par son moyen
nous voulons améliorer le sang d'une de nos races, nous en altérons
aussitôt la forme ; que pour remédier à cet inconvénient, nous sommes
immédiatement forcés de recourir à la race locale, et de rechercher la
forme au détriment du sang, c'est-à-dire de revenir précisément au
point de départ, sauf à recommencer aussitôt. C'est précisément le
métier que nous faisons depuis nombre d'années, et auquel nous ne
pouvons échapper, tant que nous ne changerons pas de système, et que
nous ne voudrons pas nous souvenir qu'entre la course et la production,
il y a un abîme.
On a dit : Le cheval de pur sang doit suffire à tout ; avec la jument
de son espèce, propager sa race ; avec la jument d'attelage, la jument
à deux fins, la jument d'escadron, la jument de selle, produire le
carrossier, le cheval à deux fins, le cheval de troupe, le cheval de
selle ; oui, sans doute, quand il aura été créé dans la vue de la
production, c'est-à-dire qu'il sera lui-même conformé d'une manière
analogue au genre de service que l'on attend de ses produits ;
autrement non ; et il a bien fallu finir par le reconnaître, quoiqu'un
peu tard peut être. Alors on a eu recours à une autre théorie : on a
découvert que le pur sang était un remède trop héroïque, qu'il
demandait à n'entrer dans l'amélioration que par degrés, et que pour
être appliqué avec avantage, il fallait qu'il fût délayé. En d'autres
termes que le cheval de pur sang ne devait pas directement produire les
chevaux de service, mais qu'accouplé à des juments du pays, on en
obtiendrait des produits qui, par l'influence de leur mère plus
rapprochée de nos besoins, pourraient, dans certains cas, sous le nom
de demi-sang, produire directement les chevaux de commerce ; dans
d'autres, produire d'autres producteurs qui, sous le nom de quart de
sang, entretiendraient l'espèce dans les conditions de taille et de
volume nécessaires. C'était, comme on le voit, de l'homéopathie de
cheval. Il s'agissait de renouveler et de régénérer un sang appauvri,
par les influences ennemies du sol et du climat ; au lieu d'en prendre
à la source et de le verser à flots, on l'insinue goutte à goutte après
avoir eu grand soin de le noyer dans les veines de trois ou quatre
générations ! Voilà donc les derniers mots de la science hippique en
France ; vous tous qui voulez améliorer vos élèves, approchez, la chose
est des plus simples : ceci, c'est le cheval améliorateur ; employez
le, mais prenez garde, ce n'est pas lui qui vous fera immédiatement
votre affaire ; il en engendrera un autre qui, peut-être... Non,
celui-là est encore trop distingué ; laissez-le en procréer un
troisième, qui, lui, enfin, pourra devenir votre messie. Par exemple,
comme dans cette complication de générations, il n'est pas facile de
prévoir d'où viendra l'influence héréditaire, Dieu sait quels produits
il en résultera : peut-être un carrossier, sinon un cheval de selle, ou
bien un troupier ; plus probablement encore un mélange de tous trois :
mais qu'importe ? ce sera un cheval amélioré !
Tout cela paraît fort ridicule, et l'on croirait difficilement qu'il
fût possible d'aller plus loin. C'est pourtant ce qui est arrivé ; tant
il est vrai qu'une fois engagé dans une voie mauvaise, il est
impossible de prévoir où elle pourra nous conduire. On s'est aperçu
que, pour peu que les jumens eussent participé à l'amélioration, les
chevaux dits de demi-sang, souvent même ceux de quart de sang, ne se
trouvaient pas dans les conditions de carrure et de volume que l'on
désirait se procurer, et contrairement à toutes les lois de sens
commun, on a dû au moment où l'on cherchait à améliorer l'espèce,
repousser de la production toute femelle améliorée. Réduit à combattre
les extrêmes par leurs opposés, à des étalons trop minces, on a
accouplé des jumens trop massives, dans l'espoir d'obtenir un produit
dans de justes proportions, et le mérite des mères s'est mesuré, ou
plutôt pesé à la livre. La distinction, l'élégance, le train, la
vigueur, le fonds, n'ont plus été que des qualités secondaires et
nullement indispensables. Du volume, de la taille, de grosses jambes,
de gros ventres, de l'étoffe, et quelle étoffe, bon Dieu ! Telles ont
été les premières et trop souvent les seules préoccupations de
l'éleveur. Tout ce que l'espèce possède de plus pataud et de plus
ignoble, on s'en est emparé ; et de ces étranges alliances, l'on a
obtenu quelquefois des produits d'une conformation assez satisfaisante
à l'œil. Inutile d'ajouter qu'il ne fallait pas les sortir de l'écurie,
et que sous les rapports du service ou de la production, l'influence
maternelle mettait bon ordre à ce que leur mérite s'élevât au-dessus de
zéro. Aussi se garde-t-on, et pour cause, toutefois que l'on fait choix
d'un étalon, de le soumettre à aucune épreuve. Et cela pas plus pour
les écuries de l'Etat, que pour celles des particuliers ; de quoi ils
sont capables, personne ne l'ignore ; et à ceux qui s'en affligent et
qui demandent comment il se fait que les fils d'étalons si célèbres et
si chèrement payés ne soient propres à rien, on ne sait que répondre,
sinon que les chevaux de demi-sang sont des métis, et que les métis
sont frappés par la nature d'impuissance ou autant vaut. Oh ! de cette
fois ils disent vrai, leur cheval de pur sang est bien un métis ; il
est issu d'un cheval et d'une vache. Mais que l'on s'occupe par une
suite d'accouplemens bien entendus et de soins intelligens, de former
des chevaux de pur sang d'une conformation en harmonie avec le service
qu'on attend de leur descendance, et qu'on les accouple avec des jumens
qui, sans être pures comme eux, possèdent une partie de leur tournure
et de leurs qualités , et l'on verra si leurs produits sont des métis
impuissans.
De ce qui précède, devons-nous en faire le sujet d'un blâme envers ceux
qui élèvent, ou ceux qui emploient de semblables producteurs ? En
aucune manière : il ne dépend pas d'eux d'en agir autrement. Il est
certaines conditions de taille et de volume dont nous ne pouvons nous
passer, et qu'il faut conserver à tout prix. Pureté de sang, qualités,
rien ne peut en dispenser ; et tant que l'espèce amélioratrice ne sera
pas changée, il sera à peu près impossible de procéder d'une autre
façon. Hâtons-nous donc de rechercher les moyens d'opérer ce
changement, le cas presse.
F. PERSON.
(La suite au prochain numéro.)
Nota. Voulant
éviter les redites, nous avons dû traiter ici la question de
l'enveloppe actuelle du pur sang d'une manière très-concise, trop
concise même pour ceux qui ne sont pas au fait de la question, et nous
engageons le lecteur qui voudrait plus de détails, à se reporter à
notre opuscule LES CHEVAUX FRANÇAIS EN 1840, pages 50 à 60.
*
* *
Tome III. - 3e année. - 7e livraison. - janvier 1846.
 |
| COQUETTE,
Jument de la
race noire du Cotentin, dessinée en 1829. "On parle souvent de la
race noire cotentine qui s'est peu à peu éteinte et dont
on
retrouve à peine aujourd'hui quelques traces dans la Normandie.
Pensant que l'on verrait avec intérêt un type exact de
cette espèce de
chevaux, si vivement et si justement regrettée, nous donnons,
dans le
dessin actuel, le portrait de l'un des derniers individus d'une race
devenue historique. C'est celui d'une jument qui avait
été vendue par M.
Signard d'Ouffières père à M. de Rochebrune,
à Caen, en 1829." |
REMONTE DES ÉCURIES DE LA MAISON DU ROI.
Chaque année M. de Strada, premier écuyer du roi, vient dans notre pays
acheter une partie des chevaux qui sont nécessaires pour remonter le
service des écuries royales. M. de Strada est arrivé cette année pour
faire ses achats au mois de décembre, et il a fait acquisition de 36
chevaux, qui la plupart sont des carrossiers, castrés partie plus ou
moins longtems avant l'achat, partie encore entiers quand ils ont été
achetés (1).
Avant de constater le mérite de l'ensemble de cette remonte, nous
croyons utile de présenter quelques observations sur l'époque où ces
achats se font et sur le mode d'après lequel ils sont faits.
En venant en remonte à la fin de l'année, M. le marquis de Strada a
beaucoup moins de chances de trouver le nombre et l'espèce de chevaux
qui lui conviennent, que s'il visitait quelques mois plus tôt les
écuries de la plaine de Caen. En voici la raison: l'administration des
remontes de la guerre, qui est en permanence dans le pays et qui
connaît la plupart des écuries, ne laisse échapper aucun des chevaux de
mérite dont le prix se trouve dans sa limite, et cette limite va
quelquefois jusqu'au prix que M. de Strada met en moyenne à ses
acquisitions.
Premier inconvénient, auquel du reste il est facile de remédier,
puisqu'à cet effet il suffirait de procéder moins tardivement aux
achats.
Le deuxième inconvénient consiste dans le mode usité pour ces achats,
et nous ne croyons pas qu'il soit plus mal aisé d'y parer. M. de Strada
paraît même l'avoir compris, car cette année il a déjà apporté quelque
modification au système qu'il suivait précédemment.
M. de Strada avait l'habitude de faire amener dans la cour de l'hôtel
où il descend à Caen, ou sur le bord des routes qu'il devait parcourir,
ou dans la cour de l'une des fermes qu'il se proposait de visiter, les
chevaux parmi lesquels son choix pouvait s'arrêter. Ce système est
mauvais en tout point, et en parlant ainsi, nous ne sommes que l'écho
de l'opinion de tout le pays.
Cette espèce de montre est contraire aux habitudes de la contrée et
elle répugne essentiellement à nos cultivateurs. Aucun d'eux ne se
soucie, non seulement de soumettre ses chevaux à la critique du premier
venu et de tous ses concurrens intéressés à les blâmer, mais, ce qui
pis est, de compromettre ses produits dans leur santé, en les exposant,
au sortir des écuries, au vent et à la pluie, dans une cour ou sur une
grande route. L'année dernière, un très beau cheval de timon, d'un prix
élevé, est mort d'une fluxion de poitrine à la suite d'un
refroidissement causé par un stationnement prolongé sur une route où il
attendait le passage de M. de Strada.
De ce mode d'inspection qui déplaît et répugne aux éleveurs, il résulte
que M. l'Ecuyer du roi ne voit qu'une petite partie des ressources
chevalines du pays ; que son choix est borné dans la limite du nombre
de chevaux que l'on veut bien lui amener, et que souvent les meilleurs
chevaux ne lui sont point connus. Et achetât-il tout ce qu'il y aurait
de mieux dans ceux qui lui sont présentés, il n'acheterait pas les
meilleurs possibles. D'une part donc sa remonte est moins bonne quelle
ne pourrait être, et, d'un autre côté, les échantillons qu'il emmène
sont loin de donner une véritable idée des richesses chevalines de la
Normandie. Nous avons dernièrement visité une partie des écuries du
roi, et, nous le disons avec autant de sincérité que de regret, nous
avons vu dans les stalles, des chevaux normands que l'on aurait grand'
peine à vendre dans nos foires.
Avant de commencer ses achats,-que M. de Strada nous permette de lui
parler avec franchise-il faudrait qu'il se décidât à visiter toutes les
écuries principales du pays : il n'y en a pas une qui ne lui fût
ouverte avec empressement, même sans espoir de lui vendre des chevaux ,
car notre Normandie voudrait être appréciée pour ce qu'elle vaut et
pour ce qu'elle peut faire , et elle voit avec une peine qui n'est pas
assez sentie par qui elle devrait l'être, que l'on aille acheter en
Angleterre des produits que l'on pourrait trouver en France. Quand M.
de Strada aurait tout vu ou du moins ce qui mériterait de l'être, quand
il aurait relevé les prix et contrôlé le mérite des chevaux, l'un par
l'autre, il ferait ses achats avec sûreté, en toute connaissance de
cause, et n'aurait pas à regretter à la fin d'une remonte les premiers
achats opérés.
Tout le monde aurait à se féliciter de ce mode d'opérations : M. de
Strada d'abord, qui aurait fait pour sa propre satisfaction tout ce
qu'il lui aurait été possible de faire, et aurait obtenu de bons
résultats ; ensuite les propriétaires des chevaux de mérite, qui
auraient la certitude de lui vendre leurs produits, et enfin le pays en
général, qui souvent déjà a protesté contre cette malheureuse tendance
à porter à l'étranger des sommes qui seraient si
utiles chez nous pour soutenir et stimuler une industrie digne de tout
intérêt, à laquelle il serait aussi juste, aussi sage qu'urgent de
donner des encouragemens.
Cette année, nous aimons à le reconnaître, M. de Strada a visité un
plus grand nombre d'écuries que dans ses tournées précédentes. Mais ce
n'est pas assez, et nous entendons dire et redire autour de nous que le
seul moyen de bien opérer est de visiter toutes les écuries qui se
recommandent à son examen, et qui peuvent lui être signalées par des
personnes de conscience et de confiance. Qu'il veuille ne s'en
rapporter qu'à lui-même dans son inspection : ce sera pour lui un peu
plus de soin, un peu plus de fatigue, quinze jours de plus à dépenser.
Tant pis pour l'Angleterre ! ce tems ne sera pas perdu pour nos
éleveurs, le pays lui en sera reconnaissant et le service de la maison
du roi y trouvera son compte.
Cela posé, voici dans quelles circonstances, fâcheuses pour notre
contrée, favorables au contraire à la mission que M. de Strada avait à
remplir, s'est faite sa remonte de 1845. La guerre et le commerce,
ainsi que nous l'avons dit, ayant pris pour leurs différens besoins la
totalité ou la plus grande partie des chevaux qui eussent été achetés
par la liste civile, M. de Strada avait chance de réussir fort mal dans
ses opérations tardives, si l'administration des haras n'avait laissé
cette année, dans les écuries du pays, beaucoup de chevaux destinés à
faire des étalons.
M. de Strada, malgré son désir intelligent de n'acheter que des chevaux
castrés de longtems (dût-il les payer plus cher), a été assez bien
inspiré ou conseillé pour profiter de la circonstance, en complétant sa
remonte dans les chevaux laissés par les haras, et les éleveurs,
embarrassés de produits qu'ils avaient espéré placer ailleurs et à
d'autres conditions, ont abaissé leur prix assez pour que l'acheteur de
la liste civile pût y atteindre. Aussi la remonte de 1845
présentait-elle, à quelques chevaux près-les premiers achetés surtout
-un ensemble satisfaisant et de beaucoup supérieur à celui des remontes
précédentes. Il nous coûte même d'avoir à constater que parmi les
chevaux voués à la castration, il se trouvait au moins cinq à six
étalons de distinction, et que l'on s'accorde à considérer comme dignes
d'entrer parmi les bons de la dernière remonte des haras. Il serait au
surplus facile à l'administration de comparer les uns et les autres.
Ce résultat est regrettable, car le pays se trouve ainsi privé de types
distingués de reproduction. Il est regrettable aussi que M. de Strada
se soit vu dans la nécessité d'acheter des chevaux non castrés; et
cependant cet inconvénient est moins grand que celui auquel il était
exposé, de n'avoir à emmener que des chevaux médiocres ou au-dessous du
médiocre; moins grand surtout, grâce au système généralement suivi dans
la maison du roi, où les chevaux sont soignés et dressés pendant un an
ou 18 mois, avant d'être attelés aux équipages. Avec de bons soins, en
effet, ce tems est suffisant pour que des chevaux de 3 ans et demi à 4
ans soient bien remis de la castration et propres à faire un excellent
service.
Ceci nous amène à une dernière observation qui n'est pas nouvelle, mais
que nous devons reproduire en toute occasion, afin que chacun en fasse
son profit.
Depuis quelques années que l'administration des Haras a acheté dans la
Normandie, pour le service des différens dépôts, un plus grand nombre
d'étalons, la production de cette espèce de chevaux a augmenté, en même
tems que l'espèce s'est améliorée. Cette production a dépassé, sinon
les besoins, du moins les ressources dont cette administration pouvait
disposer, tout le monde voulant faire des étalons, et la plupart des
éleveurs se faisant assez d'illusion pour voir un bon producteur dans
un cheval propre tout au plus à faire pour le commerce un animal de
distinction.
Delà un encombrement dans les écuries et des pertes déplorables
d'efforts et de sacrifices ; delà un mal qui ne pourra que grandir, si
les éleveurs, mieux éclairés sur leurs véritables intérêts, ne font un
retour en dehors de la voie où ils sont entrés. En supposant, en effet,
que les chambres accordent aux Haras la somme nécessaire pour répondre
aux voeux de tant de conseils généraux réclamant de nouvelles stations,
et pour réformer tout ce qui est réformable dans les dépôts de cette
administration , ses achats auront encore une limite, et si la
production n'en a pas, les éleveurs auxquels leurs chevaux resteront ne
pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes de leurs mécomptes et de leurs
embarras; car ils doivent comprendre que les Haras ne peuvent être leur
seul acheteur, et que cette administration ne peut acheter toujours et
indéfiniment. Sans doute il lui faudra plus de chevaux qu'elle n'en
possède et elle devra se les procurer : et pour cela le pays devra de
son côté, afin que l'administration puisse exercer soir choix, élever
plus de chevaux qu'il n'en sera acheté. Mais encore une fois, il faut
que la production ne soit pas indéfinie, car les mécomptes le seraient
également.
Ce qu'on peut raisonnablement demander aux Haras et ce qu'on doit
conseiller aux éleveurs, c'est, aux premier, d'acheter de bons chevaux,
mais rien que de bons chevaux, partout où ils seront et de quelque prix
qu'il faille les payer, attendu qu'un bon étalon fait plus de bien dans
un pays que dix médiocres ; le conseil à donner aux seconds , c'est de
ne conserver pour étalons que des chevaux vraîment convenables à cette
destination, et de castrer, sans balancer, pour les vendre au commerce,
tous les chevaux d'un mérite ordinaire ou inférieur. Ce que nous venons
de dire sur les étalons remarquables que M. de Strada a achetés pour
les livrer à la castration, et d'autre part la situation fâcheuse dans
laquelle se trouvent un grand nombre d'éleveurs qui avaient compté sur
l'argent des Haras, nous autorise à insister vivement sur les
observations qui précèdent.
Que M. de Strada nous aide, en ce qui le concerne, à donner cette
direction à l'élevage ; qu'au lieu d'aller en Angleterre acheter à
grand prix des chevaux qu'il peut se procurer chez nous - et que la
Normandie seule en France est à même de lui fournir - qu'il donne
confiance à nos éleveurs dans la continuation, dans la régularité de
ses achats : ils se mettront en mesure de le satisfaire. Ils castreront
de bonne heure et en destination des écuries du roi , des chevaux
desquels , faute d'un débouché assuré, ils tenteraient à grands et à
vains frais, de faire des étalons. Que M. de Strada leur indique le
modèle, le type de chevaux qu'il faut pour les services spéciaux de la
maison du roi, et nous lui garantissons que l'intelligence des
éleveurs, aidée des ressources naturelles du pays, ne lui fera pas
défaut. Ainsi les chevaux de timon, les chevaux à la Daumont qui, pour
la taille et les proportions, forment une espèce spéciale et la plus
difficile à trouver aujourd'hui, la Normandie les lui fabriquera, quand
il voudra prendre l'engagement de les lui acheter à des prix
convenables. Elle possède pour cela des étalons et des jumens, et elle
n'attend que les commandes régulières que l'Angleterre lui enlève, pour
jeter au moule cette espèce de chevaux,
En opérant exclusivement en Normandie les achats de chevaux que ce pays
seul en France peut lui offrir, M. de Strada fera une oeuvre nationale,
il encouragera une industrie en souffrance. Car il ne faut pas compter
seulement les 40 ou 50 chevaux qu'il enlèvera chaque année. En mettant
en relief et en honneur, par le bon service qu'ils feront dans la
maison du roi, les produits trop méconnus de la Normandie, il permettra
aux riches consommateurs d'apprécier le mérite de nos chevaux; tout ce
qui entoure les princes, et de proche en proche les grands
propriétaires , voudront aussi se remonter en Normandie : les éleveurs
feront des efforts en ce sens , et le commerce reviendra visiter un
pays qu'il a déserté par suite d'erreurs et de fautes que ces éleveurs
n'ont pas toutes à se reprocher , mais dont ils sont les victimes.
Mais encore une fois, en finissant, nous engageons, nous prions
l'acheteur de la maison du roi de ne commencer sa remonte qu'après
avoir visité toutes les bonnes écuries du pays, et de tout voir par
lui-même et rien que par lui-même; et pour être certain qu'aucun cheval
de mérite n'échappera désormais à son inspection, qu'il proclame le
sinite parvulos ad me venire, au lieu d'employer des agents dont
l'intervention, toujours suspecte au pays, donne lieu à la critique des
opérations même les mieux entendues.
(1) Un de ces chevaux, demi sang, de l'espèce de chasse, est mort du tétanos quelques jours avant le départ du convoi.
*
* *
Tome III. - 3e année. - 8e livraison. - février 1846.
 |
BŒUF GRAS de race
COTENTINE, appartenant à M. Adeline, Maire de Blay, près Bayeux
(Calvados). Cet animal, âgé de 5 ans, est né et a été élevé à
St-Ebremont-de-Bon-Fossé (Manche), chez M. Samson La Valesquerie,
propriétaire, et vendu à M. Adeline, qui l'a engraissé dans ses
herbages de Blay, près Bayeux. Il a été vendu dans l'état où le dessin
le représente, aveccinq autres bœufs fort beaux, à M. Goupil,
propriétaire à Pontfol. Plusieurs de ces animaux sont destinés à
figurer au concours de Poissy, le 8 avril prochain. Le bœuf
ici dessiné à 1 mètre 60 cm. de hauteur, du garrot à terre, et 2 m. 70
c. du front à l'extrémité de la croupes. La largeur d'une hanche à
l'autre est de 80 cerntimètres.
|
ACHAT D'ÉTALONS.
Depuis long-temps l'achat des étalons occasionne les plaintes les plus
vives. Chaque année les réclamations des éleveurs redoublent de
violence. Cependant jamais à aucune autre époque cette industrie
n'avait été l'objet d'aussi grands sacrifices de la part de
l'administration, et depuis que celle-ci est aux mains qui la dirigent
en ce moment, le nombre des achats a été doublé, la somme destinée à
les payer, augmentée en proportion. Comment expliquer un résultat si
décourageant et si opposé à celui que l'on devait attendre ? Les
éleveurs seraient-ils, comme quelques personnes le prétendent, des gens
déraisonnables, jamais contents, demandant toujours d'autant plus qu'on
leur accorde davantage ; convaincus eux-mêmes de l'injustice de leurs
plaintes, mais persuadés en même temps qu'ils arracheront par leur
importunité, ce que leur bon droit ne saurait obtenir ?
L'administration, au contraire, comme d'autres le disent, cédant à
d'injustes préventions et à une partialité inexcusable, voudrait-elle
sacrifier à quelques individus l'industrie qu'elle a mission de
protéger ? — Ces deux suppositions sont également insoutenables.
Que les éleveurs désirent vendre le plus de chevaux possible, la chose
est naturelle, et personne ne peut s'en étonner. Mais qu'ils ignorent
le mécanisme de nos institutions ; qu'ils pensent qu'une administration
puisse employer au-delà des fonds qui lui sont alloués ; qu'ils fassent
un crime à cette administration d'acheter un bon cheval chez leur
voisin, et de leur en refuser un mauvais : voilà de ces inventions qui
ne méritent pas même qu'on les discute ; il suffit de les exposer pour
en faire justice. D'un autre côté, qu'une administration dirigée par
des hommes d'un esprit supérieur, — leurs ennemis même en conviennent,
—cherche à écraser l'industrie qu'elle doit soutenir et développer ;
qu'obéissant à des motifs inimaginables, elle ose à la face d'un pays
se rendre coupable de la plus révoltante partialité, pour se suicider
ainsi de gaîté de cœur : voilà ce que nul homme que n'aveugle point la
passion, ne pourra croire, et que nous ne prendrons pas une peine
inutile à réfuter.
A quoi donc attribuer ces plaintes et ces accusations réciproques ?
Nous l'avons déjà dit, nous allons le dire encore, et nous ne cesserons
de le répéter jusqu'à ce qu'on nous ait entendu. Tout le mal vient de
la manière dont on procède aux achats. Ce que nous avons à dire à cet
égard nous semble une chose importante et que nous attachons grand prix
à voir bien comprise du lecteur, dont nous solliciterons l'indulgence
pour les négligences de style et les répétitions qui pourront nous
échapper dans notre désir de tout sacrifier à la clarté.
Nous commencerons par exposer comment se font les achats ; nous
expliquerons ensuite en quoi cette méthode prête à des erreurs, par
suite à des mécontentements, et, qui pis est, à des suppositions
malveillantes dont il est à peu près impossible d'apprécier le mérite.
Nous dirons par quels moyens il nous semble possible d'échapper à ces
inconvénients, et si nous parvenons à nous faire comprendre, nous
croirons avoir rendu service, — aux éleveurs en mettant un terme, sinon
à toutes, du moins à la plus grande partie des erreurs dont ils sont ou
se croient les victimes, — à l'administration, en rendant désormais
impossibles des accusations souvent injustes, quant au fonds et
toujours, quant aux motifs qu'on lui attribue, — au pays en général, en
rétablissant entre l'administration et l'industrie cet accord et cette
confiance qui devraient toujours exister entre elles, et dont elles ont
un égal besoin pour travailler de concert à l'amélioration chevaline,
cette branche si importante de la prospérité nationale.
Nous ne pensons pas qu'il existe au monde de matière plus difficile à
connaître que le cheval. Il n'en est pas sur laquelle même les plus
habiles tombent plus fréquemment dans des erreurs inexplicables ; il
n'en est pas sur laquelle les opinions soient plus divergentes ; il
n'en est pas qui soit susceptible d'autant de variations ; il n'en est
pas où il soit aussi difficile de discerner la bonne et la mauvaise foi
; il n'en est pas enfin qui, dans les transactions, ait donné lieu à
plus de plaintes plus ou moins fondées, à plus de défiances plus ou
moins excusables.
De là il est facile de conclure combien est délicat, et de quelles
précautions méticuleuses devrait être entouré le choix des étalons de
l'Etat, eux dont les qualités ou les défauts importent d'une telle
sorte au pays tout entier ; eux dont le prix élevé prête plus aisément
qu'aucun autre aux suppositions de la malveillance ou de la prévention.
Comment procède-t-on à cette opération difficile ?
L'époque venue, un agent de l'administration se transporte chez un
éleveur quelconque. On lui sort successivement au bout de la longe tous
les chevaux que renferme l'écurie. Abondamment nourris, enfermés depuis
des semaines, ces animaux, excités de toutes les manières, font tous
une montre également brillante. Par une étrange bizarrerie de la
nature, ce sont même presque toujours les plus médiocres qui sont les
plus forts à ce jeu. Ebloui par cette lanterne magique dont
l'exhibition dure plus ou moins longtems, l'acheteur rejette, achète et
s'en va, pour recommencer chez un autre. Ce qu'il a fait, nous ne
savons s'il en est bien sûr, mais nous gagerions volontiers que si on
lui représentait les mêmes chevaux sans le prévenir, il n'en
reconnaîtrait pas la moitié. Nous prions le lecteur de bien entendre
que ce que nous disons là, ne s'applique pas en particulier plus à un
individu qu'à un autre, mais bien à toute personne, sans nous excepter,
qui se trouverait obligée de procéder de la sorte.
Avec toutes les précautions imaginables, l'erreur est parfois
inévitable ; en opérant ainsi, c'est bien pis encore, Le public, qui ne
se rend pas compte des difficultés, ne se préoccupe que du résultat, et
crie à l'ignorance.
Mais si, parmi les éleveurs, il s'en trouve quelques uns qui, par plus
d'habileté, plus de hardiesse, plus de capitaux disponibles, ou par
toute autre cause, trouvent moyen de faire en sorte que la majorité des
choix tombe sur leurs écuries, aux yeux des autres l'erreur devient
plus que de l'ignorance, c'est la partialité.
Or, une des choses que pardonnent le moins les hommes, c'est l'injustice volontaire.
De là ces récriminations, ces plaintes qui se renouvellent chaque année, à l'époque des achats.
Mais qu'on se le persuade bien, tant que le mode d'achat ne sera pas
changé, ce ne seront ni de plus nombreux achats, ni l'emploi de sommes
plus considérables qui les feront cesser. La cause de l'irritation est
dans la partialité supposée, nullement dans le plus ou moins
d'importance de la somme dépensée : aucun d'eux n'est assez sot pour
faire un crime à l'administration de ne pas employer aux achats plus
qu'il ne lui est alloué à cet effet par les chambres. Que cette somme
soit insuffisante, ils en sont convaincus, et avec raison ; mais que ce
soit la faute de l'administration si elle n'est pas plus considérable,
ils savent bien le contraire. Ici cependant nous signalerons ce qui
nous semble un tort de la part de cette dernière, ou du moins de
quelques-uns de ses agents. On a cru plus d'une fois d'une bonne
diplomatie de ne pas annoncer de prime abord le montant exact de la
somme dont on pouvait disposer ; on a tenu en réserve quelque argent
mignon comme une surprise agréable ménagée aux éleveurs. L'intention
était bonne sans doute, mais la faute n'en était pas moins sérieuse.
Dans une semblable occurrence, il est d'une haute importance de jouer
cartes sur table, et de bannir toute espèce de réticence. Qu'on
accoutume les éleveurs à croire à la sincérité de la déclaration qui
leur aura été faite, et à ne jamais voir augmenter d'une obole la somme
qui leur aura été annoncée ; sitôt qu'elle aura été toute employée, ils
n'y penseront plus. Qu'on les habitue, au contraire, à en voir surgir
après coup une seconde dont il n'avait pas été question, il n'y a pas
de raison alors pour qu'ils ne croient pas à une mine inépuisable, et
n'accablent pas de leurs importunités, pour y puiser, une
administration dont les affirmations ayant une fois été reconnues
inexactes, aura perdu le droit qu'on la croie sur sa parole.
Nous venons d'exposer comment les achats, tels qu'ils se pratiquent,
donnent lieu à des plaintes quelquefois fondées, plus souvent encore à
des suppositions injustes. Les agents de l'administration possèdent-ils
du moins quelques moyens de se justifier et d'éclairer l'opinion ?
Qu'on en juge. Ils ont opéré seuls, entourés d'une sorte de mystère,
personne n'a été à même d'apprécier le mérite de leur manière d'agir ;
les chevaux achetés par eux vont, à une époque plus ou moins éloignée,
se livrer dans un lieu écarté où il ne se trouve personne que les
accusateurs et les accusés. Vingt voix s'élèvent contre eux, pas une ne
prend leur défense : et cependant quelquefois le bon droit est de leur
côté. Inutile de répéter ici ce que l'on a tant de fois dit au sujet de
la médisance et de la calomnie. L'esprit humain est ainsi fait, qu'il
croit toujours plus volontiers le mal que le bien, surtout quand il
s'agit d'hommes en place. Il est donc facile de comprendre quel écho
trouvent dans le pays des accusations dont personne n'est à même de
juger le fondement ou de démontrer l'injustice. A nos yeux, une telle
position n'est pas tenable, et nous plaignons sincèrement ceux qui s'y
trouvent.
Pour obvier aux divers inconvénients que nous venons de signaler, nous avions demandé, et nous demandons de nouveau :
Que les agents de l'administration séjournent plus long-temps dans le
pays ; — qu'ils prennent une connaissance plus approfondie des écuries
des éleveurs ; — que long-temps avant l'époque des achats ils se
fassent présenter et qu'ils examinent sérieusement les jeunes chevaux ;
— qu'ils éliminent dès-lors tous ceux qui leur semblent indignes d'être
livrés à la production ; — que les achats soient confiés à une
commission composée d'un inspecteur-général, de l'agent spécial et du
directeur de haras ou dépôt dans la circonscription duquel ils ont lieu
; — que les chevaux ne puissent être achetés avant d'avoir été
préalablement soumis à des épreuves sinon d'hippodrome, du moins
suffisantes pour s'assurer de leurs qualités ; — qu'enfin, loin de
paraître agir dans l'ombre, et rechercher les lieux écartés, l'on donne
au contraire aux réceptions une sorte d'apparat , et que l'on choisisse
à cet effet les localités qui, par leur position, donneront le plus de
chances d'y voir assister un public nombreux.
Quelques objections ont été faites à nos demandes. La plus sérieuse
était relative à la composition des commissions. On a dit que les
inspecteurs généraux devant contrôler les achats ne devaient pas y
participer ; que les directeurs de haras ou dépôts pourraient être
suspectés de partialité en faveur des produits de certains chevaux au
détriment des autres. Ces objections, nous devons le dire, ne nous ont
que faiblement ébranlé. Nous ne discuterons même pas la dernière, qui,
si elle était fondée, s'appliquerait au mode actuel, avec encore plus
de force qu'à celui que nous demandons. Quant au contrôle des
inspecteurs généraux, sur les achats, nous répondrons d'abord que,
faits par une commission telle que nous venons de l'indiquer, ce
contrôle deviendrait à peu près sans importance, surtout que la
publicité donnée aux réceptions, où l'opinion serait appelée à en
exercer un bien autrement puissent. Ensuite dans l'état actuel des
choses, à quoi peut conduire ce contrôle ? Comment ces inspecteurs
peuvent-ils juger du mérite des achats sans point de comparaison ? On
leur affirme qu'on a choisi ce qu'il y avait de mieux, comment
peuvent-ils s'assurer du contraire ? Leur contrôle dans un cas devient
donc illusoire ; dans l'autre il serait inutile.
Nous le répétons, nous ne voyons aucun motif qui s'oppose à
l'adoption du mode par nous proposé, et nous persistons à croire que de
toutes les opérations de l'administration des haras la plus importante,
sa vie, son essence, c'est le choix et l'achat des étalons ; qu'en
conséquence, ce choix et cet achat ne sauraient être entourés de trop
de précautions, ni confiés à des hommes trop haut placés. Cependant,
comme personne moins que nous ne se croit infaillible, nous nous sommes
demandé, en supposant le système des commissions inexécutable (ce qui,
nous le répétons, ne nous semble rien moins que démontré), ce que l'on
pourrait mettre à leur place. Voici ce que nous proposerions :
Nous supposons toujours, ce qui nous semble indispensable et
inobjectionable, si l'on veut nous passer ce petit accès de néologisme,
que l'agent a résidé une partie de l'année dans le pays, qu'il a pris
une connaissance approfondie des chevaux qu'il renferme, qu'il a
éliminé les plus médiocres, et qu'il a réduits à deux cents, par
exemple, le nombre de ceux parmi lesquels il devra en choisir soixante
ou quatre-vingt. Le moment des achats est arrivé. Pour y procéder d'une
manière satisfaisante, il lui faut - échapper aux erreurs dont ne sont
pas exempts les plus habiles, — bien réellement acheter les meilleurs
chevaux, et les payer en proportion de leur mérite, — convaincre les
éleveurs et le pays en général de la pureté de ses intentions et de son
impartialité.
Le moyen d'échapper aux erreurs, c'est de s'éclairer des lumières de
ceux qui en possèdent. Qu'il les appelle donc à lui ; que par
l'entremise des sociétés d'agriculture, par exemple, il se fasse
désigner deux ou trois personnes entourées de la confiance publique,
qu'il s'en forme un conseil dont il prendra les avis, en se réservant
d'ailleurs toute liberté d'agir d'après sa conviction.
Pour être certain d'acheter les meilleurs chevaux et de les payer en
proportion de leur mérite, il faut les pouvoir comparer, et la chose ne
se peut faire avec quelque chance de succès, qu'en les mettant en
présence. Il ne devrait donc jamais procéder aux achats définitifs et
aux classements chez les éleveurs ; m'ais après avoir désigné chez
chacun d'eux les chevaux qui lui auraient paru les plus convenables, il
les devrait réunir tous dans un lieu où il lui fût possible d'apprécier
leur mérite relatif.
Quant à convaincre les éleveurs de son impartialité et de la bonté de
ses choix, l'adjonction-du conseil ci-dessus, la publicité des
opérations en seraient de sûrs garants, et le dégageraient sous ce
rapport de toute espèce de responsabilité. Des erreurs, sans doute, ne
seraient pas encore matériellement impossibles, mais elles seraient peu
nombreuses, et bien évidemment involontaires, conséquemment sans
importance ; car, nous le répétons, la seule chose que l'homme n'excuse
pas, c'est la partialité, c'est l'injustice commise avec intention.
Dira-t-on que l'on ne trouverait pas d'hommes de quelque valeur qui
consentissent ainsi à jouer un rôle secondaire, et à donner des
conseils qui pourraient ne pas être suivis ? Ce serait une erreur, et
c'est ce qui se pratique journellement, au contraire, sur tous les
points du territoire, où nous voyons les représentants de l'industrie,
du commerce, de l'agriculture, de la propriété, appelés à formuler leur
avis sur les points qui leur sont soumis par l'autorité, qui n'en reste
pas moins libre d'agir comme elle le croit le plus avantageux pour le
bien du pays. Aussi ne doutons-nous pas que, dans le cas dont il
s'agit, il ne serait aucune des personnes désignées qui ne s'estimât
heureuse et honorée de remplir de semblables fonctions.
Ainsi donc, suivant nous, un acheteur des haras devrait séjourner dans
le pays pendant une notable partie de l'année ; prendre connaissance
des écuries des éleveurs, non pas en entrant par une porte et sortant
immédiatement par une autre, mais en examinant chaque cheval avec
attention, en le faisant sortir de temps à autre ; en le voyant monter
; enfin en usant de tous les moyens en son pouvoir, pour arriver à le
connaître à fonds. Il devrait, dans l'intérêt de tous, employer son
influence pour faire castrer tout animal chez lequel il reconnaîtrait
une inaptitude évidente à devenir étalon. En suivant cette marche, il
ne tarderait pas à connaître, de manière à ne point s'y méprendre, ce
qui devrait être acheté, ce qui devrait être rejeté. Cependant, par
surcroît de précaution, et plus encore pour mettre à jour sa manière
d'opérer, et s'épargner jusqu'à l'ombre du soupçon, il prendrait, lors
des achats définitifs, l'avis d'une commission composée des hommes qui
lui auraient été désignés par l'opinion générale, comme les plus
habiles. Ces achats définitifs seraient faits en présence de toutes les
parties intéressées, et de quiconque voudrait en être témoin.
En procédant ainsi, plus de soupçons, plus de plaintes, liberté
d'action complète. Que tous les chevaux soient pris dans la même main
ou dans cinquante, peu importe ; tout se passe au grand jour ; les
meilleurs sont choisis, tant mieux pour qui a su se les procurer !
Vainement quelque voix isolée qu'excite un intérêt déçu veut-elle se
faire entendre, la voix publique s'élève aussitôt pour lui imposer
silence.
Nous soumettons nos idées à l'administration avec d'autant plus de
confiance que ses bonnes intentions nous sont connues, ainsi que son
désir de faire droit à toutes les demandes raisonnables. Mieux placé
qu'elle pour juger certaines choses, nous lui pouvons affirmer qu'il
n'est rien de ce que nous réclamons qui ne soit d'exécution facile, et
qui ne fût accueilli avec des transports de joie par tous les éleveurs,
sans en excepter ceux-là même pour qui on lui suppose le plus de
partialité.
Qu'elle se garde surtout de croire trouver remède au mal dans un simple
changement d'individus. Ce ne serait là qu'un palliatif impuissant. Le
système lui-même doit être changé ; il en est temps ; il le faut. Sans
doute, dans plus d'une occurrence, les plaintes ont pu revêtir un
caractère personnel ; mais supposer que quiconque procédera comme on
l'a fait jusqu'à ce jour ne sera pas exposé aux mêmes fautes et aux
mêmes reproches, serait une erreur dangereuse. L'intérêt du pays, celui
de l'administration, sa considération même exigent qu'un semblable étal
de choses ait un terme, et nous aimons à croire que ce terme n'est pas
éloigné.
F. PERSON.
CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE.
QUESTION CHEVALINE.
§ 3. — AMÉLIORATION (Suite).
La conformation la plus favorable à l'extrême vitesse est en désaccord
avec celle du cheval de service. Prendre le coureur pour type
améliorateur de ce dernier, est donc, comme nous venons de le voir,
agir contre les premiers rudimens de la logique. A cela on répond que
le pur sang est indispensable à l'amélioration, et qu'il faut le
prendre n'importe sous quelle forme il se présente. D'accord ! Si cette
forme est la seule qu'il lui soit possible de revêtir, mieux vaut
encore le prendre ainsi que de s'en passer. C'est notre opinion. Mais
si nous supposons pour un moment que, mettant de côté les prévisions de
la course, l'éleveur du cheval de pur sang ne se préoccupe que des
besoins de la production, quelle marche pense-t-on qu'il suivra ? Celle
de tout homme qui veut obtenir un résultat ; celle qu'indique le sens
commun. Pour obtenir un coureur, il aurait accouplé l'étalon et la
poulinière les plus vites ; pour obtenir un producteur de chevaux de
service, il accouplera le mâle et la femelle dont les qualités et la
conformation seront le plus en harmonie avec celles du cheval de
service. En suivant, celle méthode pendant quelques générations, il
arrivera nécessairement avec l'aide d'un climat, d'un sol et d'une
nourriture convenables, à se procurer un cheval d'une taille et d'une
conformation analogues à celles que réclament nos besoins : et comme ce
cheval possédera en même temps la pureté de sang, le problème sera
résolu. Alors plus de tâtonnemens, plus d'accouplemens hétérogènes,
plus de mécomptes. Chaque genre de service aura ses producteurs de pur
sang nettement caractérisés, et l'éleveur qui les emploiera, sera sûr à
l'avance de ce qu'il en pourra attendre.
Pour base de cette race, devrons-nous prendre le sang arabe ou le pur
sang européen ? Nous l'avons déjà dit, nous aurions plus de confiance
au sang arabe. Comme pureté, il est plus près de la souche. Comme
conformation il se rapproche également davantage de celle que nous
devons rechercher. Celle dernière assertion fera sourire plus d'un
incrédule ; elle est cependant d'une exacte vérité. La symétrie des
proportions, l'accord de toutes les parties chez lui sont tels, que
pour réaliser à nos yeux le beau idéal de nos différents services, il
nous suffit de faire usage en le regardant, de verres plus ou moins
grossissants. Il sera suivant le degré cheval de selle, cheval de
guerre, cheval d'attelage. Qu'on emploie le même moyen à l'égard du
cheval de course, sous quelque volume qu'il apparaisse, il ne
représentera jamais qu'un coureur.
Cette admirable symétrie, nous dira-t-on peut-être, n'empêche pas le
cheval arabe d'être une espèce de miniature, et combien de générations
ne faudra-t-il pas, pour l'amener au volume requis ! — Combien de
générations ? Trois ou quatre ; cinq tout au plus. C'est une chose
presqu'incroyable que la rapidité avec laquelle la race arabe
transportée dans nos climats, voit se développer ses formes et sa
taille. Phénomène cependant d'explication facile pour qui ne perd pas
de vue la nature du sol de l'Arabie, sa température, le genre de
nourriture et de traitemens auxquels le cheval arabe est soumis dès sa
naissance. Quelques brins d'herbe desséchée par un soleil dévorant, peu
ou point d'eau, à de rares intervalles une poignée d'orge, telles sont
les influences sous lesquelles se développe la croissance du jeune
animal : qu'il devienne sobre, agile, vigoureux, la chose se conçoit ;
mais il est également clair qu'avec un pareil régime, il lui est
impossible de jamais acquérir des dimensions bien considérables,
surtout si l'on prend en considération les mauvais traitemens auxquels
il est en butte dès l'âge le plus tendre. Car il faut le dire, quelque
pénible qu'il soit de détruire de touchantes illusions ; l'amour de
l'Arabe pour son coursier, les caresses qu'il lui prodigue, le logement
qu'il partage avec lui, les pleurs qu'il répand quand il le voit mourir
, tout cela sans doute figure d'une admirable façon dans les ballades ;
malheureusement c'est une de ces mille niaiseries dont il est temps que
justice se fasse. Humbug est un mot qui nous manque ; c'est dommage.
L'Arabe aime son coursier. Oui sans doute ; c'est un objet d'une
immense utilité pour son service. — Il le loge dans sa tente. La raison
en est simple, il n'a pas d'écurie où le mettre ; et il craint en le
laissant dehors, qu'il ne se sauve, ou qu'on ne le lui vole, ou qu'il
ne soit mangé par les bêtes. — Il le regrette vivement quand il
meurt. C'est encore assez naturel ; il forme une partie essentielle de
son mobilier, et il est facile de comprendre qu'il n'ait guère envie de
rire en perdant un animal qui pouvait lui représenter une valeur de
plusieurs milliers de francs : il n'est pas besoin d'être arabe pour
cela , et c'est un genre de sensibilité qu'on pourrait trouver sans
aller aussi loin. Quant à cette tendresse de cœur, à cet amour
platonique dont on nous a bercés, c'est une autre affaire. Nous venons
de voir comme il est nourri ; voici comme il est traité. Monté dès
l'âge de dix-huit mois à deux ans, de ce moment la selle ne lui quitte
plus, pour ainsi dire, le dos. Les flancs déchirés par des étriers
tranchans comme des lames de couteau, la bouche fendue par un mors dont
les branches sont longues comme le bras, la pauvre bête parcourt
journellement sous son maître, des distances fabuleuses. Celui-ci
reste-t-il au camp, par hasard ; qu'on n'aille pas croire que le cheval
se repose : malheur à lui au contraire. Ce jour-là, c'est jour de fantasia.
De toute la horde, c'est à qui fera le plus d'extravagances. Lancés à
fond de train, ils vont, ils viennent, ils tournent, ils retournent, et
semblent surtout se disputer à qui mettra le plus de brutalité dans
l'emploi de la bride et des aides. Jamais de transition, jamais de
demi-temps ; veulent-ils arrêter, c'est à ce moment qu'ils appliquent
le plus durement les éperons, et qu'au milieu du nouvel élan de
l'animal, ils le clouent sur place par une saccade abominable qui le
jette sur les jarrets, et souvent l'estropie, si même elle ne lui rompt
les reins.
Qu'on le suppose élevé dans nos gras pâturages, recevant une nourriture
abondante, soigné, ménagé jusqu'à l'époque de son complet
accroissement, il est facile de comprendre quel développement de formes
il doit acquérir en peu de générations. Il y perd, la chose est
infaillible, de son agilité, de sa sobriété, de son aptitude à
supporter d'extrêmes fatigues ; mais nous n'avons ni voyageurs à
dévaliser, ni déserts à traverser, ni fantasia à exécuter.
Cependant si nous donnons la préférence au producteur arabe, ce ne
serait point à nos yeux un motif pour repousser surtout dans les
commencements, celui de pur sang européen. En le choisissant d'une
conformation satisfaisante, et en cessant de mesurer le mérite sur la
vitesse, on ne tarderait pas à en obtenir des produits convenables.
Mais il n'en faudrait pas moins former quelques familles de sang
purement arabe ; et nous sommes convaincus qu'elles ne tarderaient pas
à donner des producteurs de beaucoup supérieurs à tous les autres.
Nous ne nous dissimulons pas que plus d'une objection peut être faite à
notre système. Comme la recherche de la vérité est notre unique but,
nous allons les présenter sans rien atténuer de leur force ni de leur
importance.
Vous voulez, dira-t-on, prendre pour type le cheval arabe. Et les
Anglais qui l'avaient fait avant vous, trouvent la race qu'ils ont
créée tellement supérieure à lui, qu'aujourd'hui ils repoussent sans
pitié toute coopération de sa part ! A cela nous répondons qu'à leur
point de vue les Anglais ont raison ; mais que ce n'est pas un motif
pour nous de les imiter. En effet, le cheval arabe étant
incontestablement moins vite que le coureur anglais, pour qui recherche
avant tout l'extrême vitesse, c'est un défaut : mais comme ce défaut
est le résultat de l'ensemble, pour qui recherche avant tout la bonne
conformation et l'accord de toutes les parties, il devient une qualité.
Si nous demandons la vitesse chez le producteur, nous répondra-t-on,
c'est moins pour elle-même qu'en raison des causes auxquelles elle est
due. Pour que le cheval soit le plus vite, il faut que ses organes
essentiels aient acquis tant intérieurement qu'extérieurement le plus
haut degré de perfection ; et c'est là ce dont il est indispensable de
s'assurer. Or, les courses chez les peuples civilisés, remplacent ces
épreuves pénibles dont vous parliez à l'instant chez les Arabes ; elles
servent à classer le mérite relatif des individus ; elles débarrassent
des mauvais, et développent chez les bons, par suite des exercices
auxquels elles les obligent, leurs qualités innées.
Sans nul doute l'emploi de la régénération des races doit être confié
aux individus les plus près de la perfection. C'est un principe que
nous enseigne la nature elle-même ; et nous voyons les animaux les plus
inoffensifs, quand vient la saison des amours, se livrer des combats
acharnés dont le résultat est de réserver la propagation de l'espèce à
ceux qui sont le plus vigoureusement constitués. Il y a donc nécessité
absolue de nous assurer si les chevaux que nous destinons à la
production, possèdent toutes les qualités que réclament nos services.
Jusque-là nous sommes parfaitement d'accord avec nos adversaires. Mais
voici où nous différons. Ces qualités, dont nous avons besoin, sont de
plusieurs espèces : légèreté, vitesse, action ; sensibilité,
tempérament, vigueur, fonds ; force, carrure, volume, taille, ensemble
surtout. Cet exposé seul répond à l'objection. Si l'extrême vitesse est
une garantie de quelques-unes de ces qualités, elle est évidemment
incompatible avec plusieurs autres, et ce sont précisément celles dont
il nous est le moins possible de nous passer. Il nous est donc
nécessaire de recourir à d'autres moyens d'apprécier le mérite de nos
étalons, et ce que nous avons à constater, ce sont la qualité de leurs
allures bien plus que leur rapidité ; la solidité, le fonds, la
régularité bien plus que la vitesse.
Il ne sera point possible, nous objectera-t-on encore, d'apprécier
toutes ces choses dans une course. Qui vous dit le contraire ? les
courses ! C'est un chapitre que nous n'aborderons pas ici ; il nous
mènerait trop loin. Mais il est d'autres moyens plus rationnels et plus
sûrs de nous assurer de ce que nous voulons savoir. Tout étalon devra
être livré au genre d'exercice auquel sont destinés ses produits, et
subir de cette manière toutes les épreuves désirables. Quoique l'on
puisse dire, nous aurions plus de confiance dans un producteur de
chevaux d'attelage qui ferait douze lieues en trois heures, par exemple
sur un tilbury, et recommencerait huit jours de suite, que dans celui
qui aurait parcouru un hippodrome en deux minutes et quelques secondes
: et de même proportionnellement pour les autres services.
Mais, dira-t-on encore, sans contester l'utilité de semblables
épreuves, quel est l'homme qui voudra élever des chevaux pour les y
soumettre, du moment qu'il n'y sera pas excité par l'appât de prix de
courses, et l'entraînement de l'amour-propre ?
Répondrons-nous sérieusement à une semblable objection ? A qui est-il
nécessaire de dire que ce système à peine adopté, le nombre des
éleveurs de chevaux de pur sang serait immédiatement décuplé ; et que
le seul obstacle qui s'y oppose dès aujourd'hui, est précisément la
nécessité de les faire paraître sur un hippodrome, et de passer par les
mains des entraîneurs et des jockeys ?
D'ailleurs, c'est dans une telle occurrence surtout qu'une
administration des haras peut rendre d'immenses services. N'ayant à
s'inquiéter ni des frais ni de la dépense, sans autre préoccupation que
de procurer au pays des types de reproduction convenables, elle
marcherait d'un pas ferme et sûr vers un but qu'elle ne saurait manquer
d'atteindre en peu de temps.
Pour résumer en peu de mots ce paragraphe beaucoup plus long que nous l'aurions voulu, disons :
Que la population chevaline se divise en deux grandes familles ; les
chevaux de trait dont le type est le cheval percheron ; les chevaux de
luxe, dont le type est le cheval arabe, grandi et grossi par
l'influence des accouplemens, du climat et de l'alimentation :
Que l'amélioration des premiers ne réclame rien autre chose que le
choix parmi eux, et l'accouplement des individus les plus parfaits :
Que l'amélioration des seconds exige le secours d'une race de pur sang
, dont les individus soient appropriés aux différentes branches de
service de luxe et de l'armée :
Que celte race de pur sang est encore à créer, et ne doit pas être confondue avec le cheval de course.
F. PERSON.
(La suite au prochain numéro).
*
* *
Tome III. - 3e année. - 9e livraison. - mars 1846.
CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE.
QUESTION CHEVALINE. (Suite et fin.)
§ 4. — ENCOURAGEMENS
Il n'existe à proprement parler, qu'un encouragement digne de ce nom,
c'est un débouché avantageux et régulier. Cependant il en est d'autres
qui, sans être à beaucoup près de la même importance, peuvent
contribuer subsidiairement à l'accomplissement de l'œuvre. Telles sont
les primes accordées aux producteurs des deux sexes, doués de la
meilleure conformation, et les prix de course ou primes aux mêmes
producteurs doués des qualités les plus remarquables. Pour être
réellement utiles, il faut que ces deux espèces d'encouragements
marchent de front ; et quiconque voudra par elles exercer une influence
salutaire, ne devra jamais décerner de primes qui ne soient
accompagnées d'épreuves, de prix de course qui puissent être disputés
par d'autres que des animaux d'une conformation satisfaisante. Inutile
d'ajouter que par courses, nous entendons quelque chose d'un peu
différent de ce qui se pratique aujourd'hui, et que pour nous ce mot
signifie un système d'épreuves au trot ou au galop, en rapport avec la
spécialité des concurrents.
Au demeurant, nous le répétons, ce sont là des encouragements
secondaires ; nous pourrons nous en occuper, mais plus tard. Pour le
moment, ce qui doit absorber notre attention, ce qui forme la pierre
angulaire de l'édifice, c'est le débouché. Existe-t-il ? s'il existe,
quels sont les moyens de le rendre avantageux et assuré ? C'est ce qui
nous reste à examiner.
§ 5. - VOIES ET MOYENS.
Le débouché existe : c'est un fait avéré. Nous avons évalué à trente
mille chevaux la consommation annuelle du luxe et de l'armée. Que la
fourniture en soit assurée à la production indigène à des conditions
avantageuses et elle ne tardera pas à atteindre ce chiffre qui
est suffisant pour faire face aux éventualités. Pourquoi ce débouché ne
lui présente-t-il en ce moment ni la sécurité, ni le profit convenables
? C'est qu'elle rencontre sur les marchés la concurrence de la
production étrangère qui, par des causes inutiles à détailler ici, se
trouve dans des circonstances plus favorables, et par suite lui enlève
la fourniture du luxe, c'est à dire des trois quarts de la consommation
; et qu'enfin le surplus ne lui est pas suffisamment payé.
Comment obvier à ces inconvénients ? — Le gouvernement seul le peut. Il
peut exercer sur le débouché deux sortes d'influences : l'une directe,
en achetant pour son propre compte ; l'autre, indirecte, en frappant la
production étrangère d'un droit assez élevé pour forcer les
consommateurs à s'approvisionner a l'intérieur.
Exerce-t-il cette double influence d'une manière rationnelle et efficace ? Nous ne le pensons pas.
Son intervention directe consiste à acheter par l'entremise des dépôts
de remonte, les chevaux dont il a besoin pour la remonte de l'armée, à
des prix fixés par lui, et de beaucoup au-dessous en général de ce
qu'ils devraient être pour devenir un encouragement.
Son intervention indirecte se traduit en un droit de vingt cinq francs par tête d'animal importé !
Nul plus que nous ne rend hommage à la manière intelligente, éclairée,
bienveillante, paternelle dont les dépôts de remonte sont dirigés, si
nous en jugeons du moins par celui que nous avons sous les yeux. Nous
n'en saurions pas moins nous dissimuler qu'il existe à ce mode d'opérer
des inconvénients que rien ne peut compenser. Ils ont été signalés à
tant de reprises, que nous croyons inutile d'en rappeler la longue
nomenclature, et nous ne nous occuperons que d'un seul, l'un des plus
graves, il est vrai : nous voulons dire l'éloignement du commerce. Or,
le commerce éloigné, la remonte devient le seul débouché de la
production, et comme celte dernière tend toujours à prendre le niveau
de la consommation, et que d'un autre côté l'armée n'éprouve pas
toujours les mêmes besoins, il en résulte nécessairement une
perturbation et des tiraillemens continuels ; tantôt impossibilité de
satisfaire de pressantes exigences, tantôt encombrement ruineux. Que
d'une part l'armée vienne à subir des réductions, ou fasse moins de
pertes, la production se trouve aussitôt sans débouché ; que d'autre
part, ce qui est bien autrement sérieux, l'éventualité d'une guerre
nécessite dans un bref délai, de doubler, de tripler l'effectif, le
pays ne présente aucune ressource. On propose, il est vrai, de faire
acheter annuellement par l'armée , besoin ou non, la même quantité de
chevaux ; ce serait une amélioration, sans doute, mais sans parler de
la dépense qu'elle occasionnerait, il est évident qu'elle ne pourrait
jamais s'appliquer qu'au pied de paix et opérer sur quelques centaines,
quelque milliers de chevaux tout au plus ; tandis que pour subvenir aux
nécessités d'une guerre, c'est par dixaines, par centaine de mille
qu'il faut procéder. Où les prendre ? Le commerce seul, en leur offrant
un débouché régulier peut engager à les produire. Mais pour cela il lui
faut ses coudées franches. Si dans l'intérêt général, on lui interdit
les achats à l'extérieur, il faut du moins qu'à l'intérieur le marché
soit libre pour lui, et qu'il n'y rencontre pas sur tous les points une
concurrence contre laquelle il n'est pas pour lui de lutte possible.
Ainsi donc dans l'intérêt même de l'armée, et pour lui assurer le moyen
de trouver dans le pays, à toutes les époques, à satisfaire ses besoins
en dehors des prévisions ordinaires, ce n'est pas assez qu'elle s'y
recrute d'une manière constante et régulière ; il faut encore que le
commerce puisse à côté d'elle offrir aux producteurs un débouché assuré
d'une quantité double et même triple de ce qu'elle consomme ; quantité
qui dans des cas imprévus, deviendrait pour elle une ressource
précieuse. Mais pour que le commerce puisse prendre un pareil essor, il
faut la délivrer de toutes entraves ; il faut qu'acheteurs et vendeurs
se remontent sur le marché dans une position identique, et dans des
conditions de liberté et d'égalité absolue. C'est ce qui ne peut être
avec l'organisation actuelle de dépôts de remonte : et l'on ne rendra
la vie au commerce qu'en le débarrassant du monopole actuel, et en
réduisant l'armée au niveau des autres consommateurs.
En conséquence, suppression des dépôts de remonte ; achat des chevaux
de troupe par les corps, à des prix suffisamment rémunérateurs ; achat
des chevaux des officiers par ceux-ci moyennant contrôle : telle serait
dans notre opinion, le mode d'action directe, le plus avantageux de la
part du gouvernement.
Il est bien entendu que nous ne parlons ici que dans la supposition
d'obstacles sérieux apportés à l'introduction étrangère ; car tant que
les choses resteront sur le pied actuel, les dépôts de remonte, malgré
leurs inconvéniens, sont pour quelque temps du moins notre ancre de
miséricorde, et le dernier débouché certain qui reste à la production
indigène.
Quant aux obstacles à l'importation étrangère, ils nous semblent la
chose du monde la plus simple, et consisteraient dans l'élévation
progressive du droit d'entrée, jusqu'à ce qu'il eût atteint le taux
nécessaire pour être efficace. Cette élévation progressive aurait le
double avantage de préparer par degrés la production à se mettre en
état de suffire aux besoins ; d'empêcher la consommation d'éprouver de
trop vives secousses.
A cette élévation de droit, deux objections se présentent ; l'une basée
sur la répulsion qu'inspirent aujourd'hui les droits protecteurs et les
prohibitions, et sur le besoin éprouvé par les peuples d'abaisser les
barrières qui les séparent encore ; l'autre sur la difficulté et même
l'impossibilité d'empêcher la fraude, du moment où elle sera stimulée
par l'espoir d'échapper au paiement d'un droit élevé.
A la première de ces objections, nous répondrons qu'en thèse générale,
rien n'est plus désirable sans doute que de voir les peuples se
rapprocher et ne former pour ainsi dire qu'une grande famille ; que
s'il est nécessaire pour atteindre ce philanthropique résultat, de
lever toutes les restrictions ou prohibitions qui frappent des objets
d'un intérêt secondaire, il n'y a pas à hésiter ; mais que l'expérience
de tous les siècles nous démontre qu'il n'est pas de famille si bien
unie qu'il n'y éclate des querelles de tems à autre ; et que les
nations sont journellement exposées à voir sous les plus futiles
prétextes, leurs bonnes relations interrompues, et les horreurs de la
guerre succéder aux douceurs de la paix. La prudence exige donc que
certains objets indispensables comme moyens d'attaque ou de défense,
soient le sujet constant de la sollicitude des gouvernements, et qu'ils
prennent tous les moyens nécessaires pour que le pays les produise en
quantité et en qualité telles qu'il puisse suffire à tous les besoins
et à toutes les éventualités, et ne se trouve pas conséquemment à la
merci de voisins qui peuvent être précisément ceux-là même qu'il peut
avoir à combattre. Au nombre de ces objets, et évidemment au premier
rang se trouve le cheval ; et du moment où il est reconnu que la
production indigène se trouve hors d'état de résister à la concurrence
étrangère, le devoir impérieux de tout gouvernement sensé est de lui
venir en aide à tout prix, car ce n'est pas là une question de système
, mais bien une question de vie ou de mort.
Pour ce qui est delà prétendue impossibilité d'empêcher la fraude,
c'est une fantasmagorie qui s'évanouit devant le plus léger examen.
Sans doute, tant qu'il suffira qu'un cheval ait franchi la ligne idéale
qu'on appelle frontière, pour qu'il soit considéré comme français, il
sera fort difficile, pour ne pas dire impossible, de s'opposer à la
fraude ; mais il en serait de même pour toute autre marchandise frappée
de prohibition ou de restriction ; aussi a-t-on grand soin dans ce cas
de la soumettre à un droit de suite. Qu'il en soit de même pour le
cheval, à l'instant la fraude cesse d'être possible ; car de toutes les
marchandises, c'est la plus difficile à cacher.
A cet effet, il suffit que le marchand soit tenu à toute réquisition de
l'autorité compétente, de faire connaître les noms et adresses de ceux
qui lui ont vendu les chevaux que renferment ses écuries, ainsi que
l’époque où ils y sont entrés.
Que lorsqu'il expédie des chevaux dans une direction quelconque, il
soit obligé d'en déclarer le nombre, la route qu'ils suivent, le lieu
où ils se rendent, le nom du destinataire.
Que le conducteur de ces mêmes chevaux soit muni d'une feuille de route
relatant ces divers renseignemens, et qui devra être visée dans toutes
les localités où se trouvent des bureaux d'octroi, et être exhibée sur
la réquisition des agens de l'autorité.
Ces précautions fort simples et qui ne sont guère que la répétition de
ce qui se pratique pour les autres bestiaux, n'occasionneraient ni
frais ni dérangement, et n'apporteraient aucune entrave au commerce.
Elles suffiraient cependant pour rendre à peu près impossible la fraude
commerciale : quant à la fraude individuelle, elle ne pourrait jamais
avoir une grande importance.
Une fois cet obstacle élevé à l'importation étrangère, la production
indigène ne tarderait pas à prendre un essor proportionné au débouché
qui lui serait ouvert. Alors le gouvernement, pour seconder cet essor
d'une manière complète, et donner à l'industrie tout le développement
dont elle est susceptible, devrait agir à son égard, comme nous avons
demandé qu'il le fît à l'égard du commerce ; c'est-à-dire cesser de lui
faire concurrence avec ses dépôts d'étalons. Dans ce cas,
l'administration des haras bornerait son action à procurer au pays,
soit en les achetant, soit en les créant elle-même, les types
réellement améliorateurs, capables de donner des producteurs des deux
sexes, et qui par leur prix élevé sont au-dessus des moyens de
l'industrie privée. De plus, elle primerait entre les mains de
celle-ci, les producteurs ordinaires ; mais d'une manière assez
libérale et assez éclairée, pour être réellement un encouragement
sérieux à l'amélioration. Au demeurant, nous répétons à cet égard ce
que nous avons dit au sujet des dépôts de remonte : c'est que l'on ne
peut songer à la suppression des dépôts d'étalons, qu'autant qu'elle
deviendra la conséquence d'un ensemble de mesures qui présentent à
l'industrie, tant au point de vue de la production, qu'à celui du
commerce, un débouché sur et avantageux ; jusque-là leur suppression
serait une calamité de plus.
En terminant, répétons, car on ne saurait trop le redire : Considérer
la production chevaline seulement comme une branche plus ou moins
importante des industries agricole et commerciale, serait plus qu'une
erreur et entraînerait les conséquences les plus désastreuses. Il n'est
pas permis d'oublier un seul instant qu'elle est une des bases sur
lesquelles reposent la puissance et la sécurité du pays.
Que la France reste hors d'état de suffire aux besoins de sa cavalerie,
et à la première guerre, elle déchoit du haut rang qu'elle occupe parmi
les nations.
Aujourd'hui après trente ans de repos, elle produit à peine assez pour satisfaire les modestes exigences d'une paix profonde.
Pour pouvoir répondre aux éventualités de la guerre, elle devrait produire annuellement trois fois davantage.
Elle ne le peut qu'au moyen d’un débouché régulier et avantageux.
La consommation particulière seule est capable de lui fournir ce débouché.
En ce moment, la totalité de cette consommation s'alimente à l'étranger
dont la production se trouve dans des circonstances plus favorables que
la production indigène.
Tant que cette concurrence déplorable ne sera pas repoussée du marché
intérieur, par des droits suffisamment élevés, il n'y aura ni primes,
ni courses, ni encouragemens, ni phrases sonores qui tiennent : la
production indigène se nivellera sur la quantité que lui enlèvera
régulièrement le pied de paix de l'armée, et au premier coup de canon,
la France devient une puissance de troisième ordre. Est-ce là le
résultat qu'on veut obtenir ? Ainsi posée, la question devient des plus
simples, et tout gouvernement qui, faute d'intelligence ou de bonne
volonté, refuse de la résoudre, mérite d'être mis au ban de la nation.
F. PERSON.
P. S. Nous apprenons que
la commission permanente a décidé que le congrés central s’occuperait
dans la session de 1846 encouragemens et de la direction à donner à la
production et à l'amélioration des espèces chevaline, bovine et ovine.
Telle serait dans notre opinion la marche à suivre :
Déclarer d'abord de la manière la plus formelle que la question
chevaline est complètement distincte de toutes les autres, et ne
saurait, sans danger, être considérée comme une simple question
agricole ou commerciale,
Qu'elle se rattache au contraire aux plus chers intérêts de la France,
Qu'en ce moment la production du cheval propre au service de la
cavalerie, ou cheval de luxe peut à peine satisfaire aux besoins de
l'armée sur le pied de paix,
Que pour faire face aux nécessités du pied de guerre, il ne faudrait
pas moins d'une production triple de ce qu'elle est aujourd'hui ,
Que cette production ne peut s'obtenir sans un débouché régulier et avantageux,
Que la consommation privée peut seule fournir ce débouché,
Qu'aujourd'hui celle consommation est entièrement alimentée par la
production étrangère qui se trouve dans des conditions plus favorables
que la production indigène,
Que celle-ci ne peut atteindre le développement nécessaire pour suffire
à la consommation intérieure, qu'autant qu'elle aura été délivrée,
pendant une assez longue période, de la concurrence étrangère,
Que lorsqu'il s'agit du salut même de l'Etat, toute autre considération doit disparaître,
Qu'en conséquence le congrès est d'avis,
Qu'il y a danger dans la position actuelle de l'industrie chevaline en France,
Qu'il y a urgence de la modifier,
Que sans nul délai, l'on doit recourir aux moyens de la développer de
manière à ce qu'elle puisse suffire non-seulement aux besoins
ordinaires, mais encore aux besoins extraordinaires de la cavalerie,
Que le principal de ces moyens, et même le seul réellement efficace,
est de réserver à la production indigène, le marché intérieur en ce
moment envahi par la production étrangère,
Que ce résultat ne saurait être atteint qu’en frappant celle-ci d’un
droit qui s’élèvera progressivement jusqu’à ce qu’il est atteint le but
désiré,
Que ce premier pas une fois fait, c’est alors qu’il sera à propos de
s’occuper des encouragemens secondaire qui jusque là seraient sans
objet,
Que la seule chose à faire en ce moment est donc de supplier le
gouvernement qu’il veuille bien frapper l’introduction des chevaux
étrangers d’un droit progressif, et soumettre le commerce des chevaux
aux précautions nécessaire pour mettre obstacle à la fraude.
F.P.
HORTICULTURE. — DE LA TAILLE DES ARBRES.
Quelle que soit la forme des arbres, la taille est toujours la même.
Pour atteindre un but unique, il n'y a pas deux méthodes : aussi tous
les arbres sont-ils assujettis à la même taille, sauf de légères
modifications qui s'appliquent aux formes plutôt qu'aux espèces.
Ainsi la taille de la vigne — j'espère le démontrer — est la même que
celle du pêcher, celle-ci la même que celle du poirier, celle de
l'abricotier semblable aux deux premières, etc., et comme une méthode
devient plus facile en se simplifiant, du moment où j'aurai établi
qu'il n'y a véritablement qu'une taille ayant un objet unique, j'aurai
considérablement diminué les embarras naissant des théories qui
traitent et de chaque arbre et de la taille de chaque arbre en
particulier. Ce que je désire surtout, c'est faire comprendre d'une
manière nette et précise la taille telle qu'elle doit être entendue et
exécutée.
Le Poirier. Il y a dans le poirier comme dans toutes les espèces d'arbres fruitiers deux sortes de branches : les branches à bois, formant ou destinées à former les branches charpentières, et les branches à fruit.
Les branches charpentières
sont, ainsi que leur nom l'indique, celles qui établissent les
principales ramifications de l'arbre. Ces sortes de branches se
ressemblent dans tous les arbres ou du moins ayant à y remplir les
mêmes fonctions, elles ne doivent et ne peuvent différer que dans leur
forme, ou dans leur distance, ou dans leur position relative, ou dans
leur force. Elles s'obtiennent de la même manière et sont, pour
l'ordinaire, le produit d'œils choisis à des places et distances
raisonnées, pour former l'ensemble de l'arbre. Ainsi, on doit, avant de
commencer la taille, se bien fixer sur la forme que l'on veut donner
aux arbres à opérer.
Arbres en pyramides. La
pyramide, ainsi que tous les arbres, se compose d'une partie primitive
ou point de départ, appelée tige, qui commence à l'endroit où les
racines sont insérées. Cette tige forme l'axe principal de la pyramide
et porte les branches charpentières existant tout autour, depuis la
base jusqu'au sommet. Ces branches qui ont, à cause de leur position
sur les côtés, recule nom de branches latérales, portent les branches à
fruit. Prise isolément, chaque branche latérale doit ressembler à une
branche charpentière d'espalier, c'est-à-dire être à peu près droite et
se terminer par un rameau destiné à faire son prolongement.
La tige doit être terminée également par un rameau vigoureux appelé flèche.
La forme pyramidale est celle qui convient le mieux aux arbres plantés
en plein vent ; elle l'emporte de beaucoup sur les quenouilles surtout,
parce que, sur ces derniers, les branches de la partie supérieure ou au
moins de la partie moyenne étant aussi longues et souvent plus longues
que celles de la partie inférieure de l'arbre, celles-ci ne jouissent
que peu ou point des influences bienfaisantes de l'atmosphère,
puisqu'elles ne peuvent recevoir les pluies, les rosées, les
brouillards et même les rayons solaires, interceptés par les branches
supérieures. Dans la forme pyramidale au contraire, les branches
inférieures étant plus longues que celles de la partie moyenne,
celles-ci plus longues que celles de la partie supérieure, toutes par
conséquent peuvent jouir à la fois de l'action favorable de
l'atmosphère.
1re taille. Si l'arbre dont on
veut faire une pyramide est pris à l'état de rameau, c'est-à-dire au
moment où il n'a encore qu'un seul scion de l'année, il devra être
raccourci près du point où l'on désire obtenir les premières
ramifications (ce qui ne devra jamais être à moins de 0 m. 20 c. du
sol). On doit s'assurer d'un œil bien apparent, bien sain, devant
donner un bon bourgeon qui remplacera la partie de rameau dont on fait
la suppression, pour obtenir le développement des œils latéraux placés
là où l'on veut des branches charpentières latérales. Lors du
développement de tous ces œils, qui peuvent se trouver plus ou moins
nombreux, on devra les surveiller, et si, comme il arrive souvent, ceux
qui sont voisins de l'œil destiné à faire le prolongement ou flèche,
paraissaient prendre un développement tel qu'ils seraient aussi forts
ou plus forts que cette flèche, on devrait casser avec le bout des
doigts ou couper avec les ongles leur extrémité seulement, pendant
qu'elle est encore petite et herbacée ; c'est ce qui s'appelle faire le
pincement.
2me taille. Si l'arbre, au
lieu d'être pris à l'état de bourgeon ou rameau, a été bien choisi dans
la pépinière, ainsi que nous l'avons dit (Tome 2, p. 125), on devra
commencer par tailler le rameau terminal, qui est le résultat du
développement de l'œil près duquel la première taille avait été opérée.
On procède ainsi afin de forcer les œils latéraux à se développer en
même temps que cet œil qui doit faire la flèche. Cette flèche sera
traitée tout-à-fait comme nous l'avons dit pour la 1re taille,
c'est-à-dire coupée près d'un bon œil capable de bien continuer la
tige. Après s'être occupé de cette dernière ou de ce qui doit être son
prolongement, on passe aux bourgeons latéraux réservés pour faire les
branches charpentières latérales. On les taille à leur tour sur un œil
placé en dehors du rameau et qui devra devenir rameau de prolongement
de la branche à laquelle il est attaché ; toutes les branches devront
être opérées de la même manière ; mais surtout que l'on ne perde pas de
vue que, sur la flèche comme sur les branches, les rameaux, suite des
œils, seront toujours portés à se lancer du côté où se trouvait l'œil.
En conséquence, il convient, chaque année, de choisir sur la flèche un
œil du côté opposé à celui qui avait été adopté l'année précédente,
afin que si la flèche, une année, s'est jetée d'un côté, elle soit
ramenée vers son point de départ, l'année suivante, condition
nécessaire pour conserver à la lige sa ligne droite.
Surveillance d'été. —
Après avoir, comme la première année, taillé le rameau terminal, il
arrive fréquemment que les œils voisins de celui sur lequel on comptait
pour faire une flèche qui sera le prolongement de celle qui, par le
développement des œils latéraux, est devenue axe ou tige, se montrent
plus vigoureux que ces bourgeons d'extrémité : dans ce cas, ces œils
devront être pincés de nouveau, comme nous l'avons dit.
Enfin, à leur tour, les branches latérales, comme la tige, se chargent
tout autour de branches qui doivent être petites et prendre le
caractère de branches à fruit. Pour les y forcer, il faut, après avoir
taillé les branches latérales sur des œils en dehors, surveiller ceux
qui partiront sur cette partie, ne laisser développer que ceux qui sont
nécessaires pour faire la charpente de l'arbre , et pincer tous les
autres, sitôt qu'ils ont acquis une longueur de dix à douze
centimètres, à moins que ces bourgeons ne paraissent faibles et peu
susceptibles de former une branche vigoureuse. La taille des branches
latérales sera d'une longueur telle que celles du bas soient toujours
plus longues que celles du haut, afin de conserver la forme pyramidale,
en observant encore que les branches fortes doivent être taillées plus
court que les plus faibles ne doivent pas même être taillées.
Si la taille et le pincement ont été bien observés, à la 3année, nous aurons déjà un arbre dont la pyramide sera formée.
3e taille. A la 3e taille,
comme aux première et 2e, on devra commencer par s'assurer d'une flèche
bien droite et bien établie sur l'axe de la tige, puis la couper
environ au tiers de sa longueur, sur un œil placé de manière à ce que
le bourgeon, qui en sortira soit bien sur cet axe. Si l'un des œils sur
lesquels on comptait pour faire une des branches latérales ne s'était
pas développé ou eût été accidenté, on ferait au-dessus de cet œil une
incision transversale sur la branche, afin de partager les fibres de
continuité qui portent la sève de la base à l'extrémité, de telle sorte
que l'œil se trouvant placé comme sur l'extrémité de ces fibres,
reçoive une partie de cett sève qui était destinée aux parties
supérieures, et prenne ainsi son développement. A cette troisième
taille, les branches latérales du haut, encore à l'état de rameaux, se
tailleront comme l'année précédente : celles qui déjà ont été taillées
un an auparavant le seront de nouveau ; le rameau terminal sera coupé
environ au tiers de sa longueur, sur un œil en dehors, afin que chacune
des branches aille toujours en s'écartant de la tige et qu'elles ne se
confondent pas les unes dans les autres. Il faut qu'il soit facile de
passer le bras entre chacune des branches sans toucher les nourrices ou
branches à fruits portées par elles. La tige devra, chaque année, ainsi
que les branches latérales, être taillée dans le but, indiqué plus
haut, de former toute la charpente. A mesure que les branches latérales
s'allongent, le rayon s'agrandit et leur extrémité se trouve
respectivement de plus en plus distante ; on doit alors faire ramifier
celle-ci, et au lieu de choisir seulement un œil, en dehors pour y
établir sa coupe, on en choisira deux, placés de telle manière que les
bourgeons qui en seront le résultat soient de chaque côté de la branche
et se présentent horizontalement et jamais au-dessus les uns des autres
; ce qui a pour but d'éviter la confusion avec les branches
supérieures, et d'empêcher qu'un des bourgeons ne soit plus vigoureux
que l'autre.
B RANCHES A FRUITS. — Toutes les branches qui se
développeront sur les parties que nous venons de voir, devront faire
des branches à fruit et ne jamais prendre assez de force pour faire des
rameaux vigoureux. Autrement il serait facile de les arrêter par le
pincement. Les branches à fruit sont de trois sortes : 1° celles que le
pincement a réduites à cet état, 2e les brindilles ou petits rameaux
qui, faibles et grêles, n'ont été laissées que comme branches à fruit —
leur longueur peut atteindre 20 à 25 centimètres : elles sont souvent
arquées et maigres dans presque toute leur longueur ; 3° les dards,
petits rameaux très-courts, placés sur les branches tout-à-fait à angle
droit : ils ont l'aspect d'un ergot de coq. Les dards ne devront
éprouver de taille que lorsque l'arbre déjà âgé sera chargé de fruits,
et quand, ces dards eux-mêmes ayant déjà fructifié, il aura multiplié
ses extrémités. Alors seulement, afin de tenir la fleur et par suite le
fruit rapproché de la branche, on ravalera toujours sur le petit rameau
dard lui-même qui s'en trouvera le plus près. Les brindilles sont les
parties qui les premières se mettent à fruit ; mais il faut se garder
d'opérer ni coupe ni cassement comme le conseillent certains auteurs.
On ne devra les raccourcir que lorsque l'arbre sera à fruit dans toutes
ses parties. Dans ce cas, la taille consistera à raccourcir ces
branches près de l'œil ou petit dard, le plus près de la branche
charpentière. Les branches à fruit obtenues ou du moins réduites à cet
état par le pincement, ne devront, de même que les branches brindilles,
être taillées qu'après que l'arbre sera arrivé à fruit, à moins que ces
branches très-vigoureuses n'aient donné plusieurs bourgeons à la place
du bourgeon pincé. Alors on devra couper les plus éloignés de la
branche.
MANOURY, professeur d'horticulture.
(La suite au prochain numéro).
*
* *
Tome III. - 3e année. - 10e livraison. - avril 1846.
 |
BŒUF GRAS (Cotentin
pur), âgé de 36 mois, pesant 778 kilog., appartenant Mr Cornet, a
obtenu au concours de Poissy une prime de 800 Frs et la médaille
d'argent (3e catégorie).
Dessiné à l'abattoir du roule le 11 avril 1846, d'après nature.
|
ÉPIZOOTIE. — LA COCOTTE.
La maladie épizootique, désignée sous le nom de Cocotte,
qui, à diverses époques, et la dernière fois de 1840 à 1842, a régné
dans toute la Normandie, s'est déclarée de nouveau dans le Calvados,
depuis deux mois environ. Elle n'attaque pas les bêtes à cornes
seulement ; les porcs sont aussi très-maltraités dans quelques contrées
Dans ses précédentes invasions, la Cocotte,
que l'on croit originaire de l'Allemagne, s'étendait de l'Est à
l'Ouest, et ne nous arrivait souvent que long-tems après avoir affligé
les départemens de l'Est ou du Nord-Est. De cette fois, elle nous est
arrivée du Sud-Ouest, par les bestiaux achetés dans les foires de la
Sarthe, de Maine-et-Loire, etc. Hâtons-nous de dire aussi que cette
maladie ne se présente pas avec la gravité qu'elle avait lors de ses
premières invasions : comme toutes les affections qui reparaissent
périodiquement ou du moins plusieurs fois dans une contrée, celle-ci a
perdu de son intensité, à mesure qu'elle a pris un caractère endémique
plus marqué.
Telle qu'elle existe en ce moment, elle occasionne cependant des pertes
réelles, car elle enraye les transactions ; elle force de laisser en
route une partie des animaux que l'on amenait dans les herbages, et
retarde l'engraissement de ceux qui s'y trouvaient. Mais c'est
principalement à l'égard des vaches laitières qu'elle a des résultats
fâcheux, car celles qui sont attaquées, surtout si l'affection se porte
aux mamelles, donnent moins de lait, non-seulement pendant la maladie,
mais même après qu'elles sont rétablies, et le rétablissement complet
est long quelquefois. La cocotte, du reste, n'est pas mortelle, et la
guérison se fait généralement de dix à quinze jours après l'invasion.
Lors de la dernière apparition de la Cocotte dans le pays, c'est-à-dire
de la première invasion qu'elle ait faite dans les herbages du Bessin,
M. Vigney, vétérinaire à la Cambe, qui, dans sa clientèle nombreuse,
eut occasion d'étudier l'épizootie sous toutes ses faces, rédigea, sur
cette maladie, un mémoire pour lequel la Société d'Encouragement pour
l'industrie nationale lui décerna une médaille d'argent. De son côté,
la Société d'Agriculture de Bayeux a fait imprimer et distribuer le
mémoire de M. Vigney, afin de faire profiter le pays, si la maladie
venait à y reparaître, des conseils de cet habile observateur.
Le retour de cette épizootie à des périodes assez rapprochées, donne à
ce travail un caractère d'utilité que l'on ne peut méconnaître.
Les causes de la maladie paraissent difficiles à apprécier, et il reste
établi pour M. Vigney que les influences atmosphériques ne sont pour
rien dans son développement, pas plus que la qualité des fourrages, ni
même les causes locales. Ainsi, l'année 1840 avait été froide et sèche,
celle de 1841, froide et humide. Cependant la maladie s'est montrée
indistinctement à toutes les époques de ces deux années ; et, dans tous
les lieux, on l'a vue au même moment, sévissant avec une égale
intensité sur le bord de la mer, dans la plaine et dans les marais. La
neige, la pluie, la sécheresse, le calme et les vents, tout paraissait
propice à son développement. Marchant tantôt régulièrement, d'autres
fois inégalement, on pouvait, pour certains troupeaux, l'attribuer à la
contagion, pour d'autres à l'épizootie, mais le plus souvent sans
aucune donnée certaine.
Cette année la maladie se présente aussi d'une manière fort irrégulière
: presque toujours elle débute par une affection aphteuse de la bouche,
de la langue et de la gorge ; souvent les pieds se trouvent attaqués
d'ulcères, de telle sorte que les animaux ne peuvent plus marcher :
Voici au surplus, d'après M. Vigney, quels sont les symptômes et la
marche ordinaire de la maladie de la vache laitière à l'herbage.
« Tristesse, nonchalance, et cela tout-à-coup. Ptyalisme (salivation)
abondant et souvent fétide, difficulté extrême pour prendre les
alimens, même impossibilité lorsque la vache paît ; au lieu de prendre
l'herbe de bas en haut avec les dents, c'est de haut en bas avec les
bourlets, ce qui a lieu également lorsqu'elle recommence à manger.
Oscillation des mâchoires d'un côté à l'autre, la bouche se trouvant
embarrassée par les viscosités, ainsi que par l'épaisseur de la salive.
L'animal, autant qu'il le peut, la tient ouverte pour respirer, ou pour
se soustraire à la douleur qu'il éprouve dans cette cavité, et fait
entendre un bruit que les cultivateurs du Bessin ont désigné sous le
nom de papper.
« Les oreilles sont basses, le poil est terne et piqué, les yeux sont
quelquefois larmoyants, le pouls peu différent de l'état normal ;
cependant, chez quelques-unes il est plus activé. La rumination est
lente, difficile et peu soutenue, les matières fécales, ainsi que les
urines, ne sont pas dérangées ; mais la sécrétion du lait diminue
sensiblement.
« Si la vache est en même temps atteinte par les pieds, ce qui arrive
souvent, ou si la maladie débute par les pieds, l'animal reste comme
s'il était cloué au sol, les jambes sont rapprochées du centre ; si
l'on veut le faire marcher, il éprouve une très-grande difficulté,
paraît souffrir beaucoup , il lève les jambes à pic, comme s'il avait
des épingles ou des épines dans les pieds. Il y a tremblement des
muscles fessiers, ainsi que de ceux de l'épaule. L'épine dorsale est un
peu voûtée en contre-haut. Si l'on ouvre la bouche de l'animal, on aperçoit des points blanchâtres peu étendus, ou bien l’ epithelium
est soulevé sur la langue, sur les lèvres et même au bout du nez. Chez
certains sujets, ces symptômes sont tellement faibles qu'ils pourraient
passer inaperçus ; car alors les vaches ne cessent point encore de
manger ni de marcher, seulement on remarque de la difficulté à prendre
les alimens, à les mâcher, ainsi que dans l'action de humer les
liquides.
« Le deuxième et le troisième jour, le mal augmente, la rumination se
suspend, le lait diminue beaucoup, les mamelles deviennent flasques, la
marche plus pénible, la salivation plus abondante. Les phlyctènes
(pustules) de la bouche ont acquis chez quelques individus tout leur
développement.
« Ce cas est rare, mais il existe. La langue sort de la bouche, exhale
une odeur fétide, et laisse tomber une bave abondante, visqueuse,
écumeuse, chargée des débris des phlyctènes de la membrane muqueuse.
J'ai donné des soins à plusieurs vaches qui avaient de ces phlyctènes
dans la gorge. Elles ne pouvaient plus avaler, ne respiraient que
difficilement, et laissaient couler par les narines un mucus
jaunâtre. Le pouls alors est accéléré, le poil plus terne et plus piqué
; l'amaigrissement marche si rapidement, que huit ou dix jours
suffisent pour causer le marasme le plus complet. Un fait digne de
remarque, c'est que les vaches les plus malades de la bouche, sont en
général celles qui le sont le moins des pieds et des mamelles.
« Dans le plus grand nombre, c'est à la pointe de la langue et sur le
dessus que se trouvent les phlyctènes ; elles sont à peu près de la
couleur ordinaire de l'épidémie, transparentes, plus ou moins élevées,
déforme irrégulière. Il s'y en trouve toujours, ou presque toujours,
une, que l'on aperçoit la première, entre le bourrelet cartilagineux de
la peau de la lèvre supérieure. Les autres, qui se trouvent disséminées
dans la bouche, sur les gencives, sur les lèvres et sur le nez, varient
dans leurs formes, leur grosseur et leur quantité. C'est le troisième
ou le quatrième jour que ces vésicules crèvent. Ils répandent une
sérosité blanchâtre ; puis cette portion de l'épidémie tombe et laisse
voir la membrane charnue rouge et sanguinolente. Si vous touchez la
pointe de la langue, il reste à la main une peau épaisse, couverte de
papilles nerveuses, tout à fait semblables à celles d'une langue de
bœuf cuite que l'on pelle. Il faut que cette manipulation fasse
considérablement souffrir l'animal, puisque les plus doux s'en
défendent avec force. Ces phlyctènes ou vessies, comme le dit M.
Mathieu, ressemblent à des brûlures occasionnées par de l'eau
bouillante que l'on aurait jetée dans la bouche.
« Lorsque les pieds sont malades en même temps que la bouche, c'est
aussi du troisième au quatrième jour que l'on trouve disséminées, çà et
là, autour des onglons, dans leur intervalle, et en quantité plus ou
moins considérable, des vésicules de forme et de grandeur différentes.
Elles se prolongent quelquefois sous toute la sole, la détachent ainsi
que le pourtour de l'onglon. Il découle de ces phlyctènes une humeur
d'un blanc jaunâtre, d'une âcreté telle, chez certaines vaches, que le
coussinet plantaire est détruit, et, dans la partie qui lui correspond,
laisse l'os du pied à nu.
« Ce serait une erreur de croire que les quatre pieds d'un animal sont
attaqués ensemble, ou également malades. Il n'en est point ainsi : chez
quelques sujets, il n'y a qu'un seul pied de malade, le plus souvent
deux, et ordinairement ce sont ceux de derrière, quelquefois même
trois, mais toujours à des degrés différents.
« Dans les cas ordinaires, et en exceptant celles dont nous avons
parlé, il est rare qu'au bout de huit jours les vaches ne recommencent
pas à se nourrir : dès lors la lactation augmente, tous les symptômes
de la maladie de la bouche et de celle des pieds semblent disparaître,
lorsqu'à ces deux premières succède celle des mamelles, qui, ainsi que
les trayons, sont couvertes de pustules plus ou moins épaisses,
quelquefois confluentes. Dans presque tous les troupeaux de vaches du
Bessin, lorsque l'irruption mammaire a eu lieu, ou a été reconnue, il y
avait déjà huit ou quinze jours, et même trois semaines, que la bouche,
ainsi que les pieds, étaient guéris.
« C'est un cas extrêmement rare de voir la maladie attaquer en même
temps les mamelles et les autres parties. Il y a même beaucoup de
troupeaux, dont les mamelles n'ont point été atteintes, ou ne l'ont été
que faiblement.
« Les vésicules sont blanchâtres, transparentes et cristallines à leur
centre, en s'éloignant de ce point, elles prennent une teinte jaunâtre,
puis enfin deviennent presque rouges sur leurs bords.
« Un fait qui s'est présenté assez fréquemment, pourrait peut-être
mettre sur la voie pour découvrir la nature de celle maladie : c'est
qu'une certaine quantité de vaches, appartenant à différens troupeaux,
ont transmis ces pustules aux personnes qui les trayaient
habituellement, et qui avaient des coupures ou des excoriations, soit
aux mains, soit aux bras. Il faut bien méditer cette vérité, qu'il n'y
a eu que les personnes non vaccinées , chez lesquelles ces boulons ou
vésicules se soient développées, jusqu'au point quelquefois de devenir
confluentes, et en si grande quantité, que ces personnes étaient
forcées de cesser de traire, ainsi que de s'occuper de tout autre
travail. Chez les individus vaccinés, cet état était remplacé par de
petites rougeurs et une légère démangeaison.
« Ces vésicules parcourent les mêmes phases que celles qui sont
produites par le virus du vaccin, dont elles semblent ne différer en
rien. Je pense que l'on peut les regarder comme étant de la même nature
que le cow-pox... »
La maladie, nous l'avons dit, était beaucoup plus grave lors de la
dernière invasion qu'elle ne l'est cette année : il y eut mortalité de
quelques animaux et dépréciation considérable de beaucoup d'autres qui
restèrent estropiés et maladifs.
Lorsque la maladie n'offre pas beaucoup de gravité, on abandonne à la
nature le soin de la guérison ; mais quand l'affection aphteuse est
plus prononcée, on emploie les gargarismes de miel et de vinaigre
(oximel), plusieurs fois par jour, et si elle va jusqu'à faire baver
les animaux, par l'effet des pustules qui envahissent toute la muqueuse
buccale, on fait rentrer l'animal souffrant et on lui donne quelques
soins qui consistent principalement à nettoyer la bouche avec un linge
en guise de pinceau, que l'on charge de pernitrate de fer et que l'on
fait mâcher à l'animal. Outre ce moyen, quand les pustules de la bouche
sont percées, M. Vigney dit qu'il les fait nettoyer et sécher avec un
linge doux, puis au moyen d'un pinceau (avec du poil de la queue de
l'animal) il fait toucher les parties malades avec un mélange de cinq
parties de nitrate d'argent, fondu et dissous dans 100 parties d'eau
distillée.
« Dans le début de la maladie des pieds, continue M. Vigney je coupais
toutes les parties vives et cornées, jusqu'à faire saigner. Je
nettoyais et séchais toutes les plaies, puis je les cautérisais, soit
avec une dissolution de nitrate d'argent, soit avec le pernitratee de
fer, que j'ai employé plus souvent, et dont je me suis servi pour
cautériser toutes celles de mes vaches qui ont été malades, sans
qu'aucune complication ait eu lieu.
« Si dans le commencement ou dans le cours de la maladie, de
fortes escarres, telles que la peau interdigilée, le ligament
transversal, semblent vouloir se détacher, il faut se hâter de mettre
les vaches à l'abri de l'humidité, du soleil et des insectes. Il faut
donc les rentrer, leur faire bonne litière, leur fournir une nourriture
saine et substantielle, afin de leur donner la force de supporter un
traitement qui peut être long…
« Aussitôt que l'escarre est tombée, je fais panser avec le digestif
simple, légèrement camphré, recouvert avec de l'étoupe hachée ; puis je
fais placer par-dessus un sachet, rempli de son frais non mouillé.
« Si la plaie est en voie de guérison, je remplace le digestif par du
cérat saturné. Si, au contraire, elle s'agrandit et devient ulcéreuse,
je fais un mélange de deux parties de charbon pulvérisé et d'une de
quinquina rouge, dont je saupoudre la plaie, et je substitue au sachet
de la poudre de gentiane.
« Si les chairs s'élèvent et montent, le pansement se fait avec l'onguent égyptiac, et s'il se forme des cerises, je les touche avec du chlorure d'antimoine… »
En général, M. Vigney a évité la saignée et la diète, quand il
s'agissait de vaches laitières, parce qu'il a observé que ce mode de
traitement, en faisant diminuer de beaucoup la lactation, ne procure
point une guérison plus prompte. Cependant il ne donne point ce conseil
d'une manière absolue.
« Lorsqu'il y a, dit-il, des pustules sur les mamelles, il faut, autant
que possible, éviter de les faire saigner ; aussitôt que les vaches
sont traites, les laver avec de l'eau végéto-minérale, les sécher avec
du vieux linge, puis y mettre une légère couche de cérat saturné et
opiacé. Si un bouton se place au bout du trayon, il faut tâcher de
tenir l'orifice ouvert avec un peu de cire, et surtout avoir le plus
grand soin de ne pas laisser de lait dans la glande.
« Si une ou plusieurs glandes sont enflammées, il faut rentrer la vache
à l'étable, la saigner, la mettre à la diète, faire sur ces glandes des
lotions émollientes, leur faire prendre des bains de vapeur ; en
général, on traite les mamelles comme celles qui ont des maladies
déterminées par toute autre cause. »
M. Vigney termine sa notice en réfutant comme une erreur l'opinion des
personnes qui pensent que le lait des vaches malades est mauvais et
malfaisant. Il affirme que le lait ne perd rien de sa qualité, et qu'il
est même plus butyreux qu'avant la maladie.
Il déclare aussi que, malgré l'assertion contraire de quelques
personnes, il n'a jamais observé que l'animal ait été attaqué deux fois
de la maladie.
POMMES DE TERRE. — CULTURE HIVERNALE.
Au mois d'octobre dernier, alors que l'on avait des craintes sérieuses,
mais heureusement peu fondées, sinon de disette du moins d'insuffisance
dans le produit des récoltes, on recommanda, comme devant donner des
tubercules dès le printems, la culture hivernale des pommes de terre.
Au nombre des agronomes qui vantèrent cette méthode, se trouvait un
professeur d'agriculture de Belgique, M. Morren, qui, à l'appui de
cette recommandation, citait un grand nombre de faits établissant les
bons résultats de la culture d'hiver.
Nous avons reproduit (tome 3, p. 110 et suiv.), la notice publiée à cet
égard, avec d'autant plus d'empressement que plusieurs personnes de
notre pays nous affirmaient avoir bien réussi en plantant à l'automne
des pommes de terre qui avaient produit leur récolte au mois de mars
suivant. Voulant d'ailleurs savoir positivement à quoi l'on doit s'en
tenir, nous engageâmes quelques agriculteurs et jardiniers à essayer
celte culture.
C'est avec regret que nous avons à constater, au moins dans les essais
que nous avons été à portée de vérifier, un insuccès complet. M. Le
Barillier, dans sa propriété de Lébisey, M. Durand, dans les jardins de
l'Hôtel-Dieu, M. Manoury, au Jardin botanique, etc., ont semé, dans les
meilleures conditions, des pommes de terre au mois d'octobre dernier ;
au mois de novembre les tubercules avaient bien levé, et l'on prit soin
de couvrir les fanes, les unes avec du fumier pour stimuler la
végétation et avec de la paille, les autres avec de la paille de fumier
seulement, afin de préserver les pousses de la gelée.
Quoique l'hiver n'ait pas été rigoureux, comme la pomme de terre est
très-sensible au froid, les fanes ont péri aux premières gelées, pour
pousser de nouveau dès la fin de l'hiver, et se développer avec quelque
vigueur.
Enfin, vérification faite, à la fin de mars, il ne s'est rien trouvé ;
et ces jours derniers, c'est à peine si, au pied des plantes, on
remarquait quelques tubercules moins gros que des noisettes.
Une personne nous ayant affirmé que des pommes de terre oubliées en
terre, à l'automne dernier, avaient produit en mars des tubercules
assez beaux, mais en moindre quantité que dans la culture ordinaire,
nous avons, il y a peu de jours, fait arracher avec soin un assez grand
nombre de pieds venus sur un champ planté en pommes de terre en 1845.
Une partie de ces plantes étaient de l'espèce précoce. Sur ce point
encore, vérification faite avec attention, nous n'avons pas trouvé de
tubercules. Dans une autre vérification de même nature faite deux jours
plus tard, dans une autre terre, nous avons rencontré des tubercules
gros comme des amandes.
Il nous a donc paru certain que la personne, de fort bonne foi
d'ailleurs, qui nous avait assuré le fait ci-dessus, s'était trompée,
en prenant des tubercules oubliés de la dernière récolte pour des
pommes de terre venues depuis l'automne.
Après les vérifications dont nous venons de parler, nous avons fait
découvrir plusieurs plantes de pommes de terre précoces, semées en mars
, et nous avons trouvé les tubercules plus gros que ceux des plantes
qui ont été semées avant l'hiver.
Malgré ces faits dont nous garantissons l'exactitude, nous ne
prétendons pas conclure que la culture hivernale de la pomme de terre
soit une déception, car nous en voyons les bons résultats certifiés par
des gens dignes de foi. Dernièrement encore, M. Payen, Secrétaire de la
Société royale et centrale d'agriculture, dans le compte rendu des
travaux de l'année, citait deux agronomes chez lesquels cette culture
aurait bien réussi l'hiver dernier. Nous doutons cependant, et nous
prions ceux de nos collaborateurs qui auraient essayé la culture
hivernale ou seraient à portée de nous donner quelques faits pour ou
contre, à vouloir bien nous communiquer tous les renseignements de
nature à éclairer la question.
Après avoir exposé nos doutes, il nous reste à suivre le développement
qu'auront pris les plantes semées avant l'hiver, et à en comparer le
produit avec celui des tubercules plantés aux époques ordinaires. Car
alors, en supposant même que la culture hivernale ne soit pas possible,
s'il est établi que les plantes mises en terre en automne, donnent le
rendement le plus considérable, les essais tentés n'auront pas été
inutiles. Nous invitons, en conséquence, les personnes qui ont fait des
essais à les continuer en ce sens, et à bien constater le produit
qu'elles auront obtenu.
Si le résultat est bon, ce ne sera plus alors une question de tems, mais de rendement.
JUMENS — MORTALITÉ DES POULAINS.
Au commencement de l'hiver dernier, en rendant compte de quelques
prédispositions maladives des chevaux, nous faisions observer que la
qualité médiocre des fourrages, nourris d'eau pendant le printems
humide de 1845, devait faire craindre, à la suite, d'une alimentation
débilitante, des maladies pour le printems suivant. A cette occasion,
nous donnions aux cultivateurs le conseil de mêler du sel aux aliments
de leurs bestiaux, afin de donner du tonique à la nourriture et ainsi
de neutraliser autant que possible les effets des fourrages.
Plus d'un cultivateur de la plaine de Caen regrettera sans doute de
n'avoir pas suivi ce conseil, car un grand nombre de juments ont avorté
peu de tems avant de mettre bas, et beaucoup de poulains sont morts
quelques heures ou quelques jours après la naissance. On cite tel
éleveur qui a perdu douze à quatorze poulains. Il y a eu également
grande mortalité sur les produits de l'espèce ovine.
Cette mortalité doit être attribuée à une cause générale ; or, la cause
la plus probable, puisqu'elle avait même été prévue et indiquée
longtems à l'avance, est celle que nous rappelons, la qualité peu
substantielle des fourrages de la récolte dernière. Cette circonstance
nous engage à recommander de plus en plus l'usage du sel dans
l'alimentation des bestiaux, en faisant observer que c'est une économie
mal entendue que celle qui consiste à éviter une dépense dont le but
est de prévenir des pertes semblables à celles que l'on a pu constater
depuis deux mois.
LES PARASITES. — LA MOUSSE DU POMMIER.
Nous avons signalé, il y a quelques mois, aux cultivateurs le mal que le guy
fait dans leurs vergers, et dénoncé à l'administration le peu de soin
que l'on prend d'arrêter l'invasion de ce parasite. Mais les pommiers
ont un autre ennemi plus dangereux encore que le guy, car il est
beaucoup plus difficile à détruire : nous voulons parler de la mousse.
Tous les cultivateurs savent combien un plant de pommiers est compromis
lorsque la mousse vient à l'envahir : les arbres durcissent et s'ils
sont jeunes, ils s'arrêtent dans leur développement, deviennent
rachitiques ; s'ils sont plus forts, une partie du branchage se
dessèche et meurt, l'extrémité des branches conserve seule quelque
vigueur et produit encore des fruits.
Une partie des observations que nous avons présentées contre le guy
s'applique à plus forte raison à la mousse. Tout végétal, pour vivre et
se développer, a besoin d'air, de lumière et de chaleur ; or, à mesure
que la mousse s'étend dans un arbre et s'épaissit sur les branches,
elle empêche l'air de circuler, intercepte les rayons du soleil et
s'oppose à ce qu'ils arrivent jusqu'à l'écorce. L'arbre se trouve,
ainsi privé des impressions favorables de l'atmosphère. Comme le guy,
la mousse absorbe aussi pour vivre une partie de la vie de l'arbre, et
l'épuise sans lui permettre de réparer les pertes qu'elle lui
occasionne. En outre, la mousse donne abri et asile à une foule de
familles d'insectes qui, comme la plante où elles viennent pulluler,
subsistent aux dépens de l'arbre.
Par malheur, il est plus difficile de débarrasser un arbre de la mousse
que du guy. Pour détruire ce dernier, il suffit d'en couper la tige au
ras de la branche, tandis que la mousse est collée sur une grande
surface, et exige, pour être enlevée, beaucoup plus de tems et de
précautions.
Mais c'est quand l'arbre est jeune et dès que l'on s'aperçoit que le
parasite le menace, qu'il faut s'attaquer à l'ennemi. Alors on fait
arracher la mousse avec la main, ou bien enlever, en grattant les
branches avec un morceau de bois en forme de couteau, avec un bout de
latte, ou enfin en les frottant avec un petit balai très-dur, faisant
l'office d'une brosse.
C'est surtout après quelques jours de pluie, à l'arrière-saison,
lorsque la mousse ramollie par l'humidité a moins d'adhérence à
l'arbre, que l'opération peut se faire avec le plus de succès.
Dans les arbres âgés et dont les branches ont disparu sous une mousse
épaisse, l'opération est moins facile ; mais cependant avec du soin et
de la patience, on peut encore obtenir de bons résultats. Nous n'avons
pas besoin de dire qu'il faut procéder avec précaution, afin de ménager
l'écorce des branches et de peur de briser le jeune bois et les bouts à
fruits. Mieux vaut y aller lentement et ne pas abimer l'arbre.
C'est là bien du soin, bien du tems, bien de la dépense, par
conséquent, diront les cultivateurs. C'est vrai ; mais les arbres que
l'on conserve ou que l'on rend productifs n'ont-ils aucune valeur ?
Comptons :
Un jeune pommier de six à sept ans a une valeur réelle, tant par
l'achat, le travail de plantation, les tuteurs dont on a entouré la
tige pour la préserver des atteintes des bestiaux, que par son âge. —
car, quand il s'agit d'arbres, il faut avec soin compter le tems : avec
de l'argent on peut avoir tout, excepté des arbres que l'on n'obtient
qu'avec des années. — Evaluons donc à 6 fr. seulement un pommier de 7
ans. Un journalier laborieux nettoiera de leur mousse bien des pommiers
dans une semaine. A 1 fr. 50 par jour, c'est 9 fr. pour une semaine, et
c'est le salut ou au moins le bon entretien de 100 jeunes arbres valant
comme minimum 600 fr.
Assurément, il n'est pas un cultivateur intelligent qui ne consentît à
donner quelques francs par an pour la conservation d'un jeune plant,
dans lequel repose souvent en grande partie l'espoir de son
exploitation. Or, nous venons d'indiquer comment ces quelques francs
peuvent être utilement dépensés à cet effet.
*
* *
Tome III. - 3e année. - 11e livraison. - mai 1846.
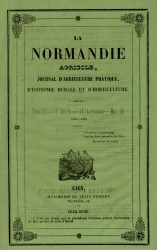
CULTURE DES ARBRES A FRUIT.
Dans un tems peu éloigné encore de nous, il n'y avait qu'un petit
nombre de localités où l'on se donnât le soin de cultiver les arbres à
fruit, et aujourd'hui même il est des contrées où l'on ne connaît que
quelques fruits et des espèces les plus grossières. Il ne coûte pas
plus cependant de cultiver un bon arbre qu'un mauvais, et de préparer
ainsi à sa famille une de ces petites jouissances qui contribuent au
bien-être et souvent même entretiennent la santé.
Aussi, d'année en année, voyons-nous se répandre et se perfectionner la
culture des arbres fruitiers. Dans quelques contrées de notre pays, les
propriétaires aisés font planter autour de leur habitation à la
campagne ce que l'on appelle une Petite-Normandie,
c'est-à-dire un verger contenant non seulement des pommiers à cidre,
mais des arbres donnant pour la table des fruits de toute espèce,
pruniers, cerisiers, noyers, poiriers, abricotiers, etc., ou bien ils
construisent des murs qui, en garantissant l'habitation des vents du
Nord, permettent d'établir des espaliers dont le produit, dépassant
souvent de beaucoup les besoins du ménage, se vend très-avantageusement
aux marchés voisins. Dans la vallée d'Auge, la culture des cerisiers
donne, dans certaines exploitations, et presque sans soin pour le
propriétaire, un profit assez rond.
Nous connaissons dans nos départemens quelques localités où des
propriétaires doublent souvent leurs revenus avec le produit de leur Normandie
et de leurs espaliers, indépendamment de l'agréable supplément de
nourriture qu'ils procurent à ce qui les entoure, en couvrant, pendant
plus de la moitié de l'année, la table de fruits savoureux.
Nous pourrions également citer des propriétés richement plantées en
noyers, dont les fruits sont d'un très-grand secours pendant l'hiver,
pour la nourriture des gens de la ferme.
Dans ces exploitations rurales, plusieurs fois chaque semaine, au repas
du soir, on sert après la soupe des noix qui sont toujours les
bienvenues.
Pourquoi ne ferait-on pas partout, ce que les hommes intelligens et
soigneux font sur leurs propriétés ? Pourquoi le petit propriétaire, au
lieu de laisser, sur le fossé de son champ, pousser un mauvais arbre
destiné à donner au bout de 30 années un peu de combustible, ne
plante-t-il pas un bon poirier ou prunier qui, au bout de quelques
années, lui fournira du fruit pour sa table ? Pourquoi, partout où
pousse la merise, ou la petite cerise sauvage, ne pas mettre une greffe
ou un écusson qui transformera en arbre précieux un méchant arbre.
Pourquoi sur le chemin qui conduit à la maison, ne pas faire une avenue
d'arbres à fruit, au lieu d'y planter des peupliers ou autres arbres,
parasites sans valeur, qui, par leur ombrage et leurs racines, nuisent
essentiellement à la végétation des arbustes ou plantes du voisinage ?
Pourquoi, dans la cour de la ferme, ne pas planter au nord des
bâtimens, afin de les abriter contre les plus mauvais vents, ou sur le
bord des fosses à engrais, afin de préserver les fumiers des ardeurs du
soleil, des noyers qui, dans notre climat et dans de bonnes conditions
de sol, prennent quelquefois un développement immense ? Ces arbres non
seulement donnent un abri ou un ombrage utile, ils deviennent aussi un
ornement de la propriété et produisent abondamment des fruits. Pourquoi
l'individu qui ne possède qu'une maisonnette, ne la garnit-il pas de
tous les côtés d'espaliers dont les fruits viendraient, aux jours de
fête, orner sa modeste table ?
Ce que nous exprimons ici comme vœux s'est, nous le répétons, réalisé
dans quelques contrées de nos départemens. Mais malheureusement cette
amélioration est loin encore d'être générale, et c'est pour engager
quiconque possède un coin de terre, à enrichir son exploitation,
étendue ou petite, du plus grand nombre possible d'arbres fruitiers, au
lieu de laisser sans bois les parties susceptibles d'en recevoir, ou de
n'y planter que de mauvais arbres.
Nous pouvons appliquer aussi aux communes ce que nous disons ici pour
les particuliers. Il est, en effet, beaucoup de communes qui pourraient
augmenter leurs revenus, si elles faisaient planter sur des parties de
terrain qui sont perdues, sur le bord des chemins, aux carrefours, sur
des côteaux en pente, etc., de bons arbres à fruit. Pour engager les
particuliers dans cette bonne voie, il suffit souvent d'un propriétaire
influent prêchant ses voisins par ses conseils et son exemple. C'est
ainsi que Montreuil doit ses pêches, et Fontainebleau son chasselas, au
contact, au voisinage, et à l'imitation de l'homme qui, dans les deux
localités, avait introduit cette culture.
D'ici quelques années, dans les départemens où, comme dans le Calvados,
les élèves des écoles normales primaires reçoivent un bon enseignement
horticole, nous verrons s'étendre la culture des arbres fruitiers. Les
instituteurs, par eux-mêmes et par les élèves qu'ils ne tarderont pas à
formera leur tour, répandront, avec le goût de cette culture, les
bonnes méthodes qui peuvent la faire prospérer.
A cet effet, il est à désirer que les communes administrées avec
intelligence et que les conseils généraux secondent dans ses louables
efforts M. le recteur de l'Académie de Caen, qui a fait entrer
l'horticulture dans les cours d'études que suivent les élèves-maîtres.
Les communes le seconderont, en attachant à la maison de l'instituteur
un jardin d'une étendue suffisante pour qu'il puisse recevoir une
petite pépinière et qu'il contienne assez d'arbres pour que la leçon
pratique accompagne l'instruction théorique : les conseils généraux
répondront à la bonne pensée de M. l'abbé Daniel, en mettant à sa
disposition tous les ans une subvention destinée à donner des
encouragements aux instituteurs, qui auront montré le plus de zèle et
d'habileté à répandre autour d'eux les méthodes les meilleures de
culture des arbres à fruit.
Nous reproduisons ci-après une notice qui nous a paru
très-intéressante, publiée par un desservant des euvirons de Metz, sur
les moyens employés par lui, avec cette persévérance qu'une conviction
profonde peut seule donner, pour doter sa commune de plantations
d'arbres à fruit. Nous supprimons seulement de ce récit, comme objet
sans utilité pour nos départemens, tout ce qui est relatif à des semis
de sapins, destinés à fournir les tuteurs nécessaires aux jeunes arbres.
« Lorsque, en 1804, je fus nommé curé, dans la commune de R..., je ne trouvai sur tout le ban que 37 arbres fruitiers.
« Dans la commune située au bord de la Moselle, que j'avais occupée
précédemment, j'avais appris à connaître les grands avantages que
procurent les arbres fruitiers. Cette commune retirait de la vente des
fruits une somme de 2,700 fr. Créer un tel revenu à la commune de R...
fut ma première pensée et ma ferme volonté. Avec l'assistance de Dieu,
je fus assez heureux pour ne pas me laisser décourager par les
obstacles que je rencontrai, et pour arriver enfin aux résultats
suivans :
« La vente des fruits produit déjà 550 fr., et paie les frais d'entretien d'une école évalués à 750 fr. au moins.
« Il n'y a certainement pas beaucoup de communes dans le canton qui
soient moins favorisées sous le rapport du climat, de l'exposition et
du sol, que la commune de R...
« Ce qui a été possible ici ne doit donc pas être plus difficile dans
les autres communes de cette partie de l'Ardenne ; c'est pourquoi je
considère comme un saint devoir pour moi de communiquer la manière dont
j'ai agi et celle dont agissent aujourd'hui avec tant d'efforts et
d'intelligence le conseil municipal et le maire de R...
« En 1805, je préparai dans le jardin curial un espace que je semai en
noyaux et pépins, en 1807 je transplantai dans une pépinière 500
pommiers, 480 poiriers et 300 quetschiers (prunier à prune longue)
qu'avait fournis le semis.
« En 1808, je greffai les pommiers et les poiriers avec des variétés
tardives ; pour les quetschiers, il n'est pas nécessaire de les
greffer, et je transplantai chaque année leurs jets enracinés, de
manière qu'en 1812 leur nombre s'élevait à 2,000.
« En 1830, ma pépinière contenait 4,000 sujets greffés de différens âges, de quatre jusqu'à quinze ans.
« Je croyais qu'il n'y avait qu'à produire des arbres pour en donner le
goût aux habitants de la commune ; mais je m'étais bien trompé :
personne ne voulut accepter gratuitement un arbre pour le planter, et
tous mes arbres me restèrent. Que pouvais-je en faire ? Je ne possédais
de terrain qu'un revers pierreux de montagne et mon bois de sapins.
« En 1815, je plantai 4,000 quetschiers sur le revers, puis je plantai
sur les bords du chemin du cimetière, long de 1,000 mètres, sur 8
mètres de largeur, et autour du cimetière, des pommiers et des
poiriers, en ayant soin de mettre entre deux arbres à pépins un arbre à
noyaux ; en tout 600 arbres y trouvèrent place.
« En 1822, je vendis la récolte de 1,000 quetschiers, à raison de 25
cent, par arbre. En 1823, ils me rapportèrent 220 fr. ; en 1824, 360
fr. ; et jusqu'à 1830, une moyenne de 400 francs.
« Ce beau résultat ne fut pas encore suffisant pour vaincre les préjugés de la commune.
« Le maître d'école, qui jusqu'alors avait dirigé sous mes ordres les
enfants dans la culture pratique des arbres, mourut en 1830. De son
école étaient sortis à peu près 60 jeunes gens connaissant bien la
culture des arbres -, les plus âgés avaient 24 ans, et étaient en
partie établis dans le village.
« Le salaire du maître d'école ne montait alors qu'à 350 fr., et il n'y
avait point de pépinière communale. L'administration fixa le traitement
du nouveau maître d'école à 560 fr., et imposa à la commune
l'obligation de créer une pépinière.
« L'impôt pour l'école monta de 4 à 8 fr. par enfant, et devint ainsi
très lourd pour la classe peu aisée. A l'exception de deux membres,
toute la commune appartenait à cette classe.
« Pour les soulager de ce lourd fardeau et arriver à l'accomplissement
de mes projets, je leur offris mes plantations et les revenus qu'elles
pouvaient produire, aux conditions suivantes :
« 1° Que la commune donnerait à l'école 1 hectare de terre inculte pour
y établir une pépinière ; que ce terrain serait tout d'abord labouré,
fumé et entouré d'une clôture ;
« 2° Que tous les chemins et tous les terrains incultes appartenant à
la commune, et susceptibles de produire des arbres fruitiers, seraient
plantés en arbres fruitiers, par le maître d'école ; que ce dernier
devrait en planter tous les ans 400, et recevoir pour chaque arbre 1
fr. 10 c. ; qu'il serait tenu de les soigner jusqu'à ce qu'ils
portassent fruit, moyennant 6 c. par arbre, qui devraient être payés
par la caisse communale ;
« 3° Que le maître d'école serait tenu de donner aux habitants du
village, qui voudraient les planter sur leur propre terrain, les arbres
greffés, âgés de sept à neuf ans, pour 25 c. la pièce, qu'il ne
pourrait en vendre à des étrangers qu'avec l'autorisation du conseil
municipal ;
« 4° Afin que les tuteurs ne manquent pas par la suite et qu'il n'y ait
pas disette de bois, la commune devra s'engager à semer tous les ans en
sapins 5 hectares de ses 75 hectares de friches (ces friches étaient de
mauvais pâturages dont jouissaient seulement quelques habitants), et à
donner par la suite les tuteurs qui proviendraient de ces semis , au
maître d'école et aux habitants du village, pour 6 c. la pièce ;
« 5° Que les fruits et autres produits des plantations seraient vendus
tous les ans au profit de la commune. Sur le produit de cette vente on
prélèverait 300 fr., qui, ajoutés aux 450 fr. assurés au maître d'école
pour 400 arbres à 1 fr. 10 c. qu'il doit planter chaque année,
compléteraient son salaire de 750 fr.
« Le conseil municipal n'accepta pas ces offres, quoique toute la
commune le voulût et quoiqu'elle en témoignât hautement le désir. En
vain le maire s'efforça de faire comprendre aux membres de ce conseil
les avantages qui en résulteraient, de leur faire voir les beaux
résultats que j'obtenais tous les ans. Quelque séduisant que fût mon
bois de sapins, la perspective d'en avoir une étendue beaucoup plus
considérable appartenant au village, et la fondation d'une école
gratuite, ce beau projet échoua contre la considération du troupeau de
bêtes à laine dont jouissaient seulement quelques riches habitants qui
avaient le plus grand nombre de voix dans le conseil, et ne voulaient
pas sacrifier leurs petits intérêts au bien-être de la majorité des
habitans.
« D'après la loi, la moitié des membres du conseil municipal furent
changés en 1831. Celle circonstance rendit de l'espoir au maire. Le
changement eut lieu, les propriétaires de moutons ne furent pas
renommés. A leur place vinrent de jeunes hommes élevés par l'ancien
maître d'école, amis des arbres et du bien public ; le maire présenta
de nouveau mes propositions au nouveau conseil municipal, qui les
accepta.
« Dès 1831 on mit la main à l'œuvre, les 175 ares pour la pépinière furent préparés.
« Heureux d'avoir atteint ce résultat, je fis cadeau de tout ce que
contenait ma pépinière au maître d'école. Il transplanta tout de suite
les semis, et en fil de nouveaux dans la pépinière communale. Il y
transplanta également les petits sujets, et ceux de dix à quinze ans
furent plantés le long des chemins communaux et sur des revers exposés
au midi.
« En 1835 il avait déjà transplanté 2,000 arbres sur les communaux,
avec l'aide des enfans de l'école ; en 1837 la commune avait 3,000
arbres qui portaient des fruits. A la vente des fruits, chaque arbre
donna un revenu de 50 c, et en 1842 un produit moyen de plus de 1,300
fr.
« La commune se réjouissait ; car, outre les 750 fr. pour le maître
d'école, elle avait une école qui ne lui coûtait rien, et 375 fr. de
reste. C’était de hauts intérêts pour les 1 fr. 12 c. payés pour chaque
arbre planté.
« Le maître d'école continua à planter tous les ans 400 arbres, jusqu'à
ce qu'il n'y eût plus de terrain vide. Les enfants de l'école, qui
avaient aidé à faite ces plantations, furent chargés de les soigner et
de les protéger, charge qu'ils conservèrent après être devenus des
hommes établis dans le village : pour cela chaque élève reçoit tous les
ans, gratis, de la pépinière,
un arbre greffé. Les suites de cette mesure eurent l'avantage de donner
le goût de l'étude, l'amour des arbres et des plantations en général.
Le territoire que j'avais trouvé nu en 1804 se transforma en un
verger...
« En résultat, la commune possède aujourd'hui 75 hectares d'arbres
verts venus sur des terrains jusque-là improductifs ; 2,500 pommiers
qui couvrent à l'exposition du midi 7 hectares 1/2 de revers de
montagne. Elle a un bâtiment communal attenant à la maison d'école,
dans lequel se trouve le pressoir pour faire le cidre. On fait
actuellement dans les bonnes années jusqu'à 1,800 hectolitres de cidre
et 4 à 500 hectolitres de vinaigre. Si l'on ne compte en moyenne que 4
fr. par hectolitre, et que 800 hectolitres par an, on trouve que la
commune a un revenu d'environ 3,000 fr., avec lesquels elle peut payer
tous les impôts et charges communales.
« Les quetschiers portent tous les deux ans ; les fruits sont
employés dans les ménages en partie frais, en partie secs, et le reste
est converti en eau-de-vie. Les habitans de la commune possèdent 8,000
quetschiers, dont 6,000 sont en rapport et produisent un revenu en
argent comptant de 3,800 fr. par an. Comme les arbres sont très
éloignés les uns des autres, ils nuisent peu aux récoltes.
Les plantations d'arbres ont aussi fait prospérer le métier de
tonnelier. La commune compte dix maîtres tonneliers et 30 apprentis. »
*
* *
Tome III. - 3e année. - 12e livraison. - juin 1846.
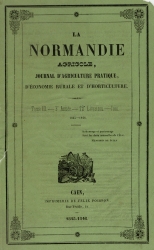
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE ET DES HARAS.
Lorsque dernièrement une mort déplorable atteignait M. Dittmer, au
milieu d'une carrière honorablement parcourue, et à laquelle de longs
jours semblaient encore réservés, tous ceux qui en France s'intéressent
à l'industrie chevaline, en furent vivement affectés. C'est que pour
eux , il ne s'agissait pas seulement de la perte d'un bon citoyen, d'un
homme de cœur, d'un administrateur éclairé ; ce qui, dans un intérêt
général, préoccupait tous les esprits, était de savoir comment il
serait remplacé, et de fâcheux exemples faisaient craindre que
l'intrigue et la faveur, jouant en cette circonstance leur rôle
ordinaire, n'amenassent l'avènement d'une nullité privilégiée dont
l'incapacité viendrait ouvrir une plus large porte à des abus déjà trop
nombreux.
On ne saurait en effet se le dissimuler, il a existé, il existe encore
des abus dans celte administration ; et pour elle-même comme pour le
pays, il faut qu'il y soit mis un terme. Qu'on se garde cependant de
prendre ce que nous disons comme une attaque contre la mémoire de celui
qui en était l'âme et pour ainsi dire la personnification. Nous le
disons hautement, et ses ennemis, ou plutôt ses adversaires, car un
pareil homme ne doit pas avoir d'ennemis, ses adversaires eux-mêmes en
conviennent, M. Dittmer était un homme supérieur. Malheureusement,
comme pour donner une nouvelle preuve que rien ici-bas ne peut être
parfait, il lui manquait une chose, une seule, mais sans laquelle il
n'est pas d'homme de cheval complet : il n'avait pas été élevé au
milieu des chevaux, et n'avait pas eu l'occasion d'acquérir de jeune
âge les connaissances pratiques que réclamait sa position. Autant qu'il
était humainement possible de le faire, il y avait suppléé par le
travail et l'étude, et tout ce que peut, enseigner la théorie, il le
possédait. Personne mieux que lui d'ailleurs ne savait écouter et
mettre à profit les idées qui lui étaient soumises. Cependant il existe
des bornes qu'il n'est donné à personne de franchir : il avait dû
s'arrêter, et malgré sa capacité, son intelligence et son zèle, il est
de certaines nuances, de certaines subtilités, si je peux m'exprimer de
la sorte, qu'il n'avait, qu'il n'aurait jamais pu ni saisir ni
comprendre. La conséquence en est facile à déduire, et explique
comment, avec d'excellentes intentions, il a pu commettre plus d'une
erreur, et faire même quelquefois le contraire de ce qu'il avait voulu,
de ce qu'il avait cru faire. De là des plaintes et des accusations qui,
pour n'être pas toujours sans fondement, n'en étaient pas moins à ses
yeux d'une haute injustice ; de là conséquemment de vives contrariétés
et d'amères déceptions qui n'ont peut-être pas été étrangères au
funeste événement que nous déplorons autant que personne, et dans
lequel nous ne savons qui regretter le plus, de l'homme public ou de
l'homme privé.
Il faut donc le reconnaître, jamais directeur général d'une
administration des haras auquel manqueront les connaissances pratiques,
ne pourra, quel que soit son mérite sous tout autre rapport, remplir
ses fonctions d'une manière complètement satisfaisante. Or ces
connaissances se rencontrent si rarement dans les hautes classes de la
Société, on en a d'ailleurs si peu tenu compte dans la distribution des
emplois, depuis qu'il existe des haras en France, que les inquiétudes
de l'industrie, à l'annonce delà mort de M. Dittmer, sont faciles à
concevoir. Sa place serait-elle donnée à un homme influent mais sans
spécialité, conséquemment incapable de rien juger par lui-même ; le
serait-elle au contraire, toute autre considération cessant, à un homme
dont le principal titre de recommandation serait une spécialité qui lui
permît de tout voir, de tout apprécier sans le secours d'un
intermédiaire ? Telle était la question qu'avait à résoudre M. le
Ministre de l'agriculture, et dont la solution était attendue avec une
anxiété d'autant plus vive, que, par le temps qui court, certaines
combinaisons que nous n'avons pas à qualifier ici, accordent de bien
autres chances aux hommes à qui les places conviennent, qu'à ceux qui
conviennent aux places. Dans cette circonstance cependant, M. le
ministre de l'agriculture, nous sommes heureux d'avoir cette justice à
lui rendre, n'a pas hésité à suivre la marche que lui traçaient les
véritables intérêts du pays, et à ne laisser déterminer son choix par
d'autres considérations que celles de l'aptitude et de la capacité. Il
a bien à la vérité pris, pour y arriver, une voie quelque peu détournée
; mais comme en définitive le résultat est le même, et que c'est une
chose presque inouïe que les faveurs du pouvoir tombant sur des
personnes qui n'y ont point d'autre litre que leur spécialité, il
serait de mauvais goût de joindre une critique même légère à des éloges
si bien mérités.
Voici donc comment a procédé M. le Ministre. Il a réuni la direction
générale de l'agriculture et des haras au secrétariat-général du
ministère. Il a de plus créé une place de sous-directeur de
l'agriculture et des haras. Or quiconque sait ce que sont les fonctions
de secrétaire général, quelque bien connue que lui soit la haute
capacité de celui qui les remplit en ce moment, comprendra qu'y en
ajouter d'autres auxquelles suffisait à peine un homme de l'étoffe de
M. Dittmer, serait demander de l'humanité plus qu'il n'est permis d'en
attendre. Aussi est-il évident que tout le travail roulera sur le
sous-directeur. Cette combinaison, nous le répétons, pourrait prêter à
la critique, mais les causes qui l'ont fait éclore sont faciles à
apercevoir, et l'on doit tenir compte de certaines difficultés de
position. La direction sera donc en réalité aux mains du
sous-directeur, et c'est du choix de celui-ci que nous avons à nous
occuper pour apprécier ce que doit attendre l'industrie chevaline de la
marche adoptée par M. le Ministre de l'agriculture.
M. Gayot n'est pas de ces hommes que le hazard ou la protection jettent
d'emblée dans des emplois pour lesquels rien ne les avait préparés.
Fils de ses œuvres, il est de ceux au contraire qui ont commencé par le
commencement. Dès sa jeunesse des études consciencieuses le disposèrent
pour la carrière qu'il devait parcourir. Ce ne fut qu'après avoir passé
par les grades inférieurs, et les établissemens secondaires, qu'il est
arrivé enfin à diriger successivement les deux grands haras du royaume.
Travailleur infatigable, écrivain distingué, il n'a cessé de faire
marcher de front la pratique et la théorie et de se livrer surtout dans
les dernières années à des essais de toute espèce. Ayant résidé plus ou
moins longtemps dans les diverses provinces de production, il est plus
que personne en position d'apprécier les ressources qu'elles possèdent,
et les moyens de les féconder, sans être forcé de recourir aux
renseignemens trop souvent trompeurs de tiers ignorans ou intéressés.
Longtemps confondu dans la foule, il a pu voir de près certaines
choses, connaître certains abus, en souffrir peut être le premier, être
initié en un mot à une foule de détails qui échappent nécessairement à
ceux qui de plein saut arrivent au faîte de l'échelle. Nul plus que lui
n'est donc à même de donner à l'administration une impulsion
satisfaisante, et démettre un terme à des plaintes, nous devons en
convenir, trop souvent justes et fondées. Il lui faut pour cela du
courage, nous ne le lui dissimulons pas ; mais il faut aussi qu'il se
dise que si le ministre en le choisissant, n'a pas craint de déroger
aux habitudes, et de s'attirer peut-être de vives inimitiés, il a le
droit d'attendre de lui autre chose que de se traîner dans l'antique
ornière , comme le pourrait le premier venu.
A cet effet il est un point sur lequel dès aujourd'hui nous appellerons
son attention, parce qu'à nos yeux ce point est capital, et que c'est
pour l'avoir négligé, ou du moins pour avoir paru le faire, que
l'administration s'est vue attaquée de la manière la plus vive : nous
voulons dire l'encouragement de l'industrie privée. Non pas qu'il entre
dans notre pensée de soulever ici la grande question de savoir si cette
dernière pourrait, dès à présent, avec des encouragemens convenables,
suffire aux besoins de la production. Quelle que soit à cet égard notre
opinion personnelle, nous admettrons même sans discussion, si l'on
veut, la nécessité de la coopération directe de l'État. (Nous ne
parlons ici, bien entendu, que de la production ordinaire ; quant à
celle des types, l'indispensable nécessité de cette coopération ne nous
a jamais paru pouvoir être l'objet d'un doute.) Mais nous dirons qu'en
supposant reconnu que les dépôts d'étalons doivent être conservés,
augmentés même, il est une chose dont l'administration doit se
préoccuper avant tout, aussi bien dans son intérêt particulier que dans
l'intérêt général, c'est de se montrer plus large et plus intelligente
qu'elle ne l'a été jusqu'à ce jour, dans ses encouragemens à
l'industrie privée : et par là nous n'entendons pas seulement
l'application de primes plus élevées, mais encore un ensemble de
mesures réellement capables d'activer le développement de cette
industrie.
Ce n'est point ici le moment d'entrer dans des détails, trop importants
pour être traités à la légère, et nous leurs consacrerons incessamment
un article spécial où nous espérons pouvoir indiquer à l'administration
une marche infiniment préférable à celle qu'elle a suivie jusqu'à ce
jour, et qui pourra concilier lotis les intérêts.
Contentons-nous quant à présent de lui dire que si, plus d'une fois ,
dans l'intérêt du pays, nous avons cru devoir lui signaler ce qui nous
semblait des erreurs, nous n'en avons pas moins été mus uniquement à
son égard par des sentimens de bienveillance ; que nul n'est plus
disposé à reconnaître le bien qu'elle pourra faire ; qu'enfin,
convaincus des services qu'elle est capable de rendre, nul ne forme des
vœux plus sincères pour sa conservation et sa consolidation. Telle est
la cause qui nous fait chaudement applaudir au choix qui nous occupe en
ce moment, persuadés que nous sommes de l'heureuse influence qu'il est
de nature à exercer. Que celui qui en est l'objet cependant ne s'étonne
pas de nous trouver parfois quelque peu exigeans : c'est qu'il ne
saurait nous donner l'inexpérience pour excuse.
F. PERSON.
HYGIÈNE PUBLIQUE. — ANIMAUX DE BOUCHERIE.
L'Académie de médecine de Caen s'est préoccupée, comme on se préoccupe
actuellement en Allemagne et en Prusse, d'une question qui intéresse
hautement la salubrité publique : c'est-à-dire des mesures à prendre
pour que les animaux destinés à la Boucherie soient amenés sur les
marchés ou conduits aux Abattoirs, sans éprouver de ces tortures qui
nuisent essentiellement à la qualité de la viande.
Ce qui paraît avoir fixé plus particulièrement l'attention du corps
savant, c'est l'état dans lequel les veaux sont traités dans le
transport et sur la place du marché. Ces malheureux animaux, les
quatres pattes liées ensemble et souvent tellement serrées que les
cordes pénètrent dans les chairs, tuméfiées et presque gangrenées, sont
jetés pêle-mêle dans une charrette, la tête pendante et heurtée à
chaque secousse contre les montants de la voiture ; arrivés sur le
marché, ils sont étendus tantôt sur un sol glacé, sous une pluie
battante, où l'on petit les voir grelotter, ou bien sous un soleil
brûlant qui les asphyxie à demi.
Il est aisé de comprendre que des animaux qui, avant d'être tués, ont
éprouvé de telles souffrances, ne peuvent fournir une nourriture aussi
bonne que s'ils arrivaient à l'abattoir sains et bien portants. Il y a,
pour la plupart des consommateurs, répugnance bien naturelle à manger
de la chair d'animaux morts accidentellement ou d'une maladie
quelconque ; or, presque tous les veaux qui sont mis en vente sur les
marchés sont gravement malades quand on les met à mort, et
vraisemblablement un grand nombre périraient de diverses maladies, si
on les retirait du marché avec intention de les conserver.
Nous félicitons notre académie de médecine de ses bonnes intentions,
tout en regrettant qu'elles ne se réalisent pas plus tôt. Il est de
l'intérêt général que l'avis de ce corps compétent vienne éclairer
l'administration sur ce qu'il convient de faire pour la santé publique
; il est de l'intérêt même du corps qui a pris cette honorable
initiative, de ne pas se laisser devancer et, à cet effet, de publier
sans retard le rapport de sa commission.
Voici au surplus, pour aider cette commission dans l'accomplissement de sa tâche, les documents que nous trouvons dans l’ Union Agricole
sur ce qui, par ordonnances royales et par arrêtés administratifs, se
pratique en Bavière, en Saxe et autres Etats de l'Allemagne, dans le
double but d'hygiène publique et de souffrances inutiles épargnées aux
animaux.
Provisoirement il est prescrit :
« 1° De ne plus lier les veaux au moyen de cordes trop tranchantes, et
de se servir de préférence de paille tordue, afin d'éviter de les
blesser,
« 2° De ne plus lier ensemble que deux pieds, d'une part, ceux de
devant, de l'autre, ceux de derrière, au lieu de les réunir tous quatre
dans un même lien,
« 3° Le cou et la bouche du veau doivent rester libres de toute entrave,
« 4° Le conducteur est tenu de veiller à ce que les veaux soient
couchés à l'aise sur une quantité de paille suffisante, et de manière
que leur tête se trouve un peu plus élevée que le reste du corps, ou du
moins qu'elle ne pende pas au dehors de la charrette. »
Cette ordonnance, qui est du 28 avril 1843, a reçu le 15 avril dernier,
un article additionnel qui défend la transport des animaux destinés aux
abattoirs durant la saison chaude, si ce n'est le matin, le soir et la
nuit.
En Prusse, depuis longtemps déjà, les marchands de bestiaux
transportent les veaux en liberté dans des voitures construites exprès.
L'association de Berlin leur a adressé des félicitations à ce sujet.
Enfin, la même société vient de publier un écrit qui porte la signature
de 27 des médecins les plus distingués de Berlin, sur les dangers qu'il
y a pour la santé de l'homme de manger de la viande d'animaux surmenés
ou garottés.
OBSERVATIONS SUR DEUX ARTICLES DU RECUEIL DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE PRATIQUE.
Nous nous sommes souvent demandé si ce n'était pas abuser de la
patience du lecteur, que de revenir sans cesse sur le même sujet, et de
ne laisser échapper aucune occasion de lui parler chevaux, question
chevaline, hippologie. Plus d'une fois même une sorte de honte nous a
fait tomber la plume des mains. Cependant ces questions sont si peu
comprises même des hommes qui sembleraient devoir être le plus
compétens, que, mal qu'on en ait, pour qui sent leur importance, il
faut bien y revenir encore et toujours, dût-on s'exposer à s'entendre
traiter de rabâcheur.
Ces réflexions nous sont suggérées par la lecture de deux articles d'un
recueil d'hippiatrique que publient plusieurs de nos plus célèbres
professeurs dans l'art vétérinaire. Ces articles portant le titre
d'analyses et consacrés à la Normandie agricole,
sont rédigés, nous nous empressons de le reconnaître, avec toute la
convenance et l'urbanité que l'on peut attendre d'un homme de bonne
compagnie, ce qui redouble nos regrets d'avoir à le combattre.
Nous ne parlerons pas de certaines contradictions qu'il a cru découvrir
dans divers articles de notre journal. Nous lui rappellerons seulement,
ce que nous avons dit et répété cent fois, que la Normandie agricole
est une tribune que nous avons entendu ouvrir à toutes les opinions
consciencieuses ; que loin de la vouloir monopoliser au profit de
quelques individus, nous faisons appel au contraire à tous les hommes
dévoués ; qu'enfin ne nous proposant d'autre but que la recherche de la
vérité, nulle théorie, fût-elle en opposition directe avec les nôtres,
ne
serait repoussée par nous, sauf à chacun le droit de la discuter. Il
résulte de là, que plusieurs personnes ayant traité les mêmes sujets,
n'ont pu manquer surtout dans la question si complexe des chevaux,
d'émettre des idées différentes, et dont il n'est pas difficile à
coup-sûr de faire sortir des contradictions Pour qui veut exercer une
critique sérieuse et utile, ce n'est pas ainsi, ce nous semble, que
l'on doit procéder. Que l'on prenne une série d'articles du même
auteur, qu'on les soumette à l’analyse, qu'on les discute, qu'on les
combatte, rien de mieux ; mais mettre en regard les idées de deux ou
trois écrivains différens, qui souvent même ont envisagé les questions
d'un point de vue opposé, c'est se préparer un triomphe par trop
facile, et qui ne nous paraît pas digne d'un aussi habile jouteur.
Ceci soit dit en passant, car si les observations de M. M*** n'eussent
eu pour résultat que de froisser quelques amours-propres, le nôtre
inclus, nous nous serions bien gardé de desserrer les dents. Mais nous
avons remarqué dans son travail une erreur grave, qui touche aux plus
chers intérêts de la France, et nous croyons devoir la relever, quel
que soit d'ailleurs notre éloignement pour toute espèce de polémique.
Voici le fait :
Dans une suite d'articles publiés sous le titre de Question chevaline au Congrès central d'agriculture,
nous avions dit que l'insuffisance de la production du cheval de luxe
en France étant constatée, et la nécessité de l'intervention du
gouvernement étant reconnue, nous pensions que pour être fructueuse,
celle-ci, nécessairement toujours limitée, devait être concentrée sur
les localités qui se montraient les plus propres à ce genre de
production. Nous ajoutions que l'on aurait tort d'en conclure que nous
entendissions par-là réclamer un privilège en faveur de ces localités,
attendu que cette espèce de produits était loin d'être lucrative ; mais
qu'en fût-il autrement, nous ne voyions pas pourquoi telle province
susceptible de produire de meilleurs chevaux, ne les fournirait pas aux
autres provinces, de même que celles-ci lui fournissent à leur tour les
denrées qui leur sont propres, etc.
A cela qu'objecte M. M*** ? Sous prétexte, dit-il, que la Normandie est
plus propre que les autres provinces à la production des chevaux de
luxe, les éleveurs du Calvados réclament des privilèges tout
particuliers... (Suit la citation de ce qui précède). Il ajoute : «
Est-ce que la Bourgogne, le Médoc ou le Languedoc demandent des primes
d'encouragement pour leurs produits, réclament l'interdiction de
l'entrée des produits similaires ? Est-ce que les droits de douane, les
droits réunis, les octrois ne portent pas atteinte à leur industrie ?
Est-ce que pour les chevaux, il est rien de semblable ? Est-ce qu'un
grand nombre de poulinières ne reçoivent pas annuellement des primes
élevées ? Est-ce que l'administration ne fait pas de grands sacrifices
pour mettre à la disposition des éleveurs les meilleurs étalons ? etc.,
etc. ?
Sans doute : mais qu'est-ce que cela prouve ? Rien ; sinon que M. M***
est complètement à côté de la question, et se donne une peine bien
inutile à s'escrimer contre des moulins à vent. Il a pris pour le coup
Le nom d'un port pour un nom d'homme !
Mais procédons par ordre ; et d'abord, pourquoi les éleveurs du
Calvados, s'il vous plaît ? Est-ce que nous avons rien demandé pour eux
en particulier ? Certes le Calvados est une des localités qui de tous
temps se sont montrées le plus propres à la production chevaline ; mais
elle n'est pas la seule, et nous n'avons jamais prétendu dans cette
circonstance, le séparer des autres parties de la Basse-Normandie, ni
de l'Anjou, ni du Limousin, ni de la Navarre, ni de toute autre
contrée, s'il en est, qui aient fait preuve de cette aptitude, de cette
disposition spéciale, dans des proportions convenables.
Maintenant que signifie, nous vous le demandons, votre parallèle entre
les chevaux et le vin ? Oh ! si la question chevaline était une affaire
uniquement industrielle, agricole ou commerciale, nous concevrions
votre raisonnement quoiqu'il ne fût guère difficile d'y répondre. Mais
soyez parfaitement tranquille, si la Normandie ne la considérait qu'à
ce point de vue, elle ne demanderait ni privilèges, ni subventions, ni
primes, ni faveurs de l'administration, ni même d'administration
d'aucune espèce (chevalinement parlant, bien entendu). Elle planterait
là MM. les chevaux de luxe, et les remplacerait par des bœufs et des
chevaux de trait, qu'elle sait faire assez passablement quand elle veut
s'en donner la peine. Les uns et les autres exécuteraient beaucoup
mieux ses travaux agricoles, et obtiendraient en tout temps et partout
un débouché avantageux ; car pour ceux-là elle ne craint pas plus la
concurrence, que la Bourgogne, le Médoc et le Languedoc pour leurs
vins. Ainsi qu'on se rassure, quand les Normands n'envisageront la
question chevaline qu'au point de vue de leur intérêt privé, ils ne
demanderont rien à personne, et laisseront le gouvernement parfaitement
libre d'en agir à sa fantaisie. Mais la question qui les préoccupe en
ce moment et dans laquelle ils réclament l'intervention du
gouvernement, est d'une nature tout-à-fait différente. Il s'agit de
faire produire à la France des chevaux propres au service de la
cavalerie, en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins
ordinaires et extraordinaires. C'est là, s'il en fut jamais, un intérêt
général et commun à toutes les provinces. La France ne peut pas plus se
passer de cavalerie que de places fortes, de matériel de guerre, de
vaisseaux. Or, la production du cheval de luxe et celle du cheval de
guerre qui sont inséparables, est essentiellement dispendieuse,
présente beaucoup plus d'inconvéniens que d'avantages, et ne saurait —
les avis sont unanimes à cet égard — se passer des secours du
gouvernement. Maintenant existe-t-il des provinces plus propres que
d'autres à la production de cette espèce de chevaux ? S'il en existe,
lequel vaut le mieux dans l'intérêt commun, que le gouvernement
concentre ses efforts sur elles, pour y développer la production au
niveau des besoins, ou qu'il continue, comme il l'a fait jusqu'à ce
jour, à les éparpiller sur tous les points du territoire ? En d'autres
termes, est-il préférable, avec une somme égale d'efforts et de
dépenses, d'obtenir d'excellens produits ou des produits médiocres ?
Voilà toute la question ; libre à chacun de la résoudre à sa guise.
Seulement, de ce que nous réclamons la solution qu'indique le bon sens,
qu'on ne vienne pas nous accuser de solliciter un privilège en faveur
de telle ou telle localité. Il ne s'agit pas on effet de savoir si
l'Etat doit ou non donner des encouragemens ; on est d'accord à cet
égard : mais bien où il doit les placer. Or, en les appliquant aux
localités qui produisent le mieux un objet indispensable pour toutes,
ce ne serait nullement dans un intérêt privé qu'il agirait, mais bien
dans un intérêt général. En effet, pourquoi est-il forcé de donner des
encouragemens ? C'est que la production n'est pas au niveau des besoins
: c'est que de toutes elle est la plus dispendieuse, la plus chanceuse,
la plus ingrate ; c'est qu'aujourd'hui, malgré ces prétendues faveurs
dont nous accable, dit-on, le gouvernement, la moitié au moins de nos
écuries sont pleines de chevaux de trait, et que chaque jour en voit
augmenter le nombre, Un privilège ! Eh ! ce n'est pas même une
compensation ; et si nous réclamons pour nos localités la totalité des
efforts de l'administration, ce n'est ni comme Normands, ni comme
Angevins, ni comme Limousins, ni comme Béarnais, mais uniquement comme
Français. Si nous n'écoutions que la voix de notre intérêt privé, nous
tiendrions un tout autre langage. Plût au ciel que d'autres provinces
possédassent au même degré la faculté qu'on nous envie ! Elles
verraient avec quel empressement nous leur concéderions ce qu'elles
appellent nos privilèges. Mais sait-on ce qu'ils réclament ceux qui
nous les reprochent si amèrement ? Dans le Poitou, dans le Midi, des
étalons mulassiers. En Bretagne, dans le Nord, dans l'Est, dans le
Centre, partout, des étalons de trait. Des chevaux de luxe, des chevaux
de cavalerie, nulle part ! Personne n'en veut, et pour cause. Telle est
l'exacte vérité. Ont-ils tort ? Non sans doute, chacun veut produire ce
qu'il produit le mieux et lui rapporte davantage ; c'est tout simple.
Nous ne pousserons pas plus loin l'examen des analyses de M, M***. Les
autres points qu'il a traités sont d'une moindre importance, et nous
n'avons en général que des éloges à donner à la rectitude de ses
jugements et de ses aperçus. D'ailleurs, nous le répétons, nul plus que
nous n'est ennemi de toute espèce de discussion. Mais nous nous sommes
crus d'autant plus obligés d'entrer avec quelques détails dans la
question des encouragemens, qu'il y a longtems que nous sommes fatigués
de ces accusations banales qui nous deviennent doublement pénibles,
lorsqu'elles nous sont adressées par des hommes au mérite desquels
personne plus que nous n'est disposé à rendre justice.
Disons donc, puisque l'occasion se présente, disons hautement et que tout le monde l'entende, s'il est possible :
Que la Normandie est la province de France la plus capable, à peu de
chose près, la seule capable de produire en abondance le carrossier, le
cheval à deux fins, le cheval de réserve, le cheval de ligne ;
Qu'elle ne demande pas mieux que de se livrer à cette production dans la proportion des besoins du pays ;
Mais qu'elle ne veut ni n'entend faire la guerre à ses dépens ;
Que celte espèce d'industrie étant tout autre chose qu'avantageuse,
c'est à ceux qui ont intérêt à son développement, d'y employer des
encouragemens convenables ;
Qu'autrement d'ici à peu d'années, ils la verront anéantie ;
Que loin de favoriser la Normandie, d'une manière toute particulière ,
comme le répètent journellement des gens qui ne voient que la surface
des choses, l'administration au contraire lui rend le plus mauvais des
services, en l'entraînant dans un genre de production ruineux, et que
si le gouvernement ne peut faire davantage, il sera parfaitement bien
venu de ne rien faire du tout, parce qu'alors l'industrie se lancera
dans des voies plus avantageuses, et où elle n'aura besoin du secours
de personne.
F. PERSON.
LES MELONS,
RAPPORT FAIT A LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE CAEN, PAR M. MANOURY,
SUR UN NOUVEAU PROCÉDÉ EMPLOYÉ PAR M. J. LENVOISÉ,
JARDINIER EN CHEF DE L'HÔTEL-DIEU DE CAEN,
POUR LA TAILLE DES MELONS (1).
Les Melons, on ne le sait que trop, sont exposés à une maladie appelée
chancre, qui fait souvent périr les parties qui en sont affectées. Elle
est, dit-on, le résultat de la taille ou de la piqûre d'un insecte ;
mais, quoiqu'il en soit, elle est toujours occasionnée par une
agglomération de sève qui peut aussi bien s'attaquer aux melons non
taillés, c'est-à-dire aux plantes sur lesquelles aucune coupe n'a été
faite, et qui sont ce qu'on appelle, à tout laisser aller.
En effet, ces dernières plantes, ordinairement plus vigoureuses que
celles qui ont été assujetties à une taille réglée, ont souvent
plusieurs branches très-fortes qui, partant du même point, forment vers
leur base un empatement dans lequel la sève s'agglomère en si grande
quantité qu'elle déchire les organes qui devraient la contenir et y
détermine des épanchements mortels. Le remède à celle maladie n'est pas
encore bien trouvé ; cependant il est certain qu'en faisant disparaître
les causes connues, on en diminuera du moins les ravages. Lorsqu'une
graine de melon lève, elle sort de terre avec deux feuilles séminales,
productions charnues qui servent à la nourriture de la plante pendant
son jeune âge ; il sort du centre de ces feuilles séminales, appelées
encore cotylédons, un bourgeon qui a d'abord une direction droite et
qui émet des feuilles. Les deux premières sont très-près des cotylédons
et sont elles-mêmes rapprochées l'une de l'autre ; elles ont dans leurs
aisselles, ainsi que les cotylédons, des yeux ou bourgeons capables de
produire des branches vigoureuses.
Ordinairement, lorsque la troisième feuille au-dessus des cotylédons
est formée, on commence la taille qui consiste dans la suppression du
bourgeon terminal et de la feuille qui l'accompagne. Cette première
opération est appelée castration
; elle est nécessaire pour faire développer promptement les yeux qui
existent dans les aisselles des deux premières feuilles, dont les
bourgeons, poussant horizontalement, s'appliqueront sur la terre de
chaque côté de la plante et en commenceront la charpente. Non-seulement
ceux-ci se développent par ce moyen, mais ceux que renferment les
aisselles des cotylédons se développeraient en même temps, si on ne les
supprimait avec la pointe d'un greffoir. En les conservant, on aurait
quatre branches partant presque toutes du même point de la tige, et par
conséquent un empatement considérable qui ne manquerait pas de donner
naissance à la maladie dont nous avons parlé. On diminue la cause du
mal en supprimant les deux yeux qui sont dans les feuilles séminales,
et en ne formant la charpente qu'avec les deux bourgeons sortis des
vraies feuilles ; mais on a beau supprimer ces yeux avec tout le soin
possible pour ne pas attaquer la tige, il reste toujours une ou
plusieurs petites plaies qui, très-voisines les unes des autres et fort
rapprochées de la base des grosses branches, forment bientôt un
bourrelet qui occasionne un chancre.
M. Julien Lenvoisé, jardinier en chef de l'Hôtel-Dieu de Caen, s'étant
aperçu que, par le procédé qui lui était commun avec la plupart des
jardiniers, ses melons étaient souvent attaqués par le chancre
avant la maturité des fruits, M. Lenvoisé, disons-nous, avec l'adresse
et l'intelligence qui lui sont propres, a essayé plusieurs moyens pour
prévenir le développement de celle funeste maladie :
1° Il a, dans ce but, taillé une certaine quantité de ses plantes à
deux feuilles au-dessus des cotylédons et il a laissé se développer
tous les rameaux dont les feuilles séminales et les feuilles conservées
contenaient le germe. Il y a eu bourrelet, puis chancre, comme cela a lieu ordinairement.
2° Il a taillé d'autres plantes de la même manière, mais en supprimant
avec précaution les rameaux produits par les cotylédons : pour cela il
a choisi le moment où le soleil était le plus ardent ; il a enlevé ces
petits rameaux avec la pointe d'un greffoir et a mis sur la plaie une
pincée de verre pilé, cette plaie s'est desséchée presque
instantanément sans aucune perte de sève ; mais il s'y est de même
formé un bourrelet et le pied s'est chancré comme dans l'autre méthode.
3° Sur d'autres plantes il a laissé une feuille de plus ; il a enlevé
le bourgeon qui se serait développé dans son aisselle et a suivi pour
le reste le procédé de taille n° 2. Le bourrelet s'est formé et le chancre a paru un peu plus tard, mais encore assez tôt pour tuer la plante avant la complète maturité des fruits.
4° Enfin, il a voulu isoler les branches, de sorte que leur base ne se
trouvât pas au même point, et pour y parvenir il a supprimé non
seulement les deux petits rameaux des cotylédons, mais encore ceux des
deux premières feuilles, de cette manière il s'est établi sur les
troisième et quatrième feuilles qui, pour l'ordinaire, sont assez
distantes l'une de l'autre. Il a ensuite chaussé sa plante. Le succès le plus complet a couronné son attente ; c'est-à-dire qu'aucun pied n'a présenté de chancre,
que les fruits sont devenus plus beaux et qu'ils sont arrivés à leur
maturité complète sans qu'aucune maladie vint les altérer.
Une pareille expérience ne souffre aucune réplique. On doit donc,
aussitôt que les plantes de melons se développent, enlever les petits
bourgeons qui se trouvent dans les cotylédons et dans les deux
premières feuilles, afin d'exciter le développement des autres parties
du végétal ; supprimer la cinquième feuille ainsi que le bourgeon
terminal, chausser ensuite la
plante et traiter les yeux des troisième et quatrième feuilles suivant
les procédés connus. De cette manière le point où se forme d'ordinaire
le bourrelet se trouvant caché sous la terre, aucun chancre
ne se forme ; loin de là, il se développe sur ce point des racines qui
vivifient la plante ; d'un autre côté, les branches qu'on peut par
analogie appeler charpentières, se trouvant distancées l'une de
l’autre, la sève peut circuler plus facilement. On obtient donc par
cette méthode des plantes parfaitement saines, et par suite des fruits
plus nombreux et dont la maturité est plus assurée.
Nous saisissons avec empressement celle occasion de faire connaître au
public un perfectionnement aussi important, apporté par M. Lenvoisé
dans la taille des melons, et de rendre à cette intelligent et
laborieux Horticulteur la justice qui lui est due.
(1) Extrait du Bulletin de mai de la Société
ENGRAIS. — CONSERVATION DES URINES.
Dans un de nos derniers n os nous avons publié un rapport
fait par M. Durand, professeur de pharmacie, sur les procédés de
désinfection des urines et madères fécales, employés par la compagnie
Baronnet. Ce rapport, reproduit par plusieurs journaux de la localité,
ayant été l'objet d'observations en ce sens qu'il doit y avoir
exagération dans les évaluations d'azote que l'on pourrait conserver au
profit de l'agriculture, M. Durand, pour justifier ses assertions, a
répondu par une lettre que nous reproduisons à notre tour, bien moins
dans l'intention de prendre une part quelconque à la discussion
engagée, que pour fixer de plus en plus l'attention générale sur la
nécessité de conserver l'un des plus abondans et des plus précieux
engrais (1).
Voici la lettre de M. Durand au Pilote du Calvados :
« …. Pour donner une idée de l'importance qu'on doit attacher à la
récolte des urines et des matières fécales, considérées comme engrais,
j'ai admis, d'après M. Liebig, que les excréments liquides et solides
d'un homme sont, pour une année, de 283 kilo, et qu'ils renferment 3
p.% d'azote ; j'ai ajouté que, par suite de ce calcul, on pouvait dire
que la quantité d'azote ainsi éliminée pendant une année, par une
population comme celle de Caen, est susceptible de produire 16 millions
de kilogr. de froment.
« Un de vos abonnés a cru
devoir avancer que cette proportion d'azote (3 pour cent), ne peut se
trouver dans le mélange des urines et des matières fécales,
conséquemment qu'il y a exagération dans le résultat que j'ai indiqué.
Il va jusqu'à supposer des fautes d'impression dans le paragraphe d'un
ouvrage de M. Liebig ( Chimie appliquée à la physiologie végétale et à l'agriculture,
t. 1, p. 269), où cette question est traitée. Une pareille supposition
ne peut être soutenue, puisque, à la page 159 de sa chimie organique
(introduction) le même auteur admet encore 3 pour cent d'azote dans les
matières excrémentielles.
« Mais, si d'un côté, l'analyse ne constate que rarement trois pour
cent d'azote dans le mélange des urines et des matières fécales qui n'a
pas encore perdu d'eau, d'un autre côté, il est évident que M. Liebig,
qui ne porte qu'à 3/4 de kilogr. par jour les excréments liquides et
solides d'un homme, est bien au-dessous de la quantité réelle.
« Il est inutile de s'arrêter ici plus long-temps, la question à
laquelle j'ai sérieusement affaire, est celle-ci : la population de
Caen élimine-t-elle chaque année, par les urines et les excréments une
quantité d'azote capable de produire 16 millions de kilogr. de froment
? Pour y répondre de la manière la plus décisive, il fallait apprécier
la quantité et la qualité des matières alimentaires dépensées pendant
un an et déterminer ensuite le chiffre de l'azote qu'elles renferment.
C'est ce que j'ai fait. Voici le résultat de mes recherches : la
quantité de pain, de viande de boucherie et de charcuterie, de
volailles, de poisson, en y comprenant le hareng et la morue, de
fromage, de lait, d'œufs, de chocolat, de thé, de lentilles, de pois,
de pommes de terre, dépensée pendant une année à Caen comme matière
alimentaire, renferme assez d'azote pour produire au moins 19 millions
de kilogrammes de froment.
« Mais par quelles voies est évacué l’azote de nos aliments ? Par les
reins, la bile et les excréments, et par les divers mucus qui n'en
rejettent qu'une faible quantité. Nous devons donc retrouver à peu près
tout l'azote de nos aliments dans les urines et les excréments (2),
moins celui que nous emportons avec nous dans la tombe, mais qui n'est
pas en quantité considérable, car M. Liebig ne l'estime, pour chaque
individu , qu'à 1 kil.1/2.
« Avant d'exposer les conséquences de ce calcul, j'en fais un autre. M. Liebig dit, dans son traité de Chimie organique
(édition de 1840), introduction, page 161, qu'avec un kilogramme
d'urine on peut reproduire un kilogramme de froment ; ce que M. Dumas
répète dans le 8e volume de sa Chimie, page 717.
« Et maintenant quelle est la quantité d'urine qu'une personne rend en
24 heures ? Voici ce qu'on lit dans le volume de M. Dumas que je viens
de citer, page 545 : « La moyenne de 48 expériences donne 1,268 grammes
d'urine ; mais chez les uns la quantité d'urine sécrétée n'atteint pas
ce chiffre ; chez d'autres elle le dépasse toujours. » Quoiqu'il en
soit, il n'y a certainement point d'exagération à admettre que chaque
jour la ville de Caen peut rendre 40 mille kilogrammes d'urine humaine.
Or, 40 mille kilogrammes d'urine représentent 40 mille kilogrammes de
froment, et ce chiffre multiplié par le nombre de jours de l'année,
c'est à dire par 365, donne 14 millions de kilogrammes de froment. Il
reste à évaluer les excréments qui représentent bien, et au-delà, le
huitième en azote de la valeur de l'urine dans la production du
froment, d'autant plus qu'ils proviennent d'une population qui dépense
beaucoup de substances azotées.
« Ainsi, par l'un ou l'autre de ces calculs, j'arrive à justifier
amplement ce que j'ai avancé dans mon rapport. Mais qu'on le remarque
bien, si je dis qu'il y a d'éliminé chaque année dans notre ville une
quantité d'azote susceptible de produire 16 millions de kilogrammes de
froment, je suis loin de prétendre que ce sera précisément cette
quantité qu'on obtiendra ; il faut s'attendre à une perte plus ou moins
considérable ; on approchera d'autant plus près de ce chiffre que les
matières excrémentielles seront recueillies et désinfectées avec plus
de soin.
« Du reste, quand on supposerait, dans cette appréciation que j'avais
donnée, quelque exagération (et j'ai démontré que mon chiffre était
exact), je ne vois pas en quoi on compromettrait par-là les intérêts des agriculteurs praticiens.
Ce qui leur importe après tout, n'est-ce pas de se procurer en quantité
suffisante et à bon marché, un engrais inodore, pulvérulent, renfermant
3 pour cent d'azote, et riche en phosphates alcalins ou terreux ? Et
n'est-ce pas précisément ce que leur offre la maison Baronnet ?
« Demanderai je maintenant pardon aux lecteurs de les avoir entretenus,
à plusieurs reprises, d'une question de cettle nature ; ils ne la
considéreront comme moi, que par le côté qui la rattache à l'une des
plus hautes questions de l'économie sociale. Le jour, en effet, où la
récolte des excréments humains se fera sans perte de leurs principes
fertilisants, la richesse végétale du sol, comme le dit M. Dumas, sera
complètement régénérée »
— En reproduisant cette lettre, notre but, nous le répétons, n'a point
été d'intervenir en aucune façon dans le débat entre M. Durand et son
contradicteur ; nous n'avons voulu que faire bien comprendre à toutes
les personnes qu'intéresse la conservation des engrais, combien il est
utile pour le bien de l'agriculture que ceux fournis par les déjections
liquides ou solides puissent être utilisés dans la plus forte
proportion possible.
Aussi, c'est avec intérêt que nous avons appris que l'enquête ouverte
sur le projet d'établissement à fonder à Caen n'a présenté qu'une
faible opposition et que l'administration municipale en renvoyant à
l'administration supérieure le procès-verbal de cette enquête, a donné
un avis motivé en faveur de l'établissement.
(1) Nous aurons prochainement, etc. (voir la copie).
(2) Nous aurons prochainement à parler d'une machine que M. Thierry,
professeur de chimie, a fait confectionner pour la désinfection
continuelle des urines, de manière à ce que, sans inconvénient, elles
puissent être conservées dans toutes les maisons.
|