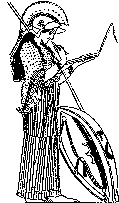GUY DE MAUPASSANT
(1850 - 1893)
L'Horrible
L'Horrible a paru dans le Gaulois
du 18 mai 1884
Numérisation: Thierry SELVA (maupassant@free.fr)
![]()
La nuit tiède descendait lentement.
Les femmes étaient restées dans le salon de la villa. Les hommes, assis ou à cheval sur les chaises du jardin, fumaient, devant la porte, en cercle autour d'une table ronde chargée de tasses et de petits verres.
Leurs cigares brillaient comme des yeux, dans l'ombre épaissie de minute en minute. On venait de raconter un affreux accident arrivé la veille: deux hommes et trois femmes noyés sous les yeux des invités, en face, dans la rivière.
Le général de G... prononça:
- Oui, ces choses-là sont émouvantes, mais elles ne sont pas horribles.
L'horrible, ce vieux mot, veut dire beaucoup plus que terrible. Un affreux accident comme celui-là émeut, bouleverse, effare: il n'affole pas. Pour qu'on éprouve l'horreur il faut plus que l'émotion de l'âme et plus que le spectacle d'un mort affreux, il faut, soit un frisson de mystère, soit une sensation d'épouvante anormale, hors nature. Un homme qui meurt, même dans les conditions les plus dramatiques, ne fait pas horreur; un champ de bataille n'est pas horrible; le sang n'est pas horrible; les crimes les plus vifs sont rarement horribles.
Tenez, voici deux exemples personnels qui m'ont fait comprendre ce qu'on peut entendre par l'Horreur.
C’était pendant la guerre de 1870. Nous nous retirions vers Pont-Audemer, après avoir traversé Rouen. L'armée, vingt mille hommes environ, vingt mille hommes de déroute, débandés, démoralisés, épuisés, allait se reformer au Havre.
La terre était couverte de neige. La nuit tombait. On n'avait rien mangé depuis la veille. On fuyait vite, les Prussiens n'étant pas loin.
Toute la campagne normande, livide, tachée par les ombres des arbres entourant les fermes, s'étendait sous un ciel noir, lourd et sinistre.
On n’entendait rien autre chose dans la lueur terne du crépuscule qu'un bruit confus, mou et cependant démesuré de troupeau marchant, un piétinement infini, mêlé d'un vague cliquetis de gamelles ou de sabres. Les hommes, courbés, voûtés, sales, souvent même haillonneux se traînaient, se hâtaient dans la neige, d'un long pas éreinté.
La peau des mains collait à l'acier des crosses, car il gelait affreusement cette nuit-là. Souvent je voyais un petit moblot ôter ses souliers pour aller pieds nus, tant il souffrait dans sa chaussure; et il laissait dans chaque empreinte une trace de sang. Puis au bout de quelque temps il s'asseyait dans un champ pour se reposer quelques minutes, et il ne se relevait point. Chaque homme assis était un homme mort.
En avons-nous laissé derrière nous, de ces pauvres soldats épuisés, qui comptaient bien repartir tout à l'heure, dès qu'ils auraient un peu délassé leurs jambes roidies! Or, à peine avaient-ils cessé de se mouvoir, de faire circuler, dans leur chair gelée, leur sang presque inerte, qu'un engourdissement invincible les figeait, les clouait à terre, fermait leurs yeux, paralysait en une seconde cette mécanique humaine surmenée. Et ils s'affaissaient un peu, le front sur leurs genoux, sans tomber tout à fait pourtant, car leurs reins et leurs membres devenaient immobiles, durs comme du bois, impossibles à plier ou à redresser.
Et nous autres, plus robustes, nous allions toujours, glacés jusqu'aux moelles avançant par une force de mouvement donné, dans cette nuit, dans cette neige, dans cette campagne froide et mortelle, écrasés par le chagrin, par la défaite, par le désespoir, surtout étreints par l’abominable sensation de l'abandon, de la fin, de la mort, du néant.
J'aperçus deux gendarmes qui tenaient par le bras un petit homme singulier, vieux, sans barbe, d'aspect vraiment surprenant.
Ils cherchaient un officier, croyant avoir pris un espion.
Le mot “espion” courut aussitôt parmi les traînards et on fit cercle autour du prisonnier. Une voix cria: “Faut le fusiller!” Et tous ces soldats qui tombaient d'accablement, ne tenant debout que parce qu'ils s'appuyaient sur leurs fusils, eurent soudain ce frisson de colère furieuse et bestiale qui pousse les foules au massacre.
Je voulus parler; j'étais alors chef de bataillon; mais on ne reconnaissait plus les chefs, on m'aurait fusillé moi-même.
Un des gendarmes me dit:
“Voilà trois jours qu'il nous suit. Il demande à tout le monde des renseignements sur l'artillerie.”
J'essayai d'interroger cet être:
“Que faites-vous? Que voulez-vous? Pourquoi accompagnez-vous l'armée?”
Il bredouilla quelques mots en un patois inintelligible.
C’était vraiment un étrange personnage, aux épaules étroites, à l'oeil sournois, et si troublé devant moi que je ne doutais plus vraiment que ce ne fût un espion. Il semblait fort âgé et faible. Il me considérait en dessous, avec un air humble, stupide et rusé.
Les hommes autour de nous criaient:
“Au mur! au mur!”
Je dis aux gendarmes:
“Vous répondez du prisonnier?...”
Je n'avais point fini de parler qu'une poussée terrible me renversa, et je vis, en une seconde, l'homme saisi par les troupiers furieux, terrassé, frappé, traîné au bord de la route et jeté contre un arbre. Il tomba presque mort déjà, dans la neige.
Et aussitôt on le fusilla. Les soldats tiraient sur lui, rechargeaient leurs armes, tiraient de nouveau avec un acharnement de brutes. Ils se battaient pour avoir leur tour, défilaient devant le cadavre et tiraient toujours dessus, comme on défile devant un cercueil pour jeter de l'eau bénite.
Mais tout d'un coup un cri passa:
“Les Prussiens! les Prussiens!”
Et j'entendis, par tout l'horizon, la rumeur immense de l'armée éperdue qui courait.
La panique, née de ces coups de feu sur ce vagabond, avait affolé les exécuteurs eux-mêmes, qui, sans comprendre que l'épouvante venait d'eux, se sauvèrent et disparurent dans l'ombre.
Je restai seul devant le corps avec les deux gendarmes, que leur devoir avait retenus près de moi.
Ils relevèrent cette viande broyée, moulue et sanglante.
“Il faut le fouiller”, leur dis-je.
Et je tendis une boîte d'allumettes-bougies que j'avais dans ma poche. Un des soldats éclairait l'autre. J'étais debout entre les deux.
Le gendarme qui maniait le corps déclara:
“Vêtu d'une blouse bleue, d'une chemise blanche, d'un pantalon et d'une paire de souliers.”
La première allumette s'éteignit; on alluma la seconde. L'homme reprit, en retournant les poches.
“Un couteau de corne, un mouchoir à carreaux, une tabatière, un bout de ficelle, un morceau de pain.”
La seconde allumette s'éteignit. On alluma la troisième. Le gendarme après avoir longtemps palpé le cadavre déclara:
“C'est tout.”
Je dis:
“Déshabillez-le. Nous trouverons peut-être quelque chose contre la peau.”
Et, pour que les deux soldats pussent agir en même temps, je me mis moi-même à les éclairer. Je les voyais à la lueur rapide et vite éteinte de l'allumette, ôter les vêtements un à un, mettre à nu ce paquet sanglant de chair encore chaude et morte.
Et soudain un d'eux balbutia:
“Nom d'un nom, mon commandant, c'est une femme!”
Je ne saurais vous dire quelle étrange et poignante sensation d'angoisse me remua le coeur. Je ne le pouvais croire, et je m'agenouillai dans la neige, devant cette bouillie informe, pour voir: c'était une femme!
Les deux gendarmes, interdits et démoralisés, attendaient que j'émisse un avis.
Mais je ne savais que penser, que supposer.
Alors le brigadier prononça lentement:
“Peut-être qu'elle venait chercher son éfant qu'était soldat d'artillerie et dont elle n'avait pas de nouvelles.”
Et l'autre répondit:
“P't'être ben que oui tout de même.”
Et moi qui avais vu des choses bien terribles, je me mis à pleurer. Et je sentis, en face de cette morte, dans cette nuit glacée, au milieu de cette plaine noire, devant ce mystère, devant cette inconnue assassinée, ce que veut dire ce mot: “Horreur”.
Or, j'ai eu cette même sensation, l'an dernier, en interrogeant un des survivants de la mission Flatters, un tirailleur algérien.
Vous savez les détails de ce drame atroce. Il en est un cependant que vous ignorez peut-être.
Le colonel allait au Soudan par le désert et traversait l'immense territoire des Touareg, qui sont, dans tout cet océan de sable qui va de l’Atlantique à l’Egypte et du Soudan à l'Algérie, des espèces de pirates comparables à ceux qui ravageaient les mers autrefois.
Les guides qui conduisaient la colonne appartenaient à la tribu des Chambaa, de Ouargla.
Or, un jour on établit le camp en plein désert, et les Arabes déclarèrent que, la source étant encore un peu loin, ils iraient chercher de l'eau avec tous les chameaux.
Un seul homme prévint le colonel qu'il était trahi: Flatters n'en crut rien et accompagna le convoi avec les ingénieurs, les médecins et presque tous ses officiers.
Ils furent massacrés autour de la source, et tous les chameaux capturés.
Le capitaine du bureau arabe de Ouargla, demeuré au camp, prit le commandement des survivants, spahis et tirailleurs, et on commença la retraite, en abandonnant les bagages et les vivres, faute de chameaux pour les porter.
Ils se mirent donc en route dans cette solitude sans ombre et sans fin, sous le soleil dévorant qui les brûlait du matin au soir.
Une tribu vint faire sa soumission et apporta des dattes. Elles étaient empoisonnées. Presque tous les Français moururent et, parmi eux, le dernier officier.
Il ne restait plus que quelques spahis, dont le maréchal des logis Pobéguin, plus des tirailleurs indigènes de la tribu de Chambaa. On avait encore deux chameaux. Ils disparurent une nuit avec deux Arabes.
Alors les survivants comprirent qu'il allait falloir s'entre-dévorer, et, sitôt découverte la fuite des deux hommes avec les deux bêtes, ceux qui restaient se séparèrent et se mirent à marcher un à un dans le sable mou, sous la flamme aiguë du ciel, à plus d'une portée de fusil l'un de l'autre.
Ils allaient ainsi tout le jour, soulevant de place en place, dans l'étendue brûlée et plate, ces petites colonnes de poussière qui indiquent de loin les marcheurs dans le désert.
Mais un matin, un des voyageurs brusquement obliqua, se rapprochant de son voisin. Et tous s'arrêtèrent pour regarder.
L'homme vers qui marchait le soldat affamé ne s'enfuit pas, mais il s'aplatit par terre, il mit en joue celui qui s'en venait. Quand il le crut à distance, il tira. L'autre ne fut point touché et il continua d'avancer puis, épaulant à son tour, il tua net son camarade.
Alors de tout l'horizon, les autres accoururent pour chercher leur part. Et celui qui avait tué, dépeçant le mort, le distribua.
Et ils s'espacèrent de nouveau, ces alliés irréconciliables, pour jusqu'au prochain meurtre qui les rapprocherait.
Pendant deux jours ils vécurent de cette chair humaine partagée. Puis la famine étant revenue, celui qui avait tué le premier tua de nouveau. Et de nouveau, comme un boucher, il coupa le cadavre et l'offrit à ses compagnons, en ne conservant que sa portion.
Et ainsi continua cette retraite d'anthropophages.
Le dernier Français, Pobéguin, fut massacré au bord d'un puits, la veille du jour où les secours arrivèrent.
Comprenez-vous maintenant ce que j'entends par l'Horrible?
Voilà ce que nous raconta, l'autre soir, le général de G...18 mai 1884