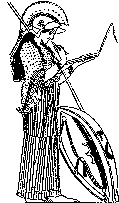LETTRE XCVI.
USBEK AU MEME.
Les magistrats doivent rendre la justice de citoyen à citoyen: chaque peuple la doit rendre lui-même de lui à un autre peuple. Dans cette seconde distribution de justice, on ne peut employer d'autres maximes que dans la première.
De peuple à peuple, il est rarement besoin de tiers pour juger, parce que les sujets de disputes sont presque toujours clairs et faciles à terminer. Les intérêts de deux nations sont ordinairement si séparés, qu'il ne faut qu'aimer la justice pour la trouver: on ne peut guère se prévenir dans sa propre cause.
Il n'en est pas de même des différends qui arrivent entre particuliers. Comme ils vivent en société, leurs intérêts sont si mêlés et si confondus, il y en a tant de sortes différentes, qu'il est nécessaire qu'un tiers débrouille ce que la cupidité des parties cherche à obscurcir.
Il n'y a que deux sortes de guerres justes: les unes qui se font pour repousser un ennemi qui attaque; les autres pour secourir un allié qui est attaqué.
Il n'y aurait point de justice de faire la guerre pour des querelles particulières du prince, à moins que le cas ne fût si grave qu'il méritât la mort du prince, ou du peuple qui l'a commis. Ainsi un prince ne peut fait la guerre parce qu'on lui aura refusé un honneur qui lui est dû, ou parce qu'on aura eu quelque procédé peu convenable à l'égard de ses ambassadeurs, et autres choses pareilles; non plus qu'un particulier ne peut tuer celui qui lui refuse le pas. La raison en est que, comme la déclaration de guerre doit être un acte de justice, dans lequel il faut toujours que la peine soit proportionnée à la faute, il faut voir si celui à qui on déclare la guerre mérite la mort. Car faire la guerre à quelqu'un, c'est vouloir le punir de mort.
Dans le droit public, l'acte de justice le plus sévère c'est la guerre: puisque son but est la destruction de la société.
Les représailles sont du second degré. C'est une loi que les tribunaux n'ont pu s'empêcher d'observer, de mesurer la peine par le crime.
Un troisième acte de justice est de priver un prince des avantages qu'il peut tirer de nous, proportionnant toujours la peine à l'offense.
Le quatrième acte de justice, qui doit être le plus fréquent, est la renonciation à l'alliance du peuple dont on a à se plaindre. Cette peine répond à celle du bannissement établie dans les tribunaux, qui retranche les coupables de la société. Ainsi un prince à l'alliance duquel nous renonçons est retranché par là de notre société, et n'est plus un de nos membres.
On ne peut pas faire de plus grand affront à un prince que de renoncer à son alliance, ni lui faire de plus grand honneur que de la contracter. Il n'y a rien parmi les hommes qui leur soit plus glorieux, et même plus utile, que d'en voir d'autres toujours attentifs à leur conservation.
Mais pour que l'alliance nous lie, il faut qu'elle soit juste: ainsi une alliance faite entre deux nations pour en opprimer une troisième n'est pas légitime, et on peut la violer sans crime.
Il n'est pas même de l'honneur et de la dignité du prince de s'allier avec un tyran. On dit qu'un monarque d'Egypte fit avertir le roi de Samos de sa cruauté et de sa tyrannie, et le somma de s'en corriger: comme il ne le fit pas, il lui envoya dire qu'il renonçait à son amitié et à son alliance.
La conquête ne donne point un droit par elle-même. Lorsque le peuple subsiste, elle est un gage de la paix et de la réparation du tort; et, si le peuple est détruit ou dispersé, elle est le monument d'une tyrannie.
Les traités de paix sont si sacrés parmi les hommes, qu'il semble qu'ils soient la voix de la nature, qui réclame ses droits. Ils sont tous légitimes, lorsque les conditions en sont telles que les deux peuples peuvent se conserver: sans quoi, celle des deux sociétés qui doit périr, privée de sa défense naturelle par la paix, la peut chercher dans la guerre.
Car la nature, qui a établi les différents degrés de force et de faiblesse parmi les hommes, a encore souvent égalé la faiblesse à la force par le désespoir.A Paris, le 4 de la lune de Zilhagé, 1716.