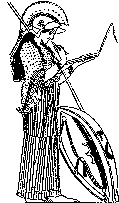CXLV - De ceux qui ne dépendent que des autres causes,
et ce que c'est que la fortune.
Pour les choses qui ne dépendent aucunement de nous, tant bonnes qu'elles puissent être, on ne les doit jamais désirer avec passion, non seulement à cause qu'elles peuvent n'arriver pas, et par ce moyen nous affliger d'autant plus que nous les aurons plus souhaitées, mais principalement à cause qu'en occupant notre pensée elles nous détournent de porter notre affection à d'autres choses dont l'acquisition dépend de nous. Et il y a deux remèdes généraux contre ces vains désirs: le premier est la générosité, de laquelle je parlerai ci-après; le second est que nous devons souvent faire réflexion sur la providence divine, et nous représenter qu'il est impossible qu'aucune chose arrive d'autre façon qu'elle a été déterminée de toute éternité par cette Providence; en sorte qu'elle est comme une fatalité ou une nécessité immuable, qu'il faut opposer à la fortune, pour la détruire comme une chimère qui ne vient que de l'erreur de notre entendement. Car nous ne pouvons désirer que ce que nous estimons en quelque façon être possible, et nous ne pouvons estimer possibles les choses qui ne dépendent point de nous qu'en tant que nous pensons qu'elles dépendent de la fortune, c'est-à-dire que nous jugeons qu'elles peuvent arriver, et qu'il en est arrivé autrefois de semblables. Or cette opinion n'est fondée que sur ce que nous ne connaissons pas toutes les choses qui contribuent à chaque effet; car lorsqu'une chose que nous avons estimée dépendre de la fortune, n'arrive pas, cela témoigne que quelqu'une des causes qui étaient nécessaires pour la produire a manqué, et par conséquent qu'elle était absolument impossible, et qu'il n'en est jamais arrivé de semblable, c'est-à-dire à la production de laquelle une pareille cause ait aussi manqué; en sorte que si nous n'eussions point ignoré cela auparavant, nous ne l'eussions jamais estimée possible, ni par conséquent ne l'eussions désirée.